Étiquette : Châtiments
Victor Hugo et le réveil du colosse

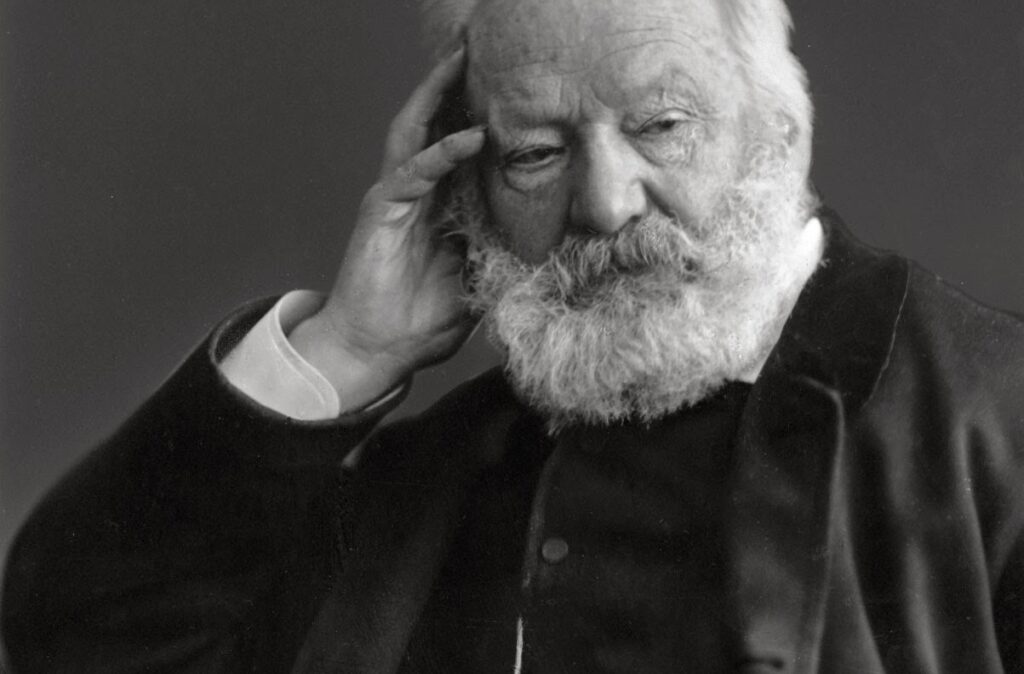
Portrait de Victor Hugo (1802-1885) par Nadar (1884).
Comme l’affirme d’emblée Christophe Hardy sur le site L’Eléphant (avril 2014), dans un article dont je me suis largement inspiré, l’auteur des Misérables passe, à juste titre, pour un homme qui, dans ses textes et ses engagements, a « défendu la cause du peuple ».
Nourri d’un humanisme chrétien et de l’amour d’autrui, Victor Hugo est mis au défi par le peuple et la misère dans laquelle il se trouve, sans pour autant être conduit à s’en faire une vision idéalisée ou romantique. Et lorsqu’il voit ce peuple s’éveiller, Hugo prend la mesure de sa puissance colossale, pour le bien comme pour le mal.
Dans son poème Au peuple (Les Châtiments, Livre VI), il utilise la puissante métaphore de l’Océan pour caractériser cette force. En l’évoquant, Hugo s’adresse au peuple :
« Il te ressemble ; il est terrible et pacifique. (…)
Sa vague, où l’on entend comme des chocs d’armures,
Emplit la sombre nuit de monstrueux murmures,
Et l’on sent que ce flot, comme toi, gouffre humain,
Ayant rugi ce soir, dévorera demain. »
Durant la première moitié de son existence, Hugo fut témoin de plusieurs soulèvements populaires. Les années 1830 sont particulièrement agitées.
Des émeutes et des grèves se déclenchent dans les grandes villes, à Paris, Lyon, Marseille, provoquées par la dureté de la vie qu’aggrave la moindre crise de la production agricole.
D’une manière générale, la rigueur des conditions de travail découle des mécanismes absurdes du marché : face à l’effondrement des prix industriels (1817-1851), les entrepreneurs décident purement et simplement de diminuer les salaires.
La paupérisation explose et les ouvriers s’insurgent contre cette baisse dramatique de leurs revenus. A Paris, Hugo a sous les yeux le spectacle d’une masse laborieuse, venue de la province s’entasser dans le centre de la capitale, déracinée, vivant dans l’insalubrité et la précarité, exposée aux épidémies (choléra en 1832), prompte à l’émeute (février et septembre 1831, juin 1832, avril 1834).
Cependant, le monde ouvrier, qui ne représente qu’une petite minorité dans un pays largement agricole et paysan, peine à faire valoir ses revendications, notamment sur la diminution des journées de travail. Pas encore structuré, son morcellement l’empêche de se doter d’une véritable conscience de classe solidaire. Cette masse malmenée, agitée régulièrement de secousses brutales, effraye les notables et les possédants, qui la voient comme une classe dangereuse menaçant leurs privilèges.
L’amour plus fort que la pitié
Hugo a très tôt conscience que la misère du peuple est la principale « question sociale ». Cette sensibilité au sort des plus pauvres n’est pas celle de la dame charitable hypocrite, elle est le fond de son âme. Et lorsque, élu député, il l’évoque à l’Assemblée, les conservateurs dont il se croyait proche jusqu’en 1849, se mettent à hurler.
« Toute ma pensée, dira-t-il,
je pourrais la résumer en un seul mot.
Ce mot, le voici :
haine vigoureuse de l’anarchie,
tendre et profond amour du peuple ! »
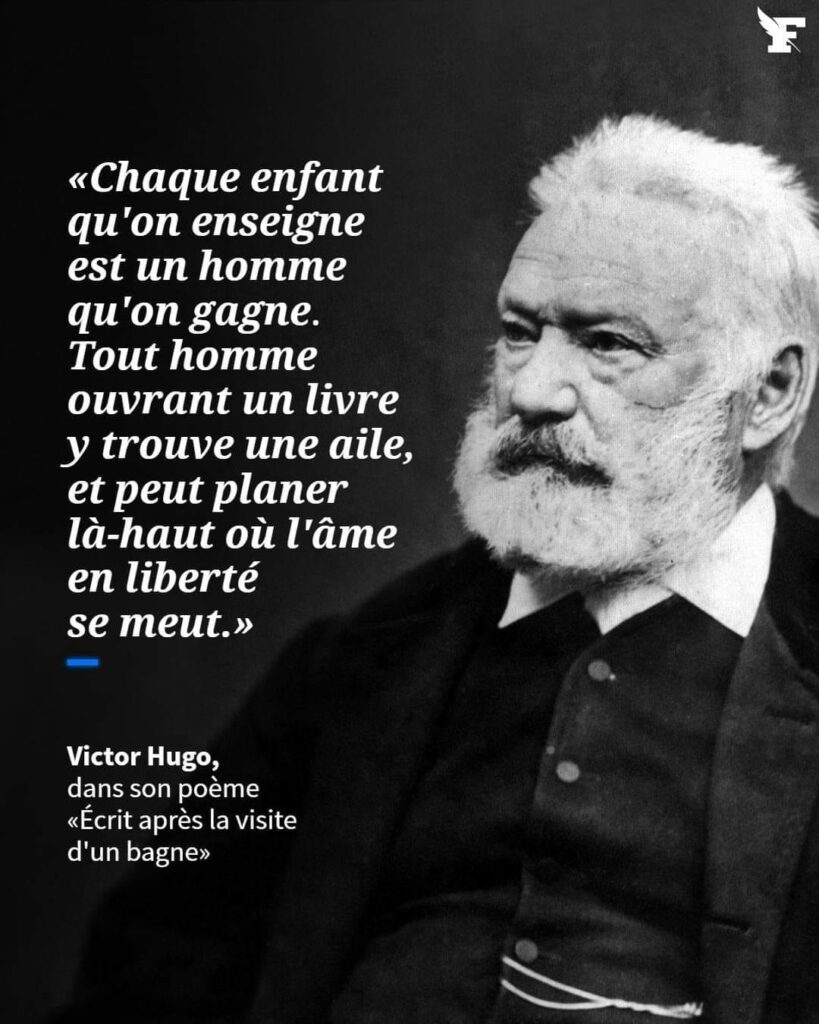
La misère des classes populaires, l’écrivain la connaît pour être allé à sa rencontre, en avoir rendu compte : misère de la prison (visite de la Conciergerie, dans Choses vues, septembre 1846), misère de la vie ouvrière (visite des caves de Lille en février 1851, discours non prononcé qui inspirera le poème des Châtiments « Joyeuse vie »). Il est persuadé qu’elle peut être vaincue.
Contredisant les conservateurs, les classes laborieuses ne sont pas, à ses yeux, des « classes dangereuses ». Elles sont même en danger, et ce danger menace la stabilité de la société tout entière :
« Je vous dénonce la misère,
qui est le fléau d’une classe et le péril de toutes !
Je vous dénonce la misère
qui n’est pas seulement la souffrance de l’individu,
qui est la ruine de la société. »
(Discours du 9 juillet 1849.)
S’il abandonne ses convictions de jeune royaliste pour devenir un républicain de progrès passionné, Hugo craint le chaos et le sang versé inutilement.
Même s’il n’a pas vécu 1793 et la Terreur, il est obsédé par le souvenir des jours sanglants de la Révolution française, où la guillotine travaillait à plein régime.
Rendant compte de l’insurrection, en 1832, plus que la violence en tant que telle, il dénonce les extrémistes qui, par calculs personnels et non pour lutter contre l’injustice, excitent les masses à la révolte et annoncent pour la fin du mois « quatre belles guillotines permanentes sur les quatre maîtresses places de Paris ».
Hugo considère cette stratégie comme une impasse politique (« Ne demandez pas de droits tant que le peuple demandera des têtes »), tout en en comprenant la légitimité :
« Il est de l’essence de l’émeute révolutionnaire,
qu’il ne faut pas confondre avec les autres sortes d’émeutes,
d’avoir presque toujours tort dans la forme
et raison dans le fond. »
Avec ironie, il signale aux puissants que
« le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé.
On marche dessus jusqu’à ce qu’il vous tombe sur la tête. »
(Choses vues, 1830 à 1885.)
Comme le poète allemand Friedrich Schiller, Hugo a la conviction que le rôle de l’artiste et du poète est d’élever le débat. L’art, telle l’étoile polaire brillant dans la nuit pour les marins perdus sur l’océan, est essentiel pour guider le peuple à bon port.
Magnanime
Politiquement, afin de poser les bases d’un destin futur, pacifique et harmonieux, il affirme que la compassion et le pardon doivent prévaloir sur la haine et la vengeance.
« Tel a assassiné sur les grandes routes qui,
mieux dirigé, eût été le plus excellent serviteur de la cité.
Cette tête de l’homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la,
arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la ;
vous n’aurez pas besoin de la couper. »
(Claude Gueux, roman, 1834.)
Lucide, le poète déclare qu’« ouvrir une école, c’est fermer une prison », car « quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain ».
C’est le traitement appliqué à Jean Valjean, héros principal des Misérables : le pauvre voleur, bagnard évadé, finira par devenir la grande âme que son hôte d’un soir, monseigneur Myriel, avait su déceler en lui alors que le reste de la société s’avérait incapable de l’identifier…
Les Gueux
Hugo passera sa vie à dédiaboliser « les gueux », c’est-à-dire le peuple. En 1812, dans sa chanson Les gueux, le chansonnier populaire Pierre-Jean de Béranger*, qu’il admirait, entonnait :
« Des gueux chantons la louange.
Que de gueux hommes de bien !
Il faut qu’enfin l’esprit venge
L’honnête homme qui n’a rien. »
Dans un de ses plus grands discours (en juillet 1851, sur la réforme de la Constitution), Hugo réclame pour le peuple (et pour tous) le droit à la vie matérielle (travail assuré, assistance organisée, abolition de la peine de mort) et le droit à la vie intellectuelle (obligation et gratuité de l’enseignement, liberté de conscience, liberté d’expression, liberté de la presse).
Bref, en embryon, la vision d’un Jaurès et d’un De Gaulle qu’on retrouvera dans « Les Jours heureux », le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), et l’antithèse de la mondialisation financière qu’on nous inflige aujourd’hui.
Lanceur d’alerte
En 1527, dans une lettre à son ami Thomas More, l’humaniste Erasme de Rotterdam avait prévenu les puissants : si l’Eglise de Rome n’adopte pas les mesures de réforme progressive et pacifique que lui, Erasme, propose, ils seront coupables d’avoir provoqué un siècle de violence !
Dans Les années funestes (1852), connaissant la puissance du colosse (Fig. 1), Victor Hugo aura, lui aussi, mis l’oligarchie en garde. Un avertissement qui garde son actualité :

Il Colosse, tableau de Goya (1808). Lorsque le colosse se lève, tous s’enfuient en courant.
Le seul qui reste immobile, c’est l’âne (symbolisant le roi d’Espagne Carlos IV, qui refusait de prendre en compte les aspirations du peuple).
« Vous n’avez pas pris garde au peuple que nous sommes.
Chez nous, dans les grands jours, les enfants sont des hommes,
Les hommes des héros, les vieillards des géants.
Oh ! Comme vous serez stupides et béants,
Le jour où vous verrez, risibles escogriffes,
Ce grand peuple de France échapper à vos griffes !
Le jour où vous verrez fortune, dignités,
Pouvoirs, places, honneurs, beaux gages bien comptés,
Tous les entassements de votre orgueil féroce,
Tomber au premier pas que fera le colosse !
Confondus, furieux, cramponnés vainement
Aux chancelants débris de votre écroulement,
Vous essaierez encore de crier, de proscrire,
D’insulter, et l’Histoire éclatera de rire. »
Victor Hugo, Les années funestes (1852)
NOTE:
*Christine Bierre, « Pierre-Jean de Béranger : la chanson, une arme républicaine » dans Nouvelle Solidarité N°07/2022.
