Étiquette : Lille
Exposition à Lille :
Ce que nous apprennent les fabuleux paysages flamands
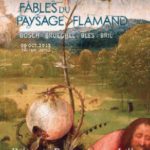
-

Jusqu’au 14 janvier 2013 au Palais des Beaux Arts de Lille, on pourra admirer l’exposition internationale intitulée « Fables du paysage flamand au XVIe siècle » réunissant une centaine d’œuvres de maîtres flamands, prêtées par plus d’une quarantaine de musées européens.
Si Jérôme Bosch et Pieter Bruegel l’ancien ne sont pas des noms inconnus en France, le grand public découvrira, en se familiarisant avec les œuvres de Joachim Patinir, Herri Met de Bles, Cornelis Metsys, Abel Grimmer, Jan Mandijn, Gilles Mostaert ou Kerstiaen de Keuninck, le vaste environnement intellectuel, spirituel et culturel dont Jérôme Bosch et Pieter Bruegel l’ancien n’ont été que les artistes les plus accomplis.
Les spectateurs s’arrêteront devant ces tableaux, fascinés, essayant de décrypter ces images qui nous paraissent « fantastiques » car elles sont le fruit d’une culture et d’un imaginaire chrétien, presque disparus aujourd’hui. Qu’avons-nous à faire aujourd’hui, bon Dieu, de ces histoires de paradis et d’enfer, ou des tentations de saints dans les déserts ?
Et pourtant, quelle puissance évocatrice ont chez nous ces métaphores picturales monstrueuses, ces scènes de Paradis où mandragores et lézards viennent hanter les images de la beauté terrestre, ces jardins des délices où l’homme finit par crouler sous les objets de son désir, ces enfers où les flammes de ce qu’il a trop aimé le consument de leur feu éternel. A croire que si les histoires de la Bible sont désuètes, tel n’est pas le cas du message universel véhiculé par ces artistes quant aux valeurs qui déterminent le chemin de notre vie, qui nous renvoie, lui, à notre propre image, dans une société où tout est devenu objet de consommation.
Ainsi, ces paysages flamands, dont une certaine critique prétend que les références à la religion seraient purement symboliques, les artistes n’ayant plus d’autre intérêt que la représentation réaliste de la nature, sont, au contraire, des œuvres où la tension entre éléments philosophico-religieux et nature est conçue pour provoquer une réflexion profonde sur le bien et le mal, sur la vie contemplative et la vie active, sur la nature de l’homme et de l’univers.
Saluons le fait que les organisateurs de l’exposition n’ont pas hésité à aborder le fond philosophique et religieux de ces œuvres. Alain Tapié, conservateur en chef du patrimoine au Palais des Beaux-Arts de Lille, a rendu justice à Erasme de Rotterdam, ce « peintre malgré lui », en constatant à quel point l’esprit d’une de ses œuvres, celle où il se prépare à la mort en examinant le chemin de sa vie, « ressemble au sentiment du paysage flamand au XVIe siècle, dans sa dynamique comme dans son contenu ».
Richard Falkenburg avait déjà souligné l’omniprésence, dans ces paysages flamands, de la métaphore du sermon du Christ sur la montagne, sur « la large porte qui est le chemin aisé conduisant à la perdition, et la porte étroite, le chemin difficile qui conduit au salut éternel ».
Enfin, Michel Weemans, professeur à l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges et l’un des commissaires de l’exposition, voit aussi un lien entre l’iconographie de cette époque et le langage imagé des penseurs de la Dévotion moderne, mouvement de réforme spirituel aux Pays-Bas qui est à l’origine de la Renaissance en Europe du Nord. Et notamment, les apports de l’un des fondateurs de ce courant, Gerard Zerbold de Zutphfen, dans son traité Des ascensions spirituelles, où il compare le cheminement de l’âme humaine à l’ascension d’une montagne vers la porte ouvrant la voie au salut. Une invitation à la réflexion sur ce que doit être la mission de l’homme dans ce temps de crise qui appelle à une nouvelle Renaissance.
Le Saint-Jean de Jérôme Bosch frappé d’acedia ?
On peut regretter que personne n’ait jamais tenté d’expliquer du point de vue de l’hypothèse supérieure ce que représente l’influence de la Dévotion moderne, le magnifique tableau de Jérôme Bosch qui honore l’exposition de Lille.
Bien que le tableau ci-dessus soit intitulé Saint Jean Baptiste en méditation (Madrid), une comparaison avec le Saint Jean peint par Hans Memling dans le Diptyque de saint Jean et sainte Véronique de la Pinacothèque de Munich (cliquez sur l’image pour l’agrandir), nous permet de croire qu’il s’agit en réalité d’un Saint Jean l’évangéliste pointant sans conviction en direction d’un agneau. Si ce dernier est généralement l’attribut de Saint Jean-Baptiste, ici il incarne le sacrifice qu’on attend de toute personne souhaitant vivre à l’image du Christ.
Chez Bosch (ci-dessous), on se demande si le Saint voit ou a envie de voir l’agneau. Jean semble plutôt sous l’effet soporifique d’une plante qu’on identifie comme la mandragore, symbole des plaisirs terrestres. Ainsi, il paraît gravement affecté d’une maladie qui ravageait l’univers monastique de l’époque du peintre : l’acedia, ce sentiment de lassitude qui anéantissait la volonté des individus, les rendant inaptes à tout véritable amour pour Dieu, le travail et l’humanité.
L’acédie, qui figure explicitement parmi les sept péchés capitaux chez Bosch, fut glorifiée ultérieurement comme une vertu par les Romantiques et rebaptisée spleen ou Mélancolie.
Or, pour la Dévotion moderne dont Bosch était proche, travail pour la société et méditation personnelle alternaient et formaient le tout cohérent d’une « Vie Commune ». Car contrairement à notre vision contemporaine imprégnée d’orientalisme, la méditation n’était ni passivité ni retrait du monde, mais « rumination » active, travail de mémoire et de remise en question.
D’ailleurs, dans ses tableaux, Bosch ne cherche jamais à « représenter » le mal ou le bien de façon formelle mais préfère, dans un dialogue socratique, nous lancer une image à la rétine nous obligeant à ruminer nos consciences, en bref à bannir en nous l’oisiveté et le désespoir.


