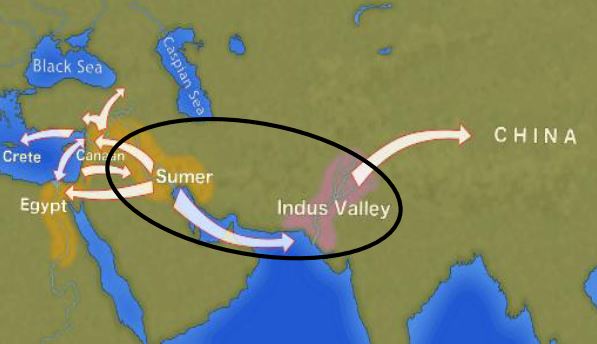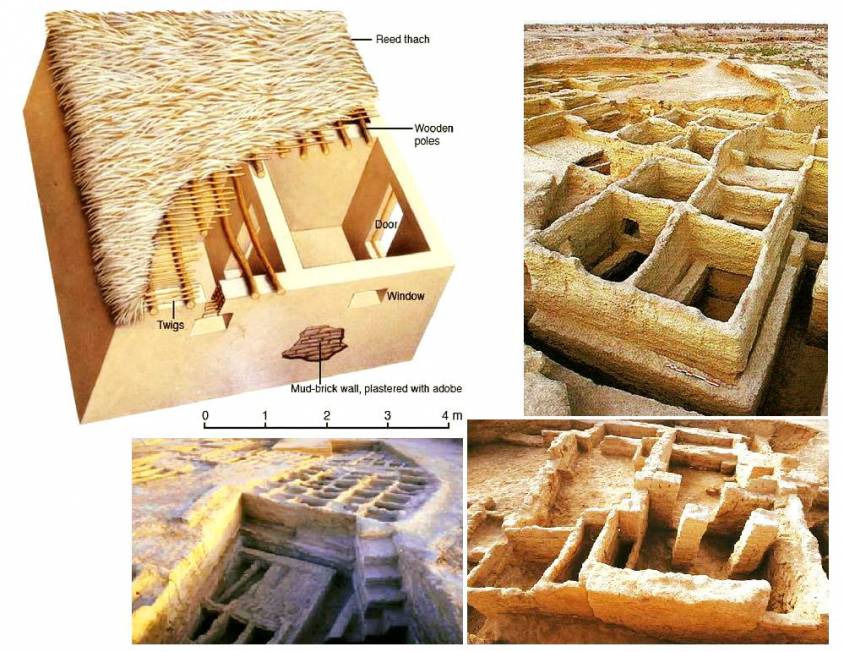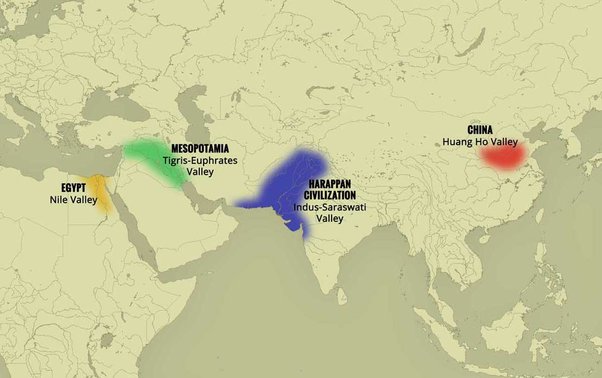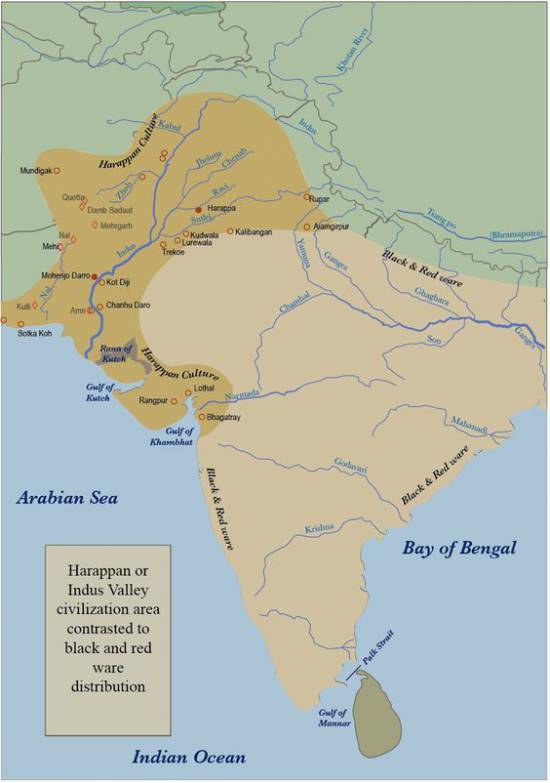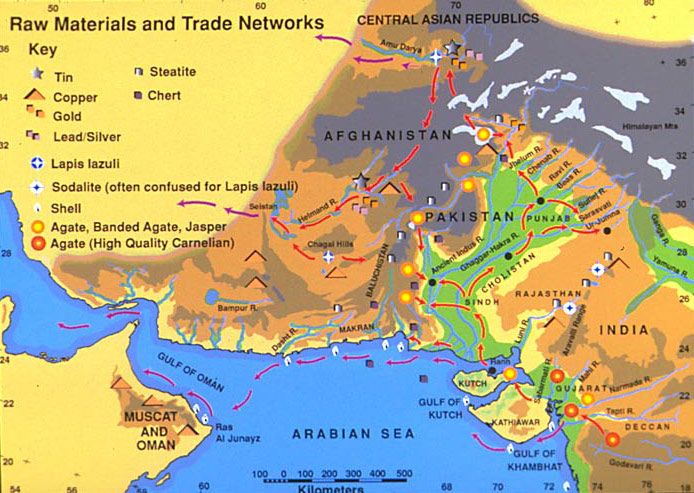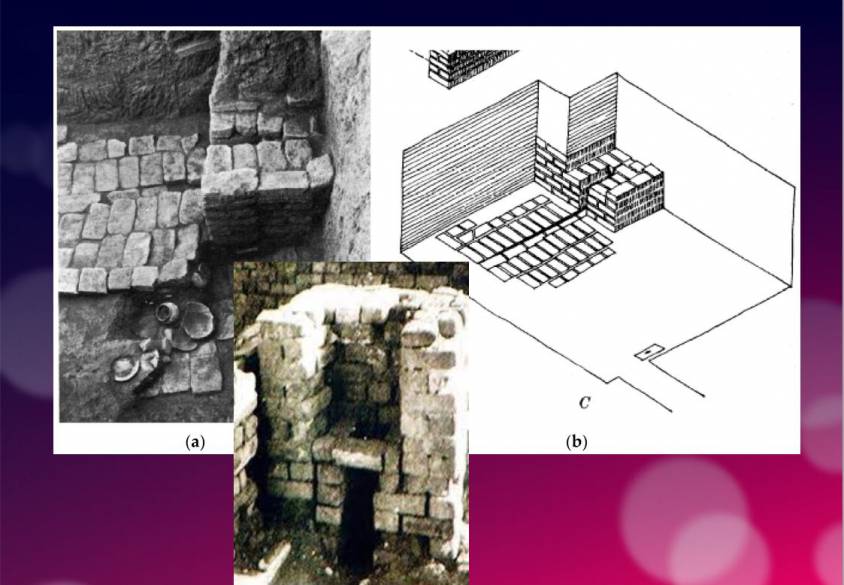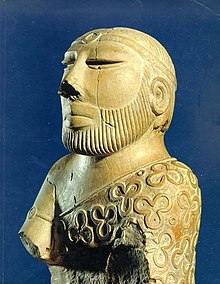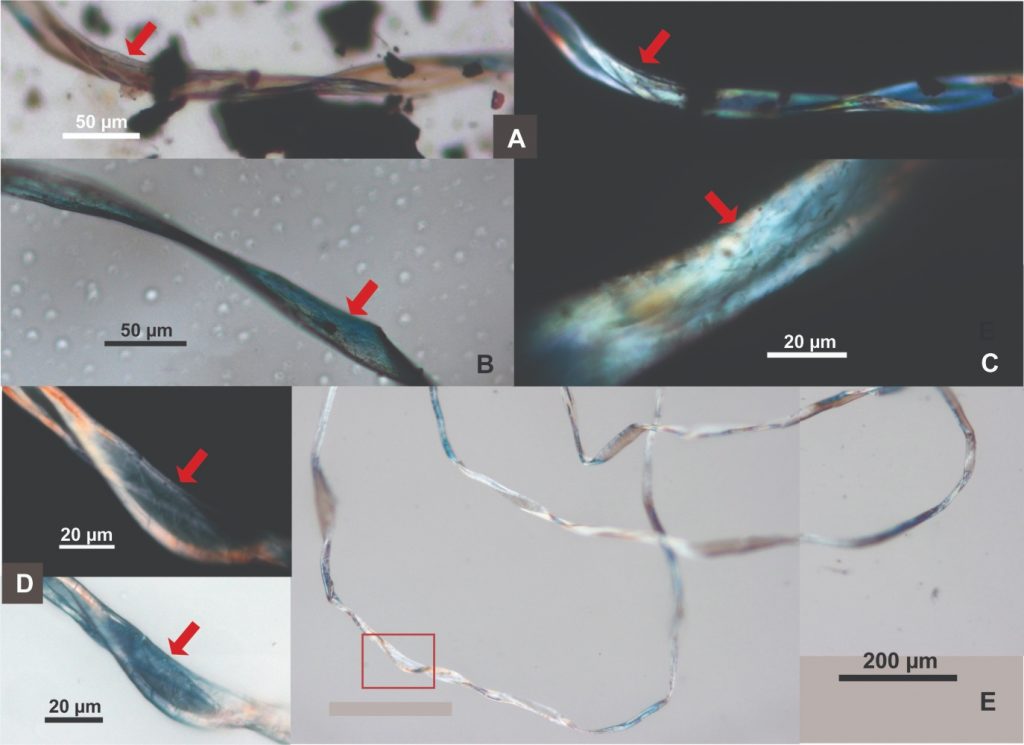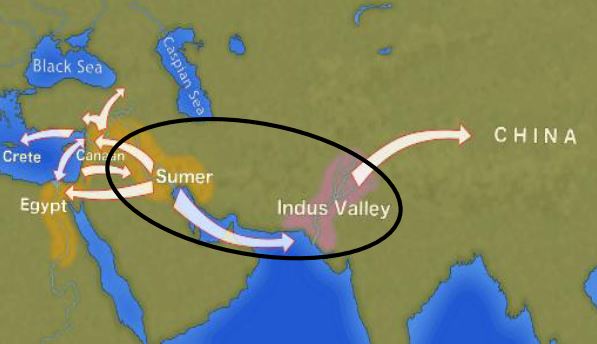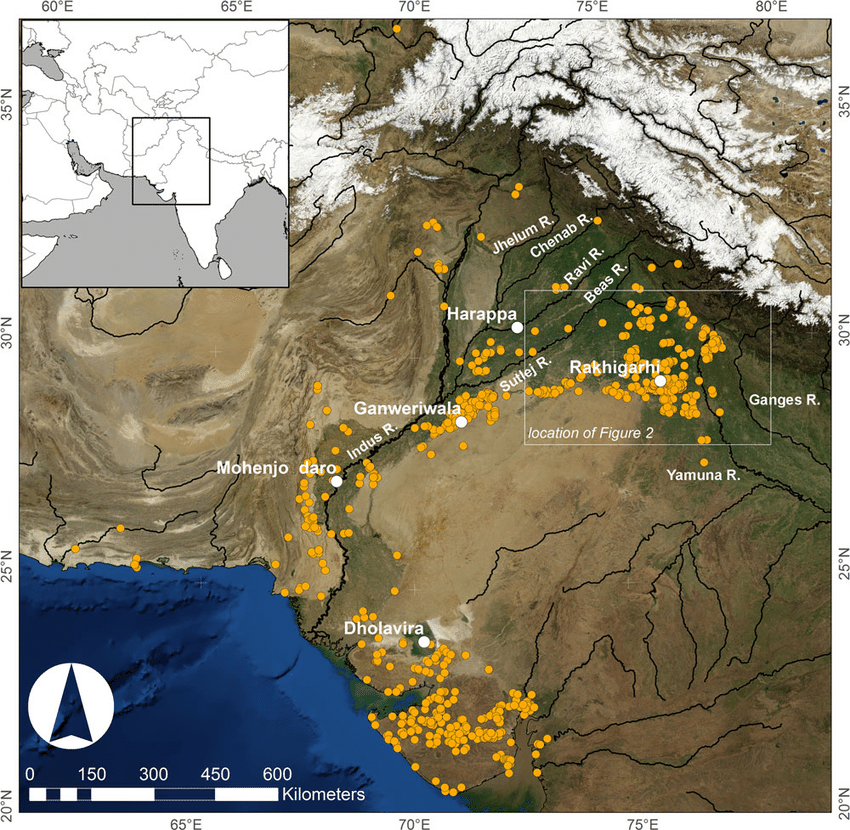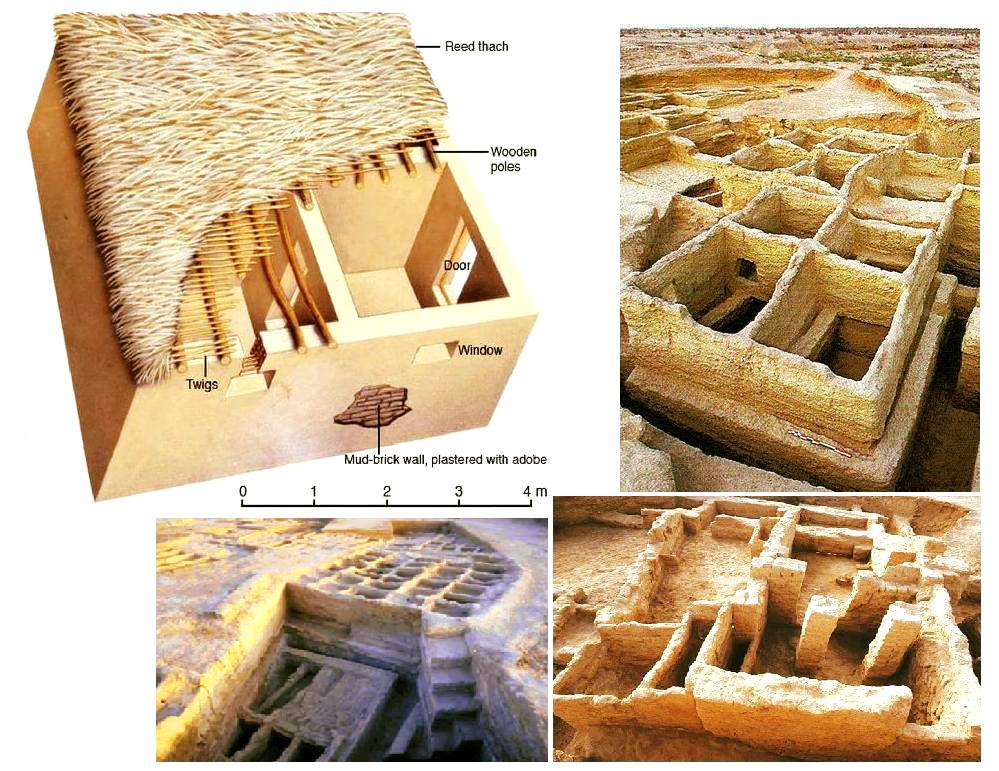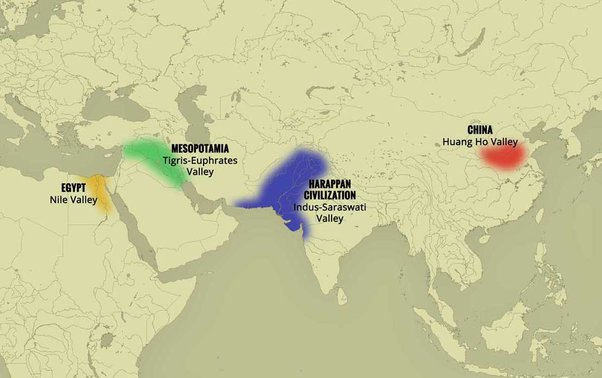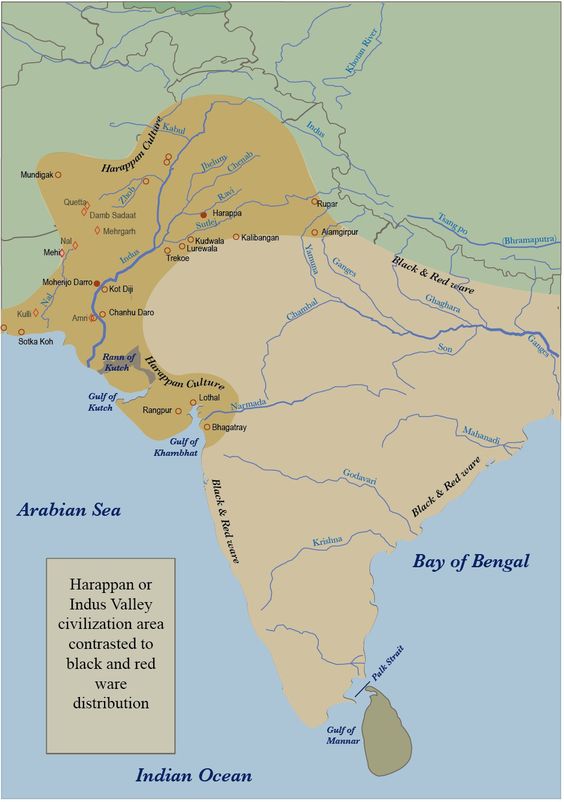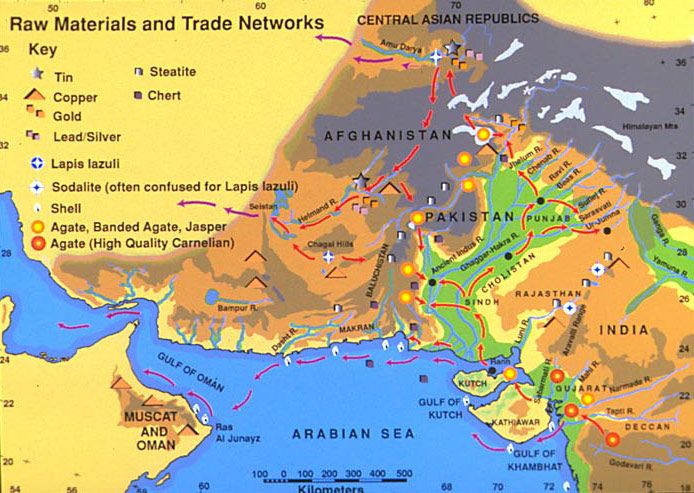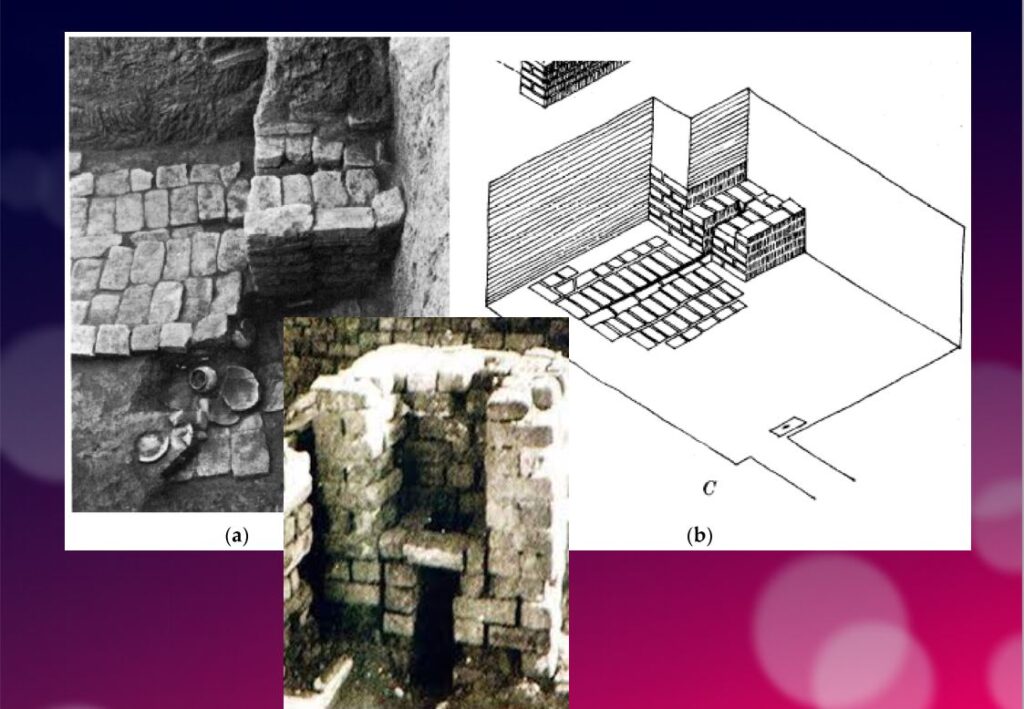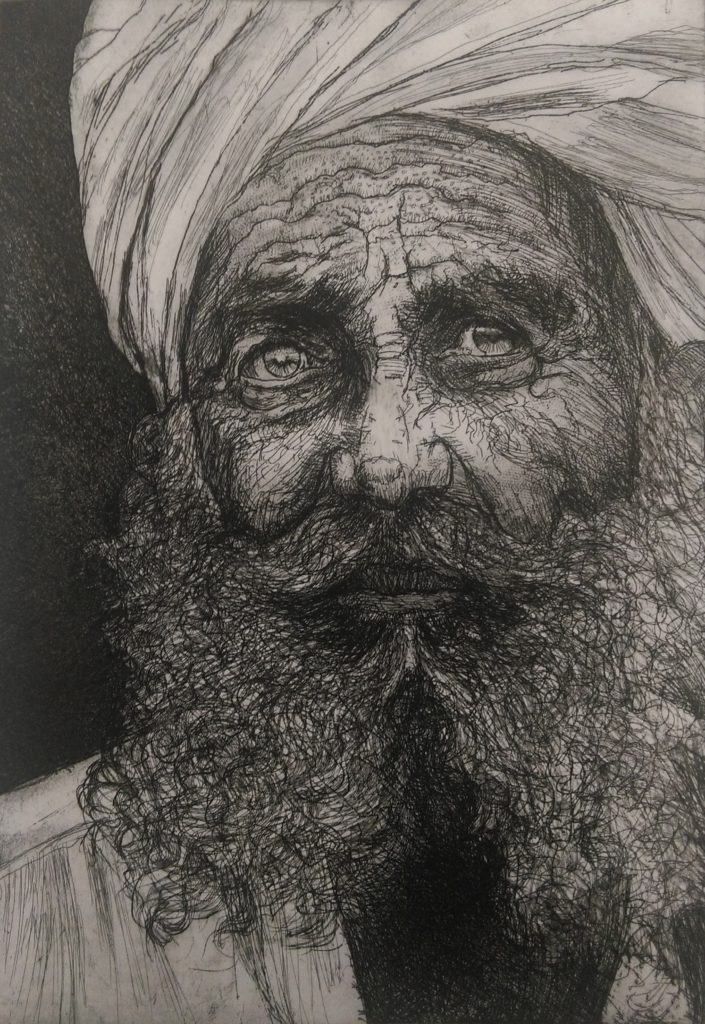Étiquette : Pakistan
Le « miracle » du Gandhara : quand Bouddha s’est fait homme


C’est lors de mon voyage en Afghanistan, en novembre 2023, que j’ai réalisé à quel point j’ignorais tout de cette partie du monde. Si aujourd’hui l’islam prévaut en Afghanistan et au Pakistan, on oublie souvent qu’une région commune à ces deux pays, historiquement connue sous le nom de Gandhara, a joué, du Ier au IIIe siècle de notre ère, un rôle majeur dans l’épopée du bouddhisme, une spiritualité qui, en refusant toute idée de caste, va bousculer l’ordre du monde.
Carrefour obligé sur les Routes de la soie reliant l’Europe à l’Inde et à la Chine, c’est au Gandhara, qu’a eu lieu un véritable dialogue entre les cultures eurasiatiques, perses, turques, grecques, chinoises et indiennes.
Bouddha. C’est par le volontarisme de deux grands rois d’Asie centrale (Ashoka et Kanishka) que le bouddhisme, né au Népal, trouvera l’énergie et la détermination pour gagner les esprits et les cœurs du monde.
Enfin, c’est au Gandhara que l’art bouddhique, en rupture avec les consignes du maître, va s’approprier les plus belles formes de diverses cultures artistiques grecques, indiennes, perses et autres, pour présenter bouddha sous une forme humaine aux fidèles, un homme éclairé, plein de sagesse et animé de compassion.
En offrant fraîcheur, poésie et un sens du mouvement spectaculairement moderne, les premiers artistes bouddhistes du Gandhara nous invitent à identifier en nous-mêmes, un saut vers l’auto-perfectionnement. A ce titre, ils sont les précurseurs de l’humanisme classique et de bien des Renaissances.
N’est-il pas temps de reconnaître la juste place que mérite leur contribution à la civilisation universelle ?
Enfin, vu la situation actuelle du monde, je tiens à citer le Premier Ministre indien Nehru, qui, le 3 octobre 1960 s’adressait à l’Assemblée générale des Nations unies avec des paroles qui n’ont cessé de gagner en pertinence : « Dans un passé lointain, un grand fils de l’Inde, le Bouddha, a dit que la seule vraie victoire était celle où tous étaient également victorieux et où personne n’était vaincu. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est la seule victoire concrète ; toute autre voie mène au désastre. »
- Introduction
- Bouddha, bio-express
- Les quatre vérités et l’octuple sentier
- Réincarnation
- Les Aryens et le védisme
- Les Brahmanes et le système des castes
- L’Inde avant le Bouddhisme
- Les grands conciles bouddhistes
- L’arrivée des Grecs
- L’Empire Maurya
- Le règne d’Ashoka le Grand
- Edits d’Ashoka
- Contenu des édits
- L’Empire Kouchan
- Le miracle de Gandhara
a) La poésie
b) La littérature
c) L’urbanisme
d) L’architecture, l’invention des stupa
e) Sculpture
–Aniconisme
–Fin de l’aniconisme
–Différence de forme, différence de contenu
1) Ecole greco-bouddhique de Gandhara
2) Ecole de Mathura
3) Ecole d’Andrah Pradesh
4) Ecole de la période Gupta. - Lorsque l’Asie rencontre la Grèce
a) Pièces de monnaies kouchanes
b) Reliquaire bimaran
c) Triade de Harra
d) Prendre la terre à témoin
e) Tous Bodhisattva - Le Bouddhisme aujourd’hui, l’exemple de Nehru
- Science et religion, Albert Einstein et Buddha.
Introduction
Les Ve et IVe siècles avant J.-C. furent une période d’effervescence intellectuelle mondiale. C’est l’époque des grands penseurs, tels que Socrate, Platon et Confucius, mais aussi Panini et Bouddha.
Dans le nord de l’Inde, c’est l’âge du Bouddha, après la mort duquel émerge une foi non théiste (Bouddha n’est qu’un homme…), qui se répand bien au-delà de sa région d’origine. Avec entre 500 millions et un milliard de croyants, le bouddhisme constitue aujourd’hui l’une des principales croyances religieuses et philosophiques du monde et sans doute une force potentielle redoutable pour la paix.
Bouddha, bio-express

« Le bouddha » (l’éveillé) est le nom donné à un homme appelé Siddhartha Gautama Shakyamuni (le muni ou sage du clan des Shakya). Il aurait atteint l’âge d’environ quatre-vingts an. Craignant l’idolâtrie, il refuse toute représentation de sa personne sous forme d’image.
Les traditions divergent sur les dates exactes de sa vie que la recherche moderne tend à situer de plus en plus tard : vers 623-543 av. J.-C. selon la tradition theravâda, vers 563-483 av. J.-C. selon la majorité des spécialistes du début du XXe siècle, tandis que d’autres le situent aujourd’hui entre 420 et 380 av. J.-C. (sa vie n’aurait pas dépassé les 40 ans).
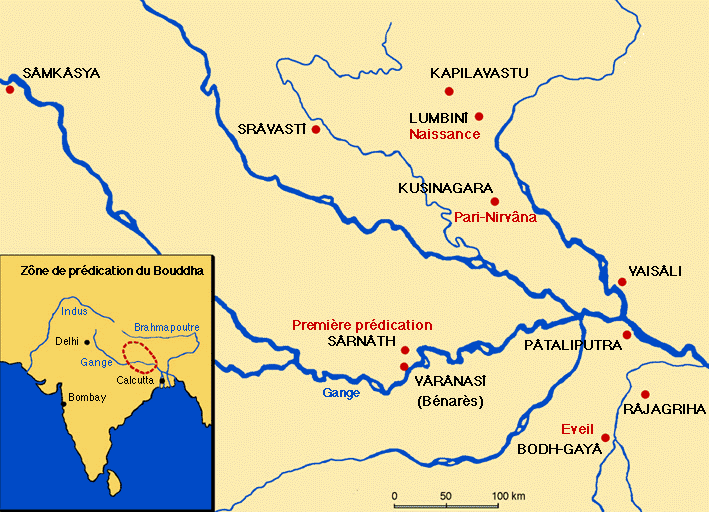

Selon la tradition, Siddhartha Gautama est né à Lumbini (dans l’actuel Népal) en tant que prince de la famille royale de la ville de Kapilavastu, un petit royaume situé dans les contreforts de l’Himalaya, dans l’actuel Népal.
Un astrologue aurait mis en garde le père du garçon, le roi Suddhodana : lorsque l’enfant grandirait, il deviendrait soit un brillant souverain, soit un moine influent, en fonction de sa lecture du monde. Farouchement déterminé à en faire son successeur, le père de Siddhartha ne le laissa donc jamais voir le monde en dehors des murs du palais. Tout en lui offrant tous les plaisirs et distractions possibles, il en fait un prisonnier virtuel jusqu’à l’âge de 29 ans.
Lorsque le jeune homme s’échappe de sa cage dorée, il découvre l’existence de personnes affectées par leur grand âge, la maladie et la mort. Bouleversé par la souffrance des gens ordinaires qu’il rencontre, Siddhartha abandonne les plaisirs éphémères du palais pour rechercher un but plus élevé dans la vie. Il se soumet d’abord à un ascétisme draconien, qu’il abandonne six ans plus tard, estimant qu’il s’agissait d’un exercice futile.
Il s’assoit alors sous un grand figuier pour méditer et y fait l’expérience du nirvana (la bodhi : libération ou, en sanskrit, extinction). On le désigne désormais sous le nom de « Bouddha » (l’éveillé ou l’éclairé).
Les « quatre vérités » et « l’octuple sentier »
Avant d’en esquisser le développement politique, quelques mots sur la philosophie sous-jacente au bouddhisme.
A ses jeunes disciples, Bouddha enseigne la « Voie du milieu », entre les deux extrêmes de la mortification et de la satisfaction des désirs.
Et il énonce les Quatre nobles vérités :
- La noble vérité de la souffrance.
- La noble vérité de l’origine de la souffrance.
- La noble vérité de la cessation de la souffrance.
- La noble vérité de la voie menant à la cessation de la souffrance, celle du Noble Chemin octuple.
Ainsi que le feront Augustin et plus encore les Frères de la Vie commune dans le monde chrétien, le bouddhisme insiste sur le fait que notre attachement à l’existence terrestre implique la souffrance.
Chez les chrétiens, c’est ce qui conduirait au « péché », notion inexistante dans le bouddhisme, pour qui l’errance vient de l’ignorance du bon chemin.
Pour Bouddha, il faut combattre, voire éteindre tout sens démesuré du moi (on dirait ego aujourd’hui). Il est possible de mettre fin à notre souffrance en transcendant ce fort sentiment de « moi », afin d’entrer dans une plus grande harmonie avec les choses en général. Les moyens d’y parvenir sont résumés dans le Noble Chemin octuple, parfois représenté par les huit rayons d’une Roue de la Loi (dharmachakra) que Bouddha mettra en marche, la Loi signifiant ici le dharma, un ensemble de préceptes moraux et philosophiques.
Ces huit points du Noble Chemin octuple sont :
- la vue juste
- la pensée juste
- la parole juste
- l’action juste
- les moyens d’existence justes
- l’effort juste
- la pleine conscience
- la concentration juste
– La vision juste est importante dès le départ, car sans cela, on ne peut pas voir la vérité des quatre nobles vérités.
– La pensée juste en découle naturellement. Le terme « juste » signifie ici « en accord avec les faits », c’est-à-dire avec la façon dont les choses sont (qui peut être différente de la façon dont je voudrais qu’elles soient).
– La pensée juste, la parole juste, l’action juste et les moyens d’existence justes impliquent une retenue morale – s’abstenir de mentir, de voler, de commettre des actes violents et gagner sa vie d’une manière qui ne soit pas préjudiciable aux autres. La retenue morale ne contribue pas seulement à l’harmonie sociale générale, elle nous aide aussi à contrôler et à diminuer le sentiment démesuré du « moi ». Comme un enfant gâté, le « moi » grandit et devient indiscipliné à mesure que nous le laissons agir à sa guise.
– Ensuite, l’effort juste est important parce que le « moi » prospère dans l’oisiveté et le mauvais effort ; certains des plus grands criminels sont les personnes les plus énergiques, donc l’effort doit être approprié à la diminution du « moi » (son ego, dirait-on aujourd’hui). Dans tous les cas, si nous ne sommes pas prêts à faire des efforts, nous ne pouvons pas espérer obtenir quoi que ce soit, ni dans le sens spirituel ni dans la vie. Les deux dernières étapes de la voie, la pleine conscience et la concentration ou absorption, représentent la première étape permettant de nous libérer de la souffrance.
Les ascètes qui avaient écouté le premier discours du Bouddha devinrent le noyau d’un sangha (communauté, mouvement) d’hommes (les femmes devaient entrer plus tard) qui suivaient la voie décrite par le Bouddha dans sa Quatrième noble vérité, celle précisant le Noble Chemin octuple.
Pour rendre le nirvana bouddhiste accessible au citoyen ordinaire, l’imagination bouddhiste a inventé le concept très intéressant de bodhisattva, mot dont le sens varie selon le contexte. Il peut aussi bien désigner l’état dans lequel se trouvait Bouddha lui-même avant son « éveil », qu’un homme ordinaire ayant pris la résolution de devenir un bouddha et ayant reçu d’un bouddha vivant la confirmation ou la prédiction qu’il en serait ainsi.
Dans le bouddhisme theravâda (l’école ancienne), seules quelques personnes choisies peuvent devenir des bodhisattvas, comme Maitreya, présenté comme le « Bouddha à venir ».
Mais dans le bouddhisme mahâyâna (Grand Véhicule), un bodhisattva désigne toute personne qui a généré la bodhicitta, un souhait spontané et un esprit compatissant visant à atteindre l’état de bouddha pour le bien de « tous les êtres sensibles », hommes aussi bien qu’animaux. Etant donné qu’une personne peut, dans une vie future, se réincarner dans un animal, le respect des animaux s’impose.
Réincarnation
Tout en voulant construire sa propre vision sur certains fondements de l’hindouisme, l’une des plus anciennes religions du monde, Siddhartha introduisit néanmoins des changements révolutionnaires aux implications politiques importantes.
Dans la plupart des croyances impliquant la réincarnation (hindouisme, jaïnisme, sikhisme), l’âme humaine est immortelle et ne se disperse pas après la disparition du corps physique. Après la mort, l’âme transmigre simplement (métempsychose) dans un nouveau-né ou un animal pour poursuivre son immortalité. La croyance en la renaissance de l’âme a été exprimée par les penseurs grecs anciens, à commencer par Pythagore, Socrate et Platon.
Le but du bouddhisme est d’apporter un bonheur durable et inconditionnel. Celui de l’hindouisme est de se libérer du cycle de naissance et de renaissance (samsara) pour atteindre, finalement, le moksha, qui en est la libération.

Le bouddhisme et l’hindouisme s’accordent sur le karma, le dharma, le moksha et la réincarnation. Mais ils diffèrent politiquement dans la mesure où le bouddhisme se concentre sur l’effort personnel de chacun et accorde par conséquent une moindre importance aux prêtres et aux rituels formels que l’hindouisme. Enfin, le bouddhisme ne reconnaît pas la notion de caste et prône donc une société plus égalitaire.
Alors que l’hindouisme soutient que l’on ne peut atteindre le nirvana que dans une vie ultérieure, le bouddhisme, plus volontariste et optimiste, soutient qu’une fois qu’on a réalisé que la vie est souffrance, on peut mettre un terme à cette souffrance dans sa vie présente.
Les bouddhistes décrivent leur renaissance comme une bougie vacillante qui vient en allumer une autre, plutôt que comme une âme immortelle ou un « moi » passant d’un corps à un autre, ainsi que le croient les hindous. Pour les bouddhistes, il s’agit d’une renaissance sans « soi », et ils considèrent la réalisation du non-soi ou du vide comme le nirvana (extinction), alors que pour les hindous, l’âme, une fois libérée du cycle des renaissances, ne s’éteint pas, mais s’unit à l’Être suprême et entre dans un éternel état de félicité divine.
Les Aryens et le védisme
L’une des grandes traditions ayant façonné l’hindouisme est la religion védique (védisme), qui s’est épanouie chez les peuples indo-aryens du nord-ouest du sous-continent indien (Pendjab et plaine occidentale du Gange) au cours de la période védique (1500-500 av. J.-C.).
Au cours de cette période, des peuples nomades venus du Caucase et se désignant eux-mêmes comme « Aryens » (« noble », « civilisé » et « honorable ») pénétrèrent en Inde par la frontière nord-ouest.

Le terme « aryen » a une très mauvaise connotation historique, en particulier depuis le XIXe siècle, lorsque plusieurs antisémites virulents, tels qu’Arthur de Gobineau, Richard Wagner et Houston Chamberlain, ont commencé à promouvoir le mythe d’une « race aryenne », soutenant l’idéologie suprémaciste blanche de l’aryanisme qui dépeint la race aryenne comme une « race des seigneurs », les non-aryens étant considérés non seulement comme génétiquement inférieurs (Untermensch, ou sous-homme) mais surtout comme une menace existentielle à exterminer.
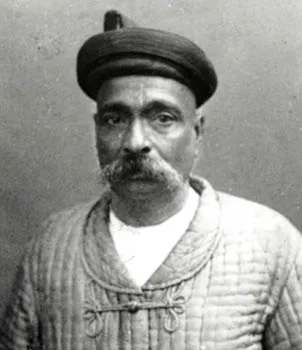
D’un point de vue purement scientifique, dans son livre The Arctic Home (1903), le patriote indien Bal Gangadhar Tilak (1856-1920), s’appuyant sur son analyse des observations astronomiques contenues dans les hymnes védiques, émet l’hypothèse selon laquelle le pôle Nord aurait été le lieu de vie originel des Aryens pendant la période préglaciaire, région qu’ils auraient quittée vers 8000 avant J.-C. à cause de changements climatiques, migrant vers les parties septentrionales de l’Europe et de l’Asie. Gandhi disait de Tilak, l’un des pères du mouvement de l’indépendance du pays, qu’il était « l’artisan de l’Inde moderne ».
Les Aryens arrivant du Nord étaient probablement moins barbares qu’on ne l’a suggéré jusqu’à présent. Grâce à leur supériorité militaire et culturelle, ils conquirent toute la plaine du Gange, avant d’étendre leur domination sur les plateaux du Deccan.
Cette conquête a laissé des traces jusqu’à nos jours, puisque les régions occupées par ces envahisseurs parlent des langues indo-européennes issues du sanskrit. (*1)

En réalité, la culture védique est profondément enracinée dans la culture eurasienne des steppes Sintashta (2200-1800 avant notre ère) du sud de l’Oural, dans la culture Andronovo d’Asie centrale (2000-900 avant notre ère), qui s’étend du sud de l’Oural au cours supérieur de l’Ienisseï en Sibérie centrale, et enfin dans la Civilisation de la vallée de l’Indus (Harappa) (4000-1500 avant notre ère).
Cette culture védique se fonde sur les fameux Védas (savoirs), quatre textes religieux consignant la liturgie des rituels et des sacrifices et les plus anciennes écritures de l’hindouisme. La partie la plus ancienne du Rig-Veda a été composée oralement dans le nord-ouest de l’Inde (Pendjab) entre 1500 et 1200 av. JC., c’est-à-dire peu après l’effondrement de la Civilisation de la vallée de l’Indus.
Le philologue, grammairien et érudit sanskrit Panini, qu’on croit être un contemporain de Bouddha, est connu pour son traité de grammaire sanskrite en forme de sutra, qui a suscité de nombreux commentaires de la part d’érudits d’autres religions indiennes, notamment bouddhistes.
Les Brahmanes et le système des castes

Cependant, avec l’émergence de cette culture aryenne apparut ce que l’on appelle le « brahmanisme », c’est-à-dire la naissance d’une caste toute puissante de grands prêtres.
« De nombreuses études linguistiques et historiques font état de troubles socioculturels résultant de cette migration et de la pénétration de la culture brahmanique dans diverses régions, de l’ouest de l’Asie du Sud vers l’Inde du Nord, l’Inde du Sud et l’Asie du Sud-Est », constate aujourd’hui Gajendran Ayyathurai, un anthropologue indien de l’Université de Göttingen en Allemagne.
Le brahman, littéralement « supérieur », est un membre de la caste sacerdotale la plus élevée (à ne pas confondre avec les adorateurs du dieu hindou Brahma). Bien que le terme apparaisse dans les Védas, les chercheurs modernes tempèrent ce fait et soulignent qu’il « n’existe aucune preuve dans le Rig-Veda d’un système de castes élaboré, très subdivisé et très important ».
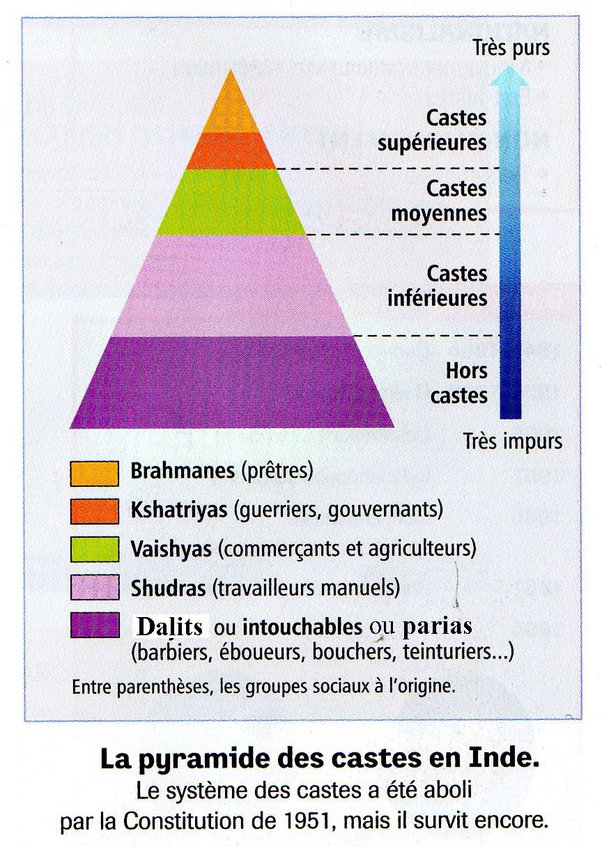
Mais avec l’émergence d’une classe dirigeante de brahmanes, devenus banquiers et propriétaires terriens, notamment sous la période Gupta (de 319 à 515 après J.-C.), un redoutable système de castes se met graduellement en place. La classe dirigeante féodale, ainsi que les prêtres, vivant des recettes des sacrifices, mettront l’accent sur des dieux locaux qu’ils intégreront progressivement au brahmanisme afin de séduire les masses. Même parmi les souverains, le choix des divinités indiquait des positions divergentes : une partie de la dynastie Gupta soutenait traditionnellement le dieu Vishnou, tandis qu’une autre soutenait le dieu Shiva.
Ce système déshumanisant des castes fut ensuite amplifié et utilisé à outrance par la Compagnie britannique des Indes orientales, une entreprise et une armée privée à la tête de l’Empire britannique, pour imposer son pouvoir aristocratique et colonial sur les Indes, une politique qui perdure encore aujourd’hui, surtout dans les esprits.
Le système hindou des castes s’articule autour de deux concepts clés permettant de catégoriser les membres de la société : le varṇa et la jati. Le varna (littéralement « couleur ») divise la société en une hiérarchie de quatre grandes classes sociales :
- Brahmanes (la classe sacerdotale)
- Kshatriyas (guerriers et dirigeants)
- Vaishyas (marchands)
- Shudras (travailleurs manuels)
En outre, la jati fait référence à plus de 3000 classifications hiérarchiques, à l’intérieur des quatre varnas, entre les groupes sociaux en fonction de la profession, du statut social, de l’ascendance commune et de la localité…
La justification de cette stratification sociale est intimement liée à la vision hindouiste du karma. Car la naissance de chacun est directement liée au karma, véritable bilan de sa vie précédente. Ainsi, la naissance dans le varna brahmanique est le résultat d’un bon karma…
« Ceux qui ont eu une bonne conduite ici auront rapidement une bonne naissance – naissance en tant que brahmane, kshatriya ou vaishya. Mais ceux dont la conduite ici a été mauvaise obtiendront rapidement une mauvaise naissance – naissance en tant que chien, porc ou chandala (bandit). »
(Chandogya Upanishad 5.10.7)
Selon cette théorie, le karma détermine la naissance de l’individu dans une classe, ce qui définit son statut social et religieux, qui fixe à son tour ses devoirs et obligations au regard de ce statut spécifique.
En 2021, une enquête a révélé que trois Indiens sur dix (30 %) s’identifient comme membres des quatre varnas et seulement 4,3 % des Indiens (60,5 millions) comme des brahmanes.
Certains d’entre eux sont prêtres, d’autres exercent des professions telles qu’éducateurs, législateurs, érudits, médecins, écrivains, poètes, propriétaires terriens et politiciens. Au fur et à mesure de l’évolution de ce système de castes, les brahmanes ont acquis une forte influence en Inde et ont exercé une discrimination à l’encontre des autres castes « inférieures ».

L’immense partie restante des Indiens (70 %), y compris parmi les hindous, déclare faire partie des dalits, encore appelés intouchables, des individus considérés, du point de vue du système des castes, comme hors castes et affectés à des fonctions ou métiers jugés impurs. Présents en Inde, mais également dans toute l’Asie du Sud, les dalits sont victimes de fortes discriminations. En Inde, une écrasante majorité de bouddhistes se déclarent dalits.
Dès le Ier siècle, le philosophe bouddhiste, dramaturge, poète, musicien et orateur indien Asvaghosa (v. 80 – v. 150 ap. J.-C.) a élevé la voix pour condamner ce système des castes, avec des arguments empruntés pour certains aux textes les plus vénérés des brahmanes eux-mêmes, et pour d’autres, fondés sur le principe de l’égalité naturelle entre tous les hommes.
Selon Asvaghosa,
« la qualité de brahmane n’est inhérente ni au principe qui vit en nous, ni au corps dans lequel réside ce principe, et elle ne résulte ni de la naissance, ni de la science, ni des pratiques religieuses, ni de l’observation des devoirs moraux, ni de la connaissance des Védas. Puisque cette qualité n’est ni inhérente ni acquise, elle n’existe pas, ou plutôt tous les hommes peuvent la posséder. »
Une allégorie bouddhiste rejette clairement et se moque de l’idée même du système de castes:
« De même que le sable ne devient pas de la nourriture simplement parce qu’un enfant le dit, lorsque de jeunes enfants jouant sur une route principale construisent des pâtés de sable et leur donnent des noms, en disant ‘Celui-ci est du lait, celui-ci de la viande et celui-ci du lait caillé’, il en va de même pour les quatre varnas, tels que vous, les brahmanes, les décrivez. »
L’Inde avant le bouddhisme
L’époque du Bouddha est celle de la deuxième urbanisation de l’Inde et d’une grande contestation sociale.
L’essor des shramaṇas, des philosophes ou moines errants ayant rejeté l’autorité des Védas et des brahmanes, était nouveau. Bouddha n’était pas le seul à explorer les moyens d’obtenir la libération (moksha) du cycle éternel des renaissances (saṃsara).
Le constat que les rituels védiques ne menaient pas à une libération éternelle conduisit à la recherche d’autres moyens. Le bouddhisme primitif, le yoga et des courants similaires de l’hindouisme, jaïnisme, ajivika, ajnana et chârvaka, étaient les shramanas les plus importants.
Malgré le succès obtenu en diffusant des idées et des concepts qui allaient bientôt être acceptés par toutes les religions de l’Inde, les écoles orthodoxes de philosophie hindoue (astika) s’opposaient aux écoles de pensée shramaṇiques et réfutèrent leurs doctrines en les qualifiant d’hétérodoxes (nastika), parce qu’elles refusaient d’accepter l’autorité épistémique des Védas.
Pendant plus de quarante ans, le Bouddha sillonna l’Inde à pied pour diffuser son dharma, un ensemble de préceptes et de lois sur le comportement de ses disciples. À sa mort, son corps fut incinéré, comme c’était la coutume en Inde, et ses cendres furent réparties dans plusieurs reliquaires, enterrés dans de grands monticules hémisphériques connus sous le nom de stupas. Alors déjà, sa religion était répandue dans tout le centre de l’Inde et dans de grandes villes indiennes comme Vaishali, Shravasti et Rajagriha.
Les grands conciles bouddhistes

Quatre grands conciles bouddhistes furent organisés, à l’instigation de différents rois qui cherchaient en réalité à briser l’omnipuissante caste des brahmanes.
Le premier eut lieu en 483 avant J.-C., juste après la mort du Bouddha, sous le patronage du roi Ajatasatru (492-460 av. J.-C.) du Royaume du Magadha, le plus grand des seize royaumes de l’Inde ancienne, afin de préserver les enseignements du Bouddha et de parvenir à un consensus sur la manière de les diffuser.
Le deuxième intervint en 383 avant J.-C., soit cent ans après la mort du Bouddha, sous le règne du roi Kalashoka. Des divergences d’interprétation s’installant sur des points de discipline au fur et à mesure que les adeptes s’éloignaient les uns des autres, un schisme menaçait de diviser ceux qui voulaient préserver l’esprit originel et ceux qui défendaient une interprétation plus large.
Le premier groupe, appelé Thera (signifiant « ancien » en pâli), est à l’origine du bouddhisme theravâda, engagé à préserver les enseignements du Bouddha dans l’esprit originel.
L’autre groupe était appelé Mahasanghika (Grande Communauté). Ils interprétaient les enseignements du Bouddha de manière plus libérale et nous ont donné le bouddhisme Mahâyâna.
Les participants au concile tentèrent d’aplanir leurs divergences, sans grande unité mais sans animosité non plus. L’une des principales difficultés venait du fait qu’avant d’être consignés dans des textes, les enseignements du Bouddha n’avaient été transmis qu’oralement pendant trois à quatre siècles. (*2)
L’arrivée des Grecs

Ainsi que nous l’avons documenté par ailleurs, l’Asie centrale, et l’Afghanistan en particulier, furent le lieu de rencontre entre les civilisations perses, chinoises, grecques et indiennes.
C’est au Gandhara, région à cheval entre le Pakistan et l’Afghanistan, au cœur des Routes de la soie, que le bouddhisme prendra à deux reprises un envol majeur, donnant naissance à un art dit « gréco-bouddhiste », qui parviendra à faire la synthèse entre plusieurs cultures à travers des œuvres d’une beauté incomparable.

Les premiers Grecs commencèrent à s’installer dans la partie nord-ouest du sous-continent indien à l’époque de l’Empire perse achéménide. Après avoir conquis la région, le roi perse Darius le Grand (521 – 486 av. J.-C.) colonisa également une grande partie du monde grec, qui comprenait à l’époque toute la péninsule anatolienne occidentale.
Lorsque des villages grecs se rebellaient sous le joug perse, ils faisaient parfois l’objet d’un nettoyage ethnique et leurs populations étaient déportées à l’autre bout de l’empire.
C’est ainsi que de nombreuses communautés grecques virent le jour dans les régions indiennes les plus reculées de l’empire perse.
Au IVe siècle avant J.-C., Alexandre le Grand (356 – 323 av. J.-C.) vainquit et conquit l’empire perse. En 326 avant J.-C., cet empire comprenait la partie nord-ouest du sous-continent indien jusqu’à la rivière Beas (que les Grecs nommaient l’Hyphase). Alexandre établit des satrapies et fonde plusieurs colonies. Il se tourne vers le sud lorsque ses troupes, conscientes de l’immensité de l’Inde, refusent de pousser plus loin encore vers l’est.
Après sa mort, son empire se délite. De 180 av. J.-C. à environ l’an 10 de notre ère, plus de trente rois hellénistiques se succèdent, souvent en conflit entre eux. Cette époque est connue dans l’histoire sous le nom des « Royaumes indo-grecs ».
L’un d’eux a été fondé lorsque le roi gréco-bactrien Démétrius envahit l’Inde en 180 avant notre ère, créant ainsi une entité faisant sécession avec le puissant royaume gréco-bactrien, la Bactriane (comprenant notamment le nord de l’Afghanistan, une partie de l’Ouzbékistan, etc.).
Pendant les deux siècles de leur règne, ces rois indo-grecs intégrèrent dans une seule culture des langues et des symboles grecs et indiens, comme en témoignent leurs pièces de monnaie, et mêlèrent les anciennes pratiques religieuses grecques, hindoues et bouddhistes, comme le montrent les vestiges archéologiques de leurs villes et les signes de leur soutien au bouddhisme.
L’Empire Maurya

Vers 322 avant J.-C., les Grecs appelés Yona (Ioniens) ou Yavana dans les sources indiennes, participent, avec d’autres populations, au soulèvement de Chandragupta Maurya (né v. -340 et mort v. – 297), le fondateur de l’Empire maurya.
Le règne de Chandragupta ouvre une ère de prospérité économique, de réformes, d’expansion des infrastructures et de tolérance. De nombreuses religions ont ainsi prospéré dans son royaume et dans l’empire de ses descendants. Bouddhisme, jaïnisme et ajivika prennent de l’importance aux côtés des traditions védiques et brahmaniques, tout en respectant les religions minoritaires telles que le zoroastrisme et le panthéon grec.
Le règne d’Ashoka le Grand
(de 268 à 231 av. JC)

L’Empire Maurya atteint son apogée sous le règne du petit-fils de Chandragupta, Ashoka le Grand, de 268 à 231 av. J.-C. (parfois écrit Asoka).
Huit ans après sa prise de pouvoir, Ashoka mène une campagne militaire pour conquérir le Kalinga, un vaste royaume côtier du centre-est de l’Inde. Sa victoire lui permet de conquérir un territoire plus vaste que celui de tous ses prédécesseurs. Grâce aux conquêtes d’Ashoka, l’Empire Maurya devient une puissance centralisée couvrant une grande partie du sous-continent indien, s’étendant de l’actuel Afghanistan à l’ouest à l’actuel Bangladesh à l’est, avec sa capitale à Pataliputra (proche de l’actuelle Patna en Inde).
Alors que l’Empire Maurya avait existé dans un certain désordre jusqu’en 185 av. J.-C., Ashoka va transformer le royaume en recourant à une violence extrême qui caractérise le début de son règne. On parle de 100 000 à 300 000 morts, rien que lors de la conquête du Kalinga !
Mais le poids d’un tel carnage plonge le roi dans une grave crise personnelle. Ashoka est gravement choqué par la multitude de vies arrachées par ses armées. L’édit N° 13 d’Ashoka reflète le profond remords ressenti par le roi après avoir observé la destruction de Kalinga :
« Sa Majesté a éprouvé des remords à cause de la conquête de Kalinga car, lors de l’assujettissement d’un pays non conquis auparavant, il y a nécessairement des massacres, des morts et des captifs, et Sa Majesté en éprouve une profonde tristesse et un grand regret. »
Ashoka renonce alors aux démonstrations de force militaires et autres formes de violence, y compris la cruauté envers les animaux. Conquis par le bouddhisme, il se consacre alors à répandre sa vision du dharma, une conduite juste et morale. Il va encourager la diffusion du bouddhisme dans toute l’Inde. Selon l’archéologue et érudit français François Foucher, même si les cas de mauvais traitements envers les animaux ne disparurent pas du jour au lendemain, la croyance en la fraternité de tous les êtres vivants est plus florissante en Inde que partout ailleurs.
En 250 avant J.-C., Ashoka convoque le troisième concile bouddhique. Les sources theravâda mentionnent qu’en plus de régler les différends intérieurs, la principale fonction du concile était de planifier l’envoi de missionnaires bouddhistes dans différents pays afin d’y répandre la doctrine.
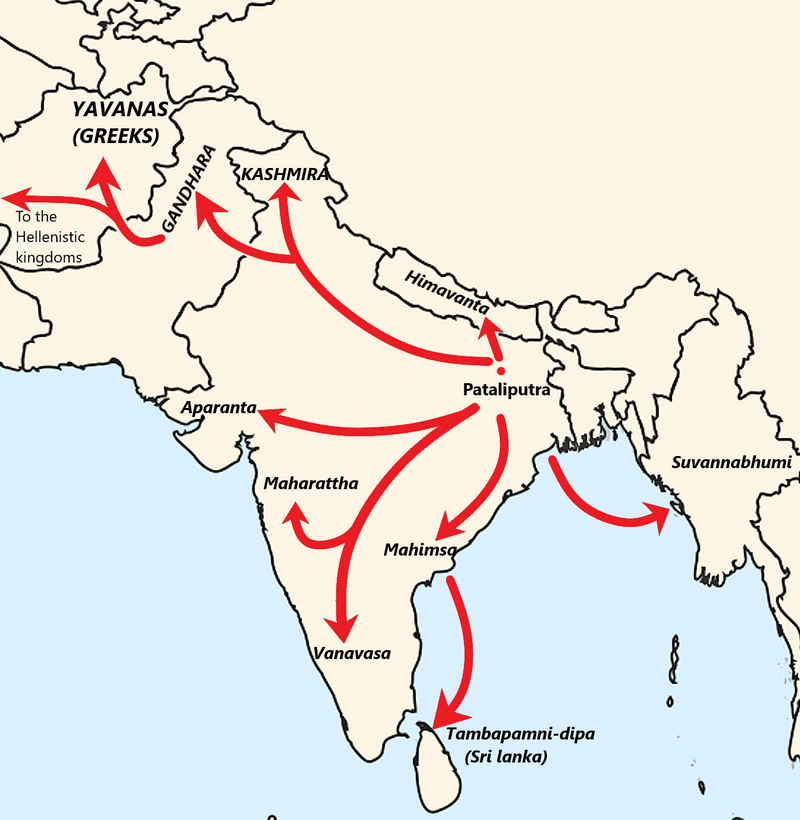
Ces missionnaires allèrent jusqu’aux royaumes hellénistiques de l’ouest, en commençant par la Bactriane voisine. Des missionnaires furent également envoyés en Inde du sud, au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est (peut-être en Birmanie).
La forte implication de ces missions dans l’éclosion du bouddhisme en Asie à l’époque d’Ashoka est solidement étayée par des preuves archéologiques. Le bouddhisme ne s’est pas répandu par pur hasard, mais dans le cadre d’une opération politique créative, stimulante et bien planifiée, tout au long des Routes de la soie.
Le Mahavamsa ou Grande chronique (XII, 1er paragraphe), relatant l’histoire des rois cinghalais et tamouls de Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka), donne la liste des missionnaires bouddhistes envoyés par le Concile et Ashoka :
- Le vieux Majjhantika prit la tête de la mission au Cachemire et au Gandhara (aujourd’hui le nord-ouest du Pakistan et l’Afghanistan) ;
- L’aîné Mahadeva dirigea la mission dans le sud-ouest de l’Inde (Mysore, Karnataka) ;
- Rakkhita, celle du sud-est de l’Inde (Tamil Nadu) ;
- Le vieux Yona (Ionien, Grec) Dharmaraksita partit vers Aparantaka (« frontière occidentale », comprenant le nord du Gujarat, le Kathiawar, le Kachch et le Sindh, toutes des parties de l’Inde à l’époque) ;
- L’aîné Mahadharmaraksita dirigea la mission de Maharattha (région péninsulaire occidentale de l’Inde) ;
- Maharakkhita (Maharaksita Thera) fut envoyé au pays des Yona (Ioniens), probablement la Bactriane et peut-être le royaume séleucide ;
- Majjhima Thera conduisit la mission dans la région d’Himavant (nord du Népal, contreforts de l’Himalaya) ;
- Sona Thera et Uttara Thera, celles de Suvannabhumi (quelque part en Asie du Sud-Est, peut-être au Myanmar ou en Thaïlande) ;
- Enfin, Mahinda, fils aîné d’Ashoka et donc le Prince de son royaume, accompagné de ses disciples Utthiya, Ittiya, Sambala et Bhaddasala, se rendit à Lankadipa (Sri Lanka).
Certaines de ces missions furent couronnées de succès, permettant d’implanter le bouddhisme en Afghanistan, au Gandhara et au Sri Lanka, par exemple.
Le bouddhisme gandharien, le gréco-bouddhisme et le bouddhisme cinghalais ont puissamment inspiré le développement du bouddhisme dans le reste de l’Asie, notamment en Chine, et ceci pendant des générations.
Si les missions dans les royaumes hellénistiques méditerranéens semblent avoir été moins fructueuses, il est possible que des communautés bouddhistes se soient établies pendant une période limitée dans l’Alexandrie égyptienne, ce qui pourrait être à l’origine de la secte dite des Therapeutae, mentionnée dans certaines sources anciennes comme Philon d’Alexandrie (v. 20 av. J.-C. – 50 apr. J.-C.).
Le courant juif des Esséniens et les Thérapeutes d’Alexandrie seraient des communautés fondées sur le modèle du monachisme bouddhique. « C’est l’Inde qui serait, selon nous, au départ de ce vaste courant monastique qui brilla d’un vif éclat durant environ trois siècles dans le judaïsme même », affirme l’historien français André Dupont-Sommer, et cette influence aurait même contribué, selon lui, à l’émergence du christianisme.
Edits d’Ashoka


Ashoka transmettait ses messages par le biais d’édits gravés sur des piliers et des rochers en divers lieux du royaume, proches des stupas, sur des lieux de pèlerinage et le long de routes commerciales très fréquentées.
Une trentaine d’entre eux ont été conservés. Ils sont souvent rédigés non pas en sanskrit, mais en grec (la langue du royaume gréco-bactrien voisin et des communautés grecques du royaume d’Ashoka), en araméen (langue officielle de l’ancien empire achéménide) ou en divers dialectes du prâkrit (une langue indo-aryenne moyenne), y compris le gândhârî ancien, langue parlée au Gandhara. (*3)
Ces édits utilisaient la langue pertinente pour la région. Par exemple, en Bactriane, ou les Grecs dominaient, on trouve près de l’actuelle Kandahar un édit rédigé uniquement en grec et en araméen.
Contenu des édits

Certains d’entre eux reflètent l’adhésion profonde d’Ashoka aux préceptes du bouddhisme et ses relations étroites avec le Sangha, l’ordre monastique bouddhiste. Il utilise également le terme spécifiquement bouddhiste de dharma pour désigner les qualités du cœur qui sous-tendent l’action morale.
Dans son édit mineur sur rocher N° 1, le roi se déclare « adepte laïc de l’enseignement du Bouddha depuis plus de deux ans et demi », mais avoue que jusqu’ici, il n’a « pas fait grand progrès ». « Depuis un peu plus d’un an, je me suis rapproché de l’Ordre », ajoute-t-il.
Dans l’édit mineur sur rocher N° 3 de Calcutta-Bairat, il affirme : « Tout ce qui a été dit par le Bouddha a été bien dit », décrivant les enseignements du Bouddha comme le véritable dharma.
Ashoka a reconnu les liens étroits entre l’individu, la société, le roi et l’État. Son dharma peut être compris comme la moralité, la bonté ou la vertu, et l’impératif de le poursuivre lui a donné le sens du devoir. Les inscriptions expliquent que le dharma intègre la maîtrise de soi, la pureté de la pensée, la libéralité, la gratitude, la dévotion ferme, la véracité, la protection de la parole et la modération dans les dépenses et les possessions.
Le dharma a également un aspect social. Il comprend l’obéissance aux parents, le respect des aînés, la courtoisie et la libéralité envers les adorateurs de Brahma, la courtoisie envers les esclaves et les serviteurs, et la libéralité envers les amis, les connaissances et les parents.
La non-violence, qui consiste à s’abstenir de blesser ou de tuer tout être vivant, était un aspect important du dharma d’Ashoka. Ne tuer aucun être vivant est décrit comme faisant partie du bien (Édit mineur sur rocher N° 11), de même que la douceur à leur égard (Édit mineur sur rocher N° 9). L’accent mis sur la non-violence s’accompagne de l’incitation à une attitude positive d’attention, de douceur et de compassion.
Ashoka adopte et préconise une politique fondée sur le respect et la tolérance des autres religions. L’un de ses édits préconise :
« Tous les hommes sont mes enfants. A mes enfants, je souhaite prospérité et bonheur dans ce monde et dans l’autre ; mes vœux sont les mêmes pour tous les hommes. »
Loin d’être sectaire, Ashoka, s’appuyant sur la conviction que toutes les religions partagent une essence commune et positive, encourage la tolérance et la compréhension des autres religions :
« Le bien-aimé des dieux, le roi Piyadassi (c’est-à-dire Ashoka), souhaite que toutes les sectes puissent habiter en tous lieux, car toutes recherchent la maîtrise de soi et la pureté de l’esprit. » (Édit majeur sur rocher N° 7)
Et il précise :
« Car quiconque loue sa propre secte ou blâme les autres sectes, –par pure dévotion à sa propre secte, dans le simple but de la glorifier, – en agissant ainsi, il porte au contraire gravement préjudice à sa propre secte. Mais la concorde est méritoire, (c’est-à-dire) que tous doivent écouter et obéir à la morale de l’autre. » (Édit majeur sur rocher N° 12)
Ashoka avait l’idée d’un empire politique et d’un empire moral, le second englobant le premier. Sa conception de sa circonscription s’étendait au-delà de ses sujets politiques pour inclure tous les êtres vivants, humains et animaux, vivant à l’intérieur comme à l’extérieur de son domaine politique. Ses inscriptions expriment sa conception paternelle de la royauté et décrivent ses mesures d’aide sociale, notamment la fourniture de traitements médicaux, la plantation d’herbes, d’arbres et de racines pour les hommes et les animaux, et le creusement de puits le long des routes (Edit majeur sur rocher N°2). Les efforts du roi pour propager son dharma ne se limitaient pas à son propre domaine politique, mais s’étendaient aux royaumes des autres souverains.
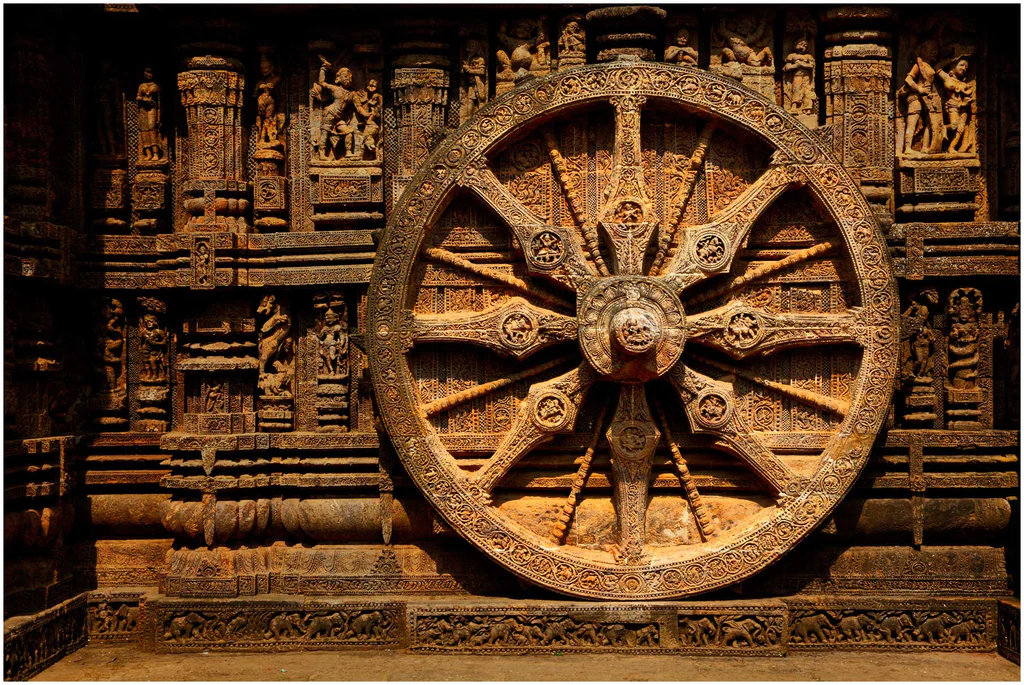
L’empereur est devenu un sage. Il dirige un gouvernement centralisé depuis Pataliputra, capitale de l’Empire Maurya. Son administration perçoit des impôts et il demande à ses inspecteurs de lui rendre des comptes. L’agriculture se développe grâce à des canaux d’irrigation. Il fait construire des routes de qualité pour relier les points stratégiques et les centres politiques, exigeant, des siècles avant notre grand Sully en France, qu’elles soient bordées d’arbres d’ombrage, de puits et d’auberges.
Si l’existence même d’Ashoka en tant que personnage historique a été quasiment oubliée, depuis le déchiffrement de sources écrites en brahmi au XIXe siècle, il est désormais considéré comme l’un des plus grands empereurs indiens. La roue bouddhiste d’Ashoka figure d’ailleurs sur le drapeau indien.
Comme nous l’avons déjà dit, Ashoka et ses descendants ont utilisé leur pouvoir pour construire des monastères et répandre l’influence bouddhiste en Afghanistan, dans de vastes régions de l’Asie centrale, au Sri Lanka et, au-delà, en Thaïlande, Birmanie, Indonésie, puis en Chine, en Corée et au Japon.
Des statues en bronze de son époque ont été déterrées dans les jungles d’Annam, de Bornéo et des Célèbes. La culture bouddhiste s’est implantée dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, même si chaque région a su conserver une partie de sa personnalité et de son caractère propres.
L’Empire Kouchan
(du Ier siècle av. JC au IIIe siècle)

L’Empire Maurya, qui régnait sur la Bactriane et d’autres anciennes satrapies grecques, s’effondra en 185 avant J.-C., à peine cinq décennies après la mort d’Ashoka, accusé d’avoir trop dépensé pour les temples et les missions bouddhistes. Les mafias brahmaniques, qui avaient abhorré son règne, revinrent immédiatement au pouvoir.
Mais la période est turbulente. Au premier siècle avant J.C., les Kouchans, l’une des cinq branches de la confédération nomade chinoise Yuezhi, émigrent du nord-ouest de la Chine (Xinjiang et Gansu) et s’emparent, après les nomades iraniens Saka, de l’ancienne Bactriane.
Ils forment l’Empire kouchan dans les territoires de la Bactriane. Cet empire s’étend assez vite à une grande partie de ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, le Pakistan et le nord de l’Inde, au moins jusqu’à Saketa et Sarnath, près de la ville de Varanasi (Bénarès).

Le fondateur de la dynastie kouchane, Kujula Kadphisès, qui suit les idées culturelles et l’iconographie grecques après la tradition gréco-bactrienne, est un adepte de la secte shivaïte de l’hindouisme. Deux rois kouchans ultérieurs, Vima Kadphisès et Vasudeva II, furent également des mécènes de l’hindouisme et du bouddhisme. La patrie de leur empire se trouvait en Bactriane, où le grec était initialement la langue administrative, avant d’être remplacé par le bactrien écrit en caractères grecs jusqu’au VIIIe siècle, lorsque l’islam le remplace par l’arabe.

Les Kouchans devinrent également de grands mécènes du bouddhisme, en particulier l’empereur Kanishka le Grand (78-144 après J.-C.), qui joua un rôle important dans sa diffusion, via les Routes de la soie, vers l’Asie centrale et la Chine, inaugurant une période de paix relative de 200 ans, parfois décrite comme la « Pax Kouchana ».
Il semble également que dès ses débuts, le bouddhisme ait prospéré dans la classe des marchands, à qui la naissance interdisait l’accès aux ordres religieux de l’Inde et de l’Himalaya. La pensée et l’art bouddhistes se développèrent grâce aux routes commerciales entre l’Inde, l’Himalaya, l’Asie centrale, la Chine, la Perse, l’Asie du Sud-Est et l’Occident. Les voyageurs recherchaient la protection des images bouddhistes et faisaient des offrandes aux sanctuaires le long de la route, ramassant des objets et des sanctuaires portables pour leur usage personnel.
Le terme quatrième concile bouddhiste désigne deux évènements différents selon les écoles theravâda et mahâyâna.
1) La tradition theravâda : afin d’éviter que ne se perde l’enseignement du Bouddha, qui se serait jusqu’alors transmis oralement, cinq cents moines menés par le Vénérable Maharakkhita se réunirent à Tambapanni (Sri Lanka), sous le patronage du roi Vattagamani (r. 103 – 77 av. J.-C.) afin de coucher par écrit sur des feuilles de palme le Canon pâli. (*4)
Le travail, qui aurait duré trois ans, se serait déroulé dans la grotte Aloka lena, près de l’actuel Matale.
2) Selon la tradition mahâyâna, c’est 400 ans après l’extinction du Bouddha que cinq cents moines sarvastivadin se réunirent en 72 après J.-C. au Cachemire pour compiler et clarifier leurs doctrines sous la direction de Vasumitra et sous le patronage personnel de l’empereur Kanishka. Ils auraient ainsi produit le Mahavibhasa (Grande exégèse) en sanskrit.
Selon plusieurs sources, le moine bouddhiste indien Asvaghosa, considéré comme le premier dramaturge classique sanskrit et dont nous avons évoqué plus haut les attaques contre le système des castes, était le conseiller spirituel du roi Kanishka dans les dernières années de sa vie.

A noter que les plus anciens manuscrits bouddhiques découverts à ce jour, tels que les vingt-sept rouleaux d’écorce de bouleau acquis par la British Library en 1994 et datant du Ier siècle, ont été trouvés, non pas en Inde, mais enterrés dans les anciens monastères du Gandhara, la région centrale de l’empire maurya et kouchan, qui comprend les vallées de Peshawar et de Swat (Pakistan) et s’étend vers l’ouest jusqu’à la vallée de Kaboul en Afghanistan et vers le nord jusqu’à la chaîne du Karakoram
Ainsi, après le grand élan donné par le roi Ashoka le Grand, la culture du Gandhara connaîtra un second souffle sous le règne du roi kouchan Kanishka Ier.
Les villes de Begram, Taxila, Purushapura (aujourd’hui Peshawar) et Surkh Kotal atteignent alors des sommets de développement et de prospérité.
Le miracle de Gandhara

C’est peu dire que le Gandhara, surtout à l’époque kouchane, fut au cœur d’une véritable renaissance de la civilisation, avec une incroyable concentration de productions artistiques et une inventivité sans pareil. Si l’art bouddhiste était principalement centré sur les temples et les monastères, les objets de dévotion personnelle étaient très courants.
Grâce à l’art du Gandhara, le bouddhisme se mua en une grande force de beauté, d’harmonie et de paix, conquérant le monde.
Il favorisa alors une création artistique qui élève la pensée et la moralité en faisant appel à des paradoxes métaphoriques.
Les médiums et supports qui prévalent sont la peinture sur soie, les fresques, les livres illustrés et gravures, la broderie et autres arts du tissu, la sculpture (bois, métal, ivoire, pierre, jade) et l’architecture. Quelques exemples :
A. La poésie
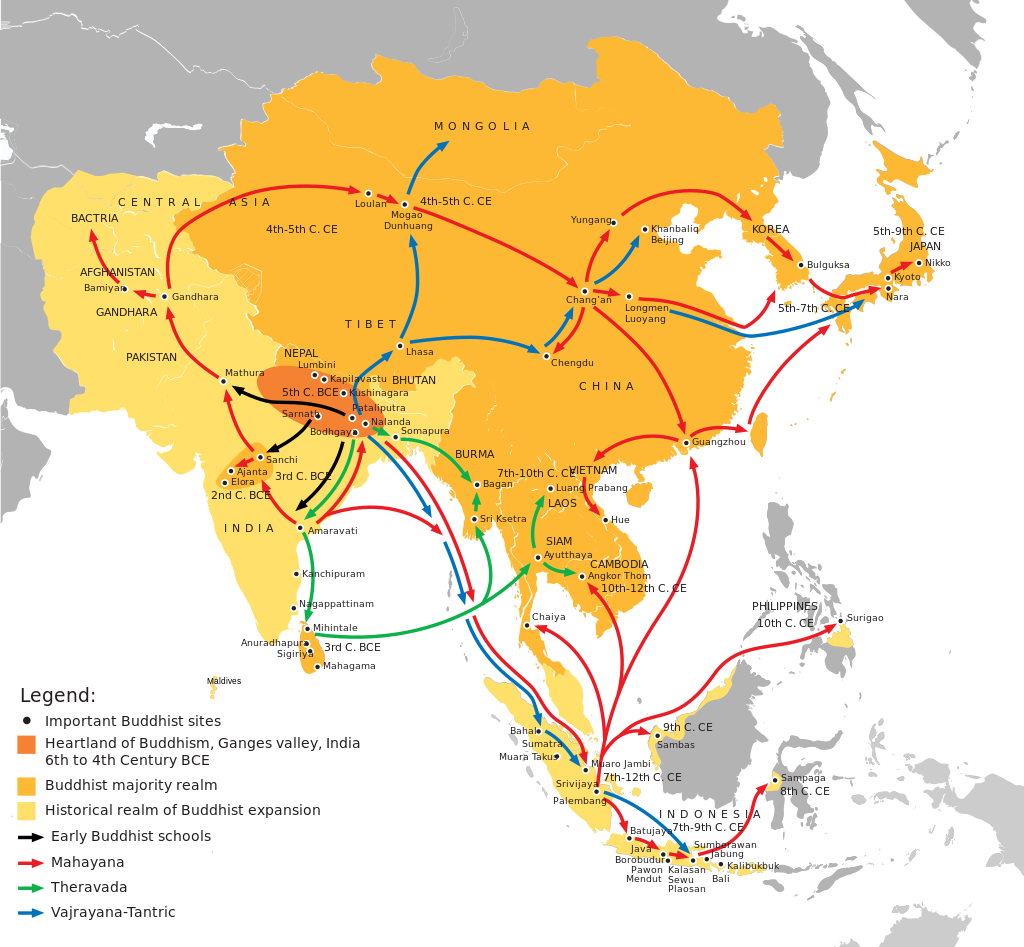
Pour la plupart des Occidentaux, le bouddhisme est une émanation typique de la culture asiatique, généralement associée à l’Inde, au Tibet, au Népal, mais aussi à la Chine et à l’Indonésie.
Peu de gens savent que les plus anciens manuscrits bouddhistes connus à ce jour (Ier siècle de notre ère) ont été découverts, non pas en Asie, mais en Asie centrale, dans d’anciens monastères bouddhistes du Gandhara.
A l’origine, avant leur transcription en sanskrit (pendant longtemps la langue des élites), ils étaient écrits en gândhârî, une langue indo-aryenne du groupe prâkrit, transcrit avec l’alphabet kharosthi (une ancienne écriture indo-iranienne). Le gândhârî était la lingua franca de la pensée bouddhiste à ses débuts. Preuve en est, les manuscrits bouddhistes écrits en gândhârî qui ont voyagé jusqu’en Chine orientale pour se retrouver dans les inscriptions de Luoyang et d’Anyang.

Afin de préserver leurs écrits, les bouddhistes étaient à l’avant-garde de l’adoption des technologies chinoises liées à la fabrication de livres, notamment le papier et la xylographie. Cette technique d’impression consiste à reproduire le texte à imprimer sur une feuille de papier transparente qui est retournée et gravée sur une planche de bois tendre. L’encrage des parties saillantes permet ensuite des tirages multiples. C’est ce qui explique que le premier livre entièrement imprimé est le Sutra du diamant bouddhique (vers 868) réalisé par ce procédé
Le Khaggavisana Sutta, littéralement « la corne du rhinocéros », est une expression authentique de la poésie religieuse bouddhiste originale. Connu sous le nom de Sutra du rhinocéros, cette œuvre poétique fait partie du recueil pâli de textes courts Kuddhhaka Nikava, la cinquième partie du Sutta Pitaka, écrit au Ier siècle de notre ère.
Parce que la tradition accorde au rhinocéros asiatique une vie solitaire dans la forêt, l’animal n’aime pas les troupeaux, ce sutra (enseignement) porte le titre approprié d’essai « sur la valeur de la vie solitaire et errante ». L’allégorie du rhinocéros permet de communiquer aux dévots un sens aigu de la souveraineté individuelle que requièrent les engagements moraux prescrits par le Bouddha pour mettre fin à la souffrance en se déconnectant des plaisirs et des douleurs terrestres.

Extrait :
Refuser la violence à l’égard de tous les êtres,
ne jamais faire de mal à un seul d’entre eux,
aider avec compassion et un cœur aimant ;
erre seul comme un rhinocéros.
Celui qui tient compagnie nourrit l’affection
et de l’affection naît la souffrance.
Réalisant le danger qui découle de l’affection,
erre seul comme un rhinocéros.
En sympathisant avec les amis et les compagnons,
l’esprit se fixe sur eux et perd son chemin.
Percevoir ce danger, c’est la familiarité,
erre seul comme un rhinocéros.
Les préoccupations que l’on a pour ses fils et ses femmes
sont comme une pensée et un bambou enchevêtré.
Reste démêlé comme un jeune bambou,
erre seul comme un rhinocéros.
Comme un cerf qui erre librement dans la forêt,
va où il veut en broutant,
un homme sage, qui chérit sa liberté,
erre seul comme le rhinocéros.
Laissez derrière vous vos fils, vos femmes et votre argent,
tous vos biens, vos parents et vos amis.
Abandonnez tous vos désirs, quels qu’ils soient,
erre seul comme le rhinocéros. (…)
B. La littérature
Deux autres chefs-d’œuvre tirés du même recueil sont d’une part les célèbres Jataka (Récits des vies antérieures du Bouddha), et d’autre part, le Milindapanha (Les questions du roi Milinda).
Les Jataka, qui mettent en scène de nombreux animaux, montrent comment, avant la dernière incarnation humaine au cours de laquelle il atteignit le nirvana, le Bouddha lui-même s’était réincarné d’innombrables fois en animal (en diverses sortes de poissons, en crabe, coq, pivert, perdrix, francolin, caille, oie, pigeon, corbeau, zèbre, buffle, plusieurs fois en singe ou en éléphant, en antilope, cerf et cheval).
Et puisque c’est Bouddha qui est incarné dans cet animal, celui-ci a soudainement des propos d’une grande sagesse.
Mais en d’autres occasions, ce sont des personnages qui sont des animaux alors que notre Bodhisattva apparaît sous forme humaine. Ces contes sont souvent pimentés d’un humour piquant. On sait d’ailleurs qu’elles ont inspiré La Fontaine, qui a dû les entendre du docteur François Bernier, qui les avait lui-même apprises alors qu’il était médecin en Inde pendant huit ans.
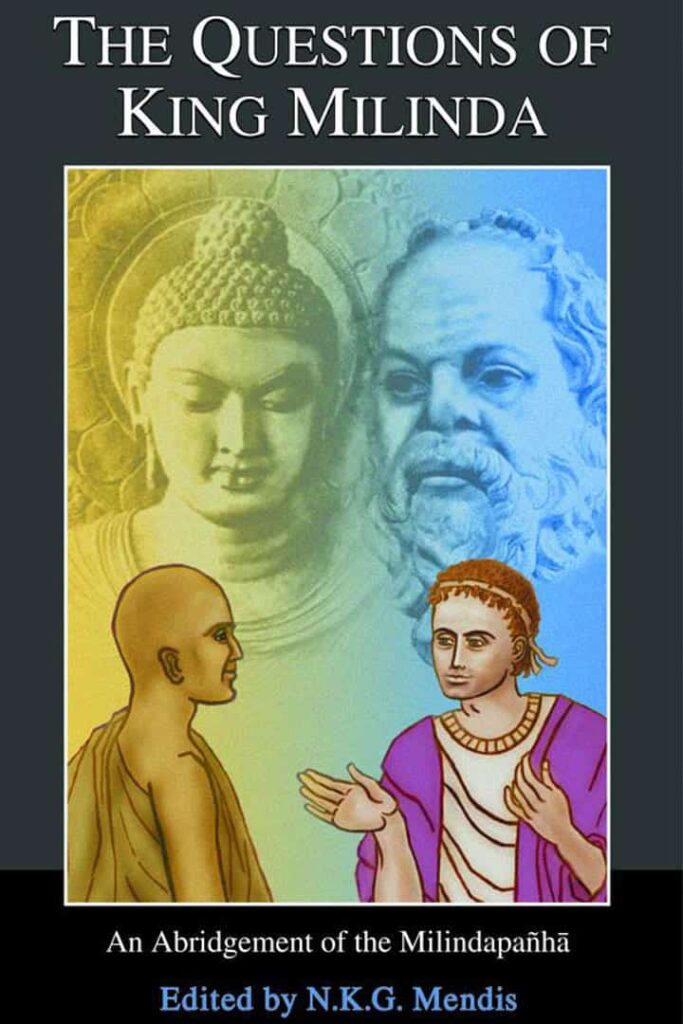
Les questions du roi Milinda est un compte-rendu imagé, véritable dialogue platonicien entre le roi grec de Bactriane, Milinda (le Grec, Ménandre), qui régnait au Pendjab, et le sage bouddhiste Bhante Nagasena. Leur dialogue animé, dramatique et spirituel, éloquent et inspiré, explore les divers problèmes de la pensée et de la pratique bouddhistes du point de vue d’un intellectuel grec perspicace, à la fois perplexe et fasciné par la religion étrangement rationnelle qu’il découvre sur le sous-continent indien.
Par le biais de paradoxes, Nagasena amène le « rationaliste » grec à s’élever jusqu’à la dimension spirituelle, au-delà de la logique et de la simple rationalité. Car le nirvana, tout comme l’espace, n’a « pas de cause » formelle et, bien qu’il peut se produire, « ne peut pas être causé ». Mince, comment faire alors pour y aboutir ?
Et à l’un de ses disciples qui un jour lui posa la question de savoir si l’univers était fini ou infini, éternel ou non, si l’âme était distincte du corps, ce que devenait l’homme après la mort, le Bouddha répondit par une parabole :
« Supposons qu’un homme soit gravement atteint d’une flèche, que l’on l’amène chez un médecin, et que l’homme dise : “Je ne laisserai pas retirer cette flèche, avant de savoir qui m’a blessé, de quel caste il est, de quel village il est né, de quel arc il s’est servi, de quelle matière a été faite la flèche, de quelle direction elle a été tirée…” Alors cet homme mourrait certainement avant d’avoir les réponses. »
C. Urbanisme
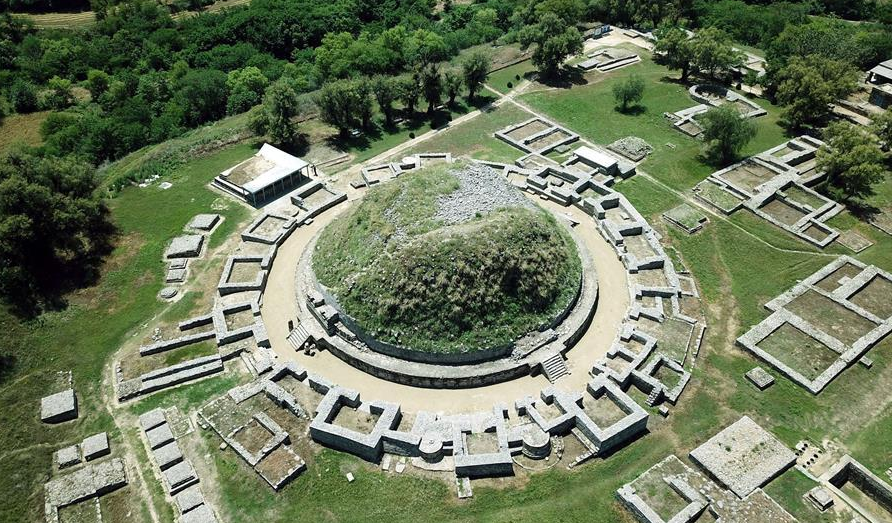
Taxila ou Takshashila (aujourd’hui au Pendjab), l’un des grands centres urbains et, pendant un certain temps, la capitale du Gandhara, fut fondée vers 1000 avant J.-C. sur les ruines d’une cité datant de la période Harappa et située sur la rive orientale de l’Indus, point de jonction entre le sous-continent indien et l’Asie centrale.
Certaines ruines de Taxila datent de l’époque de l’empire perse achéménide, suivi successivement par l’Empire Maurya, le royaume indo-grec, les Indo-Scythes et l’empire kouchan.
D’après certains témoignages, l’université de l’ancienne Taxila (des siècles avant l’université bouddhiste résidentielle de Nalanda fondée en 427 après J.-C.) peut être considérée comme l’un des premiers centres d’enseignement d’Asie du Sud. Dès 800 av. J.-C., la ville fonctionnait en grande partie comme une université, offrant des études supérieures. Avant d’y être admis, les étudiants devaient avoir terminé ailleurs leurs études primaires et secondaires. L’âge minimum requis était de seize ans. Non seulement les Indiens, mais aussi les étudiants de contrées voisines comme la Chine, la Grèce et l’Arabie affluaient dans cette ville d’apprentissage.
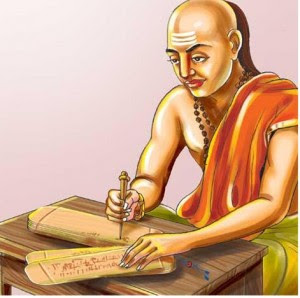
Vers 321 avant J.-C., c’est le grand philosophe, enseignant et économiste du Gandhara, Chanakya (375 à 283 av. J.-C.) qui aida le premier empereur maurya, Chandragupta, à accéder au pouvoir.
Sous la tutelle de Chanakya, Chandragupta avait reçu une éducation complète à Taxila, englobant les différents arts de l’époque, y compris l’art de la guerre, pendant sept à huit ans.
En 303 avant J.-C., Taxila tomba entre leurs mains et sous Ashoka le Grand, le petit-fils de Chandragupta, la ville devint un grand centre de l’enseignement et de l’art bouddhiste.
Chanakya, dont les écrits n’ont été redécouverts qu’au début du XXe siècle et qui fut le principal conseiller des deux empereurs Chandragupta et de son fils Bindusara, est considéré comme ayant joué un rôle majeur dans l’établissement de l’Empire Maurya.
Également connu sous les noms de Kauṭilya et Vishnugupta, Chanakya est l’auteur de l’Arthashastra, un traité politique sanskrit sur l’art de gouverner, la science politique, la politique économique et la stratégie militaire. L’Arthashastra aborde également la question d’une éthique collective assurant la cohésion de la société.
Il conseille au roi de lancer de grands projets de travaux publics dans les régions dévastées par la famine, les épidémies et autres catastrophes naturelles, ou par la guerre, tels que la création de voies d’irrigation et la construction de forts autour des principaux centres de production et villes stratégiques, et d’exonérer d’impôts les personnes touchées par ces catastrophes.
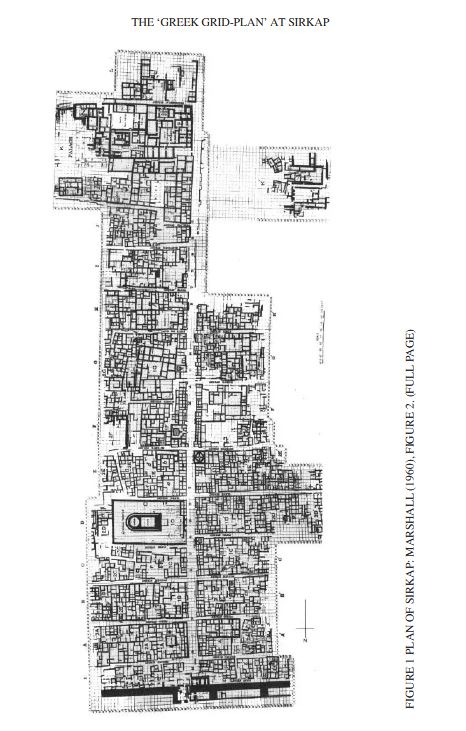
Au IIe siècle avant notre ère, Taxila fut annexée par le royaume indo-grec de Bactriane qui y érigea une nouvelle capitale nommée Sirkap, où des temples bouddhistes côtoyaient des temples hindous et grecs, signe de tolérance religieuse et de syncrétisme. Sirkap fut construite selon le plan quadrillé hippodamien (*5) caractéristique des villes grecques
Elle s’organise autour d’une avenue principale et de quinze rues perpendiculaires, couvrant une surface d’environ 1200 mètres sur 400, avec un mur d’enceinte de 5 à 7 mètres de large et de 4,8 kilomètres de long.
Après sa construction par les Grecs, la ville fut reconstruite lors des incursions des Indo-Scythes, puis par les Indo-Parthiens, après un tremblement de terre en l’an 30 de notre ère.
Certaines parties de la ville, notamment le stupa (reliquaire) bouddhiste de l’aigle bicéphale et le temple du dieu Soleil, furent construites par Gondophares, le premier roi du royaume indo-parthien. Enfin, des inscriptions datant de l’an 76 de notre ère démontrent que la ville était déjà passée sous la domination des Kouchans. Le souverain kouchan Kanishka érigera Sirsukh, à environ 1,5 km au nord-est de l’ancienne Taxila.
Des sutras bouddhistes de la région du Gandhara sont étudiés en Chine dès 147 de notre ère, lorsque le moine kouchan Lokakṣema (né en 147) commença à traduire en chinois certains des premiers sutras bouddhistes. Les plus anciennes de ces traductions montrent qu’elles ont été faites à partir de la langue
D. Architecture, l’invention des stupas
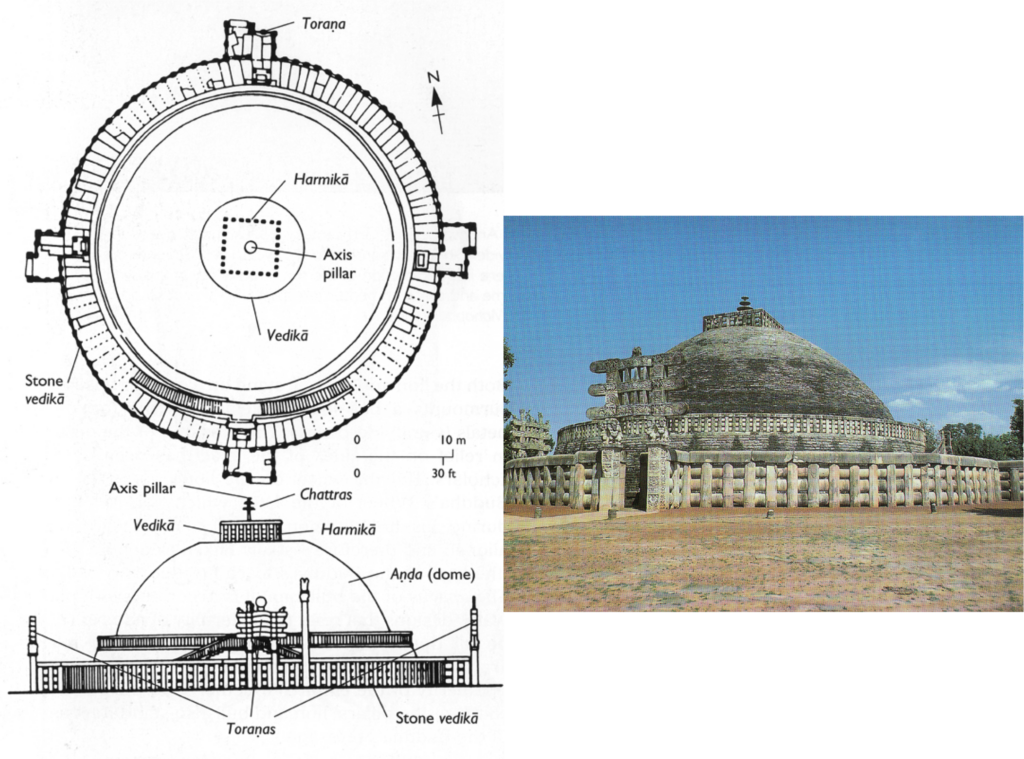
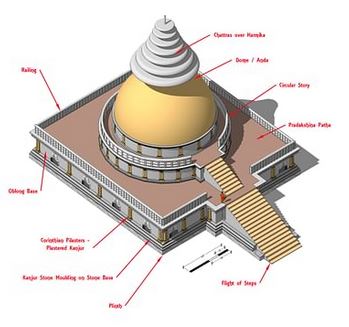
A l’origine, les édifices religieux sous forme de stupa (reliquaire) ont été érigés en Inde comme monuments commémoratifs associés à la conservation des reliques sacrées du Bouddha.
Construits en forme de dôme, ils sont entourés d’une balustrade qui sert de rampe pour la circumambulation rituelle. On accède à la zone sacrée par des portes situées aux quatre points cardinaux. Les stupas se situent souvent à proximité de sites funéraires préhistoriques beaucoup plus anciens, associés notamment à la Civilisation de la vallée de l’Indus.

Des grilles et des portails en pierre, recouverts de sculptures, leur ont été ajoutés. Les thèmes favoris sont les événements de la vie historique du Bouddha, ainsi que de ses vies antérieures, au nombre de 550, décrites avec beaucoup d’ironie dans les Jatakas. (Voir B)
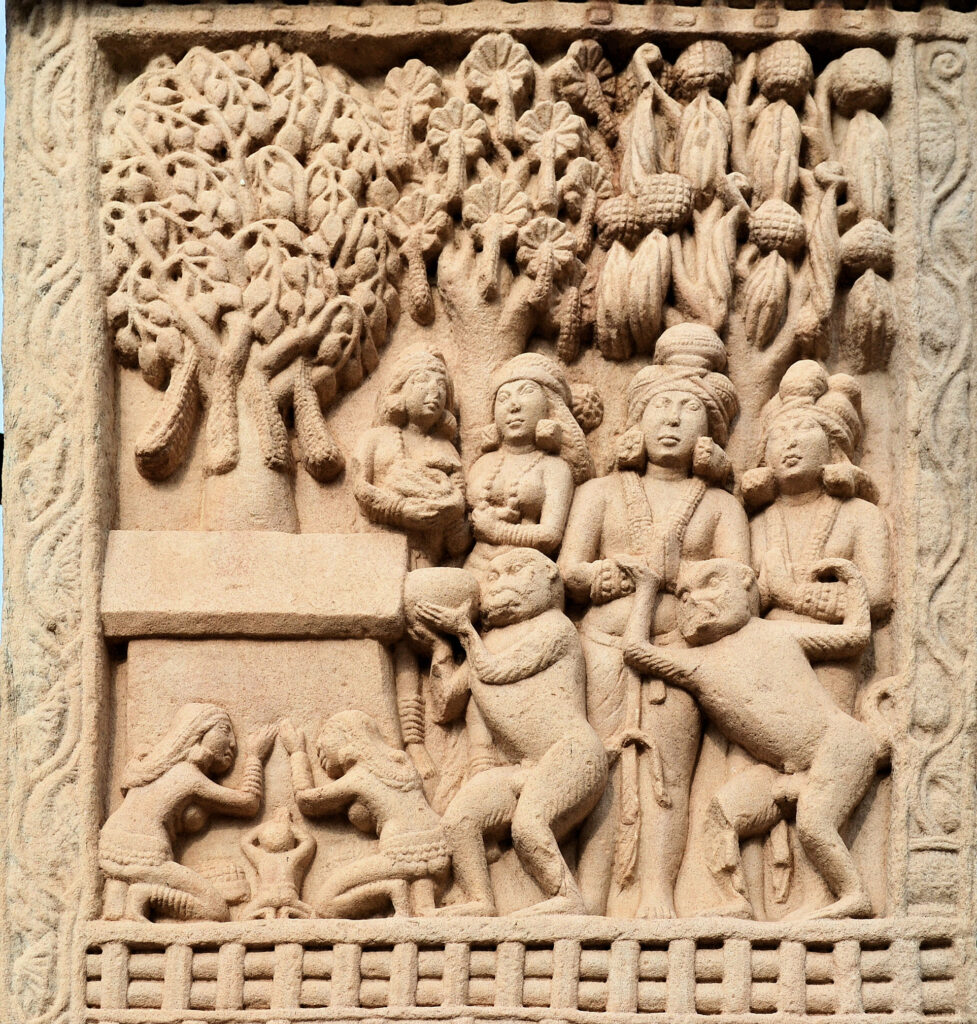
Les bas-reliefs des stupas sont comme des bandes dessinées qui nous racontent la vie quotidienne et religieuse du Gandhara : amphores, coupes à vin (kantaros), bacchanales, instruments de musique, vêtements grecs ou indiens, ornements, coiffures arrangées à la grecque, artisans, leurs outils, etc.
Sur un vase trouvé à l’intérieur d’un stupa, on trouve l’inscription d’un Grec, Théodore, gouverneur civil d’une province au Ier siècle avant J.-C., expliquant en alphabet kharosthi comment les reliques ont été déposées dans le stupa.
On pense que de nombreux stupas datent de l’époque d’Ashoka, comme celui de Sanchi (Inde centrale) ou de Kesariya (Inde de l’Est), où il a également érigé des piliers avec ses édits, et peut-être ceux de Bharhut (Inde centrale), Amaravati (sud-est de l’Inde) ou Dharmarajika (Taxila) dans le Gandhara (Pakistan).
Selon la tradition bouddhiste, l’empereur Ashoka aurait récupéré les reliques du Bouddha dans des stupas plus anciens et en aurait fait ériger 84 000 pour répartir l’ensemble de ces reliques sur tout le territoire indien.
Marchant dans les pas d’Ashoka, Kanishka ordonna la construction à Purushapura (Peshawar) du grand stupa de 400 pieds qui figure parmi les plus hauts édifices du monde antique.

Les archéologues qui en ont redécouvert la base en 1908-1909 ont estimé que ce stupa avait un diamètre de 87 mètres. Selon les rapports de pèlerins chinois tels que Xuanzang, il faisait environ 200 mètres de haut et était recouvert de pierres précieuses. Sous les Kouchans également, d’immenses statues du Bouddha furent érigées dans les monastères ou sculptées à flanc de colline.
E. Sculpture
—PERIODE ANICONIQUE
Il est important de rappeler que dans les premiers temps, Bouddha n’était jamais représenté sous forme humaine.

Pendant plus de quatre siècles, sa présence est simplement suggérée par des éléments symboliques tel qu’une empreinte de pieds, une fleur de lotus (indiquant la pureté de sa naissance), une roue à huit rayons (symbolisant la dharma), un trône vide, un espace inoccupé sous un parasol, un cheval sans cavalier ou encore le figuier sous lequel il a atteint le nirvana.
–FIN DE L’ANICONISME
Ce qui a conduit les bouddhistes à renoncer aux représentations aniconiques reste un vaste mystère. Un tel développement est assez unique dans l’histoire des religions. Imaginons soudainement les musulmans promouvant des statues du prophète Mohammed !
Les explications avancées jusqu’ici nous laissent sur la faim.
Pour les uns, les bouddhistes auraient voulu séduire une clientèle grecque, mais aussi bien les populations grecques que le bouddhisme était au Gandhara bien avant la révolution iconographique en question.
Pour les autres, les pratiquants, en l’absence de Bouddha lui-même, auraient cherché désespérément un centre d’intérêt visuel, soit une statue, une peinture ou mêmes quelques cheveux… Ces représentations symboliques, on l’a vu, répondaient à cette demande.
« Le Jataka de Kalingabodhi (écrit majeur sur les vies multiples de Bouddha) relate la frustration des habitants de Sravasti, en découvrant un jour qu’ils n’ont personne à vénérer lorsqu’ils se rendent au Jetavana et trouvent le Bouddha ‘absent’, parti en voyage. Pour remédier à cette situation, à son retour, le Bouddha permet à [son disciple] Ananda de planter un figuier Bodhi devant le [monastère de] Jetavana (…) qui sert de centre de substitution pour les dévotions des gens, chaque fois que le Bouddha n’est pas en résidence », écrit John Strong, dans Reliques du Bouddha.
Bouddha, rapporte-t-on, aurait refusé qu’il soit représenté d’aucune façon, craignant de voir prospérer l’idolâtrie.
Avec le temps, le bouddhisme va évoluer. Au Gandhara, c’est le bouddhisme mahâyâna (Grand Véhicule) qui s’épanouit. Pour ce courant, l’objectif ne se limite plus à atteindre le nirvana à titre personnel mais de libérer toute l’humanité de la souffrance.
Si pour le bouddhisme theravâda, Siddhartha Gautama n’était qu’un homme éclairé donnant l’exemple, pour le bouddhisme mahâyâna, il s’agit indubitablement, avec Bouddha, d’une tentative (réussie) de personnifier le dharma (la force spirituelle omniprésente, le principe ultime et suprême de la vie) dans la conception du premier de tous les bouddhas. Une sorte de Jésus, un dieu devenu homme pour ainsi dire…
Comme plus tard Jésus dans le christianisme à partir du Ve siècle, Bouddha pouvait dès lors être représenté sous une forme humaine.
Certains bouddhas du Gandhara représentent également des états d’âme spécifiques, tels que la sagesse, la tendresse et la compassion.
Contrairement à de nombreux artistes chrétiens chez nous, qui, conformément à la doxa, ont représenté le Christ souffrant sur la Croix (événement fondamental de la foi chrétienne), les artistes du Gandhara présentent Bouddha comme un être totalement détaché de la douleur humaine, regardant avec compassion l’humanité tout entière.
Le but étant d’éliminer la souffrance chez tous les hommes, la compassion n’est pas une notion passive chez les bouddhistes. Ce n’est pas seulement de l’empathie, mais plutôt un altruisme empathique qui s’efforce activement de libérer les autres de la souffrance, un acte de bienveillance empreinte à la fois de sagesse et d’amour.
DIFFERENCES DE FORME, DIFFERENCE DE CONTENU
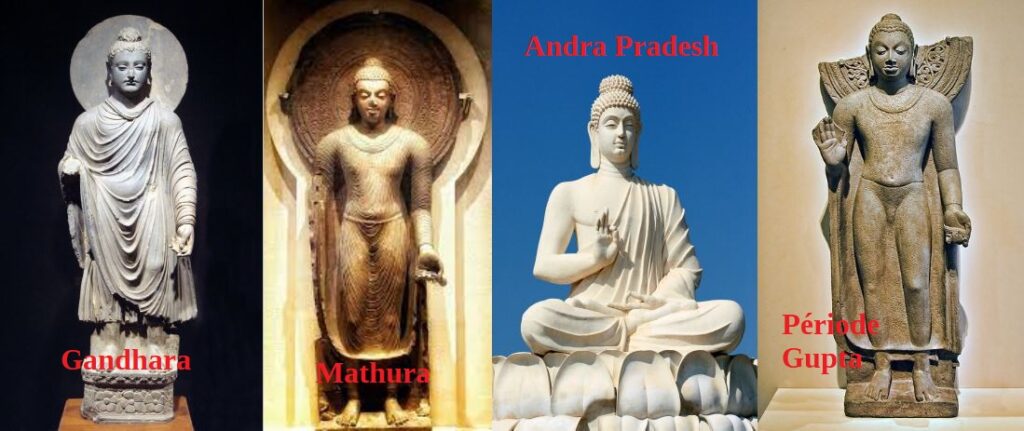
Avant de discuter de leurs différences, pour faire simple, distinguons ici, parmi tant d’autres, quatre types de représentations de bouddha:
- L’école dite « greco-bouddhique » de Gandhara produite dans la région qui va de Hadda (Afghanistan) à Taxila (Pundjab) en passant par Peshawar (Pakistan);
- L’école dite « indo-bouddhique » de Mathura;
- L’école d’Andra Pradesh, au sud de l’Inde;
- L’école de la période Gupta (3e au 5e siècle).
1. Greco-Bouddhique au Gandhara

Le terme « greco-bouddhique », renvoie à la thèse de l’archéologue Alfred Foucher (1865-1952) soutenue à la Sorbonne en 1905 sur l’art du Gandhara.
Comme l’écrivait André Malraux (1901-1976) dans les « Voix du silence », en 1951, l’art gréco-bouddhique est cette rencontre entre hellénisme et bouddhisme. Au lieu de dire que l’art venu de Grèce s’était métamorphosé en art bouddhique comme le disait Malraux, je pense plutot qu’au Gandhara, c’est l’art bouddhique qui s’est approprié le meilleur de l’esthétique indienne, grecque et des steppes.
Cependant, Foucher avait raison d’insister, contre ses amis anglais, qu’il s’agit bien d’une influence hellénique et non pas romaine. De leur coté, avec l’Inde s’émancipant de l’Empire britannique, les savants indiens ont tenté de valider la thèse d’une création autochtone de l’image de Buddha, opposant au style du Gandhara, que Foucher voulait gréco-bouddhique, le style de Mathura, dans la région de Delhi, lui aussi englobé dans l’empire des Kouchans, et vu par certains comme contemporain, même s’il est beaucoup moins prolixe que l’art du Gandhara.

L’art du Gandhara prit véritablement son essor à l’époque kouchane, et plus particulièrement sous le règne du roi Kanishka.
Des milliers d’images furent produites et répandues dans tous les coins de la région, depuis les bouddhas portatifs jusqu’aux statues monumentales des lieux de culte sacrés.
Au Gandhara, pour figurer Bouddha, on représente d’une façon très réaliste une belle personne, souvent un jeune homme, voire une femme. La charge spirituelle est telle que le genre n’est plus essentiel. On ne sait pas s’il s’agit de beaux portraits pris sur le vif, ou de purs fruits de l’imagination des artistes.


Bouddha y est souvent montré en posture méditative afin d’évoquer le moment où il atteint le nirvana.
Couronné d’une auréole, le visage grave ou souriant, les yeux mi-clos, il irradie la lumière. Plein de sérénité, il incarne le détachement, la concentration, la sagesse et la bienveillance.
Ses cheveux en chignon (l’ushnisha) au sommet du crâne indiquent qu’il est doué d’une connaissance supramondaine. Le point noire entre les deux yeux symbolise le troisième œil, celui de l’éveil.
Dans certaines sculptures, cette cavité contient une perle de cristal, symbole de lumière irradiante. Les lobes d’oreilles sont allongés et servent à accueillir les lourds bijoux que portait autrefois le jeune prince Siddhartha, durant sa jeunesse princière.
Le positionnement des mains, comme dans le reste de l’art indien, répond à des codes. Il peut s’agir de « l’abhayamudra », le geste qui rassure, la paume de la main tournée vers l’extérieur ; de la « varamudra », qui symbolise le don, la main pendante et ouverte avec le bras à demi plié, ou encore de la « vitarkamudra », qui symbolise l’argumentation, la main levée à hauteur de la poitrine, à demi fermée, paume en avant, l’index recourbé vers le pouce.
Au Gandhara, Bouddha est vêtu d’un manteau monastique qui lui couvre les deux épaules. L’étoffe n’est ni taillée, ni cousue, mais simplement drapée à la grecque autour du corps. Les plis à peine stylisés suivent les volumes naturels.
Le roi Kanitscha encouragea à la fois l’école d’art gréco-bouddhique du Gandhara (à Taxila, Peshawar et Hadda) et l’école indo-bouddhique (à Mathura, plus proche de l’Inde).
2. Ecole de Mathura


A Mathura, les artistes ont produit un Bouddha très différent. Son corps est dilaté par le souffle sacré (prana) et sa robe monastique est drapée à l’indienne de manière à laisser l’épaule droite dénudée.
On pense que les artistes, pour plaire à un public local, se sont inspirés des statues de yaksha, des esprits de la nature.
Dans les mythologies hindoue, jaïne et bouddhiste, le yakṣha a une double personnalité.
D’un côté, ce peut être une fée de nature inoffensive, associée aux forêts et aux montagnes ; mais il existe une version beaucoup plus sombre du yakṣa, qui est une sorte d’ogre, de fantôme ou de démon anthropophage qui harcèle et dévore les voyageurs.
3. Ecole d’Andrah Pradesh

Un troisième type de bouddha influent s’est développé dans l’Andhra Pradesh, au sud de l’Inde, où des représentations aux proportions imposantes, au visage grave, sans sourire, sont vêtues de robes qui laissent également apparaître l’épaule droite.
Ces sites méridionaux ont servi d’inspiration artistique à la terre bouddhiste du Sri Lanka, à la pointe sud de l’Inde, et les moines sri-lankais s’y rendaient régulièrement. Un certain nombre de statues de ce style se sont également répandues dans toute l’Asie du Sud-Est.
4. Ecole Gupta

La période Gupta, du IVe au VIe siècle de notre ère, dans le nord de l’Inde, souvent qualifiée d’âge d’or, est supposée avoir synthétisé les deux courants. En réalité, en cherchant une image idéale, elle a sombré dans le maniérisme. Les bouddhas gupta ont les cheveux disposés en petites boucles individuelles et leur tunique arbore un réseau de cordelettes suggérant les plis des draperies (comme à Mathura).
Avec leurs yeux baissés et leur aura spirituelle, les bouddhas gupta deviendront le modèle des futures générations d’artistes, que ce soit dans l’Inde post-Gupta et Pala ou au Népal, en Thaïlande et en Indonésie.
Des statues métalliques gupta du Bouddha, emportées par les pèlerins, ont également été disséminées le long de la Route de la soie jusqu’en Chine.
Mais les Bouddhas du Gandhara sont uniques et vraiment à part. Ce sont de véritables individualités échappant à toute codification et aux normes. Ils ont été fabriqués par des artistes habités d’une spiritualité élevée, explorant de nouvelles frontières de la beauté, du mouvement et de la liberté, et non produisant des objets pour satisfaire un marché émergent.
Aujourd’hui, Pakistanais, Indiens, Afghans et Européens aiment à se quereller. Tous prétendent avoir été les principaux parrains et auteurs du « miracle de Gandhara », mais peu se demandent comment il s’est produit.
Dès le Ier siècle avant J.-C., les artistes locaux délaissent les matériaux périssables avec lesquels ils travaillaient, comme la brique, le bois, le chaume et le bambou, pour adopter la pierre. Le nouveau matériau utilisé était principalement une pierre de schiste allant du gris clair au gris foncé (dans la vallée de la rivière Kaboul et la région de Peshawar). Les périodes ultérieures se caractérisent par l’utilisation du stuc et de l’argile (spécialité de Hadda).
Les techniques utilisées pour les sculptures et les pièces de monnaie du Gandhara sont très proches de celles de la Grèce. Ont-elles été créées par des sculpteurs grecs itinérants ou par des artistes locaux qu’ils ont formés ? Rien n’a été prouvé, mais est-ce vraiment important ?
Lorsque l’Asie rencontre la Grèce
Examinons maintenant des expressions artistiques attestant la belle rencontre entre la culture hellénique et les cultures indiennes et locales.
A. Pièces de monnaie kouchanes

Tout en soutenant toutes les religions qu’il jugeait dignes, Kanishka ne cachait pas sa préférence pour le bouddhisme.
Une pièce d’or datant de 120 après J.-C. montre le roi vêtu d’un lourd manteau kouchan et de longues bottes, des flammes sortant de ses épaules, un étendard dans la main gauche et faisant un sacrifice sur un autel, avec cette légende en caractères grecs : « Roi des rois, Kanishka le Kouchan. » Le revers de la même pièce représente un bouddha debout, en costume grec, faisant de la main droite le geste « ne craignez rien » (abhaya mudra) et tenant un pli de sa robe dans la main gauche. La légende en caractères grecs se lit désormais ΒΟΔΔΟ (Boddo), pour Bouddha.
B. Reliquaire bimaran

Un véritable thème classique du répertoire de tout artiste de l’époque consiste à montrer Bouddha entouré, accueilli et protégé des divinités d’autres croyances et de religions plus anciennes. La plus ancienne représentation de ce type connue à ce jour figure sur un reliquaire trouvé dans le stupa de Bimaran, au nord-ouest du Gandhara.
Sur cette petite urne en or, généralement datée de 50-60 après J.-C., figure, à l’intérieur de niches voûtées d’architecture gréco-romaine, une représentation hellénistique du Bouddha (coiffure, contrapposto, himation d’élite, etc.), entourée des divinités indiennes Brahma et Sakra.
Tout comme Ashoka, Kanishka, presque laïque, entendait régner, non pas contre mais avec, et surtout au-dessus de toutes les religions. Ainsi, à l’occasion, les divinités grecques, représentées sur les pièces de monnaie (Zeus, Apollon, Héraclès, Athéna, etc.), côtoient les divinités du védisme, du zoroastrisme et du bouddhisme.
Autre exemple, à Ellora, au centre de l’Inde, la grotte et le temple taillés dans le roc où se côtoient les représentants des trois religions (bouddhisme, hindouisme et jaïnisme).
C. Triade de Hadda


Un autre exemple exquis de cet art gandharien est un groupe sculptural connu sous le nom de Triade de Hadda, excavé à Tapa Shotor, un grand monastère sarvastivadin près de Hadda en Afghanistan, datant du IIe siècle après J.-C.
Pour donner une idée de son activité, ce sont quelque 23 000 sculptures gréco-bouddhiques, en argile et en plâtre, qui ont été mises au jour rien qu’à Hadda, entre les années 1930 et 1970.
Le site, fortement endommagé lors des dernières guerres, possédait de belles statues, notamment un bouddha assis, vêtu d’une chlamyde grecque (manteau blanc), les cheveux bouclés, accompagné d’Héraclès et de Tyché (déesse grecque de la fortune et de la prospérité), vêtue d’un chiton (robe à la grecque) et tenant une corne d’abondance.

Seule adaptation aux traditions locales de l’iconographie grecque, Héraclès tient en main, non plus son habituelle massue, mais la foudre de Vajrapani (du sanskrit vajra, signifiant « foudre », et pani « en main »), l’une des trois premières divinités protectrices entourant le Bouddha.
C’est un bodhisattva. Il apparaît dès le IIe siècle dans l’iconographie mahāyāna comme doué d’une grande force et comme protecteur du Bouddha. Dans l’art gréco-bouddhique il ressemble à Héraclès ou Zeus, tenant en main une courte massue en forme de vajra, un foudre stylisé. On l’identifie au protecteur, « puissant comme un éléphant », qui aurait veillé sur Bouddha à sa naissance.
Une autre statue rappelle le portrait d’Alexandre le Grand.

De cet ensemble sculptural, il ne reste malheureusement que des photographies.
Selon l’archéologue afghan Zemaryalai Tarzi, le monastère de Tapa Shotor, avec ses sculptures en argile datées du IIe siècle de notre ère, représente le « chaînon manquant » entre l’art hellénistique de Bactriane et les sculptures en stuc plus tardives trouvées à Hadda, généralement datées du IIIe-IVe siècle de notre ère.
Traditionnellement, l’afflux d’artistes, maître de l’art hellénistique, a été attribué à la migration des populations grecques des villes gréco-bactriennes d’Aî-Khanoum et de Takht-I-Sangin (Nord de l’Afghanistan).

Tarzi suggère que les populations grecques se sont établies dans les plaines de Jalalabad, qui comprennent Hadda, autour de la ville hellénistique de Dionysopolis, et qu’elles sont à l’origine des créations bouddhistes de Tapa Shotor, au IIe siècle de notre ère.
Les colons grecs restés au Gandhara (les Yavanas) après le départ d’Alexandre, soit par choix, soit en tant que populations condamnées à l’exil par Athènes, ont grandement embelli les expressions artistiques de leur nouvelle spiritualité.
Offrant fraîcheur, poésie et un sens du mouvement spectaculairement moderne, les premiers artistes bouddhistes du Gandhara, saisissant des instants de « mouvement-changement » permettant à l’esprit humain d’appréhender un saut vers la perfection, sont une contribution inestimable à la culture de l’humanité tout entière. N’est-il pas temps de reconnaître ce magnifique travail ?
D. Prendre la terre à témoin

Parmi les autres types productions artistiques de Gandhara, ce magnifique bas-relief, aujourd’hui conservée au musée de Cleveland, illustre la lutte du Bouddha pour atteindre le nirvana.

Au centre de la composition se trouve l’arbre de la Bodhi, sous lequel le Bouddha atteignit l’illumination. Ce figuier sacré est vénéré depuis des temps ancestraux par les villageois locaux, car il passe pour être la résidence d’une divinité de la nature. L’autel lui-même est recouvert de kusha, herbe utilisée pour des offrandes sacrificielles.
Il y a environ 2500 ans, après être resté en méditation pendant 49 jours, assis sous cet arbre, le Bouddha est défié par des démons cauchemardesques qui remettent en cause l’authenticité de son illumination.
Leur chef Mara (littéralement, la mort), qui se tient à droite dans une posture arrogante, entouré de ses filles, fait tout pour empêcher Bouddha d’atteindre le nirvana (l’éveil).
Il le menace et encourage ses propres filles à le séduire. Innocemment, il lui demande s’il est sûr de pouvoir trouver quelqu’un pour témoigner qu’il a véritablement atteint le nirvana. En réponse à ce défi, le Bouddha touche alors la terre et la prend à témoin.
Selon la mythologie, la jeune déesse de la Terre surgit alors du sol et commença à essorer les eaux déferlant de ses cheveux pour noyer Mara. Sur la sculpture, on peut la voir, toute petite, au pied de l’autel, agenouillée devant Bouddha en signe de révérence. Elle a également pris forme humaine en sortant de terre. Les anciennes religions interviennent ici pour défendre et protéger la nouvelle, celle de Bouddha.
Semblant, eux aussi, regretter les anciens dieux et déesses de leur panthéon, les Indiens convertis au bouddhisme les ajoutent au-dessus de la tête de Bouddha ou à côté, comme, par exemple, le dieu védique Indra.
E. Tous bodhisattva ?

Enfin, pour conlure cette section sur la sculpture, deux mots sur le bodhisattva, figure très intéressante sortie de l’imaginaire bouddhiste pour rendre la spiritualité bouddhiste accessible au citoyen ordinaire.

Il peut s’agir soit d’une représentation de Bouddha en personnage princier orné de bijoux, avant son renoncement à la vie de palais, soit d’un humain ordinaire, déjà conscient qu’il est sur la voie de l’illumination et qu’il est devenu un outil au service du bien.
Animé d’altruisme et obéissant les disciplines destinées aux bodhisattvas, il doit aider par compassion d’abord les autres êtres sensibles à s’éveiller, y compris en retardant sa propre libération !
Les bodhisattvas se distinguent par de grandes qualités spirituelles telles que les « quatre demeures divines » que sont:

- l’amour bienveillant (maitri),
- la compassion (karuna),
- la joie empathique (mudita) et
- l’équanimité (upekṣa),
ainsi que les diverses perfections (paramitas), qui comprennent la prajnaparamita (« connaissance transcendante » ou « perfection de la sagesse ») et les moyens habiles (upaya).
Des bodhisattvas spirituellement avancés tels qu’Avalokiteshvara (ci-dessus), Maitreya et Manjushri, largement vénérés dans le monde bouddhiste mahâyâna, sont censés posséder un grand pouvoir, qu’ils utilisent pour aider tous les êtres vivants.
Pour certains courants bouddhistes, seul Maitreya mérite le titre de « Bouddha du futur ». Dans l’art on le représente à la fois comme un bouddha vêtu d’une robe monastique et comme un bodhisattva princier avant l’illumination.
Un magnifique bodhisattva de Gandhara peut être admiré au Dallas Museum of Art (ci-dessous).
Cette sculpture en terre cuite représente un « Bodhisattva pensant » de la région de Hadda en Afghanistan, une production typique du Gandhara.

Avec très peu d’éléments visuels, l’artiste réussit un travail gigantesque. Les piliers de sa large chaise sont des lions au regard un peu fou, représentation allégorique de ces passions qui nous font souffrir et qui sont maintenues sous un sage contrôle par l’effort hautement réflexif du Bodhisattva héroïque au centre de l’œuvre.
Le bouddhisme aujourd’hui, l’exemple de Nehru

Paradoxalement, le bouddhisme, en tant que religion, a presque cessé d’exister dans son propre berceau, l’Inde, depuis le XIIe siècle de notre ère.
Bel exemple de la lutte incessante des meilleurs esprits indiens pour l’émancipation, en 1956, près d’un demi-million « d’intouchables » se sont convertis au bouddhisme sous l’impulsion du dirigeant politique à la tête du comité chargé de rédiger la Constitution de l’Inde, le réformateur social B. R. Ambedkar (1891-1956), et du Premier ministre indien et chef du Parti du Congrès Jawaharlal Nehru (1889-1964), lui-même issu d’une famille de brahmanes.
En juin de la même année, le Courrier de l’UNESCO consacrait son édition à « 25 siècles d’art et de culture bouddhistes ».
En Inde, les deux hommes d’État ont orchestré une année de célébration en l’honneur de « 2500 ans de bouddhisme », non pas pour ressusciter une ancienne religion en soi, mais pour s’approprier le statut de berceau de cette vieille religion et renvoyer au monde une image de champion de la non-violence et du pacifisme.

Quelques années plus tard, lors de sa visite d’État à la Maison Blanche, le 9 novembre 1961, le Premier ministre indien Nehru offrit une sculpture bouddhiste au président John F. Kennedy
Comme beaucoup d’hindous, Mahatma Gandhi vénérait Bouddha. Pour lui, le bouddhisme n’était qu’une « autre forme d’hindouisme » et sa critique venait donc « de l’intérieur de l’hindouisme ».
Un point de vue que ne partageait pas le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru. Profondément troublé par certaines caractéristiques intrinsèques à l’hindouisme, telles que le ritualisme et les castes, Nehru ne pouvait pas placer le bouddhisme, qui abhorrait ces institutions, dans la même rubrique…
Nehru fut fortement influencé par le bouddhisme. C’est ainsi qu’il appela sa fille (la future Première ministre Indira Gandhi) Indira Priyadarshini, du nom de « Priyadarshi » adopté par le grand empereur Ashoka, après être devenu un prince bouddhiste de la paix !

Par ailleurs, Nehru contribua à faire de l’Ashoka Chakra (la Roue bouddhiste intégrée au drapeau national) le symbole de l’Inde. Chaque fois qu’il se rendait au Sri Lanka, il visitait la statue du Bouddha à Anuradhapura.
Le dirigeant indien, qui ne cessait d’exhorter les Indiens superstitieux et ritualistes à cultiver un « tempérament scientifique » et à faire entrer l’Inde dans l’ère de l’âge atomique, était naturellement attiré par le rationalisme prôné par le Bouddha.
« Bouddha ne demandait à personne de croire en quoi que ce soit d’autre que ce qui pouvait être prouvé par l’expérience et l’essai. Tout ce qu’il voulait, c’était que les hommes recherchent la vérité et n’acceptent rien sur la foi d’un autre homme, même s’il s’agissait du Bouddha lui-même. Il me semble que c’est là l’essence de son message », alléguait Nehru.
Et d’ajouter :
« Lui-même a eu le courage d’accepter la vérité et de ne rien accepter sur la foi d’un autre (…) Bouddha a eu le courage de s’attaquer à la religion populaire, à la superstition, au cérémonial et à la prêtrise, ainsi qu’à tous les intérêts qui s’y rattachent. Il a également condamné les perspectives métaphysiques et théologiques, les miracles, les révélations et les relations avec le surnaturel. Il fait appel à la logique, à la raison et à l’expérience ; il met l’accent sur l’éthique (…) Toute son approche est comme le souffle du vent frais des montagnes après l’air vicié de la spéculation métaphysique (…) Bouddha n’a pas attaqué directement les castes, mais dans son propre ordre, il ne les a pas reconnues, et il ne fait aucun doute que toute son attitude et son activité ont affaibli le système des castes. »
L’influence du Bouddha s’est manifestée dans la politique étrangère de Nehru. Cette politique était motivée par un désir de paix, d’harmonie internationale et de respect mutuel. Elle visait à résoudre les conflits par des méthodes pacifiques. Le 28 novembre 1956, Nehru déclare :
« C’est essentiellement grâce au message du Bouddha que nous pouvons envisager nos problèmes dans la bonne perspective et nous éloigner des conflits et de la concurrence dans le domaine des conflits, de la violence et de la haine. »
Visiblement inspirés par les préceptes bouddhistes, les concepts de non-alignement et le Traité de Panchsheel de Nehru, communément appelé « Traité des cinq principes de coexistence pacifique », ont été formellement énoncés pour la première fois dans l’Accord sur le commerce et les relations entre le Tibet chinois et l’Inde, signé le 29 avril 1954.
Cet accord stipulait, dans son préambule, que les deux gouvernements,
« ont décidé de conclure le présent accord sur la base des principes suivants :
1) respect mutuel de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’autre,
2) non-agression mutuelle,
3) non-ingérence mutuelle,
4) égalité et avantage mutuel,
5) coexistence pacifique. »
Le 29 novembre 1952, lors de la Conférence culturelle bouddhiste internationale à Sanchi, où Kanitscha avait entamé la construction du plus haut stupa de l’Antiquité, Nehru précisait :
« Le message que Bouddha a transmis il y a 2500 ans a éclairé non seulement l’Inde et l’Asie, mais le monde entier. La question qui se pose inévitablement est la suivante : le grand message du Bouddha peut-il s’appliquer au monde d’aujourd’hui ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je sais que si nous suivons les principes énoncés par le Bouddha, nous gagnerons la paix et la tranquillité pour le monde. »
Le 3 octobre 1960, Nehru s’adressait à l’Assemblée générale des Nations unies :
« Dans un passé lointain, un grand fils de l’Inde, le Bouddha, a dit que la seule vraie victoire était celle où tous étaient également victorieux et où personne n’était vaincu. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est la seule victoire concrète ; toute autre voie mène au désastre. »
Nehru a fait de son mieux pour appliquer les enseignements du Bouddha dans la gestion des affaires intérieures de l’Inde. Sa conviction que le changement social ne peut être obtenu que par le consensus social le plus large découle de l’influence du Bouddha, d’Ashoka et de Gandhi.
Dans son discours du 15 août 1956 à l’occasion de la fête de l’indépendance, Nehru fixe les défis à relever :
« Nous sommes fiers que le sol sur lequel nous sommes nés ait produit de grandes âmes comme le Bouddha Gautama et Gandhi. Rafraîchissons-nous la mémoire une fois de plus et rendons hommage à Gautama Bouddha et à Gandhi, ainsi qu’aux grandes âmes qui, comme eux, ont façonné ce pays. Suivons la voie qu’ils nous ont montrée avec force, détermination et coopération. »
Science et religion, Albert Einstein et Bouddha
Pour conclure, je vous invite à méditer quelques citations d’Albert Einstein discutant les rapports entre la science et la religion où il évoque l’importance de Bouddha :
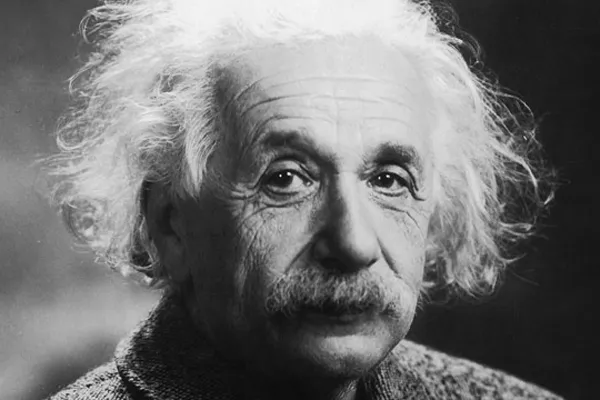
Le sentiment religieux cosmique
« Il existe un troisième état d’expérience religieuse… que j’appellerai le sentiment religieux cosmique. Il est très difficile d’expliquer ce sentiment à quelqu’un qui en est totalement dépourvu, d’autant plus qu’il n’y a pas de conception anthropomorphique de Dieu qui lui corresponde. L’individu ressent le néant des désirs et des objectifs humains, ainsi que la sublimité et l’ordre merveilleux qui se révèlent tant dans la nature que dans le monde de la pensée. Il considère l’existence individuelle comme une sorte de prison et veut faire l’expérience de l’univers comme un tout unique et significatif. Les prémices d’un sentiment religieux cosmique apparaissent déjà à un stade précoce du développement, par exemple dans de nombreux Psaumes de David et dans certains Prophètes.
Le bouddhisme, comme nous l’ont appris les merveilleux écrits de Schopenhauer en particulier, en contient un élément beaucoup plus fort. Les génies religieux de tous les temps se sont distingués par ce type de sentiment religieux, qui ne connaît ni dogme, ni Dieu conçu à l’image de l’homme, de sorte qu’il ne peut y avoir d’Église dont l’enseignement central se fonde sur lui.
C’est donc précisément parmi les hérétiques de toutes les époques que l’on trouve des hommes animés du sentiment religieux le plus élevé et qui, dans bien des cas, étaient considérés par leurs contemporains comme des athées, parfois même comme des saints. Vu sous cet angle, des hommes comme Démocrite, François d’Assise et Spinoza sont très proches les uns des autres. Comment le sentiment religieux cosmique peut-il se transmettre d’une personne à l’autre, s’il ne peut donner lieu à aucune notion précise de Dieu et à aucune théologie ? À mon avis, c’est la fonction la plus importante de l’art et de la science que d’éveiller ce sentiment et de le maintenir en vie chez ceux qui en sont capables ».
—Einstein, Albert. Le monde tel que je le vois. (Secaucus, NJ : Carol Publishing Group, 1999). p. 26.
Libéré des entraves et de ses désirs égoïstes
« Une personne religieusement éclairée me semble être celle qui, au mieux de ses capacités, s’est libérée des entraves de ses désirs égoïstes et se préoccupe de pensées, de sentiments et d’aspirations auxquels elle s’accroche en raison de leur valeur supra-personnelle. Il me semble que ce qui est important, c’est la force de ce contenu supra-personnel et la profondeur de la conviction concernant son sens impérieux, indépendamment de toute tentative d’unir ce contenu à un Être divin, car sinon il ne serait pas possible de considérer Bouddha et Spinoza comme des personnalités religieuses.
Par conséquent, une personne religieuse est pieuse dans le sens où elle ne doute pas de la signification et de la hauteur de ces objets et objectifs supra-personnels qui ne nécessitent ni ne peuvent être fondés rationnellement. Ils existent avec la même nécessité et la même évidence que lui. En ce sens, la religion est l’effort séculaire de l’humanité pour devenir clairement et complètement consciente de ces valeurs et de ces objectifs et pour renforcer et étendre constamment leur effet.«
—Einstein, Albert. Einstein, Science, Philosophy and Religion, A Symposium, publié par la Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc, New York, 1941.
Bouddha, Moïse et Jésus
« Ce que l’humanité doit à des personnalités comme Bouddha, Moïse et Jésus est pour moi plus important que toutes les réalisations de l’esprit curieux et constructif. Ce que ces hommes bénis nous ont donné, nous devons le garder et essayer de le maintenir en vie de toutes nos forces si l’humanité ne veut pas perdre sa dignité, la sécurité de son existence et sa joie de vivre ».
—Einstein, Albert. Déclaration écrite (septembre 1937), p. 70
Commencer par le coeur de l’homme
« Si nous voulons améliorer le monde, nous ne pouvons pas le faire avec des connaissances scientifiques, mais avec des idéaux. Confucius, Bouddha, Jésus et Gandhi ont fait plus pour l’humanité que la science. Nous devons commencer par le cœur de l’homme, par sa conscience, et les valeurs de la conscience ne peuvent se manifester que par un service désintéressé à l’humanité ».
—Einstein, Albert. Einstein et le poète (1983), p. 92
L’illusion optique de la conscience
L’un des échanges les plus poignants de son rôle de philosophe a eu lieu alors qu’il avait 70 ans et vivait à Princeton. Un rabbin ordonné lui avait écrit pour lui dire qu’il avait cherché en vain à réconforter sa fille de 19 ans après la mort de sa sœur, « une belle enfant de 16 ans, sans péché ».
L’être humain », écrit Einstein en réponse, « est une partie du tout, que nous appelons « Univers », une partie limitée dans le temps et l’espace. Il fait l’expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste – une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l’affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion à toutes les créatures vivantes et à toute la nature dans sa beauté. Personne n’est en mesure d’y parvenir complètement, mais le fait de s’efforcer d’y parvenir est en soi une partie de la libération et un fondement de la sécurité intérieure ».
— Walter Sullivan, “The Einstein Papers: A Man of Many Parts,” New York Times, 29 mars 1972.
NOTES :
*1. Les langues indo-aryennes. Il existe plus de 200 langues indo-aryennes connues, parlées par environ 1 milliard de personnes. Leurs formes modernes descendent des langues indo-aryennes anciennes, telles que le sanskrit védique primitif, en passant par les langues indo-aryennes moyennes (ou prakrits). Les langues indo-aryennes les plus importantes en termes de premiers locuteurs sont l’hindi-ourdou (c. 330 millions), le bengali (242 millions), le pendjabi (environ 120 millions), le marathi (112 millions), le gujarati (60 millions), le rajasthani (58 millions), le bhojpuri (51 millions), l’odia (35 millions), le maithili (environ 34 millions), le sindhi (25 millions), le népali (16 millions), l’assamais (15 millions), le chhattisgarhi (18 millions), le cinghalais (17 millions) et le romani (environ 3,5 millions). Le sud de l’Inde compte des langues dravidiennes (telugu, tamil, kannada et malayalam). En Europe, les principales langues indo-européennes sont l’anglais, le français, le portugais, le russe, le néerlandais et l’espagnol.
*2. Discords. Dès le IIIe siècle avant J.-C., pas moins de dix-huit écoles bouddhistes distinctes sont à l’œuvre en Inde, mais toutes se reconnaissent mutuellement comme des adeptes de la philosophie du Bouddha. Enfin, le bouddhisme du Véhicule du Diamant, dit Vajrayâna, dont les textes et les rituels complexes ont été élaborés dans les universités du nord-est de l’Inde vers le VIIe et VIIIe siècles.
*3. Le prâkrit est un terme qui désigne une langue indo-aryenne dérivée du sanskrit classique. Le mot lui-même a une définition assez souple, car il a parfois le sens de « originel, naturel, sans artifices, normal, ordinaire, usuel, ou encore, local », contrastant ainsi avec la forme littéraire et religieuse du sanskrit ; mais parfois, on peut aussi comprendre prâkrit comme signifiant « dérivé d’une langue originelle », c’est-à-dire dérivé du sanskrit. On peut donc dire que le prâkrit, comme toute langue vulgaire et vernaculaire de l’Inde, est issu du sanskrit. En fait, on peut comparer les prâkrits au latin vulgaire, tandis que le sanskrit serait le latin classique. L’usage le plus ancien que l’on connaisse du prâkrit est formé par l’ensemble d’inscriptions de l’empereur indien Ashoka (IIIe siècle av. J.-C.). L’un des prâkrits les plus célèbres est le pâli, qui a accédé au statut de langue littéraire et intellectuelle en devenant celle des textes du bouddhisme theravâda.
*4. Le pâli est une langue indo-européenne de la famille indo-aryenne. C’est un prâkrit moyen indien proche du sanskrit et remontant vraisemblablement au IIIe siècle av. J.-C. Le pâḷi est utilisé comme langue liturgique bouddhiste au Sri Lanka, en Birmanie, au Laos, en Thaïlande et au Cambodge. Son statut de langue liturgique l’a rendu, à l’instar du sanskrit, figé et normalisé.
*5. Hippodamos de Milet (né en 498 av. J.-C. et mort en 408 av. J.-C.) est un géomètre et ingénieur du Ve siècle av. J.-C., qui fut aussi architecte urbaniste, physicien, mathématicien, météorologiste et philosophe pythagoricien. La tradition a retenu de lui ses grands travaux de planification urbaine. Bien que ces travaux se caractérisent par l’utilisation systématique du plan en damier, il n’en est pas l’inventeur, de très anciennes colonies grecques nous fournissant déjà des exemples de cette structure urbaine.
Commentaires:
8 mars 2024, Bernard C.
Je continue la lecture du long texte illustré sur le « miracle du Gandhara ». Décidemment, tu as toujours l’art –et ce n’est pas un vain mot chez toi ! – de nous surprendre ! Quel bonheur ce doit être ! Merci Karel. Belle soirée à vous.
8 mars 2024, Bernard C., suite
J’espère qu’on reconnaitra un jour (ou l’autre) la beauté de ce travail (artkarel) dans son envergure, car tu ne cesses de nous renvoyer au moyen d’hyperliens (mots en bleu), à travers les âges, d’un bout à l’autre des continents, d’Ashoka à Sully – de véritables efforts intercontinentaux échafaudent, à grands traits pour ne pas dire à grandes enjambées, devant nos yeux surpris (encore une fois, c’est le mot!), une œuvre d’art illustrant qu’il n’est de richesse que d’hommes, et où se meuvent, d’un bord à l’autre de l’histoire de la civilisation, correspondances d’idées majeures qu’on aurait pu croire isolément réservées à leurs temps. Chapeau !
Afghanistan: Qosh Tepa canal and prospects of Aral Sea basin water management


Presentation of Karel Vereycken at the second panel discussion of the « Water for Peace » seminar organized by the Schiller Institute on January 9, 2024 in Paris.
Let’s start with current events. In August 2021, faced with the Taliban takeover, the United States hastily withdrew from Afghanistan, one of the world’s poorest countries, whose population has doubled in 20 years to 39.5 million.
While the UN acknowledged that the country was facing « the worst humanitarian crisis » in the post-war era, overnight all international aid, which represented more than half of the Afghan budget, was suspended. At the same time, $9.5 billion of the country’s central bank assets, held in accounts at the US Federal Reserve and a number of European banks, were frozen.
Qosh Tepa canal
Despite these dramatic conditions, the Afghan government, via its state construction group, the National Development Company (NDC), committed $684 million to a major river infrastructure project, the Qosh Tepa Canal, which had been suspended since the Soviet invasion.
In less than a week, over 7,000 drivers flocked from the four corners of the country to work day and night on the first section of the canal, the first phase of which was completed in record time.

Politically, the canal project is a clear expression of the re-birth of an inclusive Afghanistan, as the region is mainly inhabited by Turkmen and Tajik populations, whereas the government is exclusively in the hands of the Pashtuns. The latter represent 57% rather than 37% of the country.
According to the FAO, 62.5% of the Abu Darya’s water comes from Tajikistan, 27.5% from Afghanistan (22 million m3), 6.3% from Uzbekistan, 1.9% from Kyrgyzstan and 1.9% from Turkmenistan.

The river irrigates 469,000 ha of farmland in Tajikistan, 2,000,000 ha in Turkmenistan and 2,321,000 ha in Uzbekistan.
So it’s only natural that Afghanistan should harness some of the river’s waters (10 million m³ out of a total of 61.5 to 80 million m³ per year) to irrigate its territory and boost its ailing agricultural production

By harnessing part of the waters of the Amu Daria river, the new 285 km-long canal will eventually irrigate 550,000 ha of arid land in ancient Bactria to the north, the « Land of a 1000 Cities » and« The Land of Oases » whose incomparable fertility was already praised by the 1st-century Greek historian Strabo.
In October 2023, the first 108 km section was impounded.
Agricultural production has been kick-started to consolidate the riverbanks, and 250,000 jobs are being created.
While opium poppy cultivation has been virtually eradicated in the Helmhand, the aim is to double the country’s wheat production and to become a grain net exporter.
Today, whatever one may think of the regime, the Afghans, who for 40 years have been self-destructing in proxy wars in the service of the Soviets and Americans, have decided to take their destiny into their own hands. Putting an end to the systemic corruption that has enriched an international oligarchy, they are determined to build their country and give their children a future, notably by making water available for irrigation, for health and for the inhabitants.
How did the world react?
On November 7, in The Guardian, Daanish Mustafa, a professor of « critical geography », explains that Pakistan must rid itself of the colonial spirit of water.
In his view, the floods that hit Pakistan in 2010 and 2022 demonstrate that « colonial » river and canal development is a recipe for disaster. It’s time, he concludes, to « decolonize » our imaginations on the subject of water by abandoning all our vanitous desires to manage water.
On November 9, the Khaama Press News agency reported:

« Tensions have risen between the de facto authorities of Afghanistan and Pakistan due to the ongoing deportation of Afghan migrants. Most recently, Pakistan has called for a halt to the Qush Tepa project. Abdul Haq Hamad, former head of media publications supervision, said in a televised debate that the Pakistani authorities had made it explicitly known at an official meeting with Taliban administration leaders that they must ‘stop operations on the Qush Tepa channel’.
« According to him, the Pakistani authorities are not satisfied with the completion of the Qosh Tepa Canal, as Afghanistan gains autonomy through this canal in managing its waters. »

Two days earlier, on November 7, Cédric Gras, Le Figaro‘s correspondent in Tashkent, published an article entitled:
« En Afghanistan, les Talibans creusent le canal de la discorde » (« In Afghanistan, the Taliban are digging the canal of discord »):
« The Afghanistan of the Taliban is in the process of digging a gigantic irrigation canal upstream from the Amou-Daria river. To the detriment of downstream countries and the Aral Sea, whose water supply and agricultural crops are threatened ».
Obviously, the aim is to create scare. But if the accusation is hasty, it touches on a fundamental issue that deserves explanation.
Endoreic basin

The Amu Daria, the 2539 km long river that the Greeks called the Oxus, and its brother, the 2212 km long Syr Daria, feed, or rather used to feed, the Aral Sea, which straddles the border between Uzbekistan and Kazakhstan. The water of both rivers were increasingly redirected by soviet experts to irrigate mainly cotton cultivation causing the Aral Sea to disappear.
I won’t go into detail here on the history of the ecological disaster that everyone has heard about but I am ready to answer your questions on that later;

The « Aral Sea Basin » essentially covers five Central Asian « stan » countries. To the North, these are Kazakhstan, followed by Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan.
In fact, Afghanistan, whose border with the latter three countries is formed by sections of the Amu Darya, is geologically and geographically part of the « Aral Sea Basin ».
This is a so-called « endoreic basin ». (endo = inside; rhein = carried).
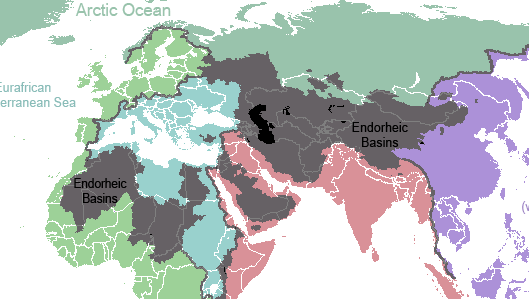

In Europe, we see falling rain and snowmelt flowing into rivers that discharge it into the sea. Not so in Central Asia. Rainwater, or water from melting snow, flows down mountain ranges. They eventually form rivers that either disappear under the sands, or form « inland seas » having no connection whatever to a larger sea and no outlet to the oceans. 18% of the world’s emerged surface is endoreic.
Among the best-known endoreic basins are the Dead Sea in Israel and Lake Chad in Africa.

In Asia, there are plenty of them. Just think of the Tarim Basin, the world’s largest endoreic river basin in Qinjiang, covering over 400,000 km². Then there’s the vast Caspian Sea, the Balkhach and Alakoll lakes in Kazakhstan, the Yssyk Kul in Kyrgyzstan and, as we’ve just said, the Aral Sea.
The very nature of an endoreic basin strongly reinforces the fear that water is a scarce limited source. That realty can either bolster the conviction that problems cannot but be solved true cooperation and discussion, or push countries to go to war one against the other. Democraphic growth, economic progress and climate/meteorogical chaos can worsen that perception and make water issues appear as a « time-bomb ».
The early Soviet planners started with a strict quota system laid down in 1987 by Protocol 566 of the Scientific and Technical Council of the Soviet Ministry of Water Resources. The system fixed quotas for all countries, both in percentage and in BCM (Billions of Cubic Meters).
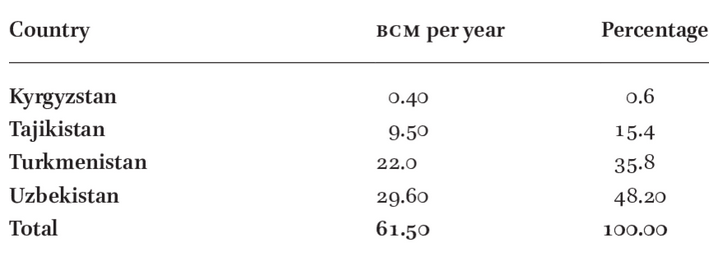
That simple quota system looks 100 % functional on paper. However, nations are not abstractions.
First, this system created quite rigid procedures and even would forbid some upstream countries to invest in their own agriculture since they had to deliver the water to their neighbors.
Second, conflict arose about dissymetric seasonal use of the water. The use of the water was completely different between « Upstream countries » such as Kyrgyzstan and Tajikistan and « Downstream countries » such as Uzbekistan and Turkmenistan.
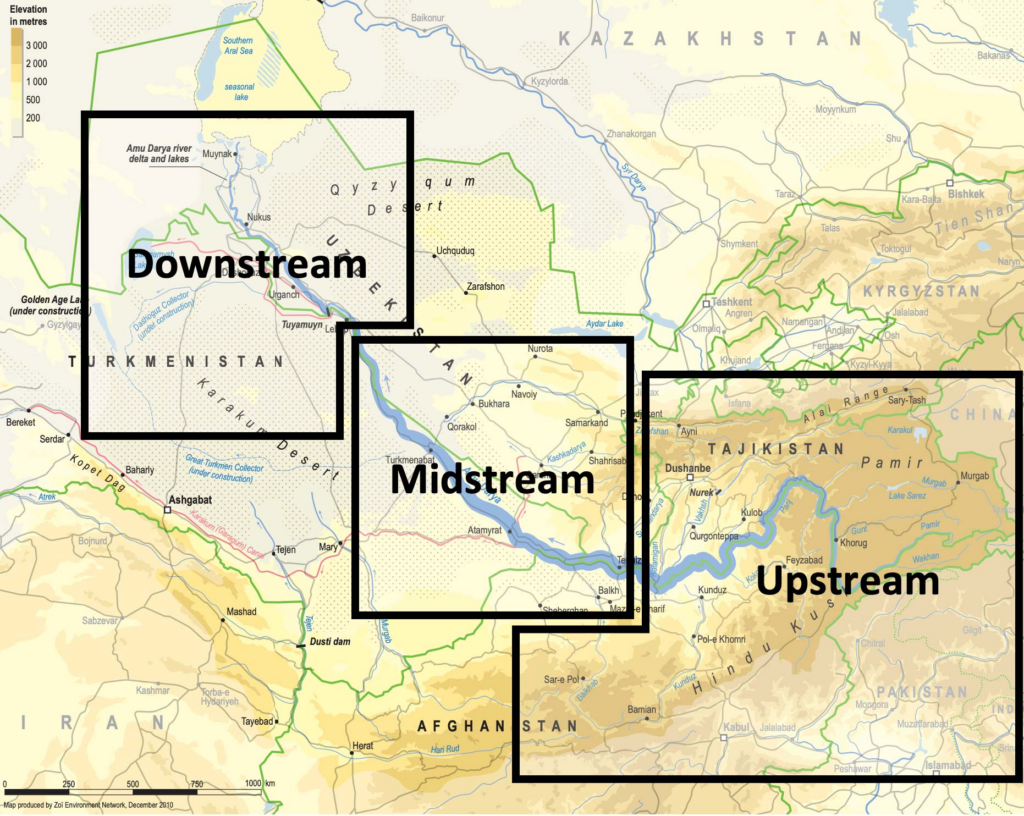
Upstream countries could accept releasing their water resources in autumn and winter since the release of the water provides them up to 90 % of their electricity via hydrodams.
Downstream countries however don’t need the water at that time but in spring and summer when their farmland needs to be irrigated.
However, in Central Asia, their seems to exist some sort of « geological justice » since downstream countries lacking water (Kazakhstan, Uzbekhistan and Turkmenistan) have vast hydrocarbon energy reserves such as coal, oil and gaz.
Therefore, not always stupid, Soviet planners, which realized that a simple quota system was insufficient to prevent conflict, created a compensation mechanism. Downstream nations, in exchange for water, would supply parts of their oil and gas to upstream nations to compensate the loss of potential energy that water represents.
However imperfect that mechanism, for want of a better one, it remained in place after the collapse of the Soviet Union in 1991.
It can be said that by appealing to an external factor of a given problem, in this case to bring energy in the equation to solve the water problem, soviet planners conceived in a rudimentary form what became known as the « Water, Energy, Food Nexus ». One cannot deal with theses factors as separate factors. They have to be conceived as part of a single, dynamic Monad.
Today, we should avoid the geopolitical trap. If we consider the water resources to be shared between the states of Central Asia and Afghanistan to be « limited », or even « declining » due to meteorological phenomena such as El Nino, we might hastily and geopolitically conclude that, with the construction of the Qosh Tepa canal, which will tap water from the Amu Daria, the « water time bomb » cannot but explode.
Solutions
So we need to be creative. We don’t have all the solutions but some ideas about where to find them:
- In Central Asia, especially in Turkmenistan but also Uzbekistan, huge quantities of water from the Abu Daria water basin are wasted. In 2021, Chinese researchers, looking at Central Asia’s potential in terms of food production, estimated that with improvements in irrigation, better seeds and other « agricultural technology », 56 % of the water can be saved farming the same crops, meaning that today, about half of the water is simply wasted.
- The lack of investment into new water infrastructure and maintenance cannot but lead to the kind of disasters the world has seen in Libya or Pakistan where, predictably, systems collapsed for lack of mere maintenance;
- Uncontrolled and controlled flooding are very primitive and inefficient forms of irrigation and should be outphased and replaced by modern irrigation techniques;
- Therefore, a water emergency should be declared and a vast international effort should assist all the countries of the Abu Daria basin, including Afghanistan, to modernize and improve the efficiency of their water infrastructure, be it lakes, canals, rivers and irrigation systems.
- Such and effort can best organized within the framework of the « One Belt, One Road » initiative and the Shanghai Cooperation Organization. BRICS countries such as China, Russia and India could help Afghanistan with data from their satellites and space programs.
- By improving the efficiency of water use, notably through targeted irrigation using « drip irrigation » as seen in the case of the Tarim basin in Xinjiang, it is possible to reduce the total amount of water used to obtain an even higher yield of agriculture production, while considerably increasing the availability of the water to be shared among neighbors. The know how and experience of African, South American, Israeli and Chinese agronomists, specialized in food production in arid countries, can play a key role.
- In the near future, Pumped Hydro Energy Storage (PHES), which means storing water in high altitude reservoirs for a later use, can massively increase the independance and autonomy of countries such as Afghanistan and others. Having sufficient water at hand at any time means also having the water security required to operate mining activities and handle thermal and nuclear electricity production units. PHES infrastructure would be greatly efficient on both sides of the Abu Daria and jointly operated among friendly nations.
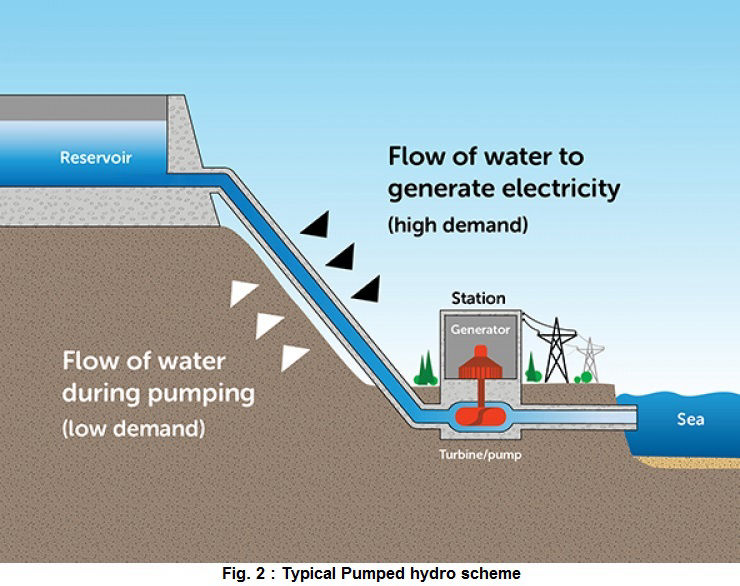
Over the past 1,200 years, nations bordering waterways have concluded 3,600 treaties on the sharing of river usufructs, whether for fishing, river transport or the sharing of water for domestic, agricultural and industrial uses.
Afghanistan’s Qosh Tepa canal project is a laudable and legitimate initiative. But it is true that by breaking the status quo, it obliges a new dialogue among nations allowing each and all of them to rise to a higher level, a willing to live together increasingly the opposite to the dominant paradigm in the Anglosphere and its european followers.
It’s up to all of us to make sure it works out fine.
Afghanistan : « Le pays des 1000 cités d’or » et l’histoire d’Aï Khanoum



Invité par le Centre de recherche et de développement Ibn-e-Sina en tant que représentant de l’Institut Schiller, Karel Vereycken est intervenu le 7 novembre à la conférence sur la reconstruction du pays.
Son propos introductif, devant un groupe de travail composé d’historiens, d’archéologues et de membres de l’Académie des sciences d’Afghanistan, a donné lieu à une longue après-midi d’échanges sur le rôle de l’art, la méthodologie scientifique et les combats à mener pour sortir l’Afghanistan de son isolement et préserver un héritage culturel qui certes est afghan, mais appartient à toute l’humanité.
Parler de la culture d’un pays étranger est toujours une chose difficile, surtout si l’on n’en connaît pas la langue et si l’on n’a pas pu séjourner et voyager dans le pays pendant de longues périodes. Par conséquent, je ne peux que vous offrir mes impressions de l’extérieur et commenter ce que j’ai découvert dans des livres. Vous allez donc m’aider en me corrigeant et en me signalant ce qui a échappé à mon attention.
L’Afghanistan est un pays fascinant. Sa réputation de « tombeau des Empires » a capté mon imagination. Récemment, votre pays s’est émancipé de l’occupation américaine et de l’OTAN. Une poignée de combattants déterminés a mis en déroute un immense empire déjà en train de s’autodétruire. 34 ans plus tôt, le pays avait chassé l’occupant russe, après avoir résisté à l’Empire britannique au cours des trois guerres anglo-afghanes du XIXe siècle (1839-42, 1878-80 et 1919), alors que Londres, engagé dans le « Grand Jeu » (Great Game), tentait d’empêcher la Russie d’accéder aux mers chaudes.
Pour éviter d’être colonisé à la fois par la Russie et la Grande-Bretagne, l’Afghanistan a même courageusement refusé d’avoir des chemins de fer, ce qui explique qu’il n’existe aujourd’hui que 300 km de voies ferrées, une situation bien sûr inacceptable aujourd’hui.
Cette capacité de résistance et ce sentiment de dignité découlent, j’en suis convaincu, du fait que votre pays a su faire siennes les diverses influences qui s’y sont rencontrées. Voilà ce qui est devenu au fil des siècles le socle d’une forte identité afghane, totalement à l’opposé de l’étiquette tribale que les colonisateurs cherchent à lui coller.
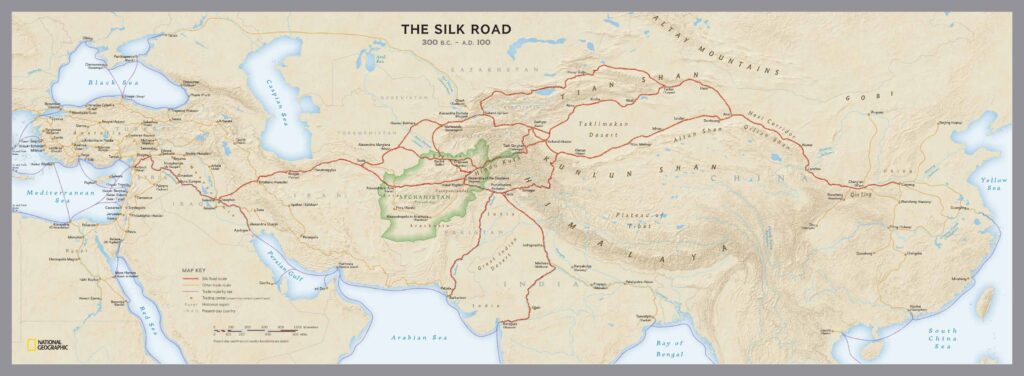
J’aborderai uniquement, aujourd’hui, l’influence grecque, qui s’est avérée majeure à partir du moment où Alexandre le Grand traverse le Hindou Kouch, en 329 av. JC.
Dès lors, des dizaines de milliers de colons grecs, appelés Ioniens, s’installent en Asie centrale.
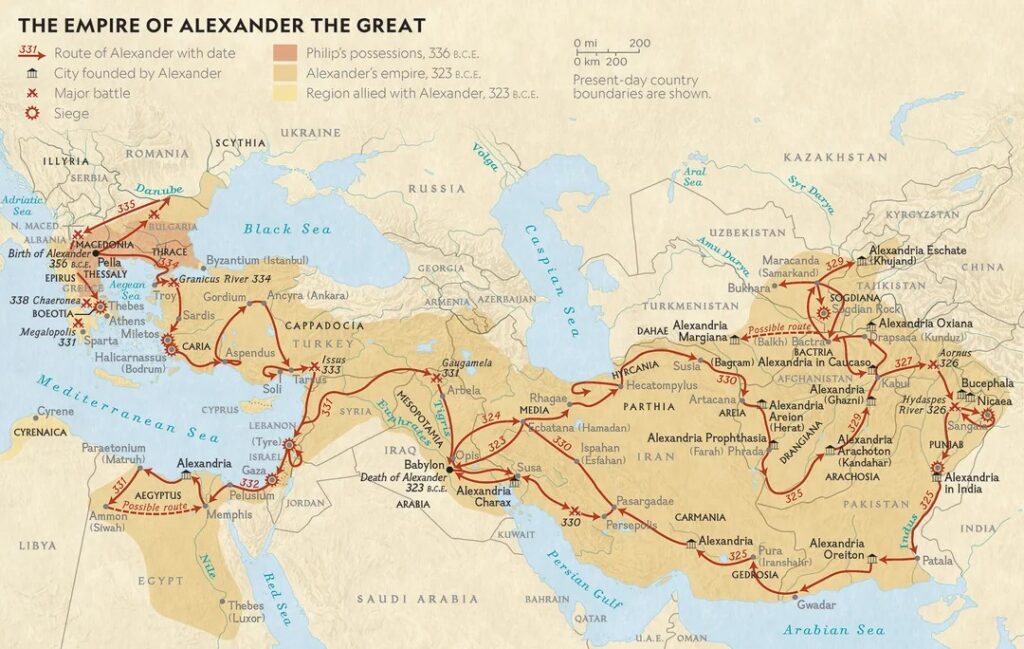
Sous le règne de ses successeurs concurrents, l’immense empire d’Alexandre le Grand se décompose en plusieurs entités et royaumes.
En 256 av. JC, Diodote Ier Soter fonde en Afghanistan le royaume gréco-bactrien, connu sous le nom de « Bactriane », dont le territoire englobe une grande partie de l’Afghanistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan actuels, ainsi que certaines parties de l’Iran et du Pakistan. L’influence grecque y perdure au moins jusqu’à l’arrivée de l’Islam au VIIIe siècle.
La Bactriane

De nombreuses fouilles archéologiques confirment un développement urbain, économique, social et culturel remarquable.
Strabon (64 av. JC – 24 après JC), comme d’autres historiens grecs, qualifiait déjà la Bactriane de « Terre des mille cités », une terre que tous les écrivains, anciens et modernes, louaient pour la douceur de son climat et sa fertilité, car « la Bactriane produit tout, sauf de l’huile d’olive. »
Pour le naturaliste romain Pline l’Ancien (23 – 79 après JC), en Bactriane,
« les grains de blé poussent si gros qu’un seul grain est aussi gros que nos épis. »
Sa capitale Bactres (aujourd’hui Balkh, proche de Mazâr-e Charîf au nord de l’Afghanistan), « Mère des cités », figure parmi les villes les plus riches de l’Antiquité.


C’est là qu’Alexandre le Grand épouse Roxana (« Petite étoile ») et adopte l’habit perse pour pacifier son Empire. C’est également là que naîtra le père du grand médecin et philosophe Ibn Sina (Avicenne), avant de s’installer à Boukhara (Ouzbékistan).
Au fil du temps, la Bactriane sera le creuset de cultures et de civilisations où se mêlent, sur le plan artistique, architectural et religieux, traditions grecques et cultures locales.
Si le grec y est la langue de l’administration, les langues locales y foisonnent. Rien que les noms des villes démontrent la prédominance de la culture hellénique.
Ainsi, Ghazni s’appelle « Alexandrie en Opiana », Bagram « Alexandrie au Caucase », Kandahar « Alexandrie Arachosia », Hérat « Alexandria Ariana », etc., et la liste ne s’arrête pas là.

La ville de Gonur Depe (actuellement au Turkménistan, au nord de Mary, l’ancienne Merv), capitale du Royaume de Margiane, est un autre exemple de ce qu’on s’accorde maintenant à appeler la « Culture de l’Oxus »)
Aï Khanoum, la grecque

Si certaines villes ne font que changer de nom, d’autres sont construites ex nihilo. C’est le cas d’Aï Khanoum (« Dame Lune » en ouzbek), cité érigée au confluent du grand fleuve Amou Daria (l’Oxus des Grecs) et de la rivière Kokcha.
En 1961, le roi d’Afghanistan (Mohammed Zahir Shah), voulant marquer son indépendance vis-à-vis des Soviétiques et des Américains, invite la France à participer aux fouilles.
C’est le Département des archéologues français en Afghanistan (DAFA) qui met au jour les vestiges d’un immense palais dans la ville basse, ainsi qu’un grand gymnase, un théâtre pouvant accueillir 6000 spectateurs, un arsenal et deux sanctuaires.
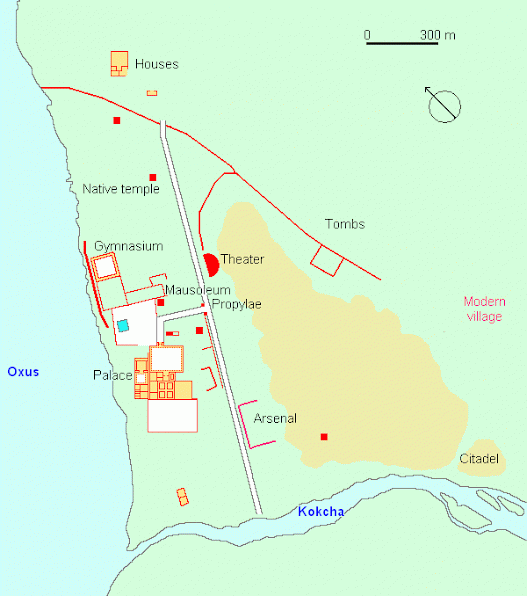
Entourée de terres agricoles bien irriguées, la ville elle-même était divisée entre une ville basse et une acropole de 60 mètres de haut.
Bien qu’elle n’est pas située sur une route commerciale majeure, Aï Khanoum commande l’accès aux mines du Hindou Koush. De vastes fortifications, continuellement entretenues et améliorées, entourent la ville.
Un monument au cœur de la ville y présente une stèle inscrite en grec avec une longue liste de maximes incarnant les idéaux de la vie grecque. Celles-ci sont copiées de Delphes et se terminent par :
« Dès l’enfance, apprends les bonnes manières ;
dans la jeunesse, maîtrise tes passions ;
dans la vieillesse, sois de bon conseil ;
dans la mort, n’aie aucun regret. »
L’architecture du site indique que les colons grecques y vivent en bonne entente avec les populations locales. Elle est très grecque mais intègre en même temps diverses influences artistiques et éléments culturels que les Ioniens ont pu observer au cours de leur voyage du bassin méditerranéen à l’Asie centrale. Par exemple, ils utilisent les styles néo-babylonien et achéménide pour la construction de leurs cours.
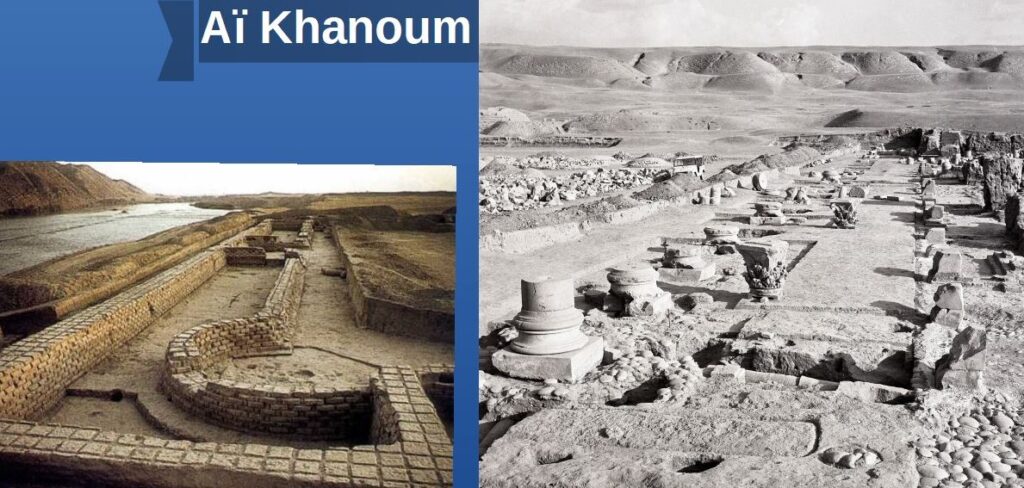
Shortugai et la Civilisation de la vallée de l’Indus

La date précise des premières fondations d’Aï Khanoum reste inconnue.
A une jetée de là, Shortugai, avant-poste commercial et minier de la fameuse civilisation de l’Indus (dite « harappéenne ») qui, au IIIe millénaire avant notre ère, était à l’avant-garde sur le plan de l’irrigation et de la maîtrise de l’eau. (voir notre article)
Des scientifiques de l’Institut indien de technologie de Kharagpur et du Service archéologique d’Inde ont publié le 25 mai 2016, dans la revue Nature, les fruits d’une recherche qui permettrait de dater la civilisation harappéenne d’au moins 8000 ans avant JC et non 5500 ans, comme on le croyait jusqu’à présent. Cette découverte majeure signifierait qu’elle serait encore plus ancienne que les civilisations mésopotamienne et égyptienne.
Shortugai est construite avec des briques standardisées typiques de la vallée de l’Indus. Des sceaux de la civilisation de la vallée de l’Indus ont également été trouvés sur d’autres sites archéologiques d’Afghanistan.
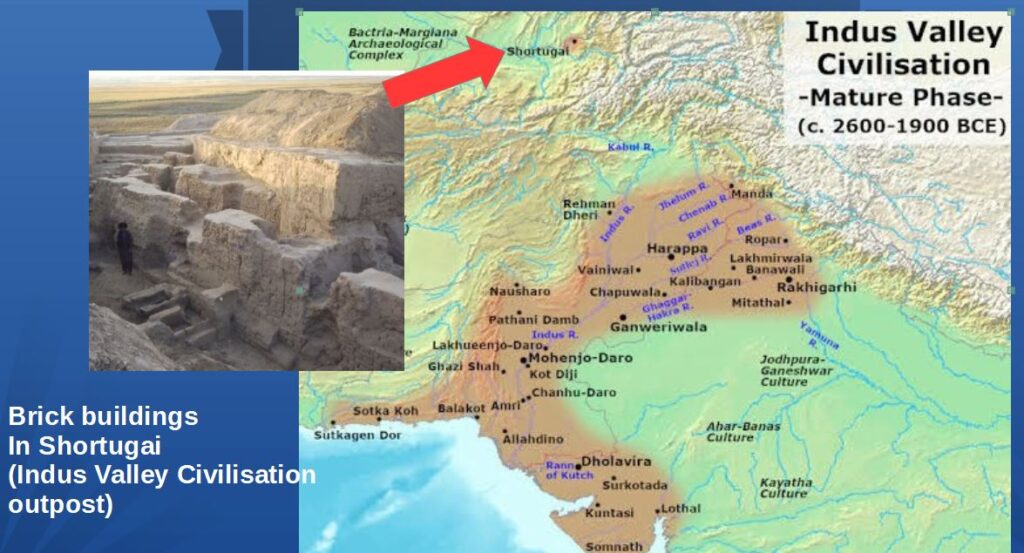
Pendant plusieurs siècles, Shortugai a fonctionné comme un site minier exceptionnel pour l’extraction de l’étain (un minerai indispensable pour la fabrication du bronze), de l’or et du fameux lapis-lazuli, cette pierre précieuse bleue qui, avec l’or, habille de sa splendeur la tombe du pharaon égyptien Toutankhamon et d’autres tombes religieuses majeures en Mésopotamie (Irak).
Les données archéologiques démontrent que Shortugai commerçait avec ses voisins d’Aï Khanoum et construisit les premiers systèmes d’irrigation de la région, une spécialité de la civilisation de la vallée de l’Indus.
Bien des sites restent inexplorés en Afghanistan, pays où les guerres, les occupations étrangères et les pillages ont perturbé ou rendu impossible les recherches archéologiques.
Voici quelques-unes des découvertes de la DAFA, dont certaines restent exposées au Musée national de Kaboul.
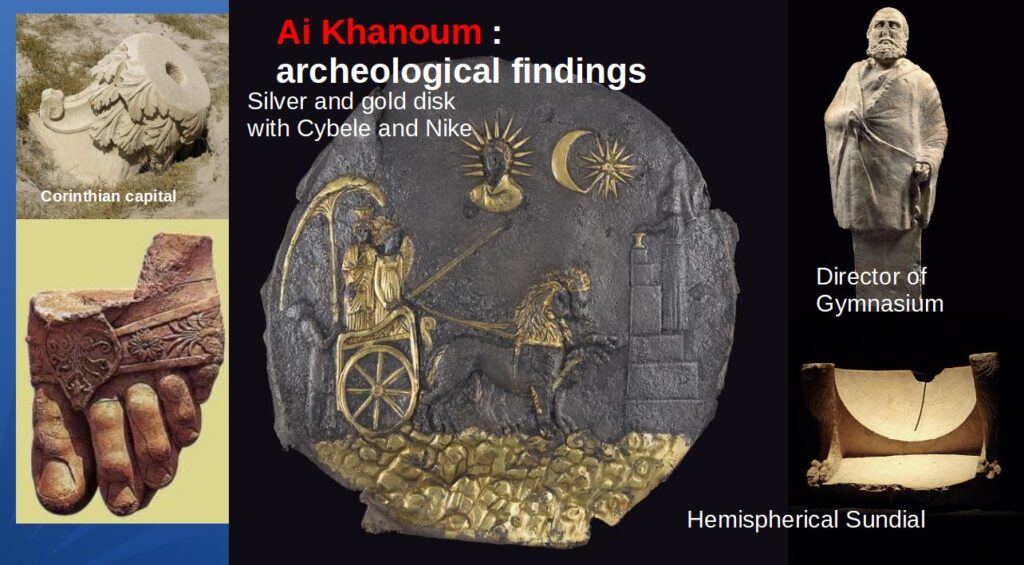

Relations avec l’Inde

Ce qu’on a trouvé à Aï Khanoum, les pièces de monnaie, les objets et les céramiques, notamment d’origine indienne, témoigne qu’il s’agissait d’une importante plaque tournante du commerce avec l’Inde.
En 258 avant notre ère, Ashoka le Grand, souverain de l’empire Maurya (l’État dominant en Inde), fait ériger ce que l’on appelle « l’Edit grec d’Ashoka à Kandahar », une inscription rupestre bilingue, en grec et en araméen. Une autre inscription d’Ashoka était rédigée uniquement en grec.
Le contenu même de ces édits donne également une indication claire du niveau des échanges entre l’Inde et le monde hellénistique. Par exemple, dans son XIIIe édit, Ashoka, faisant preuve d’érudition, énumère avec précision tous les souverains du monde hellénistique de son époque.
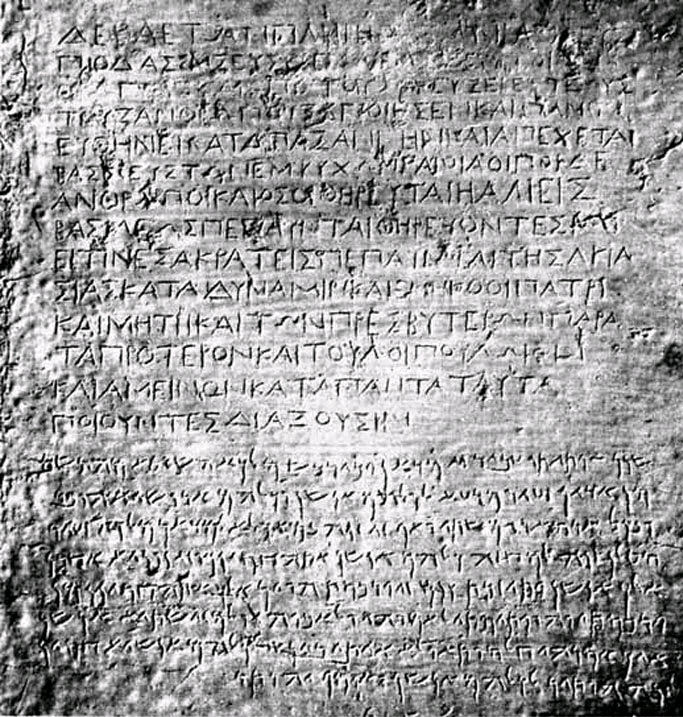
Relations avec la Chine
Outre son interaction avec le sous-continent indien, la Bactriane établira des contacts avec une puissance située encore plus à l’est : la Chine.
À la fin du IIe siècle avant JC, Zhang Qian, diplomate et explorateur de la dynastie Han, arrive en Bactriane. Le récit de sa visite, y compris son étonnement d’y trouver des marchandises chinoises sur les marchés (acquises via l’Inde), ainsi que ses voyages dans le reste de l’Asie centrale, sont conservés dans les œuvres de l’historien Sima Qian.

À son retour en Chine, Zhang Qian informe l’empereur de l’existence de civilisations urbaines sophistiquées en Asie centrale : le Dayuan (vallée de la Ferghana), la Bactriane (Afghanistan) et la Partie (nord-est du plateau iranien).
Les découvertes de Zhang Qian incitent l’empereur à envoyer des émissaires chinois en Asie centrale pour y favoriser le commerce avec la Chine. Certains historiens n’hésitent pas à qualifier cette décision de l’Empereur chinois de « naissance de la Route de la soie ».
Déclin et chute

Une grande partie des ruines actuelles d’Aï Khanoum datent de l’époque d’Eucratides Ier (172-145 av. JC), qui a considérablement réaménagé la ville et l’a peut-être rebaptisée Eucratideia, d’après son nom.
Il fut assassiné en 145 av. JC. par son fils. Un an plus tard, le royaume s’effondre face à l’invasion des nomades.
Aï Khanoum est pillée une première fois en 145 av. JC par les Sakas, des tribus iraniennes d’origine scythe, suivis quinze ans plus tard par les nomades chinois Yuezhi.
Le « complexe du trésor » d’Aï Khanoum montre des signes de pillage lors de deux assauts, à quinze ans d’intervalle. D’après des témoins oculaires, certaines villes se sont arrangées avec les envahisseurs et organisèrent une coexistence pacifique. Les villes qui ont résisté, comme Aï Khanoum, ont été pillées et incendiées.
L’empire Kouchan

Les nomades chinois Yuezhi se sédentarisent et créent au début du Ier siècle l’Empire kouchan, qui englobe une grande partie de ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde du Nord.
Son territoire s’étend de l’Asie centrale et du Gandhara (frontière occidentale actuelle du Pakistan) à Pataliputra, dans la plaine du Gange (Inde d’aujourd’hui). La capitale principale de son empire était située à Purushapura (aujourd’hui Peshawar au Pakistan).

C’est sous le règne de Kanishka le Grand (vers 127-150) que l’Empire kouchan deviendra célèbre pour ses réalisations militaires, politiques et spirituelles. Kanishka échange des ambassadeurs avec l’empereur romain Marc Aurèle (161-180) et l’empereur Han de Chine. Il noue des contacts diplomatiques avec la Perse sassanide et le royaume d’Aksoum (Yémen et Arabie saoudite d’aujourd’hui).
Si la dynastie kouchane reprend la tradition gréco-bactrienne, elle se forge peu à peu sa propre identité.
Les artistes kouchans enrichirent la sculpture bouddhique en donnant à Bouddha la forme humaine, innovation qui fut la plus importante de l’époque.
En 127, Kanishka remplace le grec par le bactrien, une langue moyenne iranienne utilisant l’alphabet grec.
Le bouddhisme
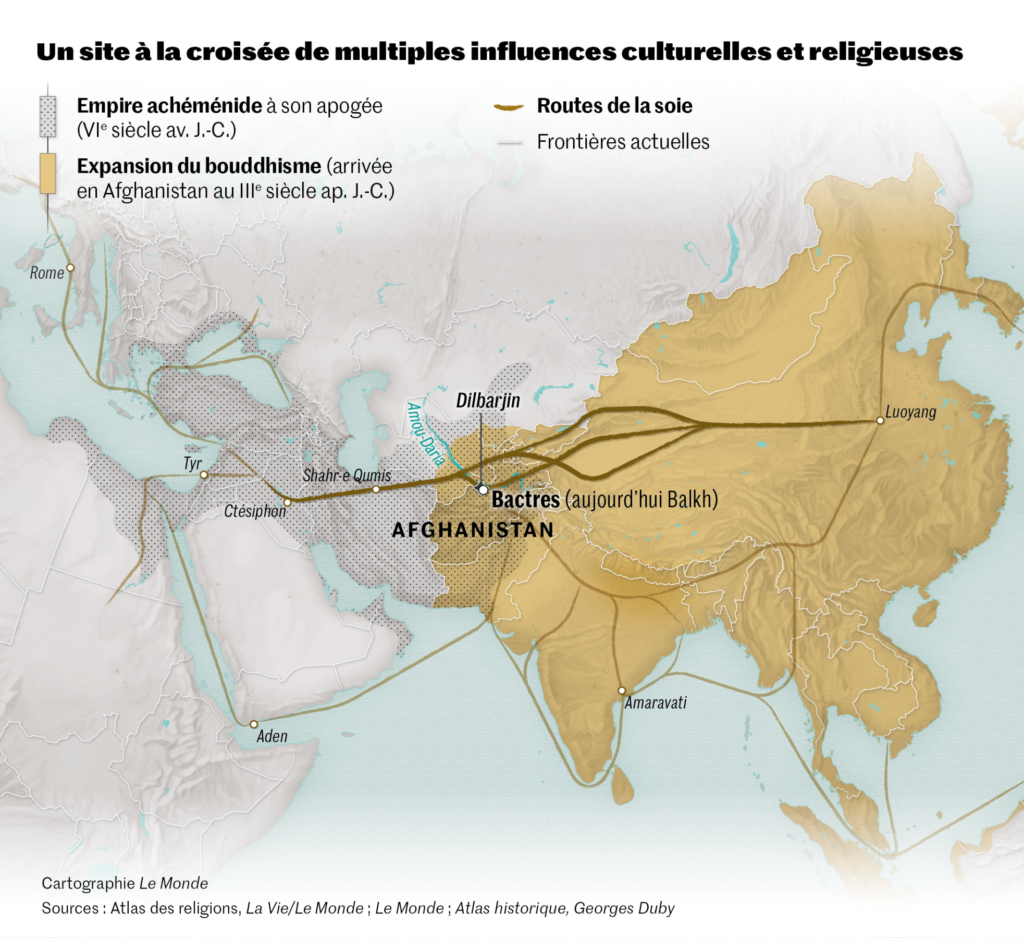
Les Kouchans joueront également un rôle majeur dans la transmission du bouddhisme. Le rayonnement de cette religion venue des rives du Gange favorisera celui des Routes de la soie.
Dans le domaine de la religion, les Kouchans, initialement attirés par l’hindouisme, joueront un rôle majeur dans la transmission du bouddhisme mahayana du Gandhara vers la Chine, l’Asie centrale et même le Sri Lanka, favorisant ainsi l’expansion de la route de la soie.
Tous ces facteurs ont inauguré une période de paix relative de 200 ans, connue comme la « Pax Kouchana ».
À partir du milieu du IIIe siècle après JC, l’Empire kouchan, affaibli, commence à se désintégrer. Dans sa partie occidentale, il passe sous le contrôle des Kushanshahs, c’est-à-dire les Indo-Sassanides (perses), progressivement supplantés au nord par les Hephtalites (appelés également les « Huns blancs » ou « Huns iraniens ») venus de la steppe d’Asie centrale.
Le bouddhisme connaît néanmoins une période de grande prospérité, comme l’illustrent les descriptions du moine chinois Xuanzang du VIIe siècle ainsi que la construction des statues géantes de bouddhas dans la vallée de Bamiyan en Afghanistan.

L’Islam
Après avoir conquis l’Iran, l’islam pénètre l’Afghanistan par le nord. Il n’y a pas de preuve d’un rejet massif de la nouvelle religion, sauf dans des régions isolées. Cependant, la volonté de rester indépendants des gouverneurs nommés par Damas (Omeyyades) puis par Bagdad (Abassides) se manifeste rapidement. C’est même à partir d’une province couvrant une partie du nord de l’Afghanistan, le Khorasan, que se répand initialement une partie de l’insurrection contre les Omeyyades pour les remplacer par le califat abbasside d’Haroun-al-Rachid, plus humaniste, et la création de Bagdad (voir notre article).
À partir de la fin du Xe siècle, une dynastie d’origine turque, les Ghaznévides, bâtit autour de leur capitale Ghazni (Afghanistan) un vaste sultanat qui s’étend jusqu’en Inde et fonde une communauté musulmane durable.


Leur influence culturelle se mesure par la beauté de l’architecture qu’ils nous ont laissée, mais aussi par le patronage qu’ils accordèrent au grand poète épique Ferdowsi (940-1025), à qui l’on doit la grande épopée nationale en langue persane, le Shahnameh : Le livre des rois.
Les Ghaznévides ont été suivis par une nouvelle dynastie, les Ghorides, originaire de la partie centrale de l’Hindou Kouch. C’est à eux que l’on doit l’impressionnant minaret de Jam.
Ce riche patrimoine culturel, qui a jeté les bases de leur identité et qui a donné sa dignité au peuple afghan, a été ignoré, détruit par les guerres successives, pillé et saccagé.
Fortement combattu par les talibans au pouvoir à Kaboul, ISIS, Daech et d’autres groupes terroristes, dont certains encouragés en sous-main par des agences de renseignement occidentales se sont livrés à un pillage à échelle quasi-industrielle du patrimoine culturel afghan. Pour eux, la revente d’objets d’art et d’antiquités est une des principales sources de revenus.
Recommandations
Aujourd’hui, le temps est venu d’un nouveau départ. L’Afghanistan peut changer complètement son image dans le monde, qui a été polluée par des adversaires et des ennemis qui veulent maintenir l’Afghanistan comme une zone de non-développement pour leur propre grand jeu géopolitique.
Ma proposition pour renouveler la contribution de l’Afghanistan à la culture mondiale est simple.
Avec Mes Aynak, qui signifie « petite mine », située à 35 km au sud de Kaboul, l’Afghanistan dispose du deuxième plus grand gisement de cuivre au monde. Alors que la Chine et les autres pays du BRICS ont besoin de ce métal précieux pour leur développement industriel, la mine offrira un revenu substantiel dont l’Afghanistan a un besoin urgent pour reconstruire le pays.
Le 25 mai 2008, Ibrahim Adel, ministre des Mines, et Shen Heting, directeur général de MCC, l’actionnaire majoritaire du consortium MCC-Jiangxi Copper MJAM, ont signé le contrat minier de Mes Aynak.
Ce contrat décrivait les conditions du premier grand projet minier et du plus important investissement étranger en Afghanistan. Cependant, suite à des incidents de sécurité qui ont créé d’importants problèmes d’insécurité, et sous la pression des puissances étrangères, le projet a été bloqué.

Paradoxalement, cela a donné aux archéologues le temps de mettre au jour sur le site minier une zone de 40 ha d’une valeur culturelle exceptionnelle de classe mondiale, principalement un vaste complexe de monastères bouddhistes, comprenant des stupas (temples), des peintures murales, des sculptures et des centaines d’artefacts archéologiques, etc.
Même si le contrat (fichier pdf) a pu être modifié depuis 2008, on ne peut que constater que le contrat initial contient une série d’aspects potentiellement très intéressants, à la fois pour la Chine mais surtout pour l’Afghanistan lui-même.
- EXPORTER DU MÉTAL, PAS DU MINERAI
De même que la Bolivie ne veut pas exporter du lithium (matière première) mais des batteries (produit fini transformé à haute valeur ajoutée), l’Afghanistan ne veut pas exporter du minerai de cuivre mais du cuivre métal. Pour atteindre cet objectif, le contrat prévoit la construction d’une fonderie sur le site.
Paragraphe IV, 33 : « Afin de respecter son engagement envers le gouvernement de financer, construire et exploiter une fonderie en Afghanistan, la MCC a demandé au gouvernement de lui donner accès à des gisements de phosphates, de calcaire et de quartz qu’elle pourra utiliser dans le cadre du projet Aynak. » - ACHATS LOCAUX
Paragraphe VII, 38 : « MCC s’efforce d’acheter des biens et des services en Afghanistan s’ils sont disponibles. » - MAIN-D’ŒUVRE LOCALE
Paragraphe VIII, 39, a : « MCC emploie du personnel afghan, dans toute la mesure du possible. » - APPROVISIONNEMENT EN EAU
Paragraphe IV, 32 : « MCC s’est engagée auprès du gouvernement à construire des puits d’approvisionnement en eau et des systèmes de canalisation … pour répondre aux besoins en eau douce du projet. La MCC s’est également engagée à réutiliser et à recycler l’eau de traitement dans la mesure du possible. » - CENTRALE AU CHARBON
Paragraphe IV, 31 : « MCC s’est engagée auprès du ministère des Mines à construire … une centrale au charbon d’une capacité de 400 mégawatts pour fournir de l’énergie électrique au projet et à Kaboul. » - CHEMIN DE FER
Paragraphe IV, 30 : « MCC s’est engagée à construire un chemin de fer associé au projet ». - LOGEMENT
Paragraphe IV, 24 : « MCC doit fournir des logements de qualité et en quantité suffisante à ses salariés et à leurs familles immédiates, à un prix de location raisonnable. » - SOINS MÉDICAUX
Paragraphe IV, 25 : « MCC fournira des soins médicaux gratuits à tous ses salariés et à leurs familles… et établira, dotera en personnel et entretiendra des dispensaires, des cliniques et des hôpitaux en nombre suffisant … » - ÉCOLES
Paragraphe IV, 26 : « MCC doit fournir gratuitement un enseignement primaire et secondaire adéquat aux enfants de tous les salariés et résidents de la zone entourant Aynak. » - CADRE DE VIE
Paragraphe IV, 27 : « MCC construira et financera le fonctionnement de centres d’activités récréatives adéquats tels que des gymnases et des terrains de sport. … En outre, il construira un marché/une zone commerciale. » - RELIGION
Paragraphe IV, 28 : « MCC respectera et protégera les convictions religieuses du peuple afghan. »
Le monde serait stupéfait en constatant que l’Afghanistan mobilise ses meilleurs architectes et urbanistes pour construire une nouvelle ville à Mes Aynak qu’il baptisera poétiquement, l’« Aï Khanoum du XXIe siècle ».
A Kaboul, un archéologue de premier plan qui travaille sur le site depuis une décennie, m’a confié avec une joie non-dissimulée que, suite à d’intenses discussions en octobre dernier entre les autorités afghanes et l’entreprise chinoise, une issue heureuse a été trouvée.
A l’heure actuelle, dit-il, les deux parties ont convenu de préserver, non plus une infime partie du site archéologique (la partie centrale avec les temples bouddhistes), mais l’ensemble des vestiges historiques du site en surface. A en croire mon interlocuteur, la décision est prise que l’ensemble du site sera désormais exclusivement exploité par la technique d’exploitation minière souterraine. N’en déplaise à la presse occidentale, le sauvetage de Mes Aynak révèle au monde le vrai visage du nouveau gouvernement afghan.
Il rendra également pensable, d’ici un certain temps, la reconstruction des bouddhas géants de la vallée de Bamiyan, l’un de 55 mètres et l’autre de 38 mètres, détruits en 2001. Plusieurs experts, lors de colloques récents de l’UNESCO, ont précisé que les difficultés techniques ne sont pas insurmontables, les bouddhas étant fabriqué en stuc. Le soi-disant « danger » que les sculptures soient considérées comme « fausses » n’a aucun sens, tant que l’intention d’atteindre un bien supérieur par leur reconstruction est réelle.
La « Proposition technique pour la revitalisation des statues du Bouddha de Bâmiyân » de 2017, élaborée par le département d’architecture de l’université japonaise Mukogawa Women’s University, mérite d’être examinée. Sans doute pourra-t-on faire mieux, mais elle a le mérite d’exister. Des chercheurs chinois se disent également prêts à donner un coup de main.
Rappelons que le monde compte 620 millions de bouddhistes qui considèrent Bamiyan comme une partie de leur culture et pourraient envisager de venir en Afghanistan pour mieux comprendre leur propre histoire.

Si l’Afghanistan indiquait clairement au monde qu’il a décidé de renforcer ses activités économiques et minières tout en protégeant, notamment grâce à l’aide généreuse de la Chine, le patrimoine culturel mondial sur son sol, il apparaîtra aux yeux de tous ce qu’il est désormais aujourd’hui : une force du bien, de la tolérance et de la paix dans le monde, en cohérence avec sa propre identité et son histoire.
L’Afghanistan apparaîtra comme le « Bouddha de feu » (IIe-IIIe siècle) du Musée national de Kaboul, où l’on voit la réponse donnée par Bouddha à un défi lancé par des hérétiques selon lequel il ne pouvait pas faire de miracles.
Connu sous le nom de « miracles jumeaux », on y voit Bouddha confiant avec des flammes sortant de ses épaules et des cours d’eau de ses pieds ! En altérant ces deux flux, dit la légende, Bouddha a même fait apparaître un arc-en-ciel !
En augmentant sa production d’énergie et en gérant d’une façon plus intelligence ses ressources en eau, l’Afghanistan démontrera, j’en suis convaincu, sa splendide force spirituelle !
Merci à tous et j’ouvre le débat à vos questions.