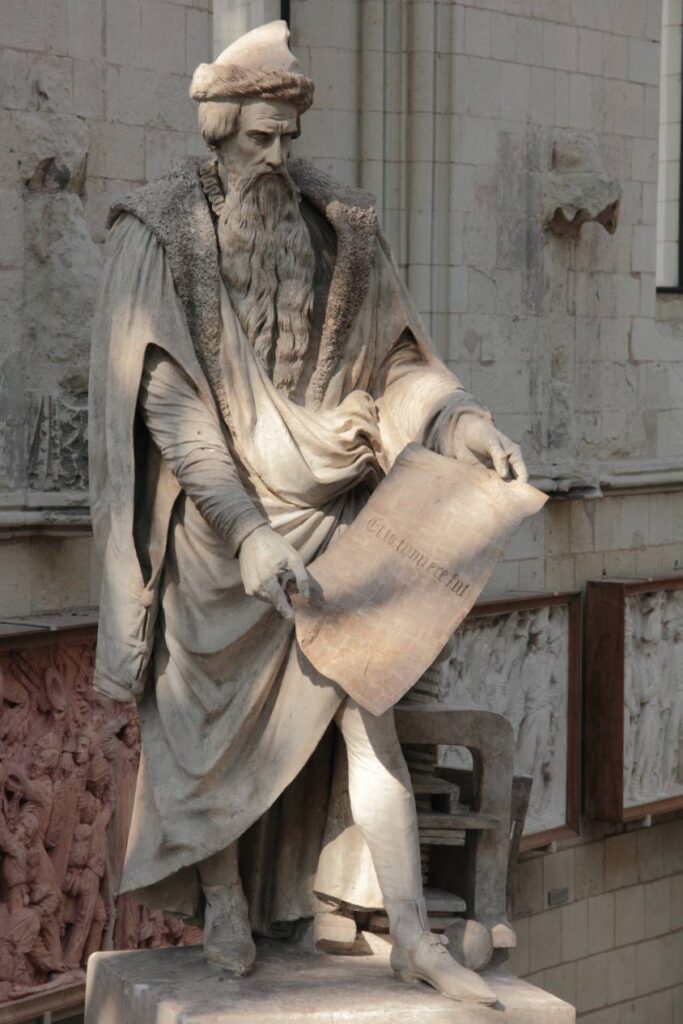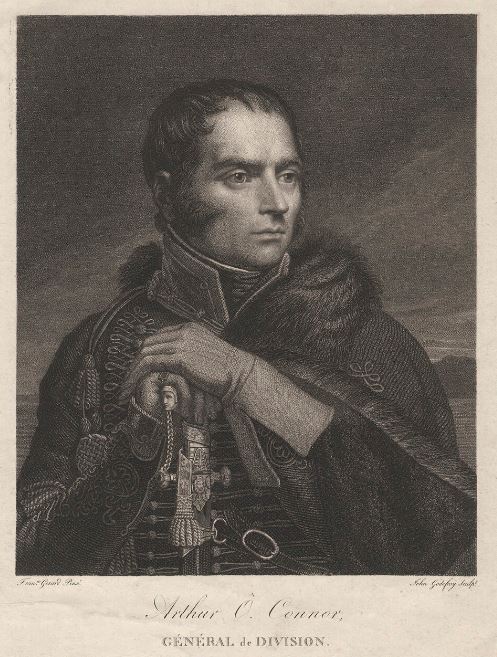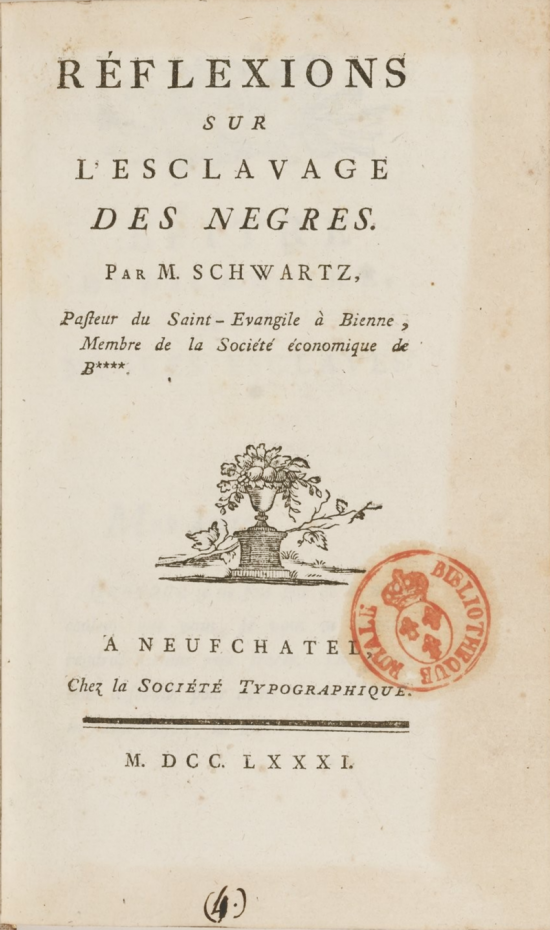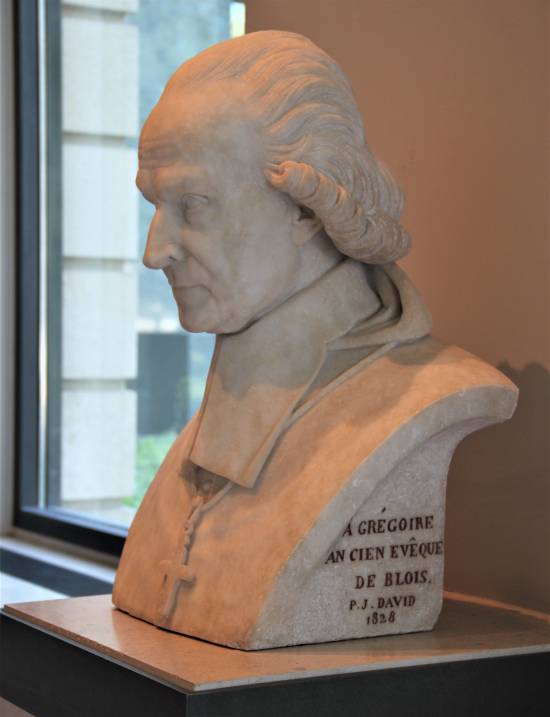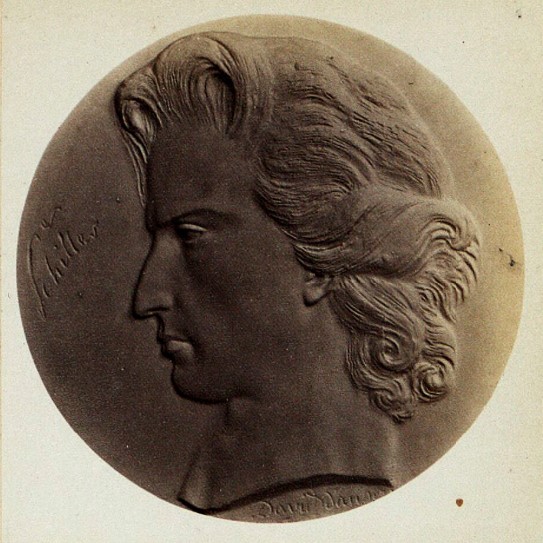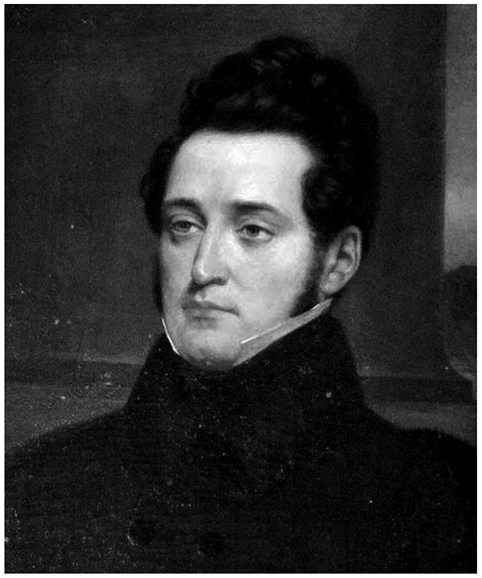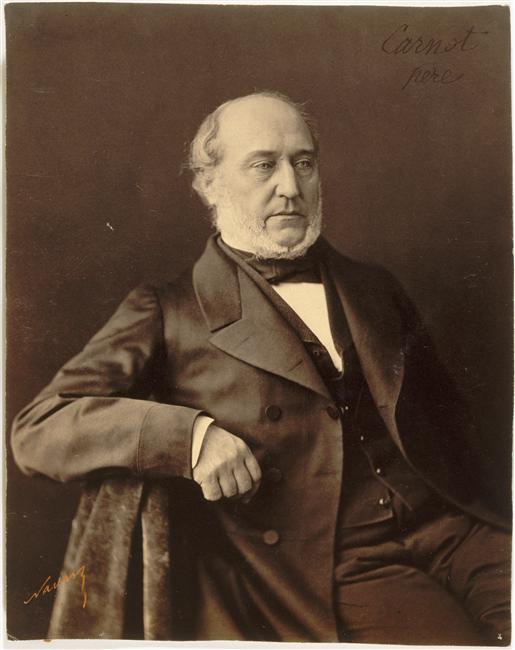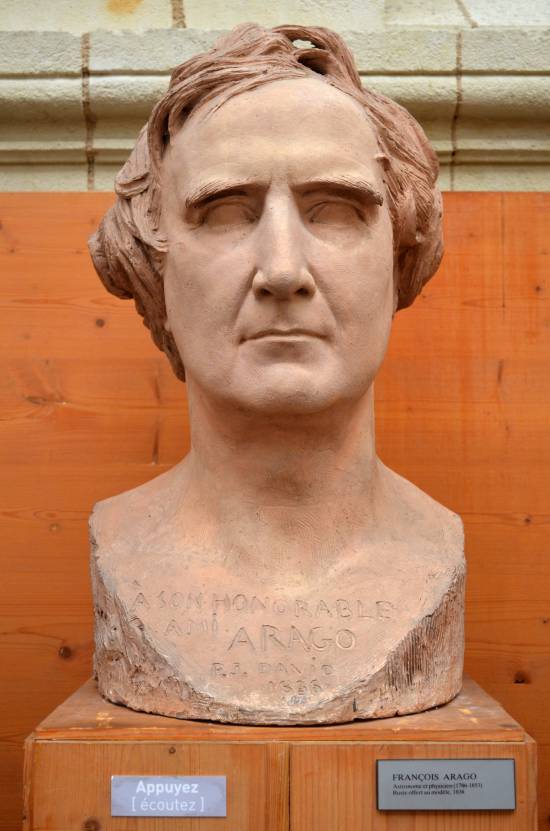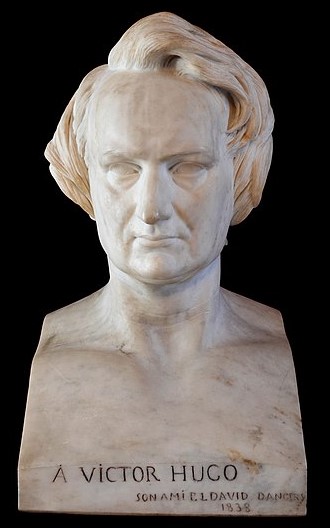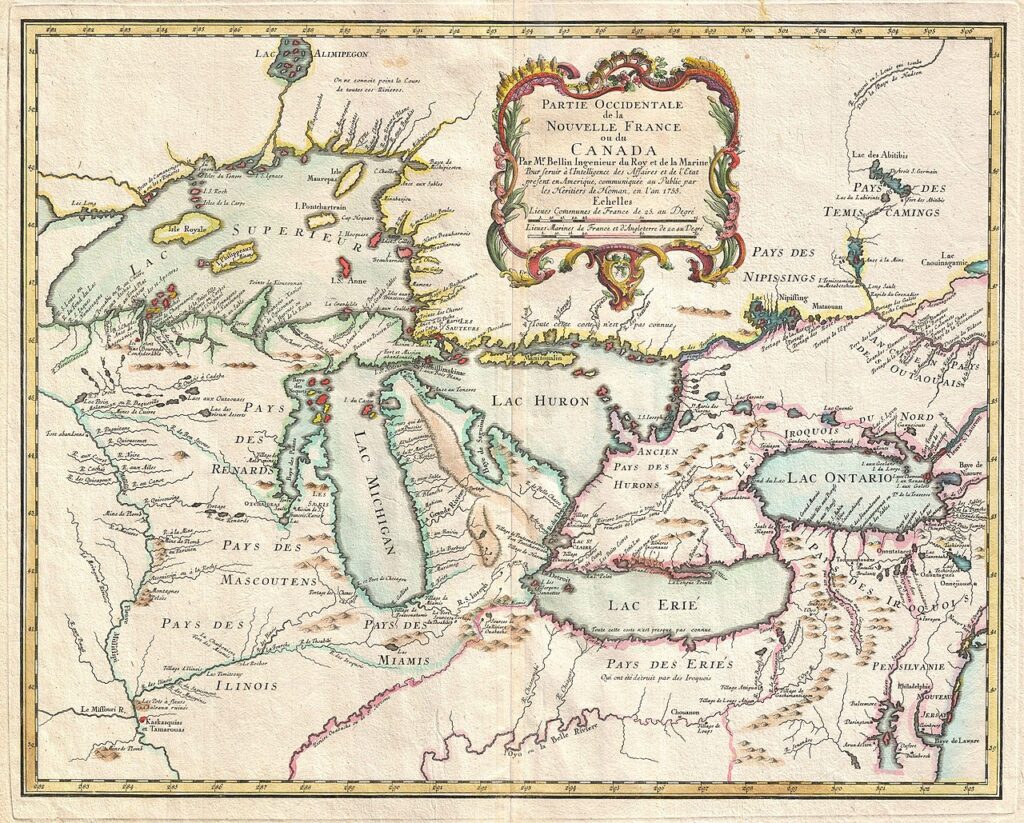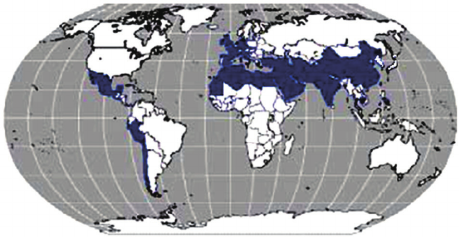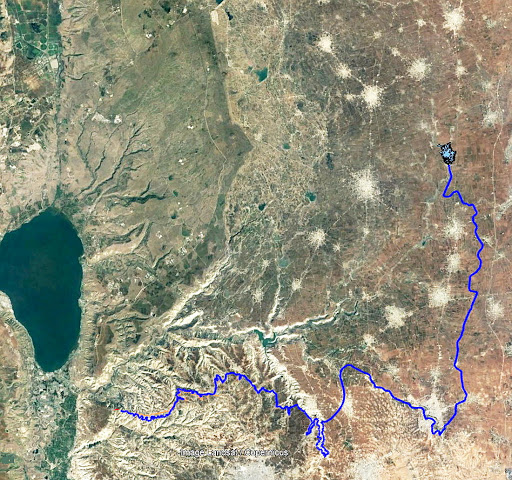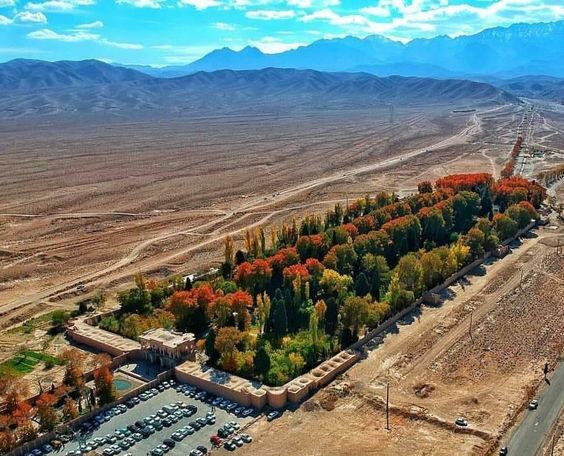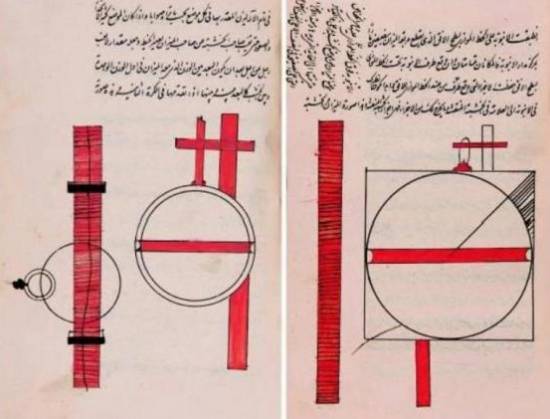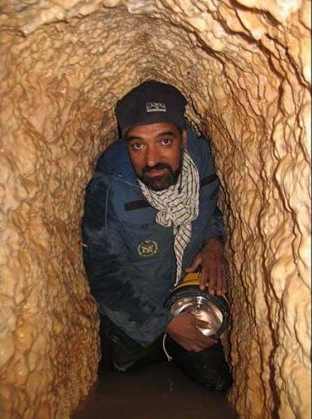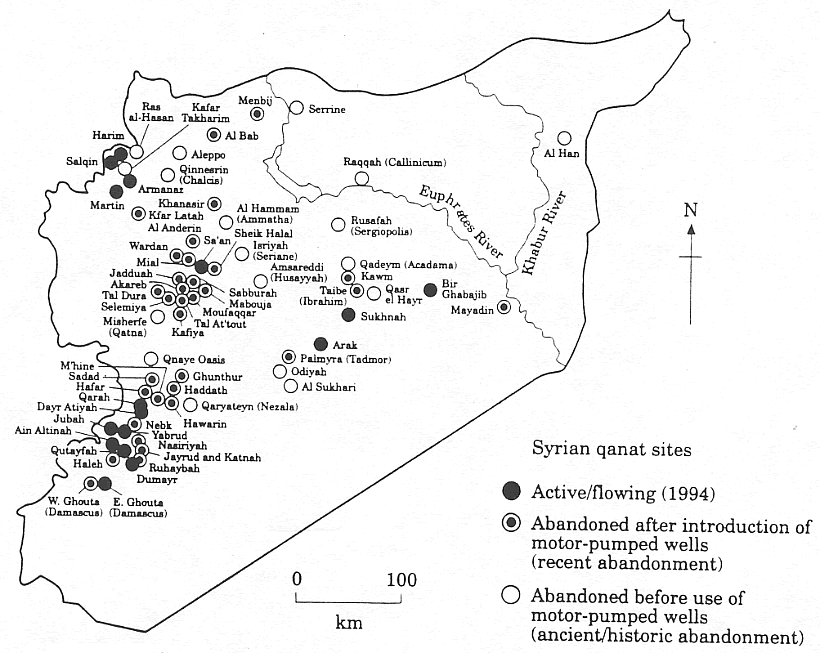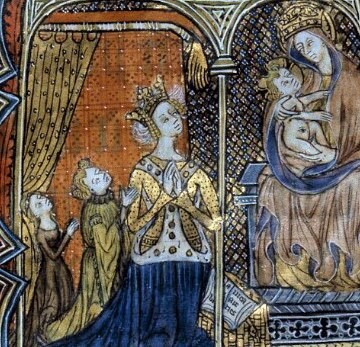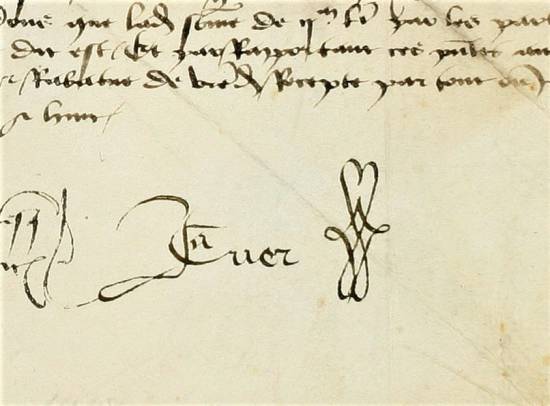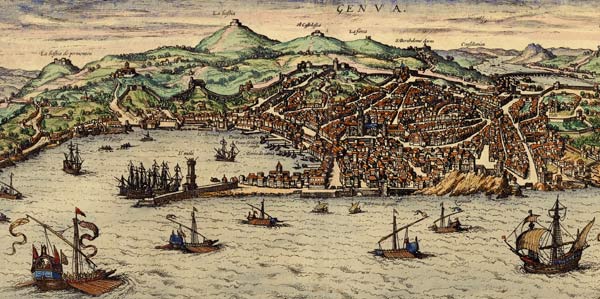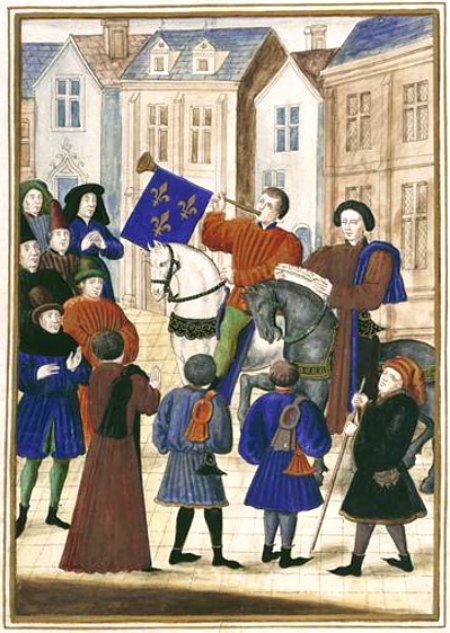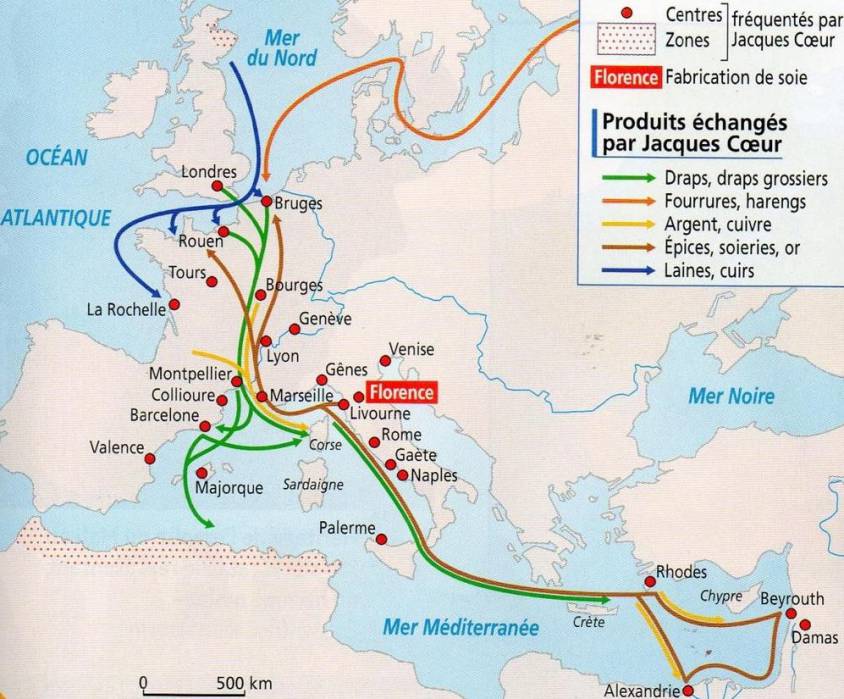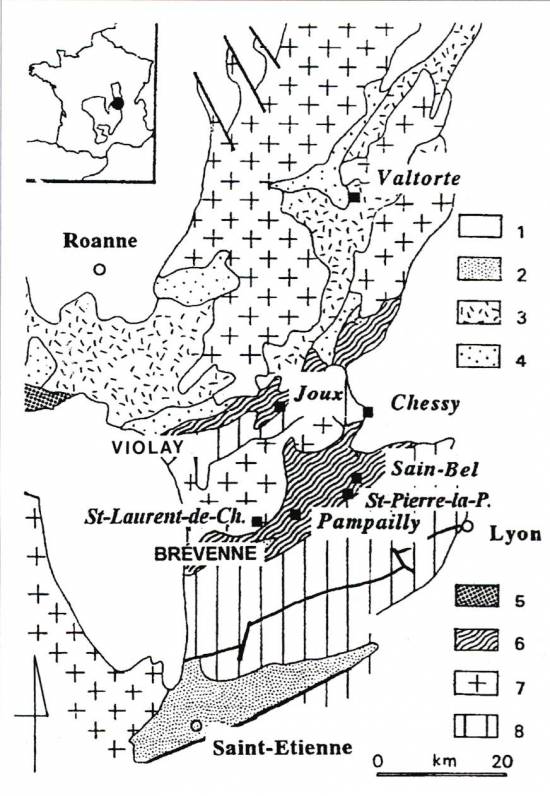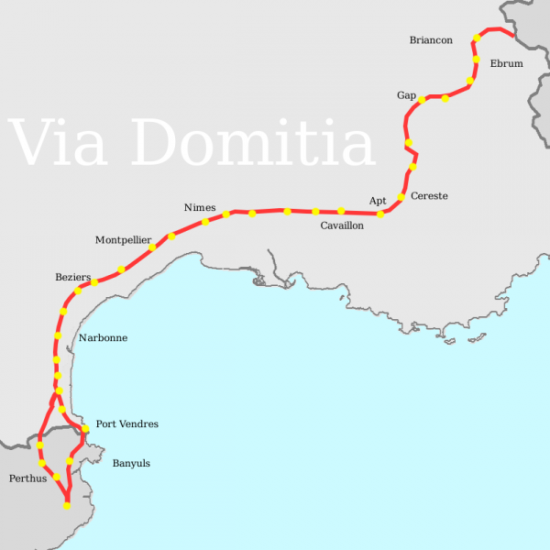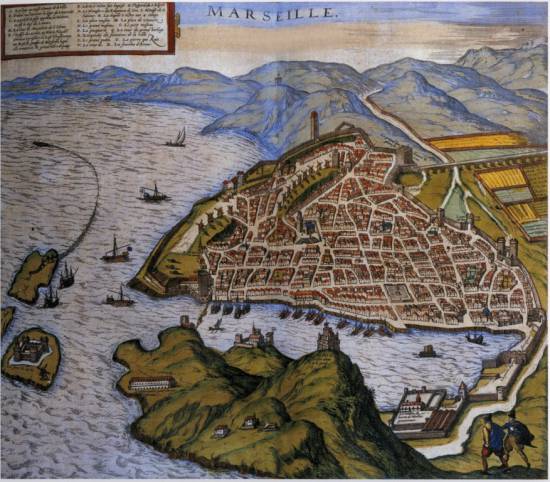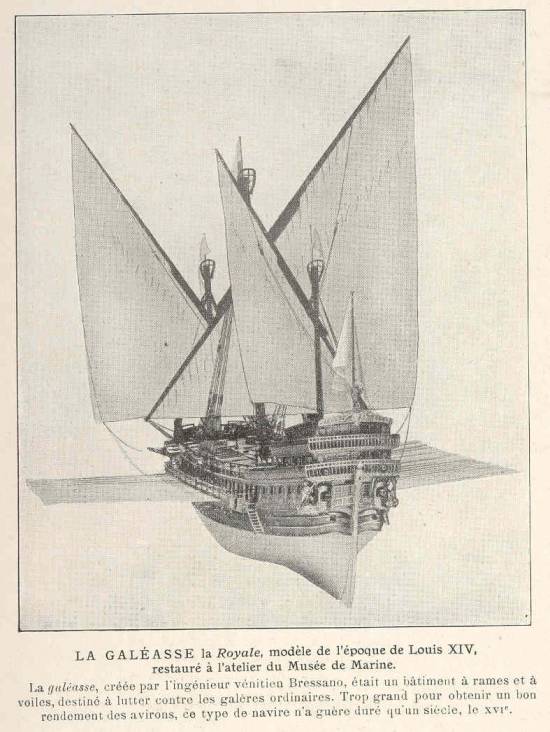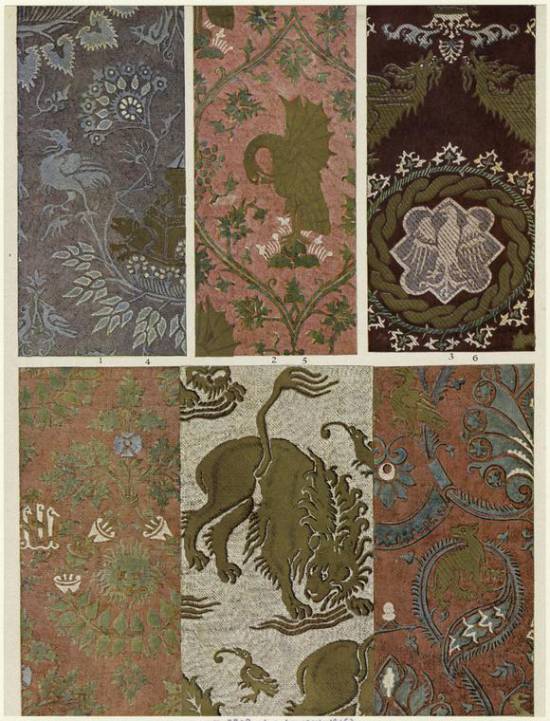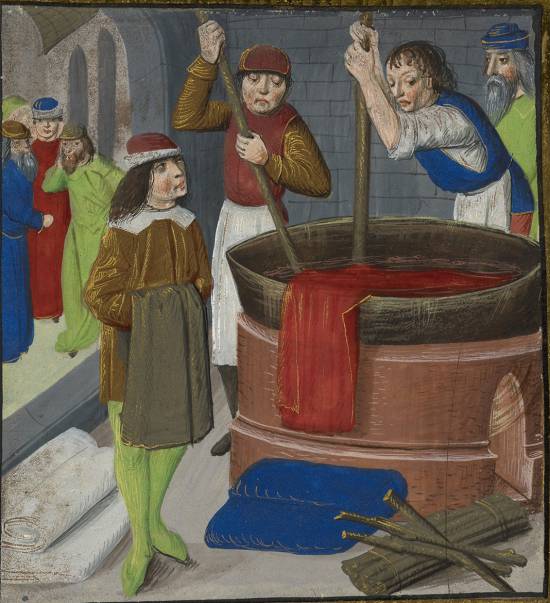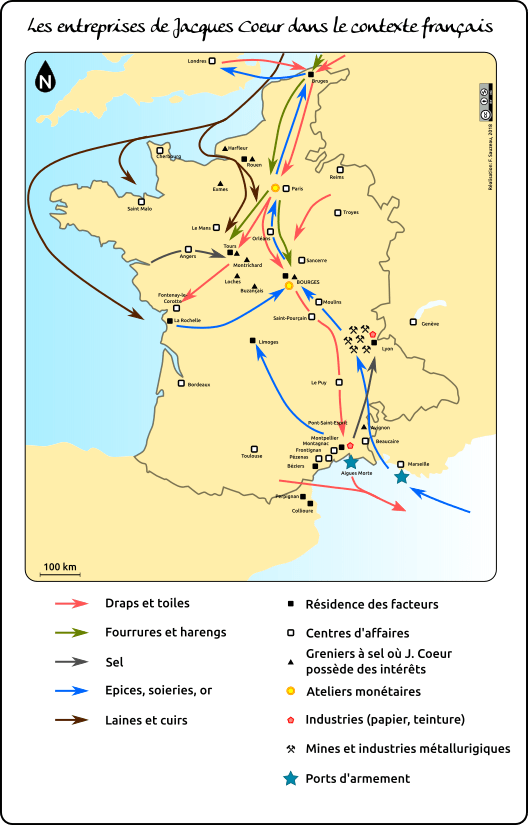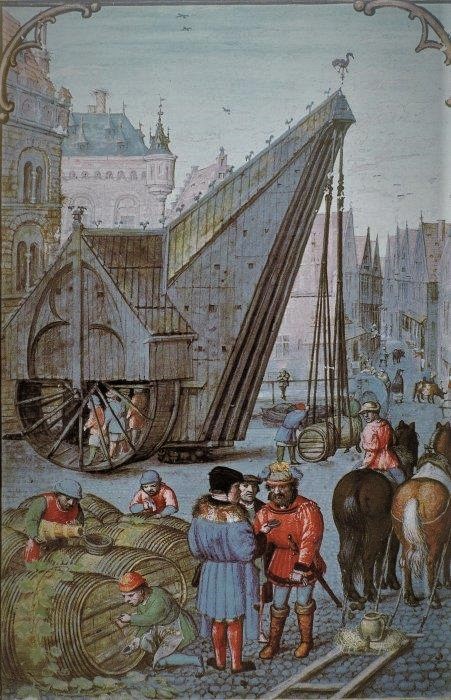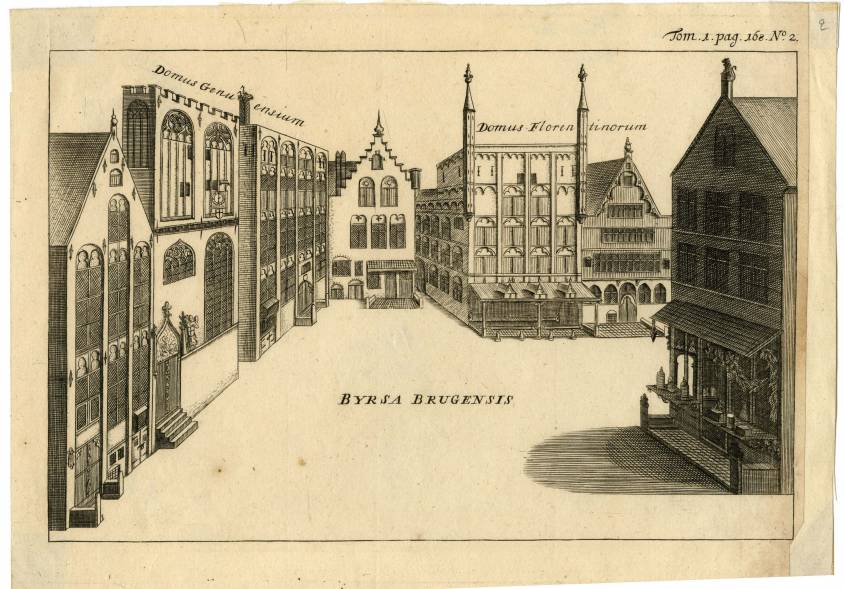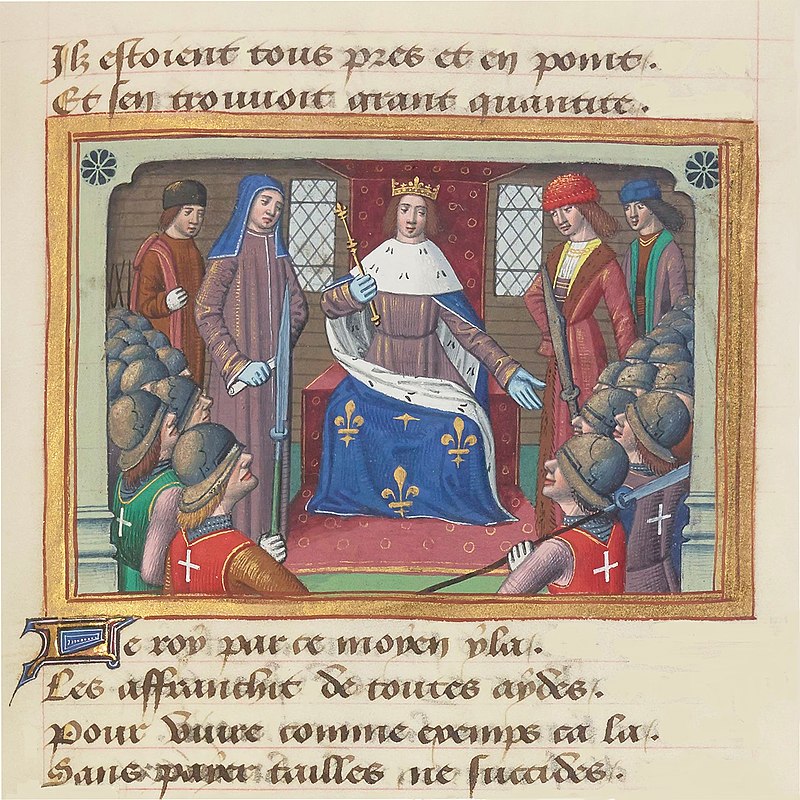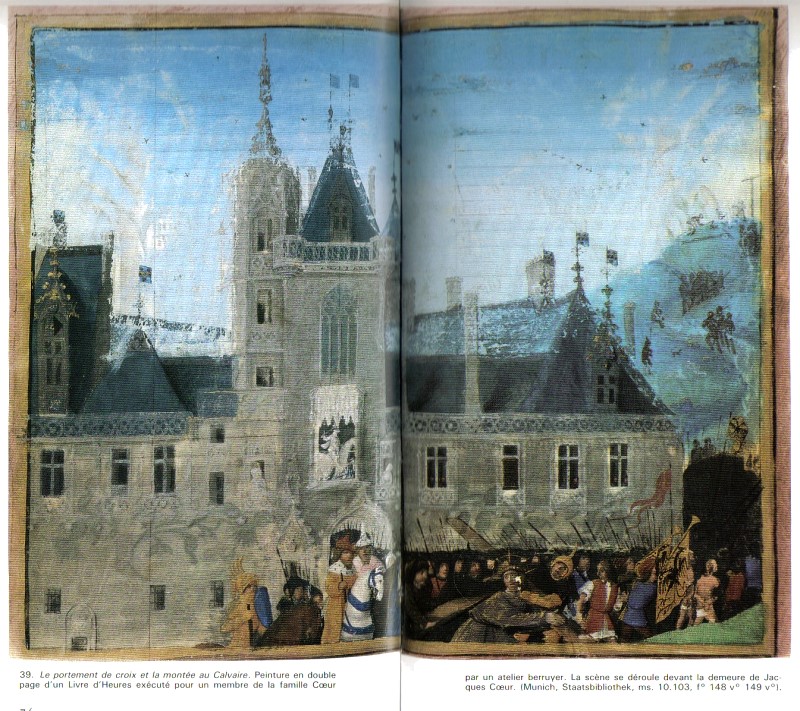Étiquette : France
Thanks to WEST’s new record, world’s nuclear fusion community moving forward


On Monday May 27, 2024, Karel Vereycken talked to physicist and nuclear fusion specialist Alain Bécoulet for Nouvelle Solidarité. He has been in charge of the ITER project’s engineering department since February 2020.
ITER is a large-scale scientific experiment intended to prove the viability of fusion as an energy source. ITER is currently under construction in the south of France. In an unprecedented international effort, seven partners—China, the European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States—have pooled their financial and scientific resources to build the biggest fusion reactor in history.
Alain Bécoulet is a former research director at the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), and in particular director of the IRFM, the Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique (Institute for Research on Fusion by Magnetic Confinement).
Karel Vereycken: Mr. Bécoulet, good morning, it’s great to have you on the phone.
Alain Bécoulet: Hello Mr. Vereycken, if I’ve understood correctly, you’re interested in what happened at WEST, in connection with the press releases that went out just about everywhere around May 15. (more below)
That’s right; I’ll give you my impressions and you can correct me. I understand that the Tore SUPRA Tokamak (in southern France)1, who with six minutes held a world record in duration till 2021, was a bit like your baby.
To tell the truth, I was director of the IRFM2, in charge of Tore SUPRA. If it can be considered “my baby”, it’s because under my governance it was radically modified and upgraded, and renamed “WEST”. Before me, it was Robert Aymar‘s baby3.

Right! But in WEST, it’s the W that does it all. And it’s a W for tungsten, a very heat resisting material that absorbs less than graphite and makes the machine more efficient?

Yes, it does. The major change we made with WEST, is that we went from a circular-limiter machine 4 to a “divertor” machine.5
On Tore SUPRA, the vertical plasma action was a circle resting on a graphite limiter and the plasma simply touched it.
For some years now, we’ve discovered that making a plasma in the shape of a D, or in the shape of a fish with an X point — called a “divertor” — produces much better results in terms of confining heat and impurities, particles, etc. So it was time for Tore SUPRA to go there.
At the same time, Tore SUPRA itself made it clear for us, that for ITER, it was not possible to continue with carbon – which was ITER’s original intention – and so ITER switched and was reconfigured to tungsten.
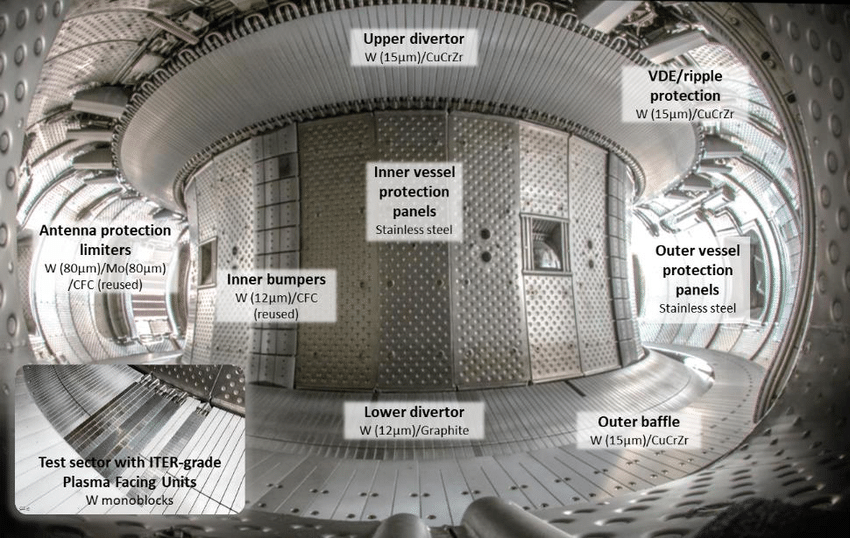
That’s when we took the opportunity to install a cooled tungsten divertor in Tore SUPRA. What’s more, Tore SUPRA’s mission has always been, even before ITER – we’ve been talking about it for a very long time now – the development and integration of technological solutions, and not so much performance-fusion.
If you put tritium in Tore SUPRA, you’re not going to get much in the way of power: it’s too small and not powerful enough in any ways to make fusion reactions of any note; but on the other hand, it’s perfectly relevant for all technological developments – it was on Tore SUPRA, it has to be recalled, that the first successful full-scale test of the superconducting coils now used in ITER took place!
I’m fully aware of that.
It was also Tore SUPRA that supplied all the rules for actively cooling all the components in front of the plasma, including diagnostics [i.e. measuring instruments], etc.; not forgetting solutions for continuous additional heating, in short a huge amount of technology.
So the idea, in the transition from Tore SUPRA to WEST, was to continue along the path of the “actively cooled tungsten divertor”.

I think the Koreans, too, with KSTAR, had already.…
There are several superconducting machines that have made equivalent advances –more successive than simultaneous– and that have inspired others; in this case, before talking about KSTAR, the machine that is closest to WEST, its little sister – you’re going to smile, but I didn’t call it WEST for nothing — is a machine that started up when Tore SUPRA was already operating, in Hefei, China, called EAST — with which we have cooperated enormously, both on coils and on plasma components, etc.

So the two laboratories have cooperated enormously; I chose the name WEST because we wanted to change the name of Tore SUPRA, to rejuvenate it and mark the fact that we were making this technology; so we called it WEST, a sort of sister machine to EAST, and the two machines really work together (EAST has now installed a tungsten divertor, etc.). ); even some of the modifications we made to WEST were made in cooperation, in partnership with the EAST machine, with the Chinese Academy of Sciences, which supplied us with components, in particular the power supplies for the divertor coils, the new ICRH antennas, etc.; we had all this done by the Chinese.6
It’s extraordinary that this kind of cooperation can still take place in this world of conflict…
It really is! As for KSTAR, it’s quite a similar machine too, but I’d call it less pioneering. It’s only now arriving in this kind of world; it’s a long way behind –not that I’m blaming them, because since the teams are smaller, it’s more difficult– but that doesn’t stop us from cooperating a lot with KSTAR.
The only real difference with WEST lies in the coils, which are all inside a single cryostat (refrigeration system) – as with ITER, whereas in Tore SUPRA, when we built it, the coils were each in a separate cryostat.
To sum up: today, the large superconducting machines accompanying the ITER project are WEST, EAST, KSTAR and now the new JT60SA tokamak which has just gone into operation in Japan. It’s the size of the JET (at Culham in the UK) in superconductor, but doesn’t yet have a tungsten environment, and won’t for several years yet; so it’s not yet fully in a world as relevant, but it’s coming! And because it’s larger, it’ll probably outperform those EAST, WEST, etc. machines.
The press, and the official press release, reports a 15% gain in energy produced – which is still less than the energy spent on the reaction – and at the same time, they talk of a doubling of plasma density.
Please note: machines like WEST, EAST and KSTAR will never produce power fusion, for at least two good reasons:
- they’re too small;
- they’re not designed to hold tritium.
So there’s no fusion in these machines. Also, beware of energy gains and the like: these are gains in energy stored inside the machine, but not at all in energy supplied, in energy produced by fusion energy.
It’s not yet “break-even” (when the energy produced exceeds that of the reaction).
In fact, we improve confinement and increase confinement time. This improves the possibility of fusion, but we don’t enjoy fusion in these machines, which are too small and not powerful enough for that, particularly in terms of core plasma.
On the other hand, they are used because their edge plasma, i.e. the plasma inside the plasma interacting with structures such as tungsten, etc., is very similar to ITER’s. That’s why they’re so interesting, and as they can produce very long-lasting plasmas, the tests carried out in these machines are perfectly relevant to ITER.
So I’d like to come back to one of your questions, namely how this advances the promises of ITER. ITER is being built, and things are being manufactured, but ITER is a kind of big eater, constantly asking: “Can you continue the research?”

Obviously, we’re into things we’ve never tested, so anything we can test, anything that can debug things for us, is very welcome. So these machines, in particular WEST, EAST, etc., are helping us to consolidate our position, both in terms of design and in terms of manufacturing solutions –a divertor like the tungsten divertor currently cooled, it works!
And what WEST has just demonstrated– compared with the last time, when it achieved very high performance, particularly in terms of duration, with the Tore SUPRA configuration, on a carbon limiter, etc. — it did so in even more relevant conditions, thanks to a tungsten divertor.
The result of WEST was 364 seconds, or 6 minutes and 4 seconds, with an injected energy of 1.15 GJ, a stationary temperature of 50 million°C (4 keV) and an electron density twice that of the discharges obtained in the previous tokamak configuration, that of Tore SUPRA.
However, what’s really new and very important for ITER is that when these machines do this, it’s with components facing the plasma that are the same as ITER’s. We’ve taken great care to ensure that the WEST divertor has exactly the same technology as the ITER divertor. That’s how we test this technology, over timescales and with power flows arriving on these components that are highly relevant, as they are representative of the conditions in which they will live in ITER.

So ITER has become a globalized scientific experiment, decentralized and centralized at the same time.
ITER is the place where all the world’s fusion knowledge is being synthesized; but this process didn’t stop the day we signed the treaty, it’s being synthesized every day!
We continue to feed ITER with scientific and technical results. For example, if a machine says to us “wait a minute, you’ve done that, but we’ve found results that are different now that we’ve done more work”, we look at that very carefully, to find out whether or not there are any impacts. We’re in constant contact with all these people, to find out what’s coming out of the labs, experiments and simulations, and to find out whether or not there’s an impact on ITER, in which case we’re able to rectify the situation according to the scale of things
This sharing of cooperative data takes place in conditions of great trust?
It’s a scientific community that works like a scientific community, with no preconceptions, no ulterior motives, nothing at all.
A bit like the astronauts on the international space station?
Absolutely. We used to say “in the old days, it was taken for granted”, but now it’s true that it’s become almost surprising. If there’s a result in a Russian or Chinese machine, we have access to it and then we understand, we work, we discuss with them, it’s really very open.
That’s very promising.
We have to fight against the journalists who love to wonder whether there’s competition, whether someone has won or whatever…. That’s not what we’re about at all; we’re about cooperative scientific development. Everyone works in their own corner, of course, but for everyone! There’s no such thing as “I know, I know”, no, none of that exists in the world of fusion.
In the article I’m preparing, I’ll conclude by saying that the big problem with ITER is that there’s only one problem!
In a way, it’s almost true, it’s not the “big problem”, but it’s something that doesn’t encourage acceleration; competition encourages acceleration, we agree on that.
After all, the Chinese have 6 fusion reactors…
Be careful, they’re not “reactors”, beware of the vocabulary. They’re experiments, Tokamaks, plasma experiments, all much smaller. The biggest one I mentioned, in Japan, is ten times smaller than ITER!
Now there are start-ups and others, which we’re hosting here (at the CEA center in Cadarache, France) for three days; 50 start-ups are here, downstairs in the amphitheater, chatting with us; they’re all convinced they’re making reactors, but no! They’re just doing experiments, manips, experimental prototypes. Yes, even ITER isn’t a reactor. Mind you, the meaning of the word “reactor” is to produce electricity or energy, and we’re not there yet!
If someone tells you he is selling you a reactor, you can laugh in his face, because it’s not true, and it will remain so for a long time, unfortunately or fortunately, I don’t know. As far as the reactor phase is concerned, we’ve only just begun, with ITER, the transition to industry. That’s what we’re also doing these days, looking at how to transfer knowledge from laboratories – and ITER is THE world laboratory, in the true sense of the word, in the sense of a public research laboratory. How do we begin to transfer this to the industrialists who will have to build the reactors? But the time scale here isn’t next week!
Wouldn’t your real competitor be the National Ignition Facility (NIF)?7
Not even close! Because with the Americans, it’s in a way even worse, because they’re even less developed in their public research, it’s a long way from maturity. They once did a demonstration in a machine that wasn’t designed for it, and so on.
So if we wanted to go from the NIF to the reactor, we’d already have to make up all the ground we’ve accumulated since the state of magnetic fusion with the big JET experiments in 1997. So we’re almost 30 years away from reaching the levels of technological maturity, integration and overall maturity needed to move towards a reactor. And we, too, are still a long way from moving towards the reactor.
As far as competitors are concerned, to be honest, no one feels like a competitor today, and this is no joke: may the best man win! The problem is so complicated, and the stakes so high, that whoever comes up with the solution will have us all on our feet! There’s no such thing as competition.
We’re starting to see, with these new start-ups, people saying “yes, but we’re moving towards industrial solutions, etc., so we may develop patents that we obviously don’t want to reveal or sell”. Fair enough!
But hey, if they know how to make one of the “technological bricks” and it has a patent, good for them. But that’s not even going to stop us talking. A patent, once you’ve registered it, isn’t a secret, it’s simply something that belongs to you and that you can put on the public square; whoever uses it is just going to have to pay for it, that’s all. So it’s not a war or anything.
The problem is really extremely complicated, and we’re now entering the pre-industrial world of the thing, which is very exciting, isn’t it! I started my career as a theoretician 35 years ago, and I can tell you that we were really on the calculator and not even on the computer yet. Now we’re in: 1/ a complete demonstration of the feasibility of the whole system with ITER, which is in a way the end (the objective) of fundamental public research; 2/ the moment when we’ll say “here’s the great recipe, now it’s up to you to industrialize it, improve it, make it economically viable, etc.”. But ITER still has to show that we can do it, and I believe we can, even though we’re still building the machine and haven’t yet made plasma! But then again, on paper it’s always beautiful…
What do you see as the final hurdles? What more can the public authorities in the various countries do?
I’d encourage you to keep an eye on things until October-November, when the International Atomic Energy Agency (IAEA) will issue a strategic document, prepared by all of us –and I’m one of its key authors. It’s a global strategy document on the development of fusion energy, i.e. the production of energy through fusion.
It’s a very interesting document which, in around twenty pages, covers all the regulatory, technological, scientific and industrial aspects – everything you could possibly dream of: it’s got it all!
And it gives a great deal of information on the challenges facing this community – which is in the process of moving from a purely public research community to a mixed public-private community, moving towards industry, etc. – and on what remains to be done by this community, in terms of nuclear regulations, industrialization, work on the overall efficiency of all sub-systems, and availability (a reactor can’t just run for three minutes every day, it has to work 24 hours a day for 40 years).
This strategic document, which will be issued by the International Agency, should enable all players – I’d almost say “outsiders”: investors, the press, politicians, etc. – to understand where the merger stands and what remains to be done. So it’s a fairly ambitious document, with such a lofty goal, but one that has been made simple and readable for once; we’ve put a lot of effort into it, and I think we’ve succeeded.
It’s really condensed: each paragraph covers 40 or 50 years of research (!), but I think it’s understandable; at the moment it’s being edited by the IAEA, and will be published in early autumn.
Ok, we’ll watch that.
And finally, here are my thoughts on what remains to be done for fusion:
- New technological building blocks. There are things that even ITER won’t be able to do, such as fully demonstrating the closure of the tritium cycle – how to make tritium, and how to really burn it in situ; we’re going to do a few demonstrations, but we don’t yet have the complete cycle, and we won’t have it just with ITER.
- Materials. Since magnetic fusion generates very energetic neutrons, and lots of them – a machine like ITER is designed to live for a certain time with a certain plasma rhythm, so it has no problem surviving these neutrons. But if we built the same ITER and ran it for 40 years, 24 hours a day, it wouldn’t last; its materials wouldn’t stand up to the shock. So we need other materials, and materials research and development.
- This brings us to maintenance: how can we learn to intervene in these kinds of objects without disturbing them too much, working with robotics and appropriate intelligence to understand these extremely complex systems? So we also need to model them; some elements are very difficult to manufacture, so we need to think about how to work on the design so that manufacturers have less difficulty in doing what they’re asked to do, etc.
- There are also nuclear regulations.
Is this new measuring device just demonstrated on WEST really a breakthrough?
The first to communicate this WEST result were the Americans, which surprised me, but hey, why not?
Yes, it surprised me too.
Because of an unfortunate sentence at the beginning of their article, we got the impression that WEST was a machine from the Princeton laboratory!
Yes, that’s right!
International Cooperation
I spoke to you about the collaboration with China; when I created WEST, we set up a collaborative, partnership-based process that is almost even more ambitious than ITER. We partnered some thirty laboratories around the world to help us build WEST. It thus became a kind of international machine, operated by the CEA without any problems, but an international machine, and we played the same role as ITER: we tried to do what we call supply in kind –I mentioned the Chinese, who gave us power supplies, heating antennas, etc., but there are many countries like that: the Indians have manufactured and supplied us with things, and in this case the Princeton laboratory has designed, manufactured and installed a diagnostic: what you call a measuring instrument is in fact an advance that we test on the machine, and the Americans, or the Princeton people now, can now say “there, we know how to do that, and the proof: we tested it there and there, etc.”. You can think of these major research instruments (like WEST, EAST, etc.), particularly in the field of fusion, as test benches for all kinds of things.
Do we have a machine that actually makes plasma? It’s a bit like CERN (Geneva based particle accellerator), where you’ve got a device that accelerates particles, and then you’ve got lots of people who come to watch, put particles together, make them collide like this, put them in this detector, make them do something, and exploit the science that goes with it.
A Tokamak is also a test bench somewhere, for testing components with plasma, diagnostics, heating systems and so on. So it lends itself well to partnership, because you’ve got a central unit, a central operator who’s going to do the bulk of the machine, who’s going to rectify the coils or the enclosures, etc.; and then afterwards, you can have a huge number of people who are going to come and contribute to a brick that we’re going to put into this machine.
And WEST works with China, with Korea, with many French laboratories –CNRS laboratories and universities that simply bring us diagnostics or simulations – with the United States, with India and with many other countries. And we have a steering committee; for this machine, it’s not just the CEA that decides on its experimental plan: once a year, people from all these labs get together to examine what we’ve done and what we want to do with this machine. Remember that these are always integrated contributions, mixing technology and physics.
It’s wonderful! Thank you for your answers, which have shown us the global, shared process towards a more peaceful world.
We’re trying… We believe in scientific diplomacy here. It’s not easy, it’s no easier than normal diplomacy, but scientific diplomacy does exist, it’s an aspect we believe in and demonstrate every day, we show that it exists and that it also contributes, effectively, to the planet’s progress, even if sometimes it’s more difficult… I’m used to comparing it to sports or artistic diplomacy; the Olympic Games shouldn’t turn as sour as it’s turning, it doesn’t make sense.
Thank you, congratulations, we’re proud of you and your teams, keep up the good work!
Thank you very much. See you soon.
- With a major radius of 2.25m (machine centre to plasma centre) and a minor radius of 0,70m, Tore Supra (before it was reconfigured as WEST) was one of the largest tokamaks in the world. Its main feature was the superconducting toroidal magnets which enabled generation of a permanent toroidal magnetic field. Tore Supra was also the only tokamak with plasma facing components actively cooled. Theses two features allow the study of plasma with long pulse duration. ↩︎
- Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique (Institute for Research on Fusion by Magnetic Confinement. ↩︎
- Robert Aymar was the Director General of CERN (2004–2008), serving a five-year term in that role. In 1977, Robert Aymar was appointed Head of the Tore Supra Project, to be constructed at Cadarache (France). In 1990, he was appointed Director of the Direction des Sciences de la Matière of the CEA, where he directed a wide range of basic research programmes, both experimental and theoretical. ↩︎
- The “Limiter” of the Tore SUPRA tokamak (made of graphite), was the element that extracted most of the energy contained in the plasma (in the shape of a flat circular ring located in the lower part of the donut shaped machine).
↩︎ - In WEST, the actively cooled 456-component divertor at the bottom of the vacuum vessel extracts the heat and ash produced by the fusion reaction, minimizes plasma contamination and protects the surrounding walls from thermal and neutron loads. ↩︎
- Most of this industrial production (i.e. 16,000 blocks of tungsten), was carried out by AT&M (China), with the support of the Chinese laboratory ASIPP as part of the joint CEA-China collaboration (SIFFER, SIno French Fusion Energy centeR). Already, in 2016, the Institute of Plasma Physics (ASIPP) of the Chinese Academy of Sciences (CAS), had supplied ICRH (Ion Cyclotron Resonant Heating) antennas for Tore SUPRA. ↩︎
- In December 2022, an NIF experiment used 2.05 megajoules of laser energy to produce 3.15 megajoules of fusion energy.
↩︎
LOUVRE AUDIO GUIDE: short note before starting your visit

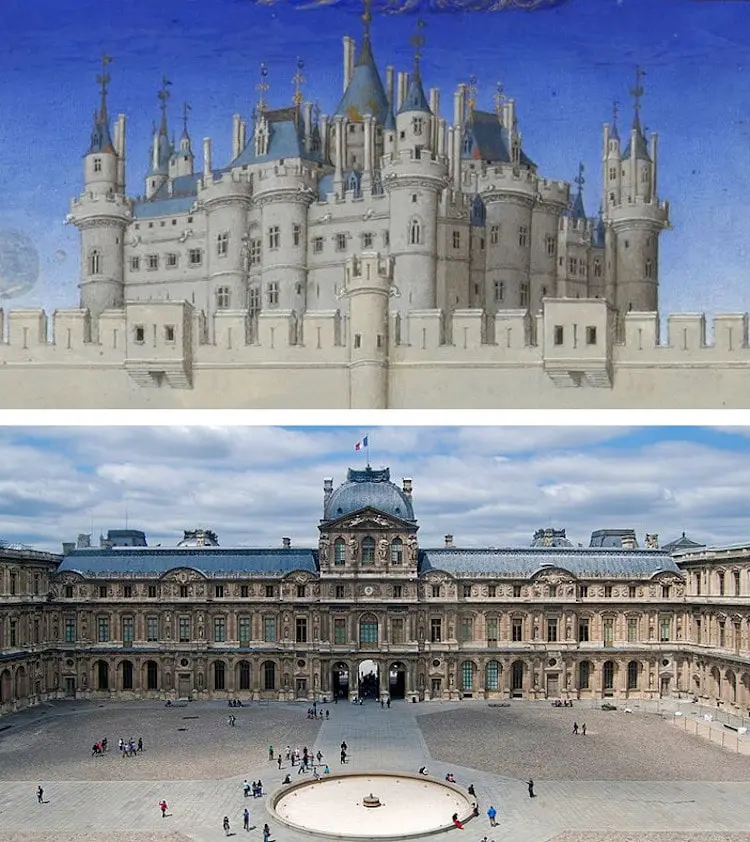
Listen:
- To the audio on this website
Read:
- Index of articles dealing with art history and Renaissance studies on this website.

——————————
LOUVRE AUDIO GUIDE: The Greek tradition behind the Fayum Mummy Portraits
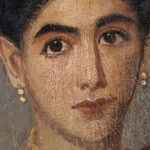
Karel Vereycken comments the Louvre’s Fayum Mummy Portraits.
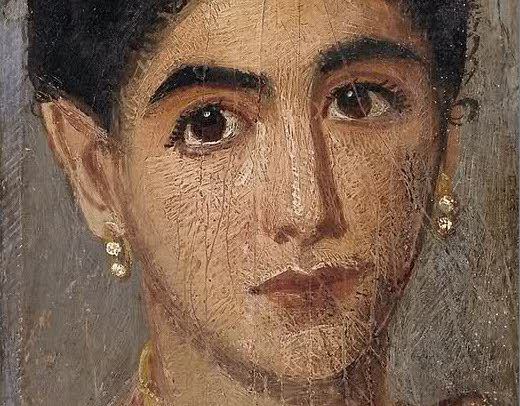

Listen:
To the audio on this website
Read:
Paris Schiller Institute stages Afghan civil society protest against UNESCO


Paris, Feb. 2024 – On Thursday February 22, between 10:00 am and 1:00 pm CET, members and supporters of the International Schiller Institute, founded and presided by Helga Zepp-LaRouche, gathered peacefully in front of one of the main buildings of the headquarters of UNESCO in Paris (1, rue Miollis, Paris 75015). An appeal (see below), endorsed by both Afghans and respected personalities of four continents, was presented to the Secretary General and other officials of UNESCO.

How it started
Following a highly successful conference in Kabul last November by the Ibn-e-Sina Research & Development Center on the reconstruction of Afghanistan, a group of senior archaeologists of the Afghan Academy of Sciences (ASA), in discussion with the organizers and the invited experts of the Schiller Institute, suggested to launch a common appeal to UNESCO and Western governments to “lift the sanctions against cultural heritage cooperation.”

The Call
“We regret profoundly, says the call, that the Collective West, while weeping crocodile tears over destruction of the world’s cultural heritage, has imposed a selective ban of scientific cooperation on nations mistakenly considered as “opposed to its rules and values.” The complete freeze of all cooperation in the field of archaeology between France and both Syria and Afghanistan, is just one example of this tragedy.”
“The dramatic neglect of international cultural institutions and donors to Afghanistan, the lack of sufficient funds in the field of cultural heritage protection, and the political treatment of international cultural heritage institutions have seriously endangered Afghanistan,” underscores the petition.
Specifically, “UNESCO, which should raise its voice against any new form of ‘cultural and scientific apartheid,’ has repeatedly worsened the situation by politicizing issues beyond its prerogatives.”
To conclude, the signers call
“on the international community to immediately end this form of ‘collective punishment,’ which creates suffering and injustice, promotes ignorance, and endangers humanity’s capacity for mutual respect and understanding.”
Living Spirit of Afghanistan
To date, over 550 signatures have been collected, mainly from both Afghan male (370) and female (140) citizens, whose socio-professional profiles indicates they truly represent the « living spirit of the nation ».
Among the signatories: 62 university lecturers, 27 doctors, 25 teachers, 25 members of the Afghan Academy of Sciences, 23 merchants, 16 civil and women’s rights activists, 16 engineers, 10 directors and deans of private and public universities, 7 political analysts, 6 journalists, 5 prosecutors, several business leaders and dozens of qualified professionals from various sectors.
International support
On four continents (Europe, Asia, America, Africa), senior archaeologists, scientists, researchers, members of the Academy of Sciences, historians and musicians from over 20 countries have welcomed and signed this appeal.
Italian Professor Pino Arlacchi, a former member of the European Parliament and the former head of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) was the first to sign. Award-winning American filmmaker Oliver Stone, is a more recent signer.
In France, Syria, Italy, the UK and Russia, among the signers one finds senior researchers suffering the consequences of what some have identified as a « New Cultural Cold War. » Superseding the very different opinions they have on many questions, the signatories stand united on the core issue of this appeal: for science to progress, all players, beyond ideological, political and religious differences, and far from the geopolitical logic of ‘blocs’, must be able to exchange freely and cooperate, in particular to protect mankind’s historical and cultural heritage.
Testifying to the firm commitment of the Afghan authorities, the petition has also been endorsed by the Deputy Minister of Foreign Affairs, the Minister of Culture and Arts, and the Minister of Agriculture, as well as senior officials from the Ministries of Higher Education, Water and Energy, Mines, Finance, and others.
“The 46th session of UNESCO’s World Heritage Committee, to be held in New Delhi in July this year, offers UNESCO the opportunity to announce Afghanistan’s full return into world heritage cooperation, if we can have our voice heard,” says Karel Vereycken of the Paris Schiller Institute. “We certainly will not miss transmitting this appeal to HE Vishal V Sharma, India’s permanent representative to UNESCO, recently nominated to make the Delhi 46th session a success.”
For all information, interview requests in EN, FR and NL:
Karel Vereycken, Schiller Institute Paris
00 33 (0)6 19 26 69 38
Full text of the appeal
International Call to Lift Sanctions Against Cultural Heritage Cooperation
Following the international conference, organized by the Ibn-e-Sina Research & Development Center’s in Kabul in early November 2023, on the reconstruction of Afghanistan, a group of researchers launched the following petition:
We, the undersigned, researchers and experts in the domains of the history of civilizations, cultural heritage, archaeology, anthropology, sociology, and many other fields, and other enlightened citizens of the world, in Afghanistan, Syria, Russia, China, and many other countries, launch the following call.
1) We regret profoundly that the “Collective West”, while weeping crocodile tears over destruction of the world’s cultural heritage, has imposed a selective ban of scientific cooperation on nations mistakenly considered as “opposed to its rules and values.” The complete freeze of all cooperation in the field of archaeology between France and both Syria and Afghanistan, is just one example of this tragedy.
2) We request particular attention to the case of Afghanistan. Its neighboring countries, national and international institutions, and countries involved in international conventions for the protection of cultural and natural heritage are committed to cooperation in the field of guarding cultural heritage sites and artifacts and preventing their smuggling and destruction. Therefore, it is expected that in the current situation, they will fully play their role in the protection of Afghanistan’s cultural heritage in accordance with international laws and conventions. However, the dramatic neglect of international cultural institutions and donors to Afghanistan, the lack of sufficient funds in the field of cultural heritage protection, and the political treatment of international cultural heritage institutions have seriously endangered Afghanistan. Undoubtedly, the non-recognition of the Afghan government has dimmed the attention of cultural institutions. Considering the above, we expect these international institutions to renew their full support to protect both the tangible and the intangible cultural heritage of Afghanistan.
3) We regret that UNESCO, which should raise its voice against any new form of “cultural and scientific apartheid,” has repeatedly worsened the situation by politicizing issues beyond its prerogatives.
4) Therefore, we call on the international community to immediately end this form of “collective punishment,” which creates suffering and injustice, promotes ignorance, and endangers humanity’s capacity for mutual respect and understanding.
The progress of scientific knowledge, in a positive climate permitting all to share it, is by its very nature beneficial to each and to all and to the very foundation of a true peace.
SIGNERS:
A. FROM AFGHAN CIVIL SOCIETY:
– Hussain Burhani, Archaeologist, Numismatist, Afghanistan ;
– Ketab Khan Faizi, Archaeologist, Director of the Academy of Sciences at the International Centre for Kushan Studies in Kabul, Afghanistan;
– Stora Ishams Mayar, Archaeologist, member of the Academy of Sciences at the International Centre for Kushan Studies in Kabul, editor in chief of the journal of this mentioned center, Afghanistan;
– Mahmood Jan Drost, Senior Architect, head of protection of old cities of Afghanistan, Ministry of Urban Development and Housing, Afghanistan;
– Ghulam Haidar Kushkaky, Archaeologist, associate professor, Archaeology Investigation Center, Afghanistan ;
— Laieq Ahmadi, Archeologist, Former head, Archeology department of Bamiyan University, Afghanistan;
– Shawkatullah Abed, Chief of staff, Afghan Science Academy, Afghanistan;
– Sardar Ghulam Ali Balouch, Head of Afghanistan Balochs Union, Afghanistan;
– Daud Azimi Shinwari, Ibn-e-Sina Research & Development Center, Germany;
– Abdul Fatah Raufi, Ibn-e-Sina Research & Development Center, Kabul, Afghanistan;
– Mirwais Popal, Dip, Master, Ibn-e-Sina Research & Development Center, Germany;
B. FROM ABROAD:
(Russia, China, USA, Indonesia, France, Angola, Germany, Turkiye, Italy, UK, Mexico, Sweden, Iran, Belgium, Argentina, Czech Republic, Syria, Congo Brazzaville, Yemen, Venezuela, Pakistan, Spain, Canada, Democratic Republic of Congo.)
– H.E. Mr Mohammad Homayoon Azizi, Afghanistan’s Ambassador to Paris, UNESCO and ICESCO, France;
— Julio Bendezu-Sarmiento, Researcher at the National Scientific Research Centre (CNRS), Archaeologist specializing in Central Asia; Former director of the Delegation of French Archaeologists in Afghanistan (DAFA) (2014-2018), France;
– Inès Safi, CNRS, Researcher in Theoretical Nanophysics, France;
– Pierre Leriche, Archeologist, Director of Research Emeritus at CNRS-AOROC, Scientific Director of the Urban Archaeology of the Hellenized Orient research program, France;
– Nadezhda A. Dubova, Institute of Ethnology and Anthropology, Dr. in Biology, Prof. in History. Head of the Russian-Turkmen Margiana archaeological expedition, Russian Academy of Science (RAS), Russia;
— Alexandra Vanleene, Archaeologist, specialist in Gandhara Buddhist Art, Researcher, Independant Academic Advisor Harvard FAS CAMLab, France;
– Raffaele Biscione, retired, associate Researcher, Consiglio Nazionale delle Recerche (CNR); former first researcher of CNR, former director of the CNR archaeological mission in Eastern Iran (2009-2022), Italy;
— Sandra Jaeggi-Richoz, Professor, Historian and archaeologist of the Antiquity, France;
– Dr. Razia Sultanova, Professor, Cambridge University, UK;
– Dr. Houmam Saad, Archaeologist, Directorate General of Antiquities and Museums, Syria;
– Estelle Ottenwelter, Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, Natural Sciences and Archaeometry, Post-Doc, Czech Republic;
– Didier Destremau, author, diplomat, former French Ambassador, President of the Franco-Syrian Friendship Association (AFS), France ;
– Wang Feng, Professor, South-West Asia Department of Chinese Academy of Social Sciences (CASS), China;
– Dr. Engin Beksaç, Professor, Trakya University, Department of Art History, Turkiye;
– Bruno Drweski, Professor, National Institute of Oriental Languages and Civilizations (INALCO), France;
– Maurizio Abbate, National President of National Agency of Cultural Activities (ENAC), Italy;
– Patricia Lalonde, Former Member of the European Parliament, vice-president of Geopragma, author of several books on Afghanistan, France;
– Pino Arlacchi, Professor of sociology, Former Member of the European Parliament, former head of United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Italy;
– Oliver Stone, Academy Award-winning Film director, Producer, and Screenwriter;
– Graham E. Fuller, Author, former Station chief for the CIA in Kabul until 1978, former Vice-Chair of the National Intelligence Council (1986), USA;
– Prof. H.C. Fouad Al Ghaffari, Advisor to Prime Minister of Yemen for BRICS Countries affairs, Yemen;
– Farhat Asif, President of Institute of Peace and Diplomatic Studies (IPDS), Pakistan;
— Dursun Yildiz, Director, Hydropolitics Association, Türkiye;
– Irène Neto, president, Fundacao Dr. Antonio Agostinho Neto (FAAN), Angola;
– Luc Reychler, Professor international politics, University of Leuven, Belgium;
– Pierre-Emmanuel Dupont, Expert and Consultant in public International Law, Senior Lecturer at the Institut Catholique de Vendée, France;
— Irene Rodríguez, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina;
– Dr. Ririn Tri Ratnasari, Professor, Head of Center for Halal Industry and Digitalization, Advisory Board at Journal of Islamic Accounting and Business Research, Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga, Indonesia;
– Dr. Clifford A. Kiracofe, Author, retired Professor of International Relations, USA;
– Bernard Bourdin, Dominican priest, Philosophy and Theology teacher, Institut Catholique de Paris (ICP), France;
– Dr. jur. Wolfgang Bittner, Author, Göttingen, Germany;
– Annie Lacroix-Riz, Professor Emeritus of Contemporary History, Université Paris-Cité, France;
– Mohammad Abdo Al-Ibrahim, Ph.D in Philology and Literature, University Lecturer and former editor in chief of the Syria Times, Syria;
– Jean Bricmont, Author, retired Physics Professor, Belgium;
– Syed Mohsin Abbas, Journalist, Broadcaster, Political Analyst and Political Justice activist, Pakistan;
– Eduardo D. Greaves PhD, Professor of Physics, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela;
– Dora Muanda, Scientific Director, Kinshasa Science and Technology Week, Democratic Republic of Congo;
– Dr. Christian Parenti, Professor of Political Economy, John Jay College CUNY, New York, USA;
– Diogène Senny, President of the Panafrican Ligue UMOJA, Congo Brazzaville;
– Waheed Seyed Hasan, Journalist based in Qatar, former Special correspondent of IRNA in New Delhi, former collaborator of Tehran Times, Iran;
– Alain Corvez, Colonel (retired), Consultant International Strategy consultant, France;
– Stefano Citati, Journalist, Italy;
– Gaston Pardo, Journalist, graduate of the National University of Mexico. Co-founder of the daily Liberacion, Mexico;
– Jan Oberg, PhD, Peace and Future Research, Art Photographer, Lund, Sweden.
– Julie Péréa, City Councilor for the town of Poussan (Hérault), delegate for gender equality and the fight against domestic violence, member of the Sète Agglopole Méditerranée gender equality committee, France;
– Helga Zepp-LaRouche, Founder and International President of the Schiller Institute, Germany;
– Abid Hussein, independent journalist, Pakistan;
– Anne Lettrée, Founder and President of the Garden of Titans, Cultural Relations Ambassador between France and China for the Greater Paris region, France;
– Karel Vereycken, Painter-engraver, amateur Art Historian, Schiller Institute, France;
– Carlo Levi Minzi, Pianist, Musician, Italy;
– Leena Malkki Brobjerg, Opera singer, Sweden;
– Georges Bériachvili, Pianist, Musicologist, France;
– Jacques Pauwels, Historian, Canada;
C. FROM AFGHAN AUTHORITIES
– Sher Mohammad Abbas Stanikzai, Deputy Foreign Minister, Islamic Emirate of Afghanistan (IEA);
– Mawlawi Muhibullah Wasiq, Head of Foreign Minister’s Office, IEA;
– Waliwullah Shahin, Member of Ministry of Foreign Affairs, IEA;
– Sayedull Afghani, Member of Ministry of Foreign Affairs, IEA;
– Hekmatullah Zaland, Member of Ministry of Foreign Affairs, IEA;
– Shafi Azam, Ministry of Foreign Affairs, IEA;
– Atiqullah Azizi, Deputy Minister of Culture and Art, Ministry of Information and Culture, IEA;
– Ghorzang Farhand, Ministry of Information and Culture, IEA;
– Ghulam Dastgir Khawari, Advisor of Ministry of Higher Education, IEA;
– Mawlawi Rahmat Kaka Zadah, Member of ministry of Interior Affairs, IEA;
– Mawlawi Arefullah, Member of Interior Affairs, IEA;
– Ataullah Omari, Acting Agriculture Minister, IEA;
– Mawlawi Hussain Ahmad, Head of office in Ministry of Agriculture, IEA:
– Musa Noorzai, Member of Ministry of Agriculture, IEA;
– Mawlawi Hussain Ahmad, Head of office, Ministry of Agriculture, IEA;
– Mawlawi Shar Aqa, Head of Kunar Agriculture Administration, IEA;
– Matiulah Mujadidi, Head of Communication of Ministry of Finance, IEA;
– Zabiullah Noori, Executive Manager, Ministry of Finance, IEA;
– Akbar Wazizi, Member of Ministry of Finance, IEA;
– Nasrullah Ebrahimi, Auditor, Ministry of Finance, IEA;
– Mir M. Haroon Noori, Representative, Ministry of Economy, IEA;
– Abdul Qahar Mahmodi, Ministry of Commerce, IEA;
– Dr. Ghulam Farooq Azam, Adviser, Ministry of Water & Energy (MoWE), IEA;
– Faisal Mahmoodi, Investment Facilitation Expert, Ministry of Mines and Petroleum, IEA;
– Rustam Hafiz Yar, Ministry of Transportation, IEA;
– Qudratullah Abu Hamza, Governor of Kunar, IEA;
– Mansor Faryabi, Member of Kabul Municipality, IEA;
– Mohammad Sediq Patman, Former Deputy Minister of Education for Academic Affairs, IEA;
COMPLEMENTARY LIST
A. FROM AFGHANS
- Jawad Nikzad, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Dr. Akram Azimi, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Najibullah Totakhel, Ibn-e-Sina R&D Centre, Germany
- Ghulam Farooq Ansari, Professor, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Imran Zakeria, Researcher at Regional Studies Center, Academy of Sciences of Afghanistan, Ibn Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Subhanullah Obaidi, Doctor, Ibn-e-Sina R&D Centre, Germany ;
- Ali Shabeez, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Germany ;
- Mawlawi Wahid Ameen, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Shar M. Amir Zadah, Ibne-eSina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Sayed Rafiullah Halim, Professor, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul Afghanistan ;
- Nazar Mohmmad Ragheb, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Ali Sina Masoumi, Ibn-e-Sina R&D Centre Kabul, Afghanistan ;
- Faisal Mahmoodi, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Fatima Basir, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Muneera Aman, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Abdul Shakoor, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Abdul Waris Ebad, Employee of Ministry of Foreign Affairs, Afghanistan ;
- Waisullah Sediqi, Ibn-e-Sina R&D Centre, Kabul, Afghanistan ;
- Sayed Hakim Aria, Employee of Ministry of Information and Culture, Afghanistan ;
- Nayebuddin Ekrami, Employee of Ministry of information and Culture, Afghanistan ;
- Latifa Azimi, Former Employee of Ministry of Education, Afghanistan ;
- Latifa Noori, Former Employee of Ministry of Education, Afghanistan ;
- Habibullah Haqani, Employee of Kabul Municipality, Afghanistan ;
- Shafiqullah Baburzai, Cultural Heritage, Afghanistan ;
- Abdullah Kamawal, Cultural Heritage, Afghanistan ;
- Abdul Rashid Lodin, Cultural Heritage, Afghanistan ;
- Asef Nang, Cultural Heritage, Afghanistan ;
- Awal Khan Shekib, Member of Afghanistan Regional Studies Center, Afghanistan ;
- Mohammad Anwar Fayaz, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Farhad Ahmadi, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Fayqa Lahza Faizi, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Dr. Hakim Haidar, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Rahimullah Harifal, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Sharifullah Dost, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Eshaq Momand, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Khalil Rahman Barekzal, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Ghulam Haidar Kushkaki, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Ghulam Nabi Hanifi, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Marina Bahar, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Sayed Muhaidin Hashimi, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Abdul Majid Nadim, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Elaha Maqsoodi, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Khadim Ahmad Haqiqi, Lecturer, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Shahidullah Safi, Member, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Abdul Wahab Hamdard, Member, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Burhanullah Niazi, Member, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- M. Alam Eshaq Zai, Member, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Ghulam Hasan Farmand, Member, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Zalmai Hewad Mal, Member, Afghanistan Science Academy, Afghanistan ;
- Abdul Rahman Atash, Head of Afghanistan National Development Company (NDC), Afghanistan ;
- Obaidullah, Head of Public Library, Afghanistan ;
- Sayed Abdul Maqdam, Head of Khawar construction company, Afghanistan ;
- Zaki Zarifi, Head of Zarifi company, Afghanistan ;
- Jamshid Faizi, Head of Faizi company, Afghanistan ;
- M. Yasin Farahman, Head of Agriculture Center, Afghanistan ;
- Mawlawi Nik M. Nikmal, Head of Planning in Technical Administration, Afghanistan ;
- Abdul Wahid Rahimi, Member of Bashtani Bank, Afghanistan ;
- M. Daud Mangal, Head of Ariana Afghan Airlines, Afghanistan ;
- Mostafa Yari, entrepreneur, Afghanistan;
- Gharwal Roshan, Head of Kabul International Airfield, Afghanistan ;
- Eqbal Mirzad, Head of New Kabul City Project, Afghanistan ;
- Najibullah Sadiq, Vice-president of Afghan Chamber of Commerce and Indunstry (ACCI), Afghanistan;
- M. Yunis Mohmand, Vice-president of ACCI, Afghanistan;
- Khanjan Alikozai, Member of ACCI, Afghanistan;
- Mawlawi Abdul Rashid, Kabul Municipality, Afghanistan ;
- Atiqullah Safi, Employee of Kabul Municipality, Afghanistan ;
- Abdul Jalil Safi, Employee of Kabul Municipality, Afghanistan ;
- Hujat Fazli, Head of Harakat, Afghanistan Investment Climate Facility Afghanistan ;
- Dr. Mehrab Hamidi, Member of Economical Commission, Afghanistan;
- Hamid Pazhwak, Economist, Afghanistan ;
- M. Awaz Ali Alizai, Economist, Afghanistan ;
- Shamshad Omar, Economist, Afghanistan ;
- Helai Fahang, Economy Specialist, Afghanistan ;
- Maryam Alikozai, Economy Specialist, Afghanistan ;
- Dunya Farooz, Economy Specialist, Afghanistan ;
- Soman Khamoosh, Economy Specialist, Afghanistan ;
- Drs. Shokoria Yousofi, Bachelor of Economy, Afghanistan;
- Sharifa Wardak, Specialist of Agriculture, Afghanistan;
- M. Asef Dawlat Shahi, Specialist of Chemistry, Afghanistan;
- Pashtana Hamami, Specialist of Statistics, Afghanistan;
- Asma Karimi, Master of Management, Afghanistan;
- Dr. Ahmad Zaki Afghanyar, Vice-President of Herat Health committee, Afghanistan ;
- Dr. Hashem Mudaber, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Hekmatullah Arian, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Abdul Wahab Rahmani, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Karima Rahimyar, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Sayeeda Basiri, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Emran Sayeedi, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Abdul Hadi Dawlatzai, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Ghani Naseri, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Nafisa Naseri, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Abdul Ghani Naseri, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Mohammad Younis Shouaib, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Halima Akbari, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Manizha Emaq, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Shafiq Shinwari, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Akbar Jan Foolad, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Haidar Omar, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Ehsanuddin Ehsan, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Abdul Wakil Matin, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Abdul Matalib, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Azizi Amer, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Nasr Sajar, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Humayon Hemat, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Humaira Fayaq, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Sadruddin Tajik, Medical Doctor, Afghanistan ;
- Dr. Abdul Baqi Ahmad Zai, Surgery Specialist, Afghanistan ;
- Dr. Beqis Kohistani, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Nafisa Nasiri, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Aziza Yousuf, Head of Malalai Hospital, Afghanistan;
- Dr. Yasamin Hashimi, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Zuhal Najimi, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Ahmad Salem Sedeqi, Medical Doctor, Afghanistan;
- Dr. Fazel Raman, veterinary, Afghanistan;
- Khatera Anwary, Health, Afghanistan;
- Rajina Noori, Member of Afghanistan Journalists Union, Afghanistan ;
- Sajad Nikzad, Journalist, Afghanistan ;
- Ahmad Suhaib Hasrat, Journalist, Afghanistan ;
- Shar Aqa Karimi, Journalist, Afghanistan ;
- Sayed Mohammad Suhrabi , Journalist, Afghanistan ;
- Mohammad Nasir Kuhzad, Journalist and Political Analyst, Afghanistan ;
- Fazel Menallah, Political Analyst, Afghanistan;
- M. Wahid Benish, Political Analyst, Afghanistan ;
- Mahmood Jan Shafizada, Political Analyst, Afghanistan ;
- Fazel Rahman Orya, Political Analyst, Afghanistan ;
- Zarghon Shah Shinwari, Political Analyst, Afghanistan ;
- Abdul Ghafor Shinwari, Political Analyst, Afghanistan ;
- Dr. Ahmad Yousufi, Dean, Kateb University, Afghanistan ;
- Dr. Yayia Balaghat, Scientific Vice-President, Kateb University, Afghanistan ;
- Chaman Shah Etemadi, Head of Gharjistan University, Afghanistan;
- Dr. Mesbah, Head of Salam University, Afghanistan;
- Dr. Pirzad Ahmad Fawad, Kabul University;
- Dr. Nasir Nawidi, Dean of a Private University, Afghanistan;
- Zabiullah Fazli, Dean of a Private University, Afghanistan;
- Ramish Adib, Vice of a Private University, Afghanistan;
- M. Taloot Muahid, Dean of a Private University, Afghanistan;
- Ebrahim Ansari, School Manager, Afghanistan;
- Abas Ali Zimozai, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Arshad Rahimi, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Fasihuddin Fasihi, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Waisuddin Jawad, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Murtaza Sharzoi, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Matin Monis, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Mohammad Wahid Benish, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Hussian Iqbal, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Muhsin Reshad, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Mohammad Sadiq Baqori, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Mohammad Zahir Halimi, Univ. Lecturer , Afghanistan ;
- Rohla Qurbani, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Murtaza Rezaee, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Ghulam Rasoul Qarluq, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Najim Wahidi, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Rashid Iqbal, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Abdul Rahman Matin, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Mujtaba Amin, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Amanullah Faqiri, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Abuzar Khpelwak Zazai, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Belal Tayab, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Adel Hakimi, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Wasiqullah Ghyas, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Faridduin Atar, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Safiullah Jawhar, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Amir Jan Saqib, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Ahmad Shekib Rahmani, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Gulzar Hashimi, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- Taj Mohammad, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Hekmatullah Mirzad, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Abdul Haq Atid, Univ. Lecturer, Afghanistan ;
- M. Fahim Momand, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Ahmad Fawad Ehsas, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Naqibullah Sediqi, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Maiwand Wahidi, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- M. Nazir Hayati, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Najiba Rahmani, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Abeda Baba Karkhil, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Dr. M. Qayoum Karim, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Sayed Sharif Shabir, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Ahmad Walid Howaida, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Zalmai Rahib, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Dr. Sadiq Baqori, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Mir Zafaruddin Ansari, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Atta Mohammad Alwak, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Dr. Zabiullah Iqbal, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Dr. Hasan Fazaili, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- M. Jawad Jalili, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Mukhtar Ali Nasto, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Namatullah Nabawi, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Ghulam Abas Noori, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Mustafa Anwari, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Fakhria Popal, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Shiba Sharzai, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Marya Hashimi, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Nilofar Hashimi, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Munisa Hasan, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Nazifa Azimi, Univ. Lecturer, Afghanistan;
- Sweeta Sharify, Lecturer; Afghanistan;
- Fayaz Gul, Lecturer, Afghanistan;
- Zakia Ahmad Zai, Lecturer, Afghanistan;
- Nigani Barati, Education Specialist, Afghanistan ;
- Azeeta Nazhand, Teacher, Afghanistan ;
- Sughra, Teacher, Afghanistan;
- Nadia Sharif, Teacher, Afghanistan;
- Maryam Omari, Teacher, Afghanistan;
- Masoud, Teacher, Afghanistan;
- Zubair Ahmad, Teacher, Afghanistan;
- Khalil Ahmad, Teacher, Afghanistan;
- Khadija Omid, Teacher, Afghanistan;
- Haida Rasouli, Teacher, Afghanistan;
- Hemat Hamad, Teacher, Afghanistan ;
- Wazir Safi, Teacher, Afghanistan ;
- Mohammad Qasim, Teacher, Afghanistan ;
- Zamin Shah, Teacher, Afghanistan ;
- Sayed Qayas, Teacher, Afghanistan ;
- Mehrabuddin, Teacher, Afghanistan ;
- Zahidullah Zahid, Teacher, Afghanistan ;
- Akmal Mahros, Teacher, Afghanistan ;
- Sadia Mohammadi, Teacher, Afghanistan;
- Mina Amiri, Teacher, Afghanistan;
- M. Sajad Nikzad, Teacher, Afghanistan ;
- Mursal Nikzad, Teacher, Afghanistan ;
- Abdul Qadir Shahab, Teacher, Afghanistan;
- M. Hasan Sahi, Teacher, Afghanistan ;
- Mirwais Haqmal, Teacher, Afghanistan ;
- Leeda Khurasai, Teacher, Afghanistan ;
- Karishma Hashimi, Instructor, Afghanistan;
- Majeed Shams, Architect, Afghanistan;
- Azimullah Esmati, Master of Civil Engineering, Afghanistan;
- Najibullah Hussaini, Engineer, Afghanistan ;
- Burhanuddin Nezami, Engineer, Afghanistan ;
- Abdul Hafiz Hafizi, Engineer, Afghanistan ;
- Bahir, Engineer, Afghanistan;
- Wali Bayan, Engineer, Afghanistan;
- Abdul Khaliq Najir, Engineer, Afghanistan;
- Diana Niazi, Engineer, Afghanistan;
- Imam Jan, Engineer, Afghanistan ;
- Khalil Ahmad Nadem, Engineer, Afghanistan;
- Sayeed Aqa, Engineer, Afghanistan ;
- Edris Rasouli, Engineer, Afghanistan ;
- Raz Mohammad, Engineer of Mines, Afghanistan ;
- Nasrullah Rahimi, Technical Engineer, Afghanistan ;
- Ehsanullah, Helmand, Construction Engineer, Netherlands;
- Ahmad Hamad, Technologist, Afghanistan ;
- Akmal Ahmadi, Technologist, Afghanistan ;
- Ershad Hurmati, Technologist, Afghanistan ;
- M. Akram Shafim, Technologist, Afghanistan ;
- M. Akbar Ehsan, Technologist, Afghanistan ;
- Raziullah, Technologist, Afghanistan ;
- Zaki Khorrami, IT Officer, Afghanistan ;
- Osman Nikzad, Graphic Designer, Afghanistan ;
- Maryam Ayani, Carpet Weaver, Afghanistan ;
- Be be sima Hashimi, Tailor, Afghanistan ;
- Maryam Masoumi, Tailor, Afghanistan ;
- Roya Mohammadi, Craftsman, Afghanistan ;
- Nadia Sayes, Craftsman, Afghanistan ;
- Nazdana Ebad, Craftsman, Afghanistan ;
- Sima Ahmadi , Bachelor of Biology, Afghanistan;
- Sima Rasouli, Merchant, Afghanistan ;
- Khatera Nawabi, Merchant, Afghanistan ;
- Haji Noor Agha Haqyar, Merchant, Afghanstan;
- Husna Anwari, Merchant, Afghanistan ;
- Nargis Hashimi, Merchant, Afghanistan ;
- Shakira Barish, Merchant, Afghanistan ;
- Nasima Darwish, Merchant, Afghanistan ;
- Wajiha Haidari, Merchant of Jawzjan, Afghanistan ;
- Shagul, Merchant, Afghanistan ;
- Fatima Nik Rasoul, Merchant, Afghanistan ;
- Haji Farid Alikozai, Merchant, Afghanistan;
- Nigina Nawabi, Merchant, Afghanistan ;
- Masouda Nazimi, Merchant, Afghanistan ;
- Najla Kohistani, Merchant, Afghanistan ;
- Kerisma Jawhari, Merchant, Afghanistan ;
- Hasina Hashimi, Merchant, Afghanistan ;
- Husna Anwari, Merchant, Afghanistan ;
- Maaz Baburzai, Merchant, Afghanistan ;
- Freshta Safari, Merchant, Afghanistan;
- Yalda Azimi, Merchant, Afghanistan ;
- Azim Jan Baba Karkhil, Merchant, Afghanistan ;
- Akhtar Mohammad, Merchant, Afghanistan ;
- M. Haroon Ahmadzai, Merchant, Afghanistan ;
- Azizullah Faizi, Former head of Afghanistan Cricket Board, Afghanistan ;
- Wakil Akhar, Prosecutor, Afghanistan ;
- Akhtar M. Azimi, Prosecutor, Afghanistan;
- Shabnam Noori, Prosecutor, Afghanistan;
- Be be Abeda Wayar, Prosecutor, Afghanistan;
- Madina Ahmad Zai, Prosecutor, Afghanistan;
- Shakila Joya, Former Employee of Attorney General, Afghanistan;
- Sardar M. Akbar Bashash, Member, Afghanistan Balochs Union, Afghanistan ;
- Eng. Abdul Dayan Balouch, Spokesperson of Afghanistan Balochs Union, Afghanistan ;
- Shah Mahmood Lahoti, Member of Afghanistan Balochs Union, Afghanistan ;
- Abdul Khaliq Barekzai, Advisor, Afghanistan Balochs Union, Afghanistan ;
- Salahuddin Ayoubi Balouch, Advisor, Afghanistan Balochs Union, Afghanistan ;
- Faizuddin Lashkari Balouch, Member, Afghanistan Balochs Union, Afghanistan ;
- Sayed Ishaq Gilani, head of the National Solidarity Movement of Afghanistan, IEA;
- Haji Zalmai Latifi, Representative, Qizilbash tribes, Afghanistan ;
- Gul Nabi Ahmad Zai, Former Commander of Kabul Garrison, Afghanistan ;
- Ghulam Hussain Rezaee, Member, Habitat Organization, Afghanistan ;
- Dr. Amani Adiba, Doctor of Liberal Arts in Architecture and Urban Planning, Afghanistan;
- Ismael Paienda, Afghan Peace Activist, France;
- Mohammad Belal Rahimi, Head of Peace institution, Afghanistan ;
- M. Mushtaq Hanafi, Head of Sayadan council, Afghanistan ;
- Sabira Waizi, Founder of T.W.P.S., Afghanistan ;
- Majabin Sharifi, Member of Women Network Organization, Afghanistan;
- Shekiba Saadat, Former head of women affairs, Afghanistan ;
- Atya Salik, Women rights activist, Afghanistan ;
- Fatima Mahmoodi, Women rights activist, Afghanistan;
- Diana Rohin, Women rights activist , Afghanistan;
- Amena Hashimi, Head of Women Organization, Afghanistan;
- Fatanh Sharif, Former employee of Gender equality, Afghanistan;
- Sediq Mansour Ansari, Civil Activist, Afghanistan ;
- Sebghatullah Najibi, Civil Activist, Afghanistan ;
- Naemullah Nasiri, Civil Activist, Afghanistan;
- Reha Ramazani, Civil Activist, Afghanistan ;
- Lia Jawad, Civil Activist, Afghanistan;
- Arezo Khurasani, Social Activist, Afghanistan ;
- Beheshta Bairn, Social Activist, Afghanistan;
- Samsama Haidari, Social Activist, Afghanistan;
- Shabnam Nikzad, Humans Rights Activist, Afghanistan;
- Mliha Sadiqi, Head of Young Development Organization, Afghanistan;
- Mehria, Sharify, University Student;
- Shiba Azimi, Member of IPSO Organization, Afghanistan;
- Nadira Rashidi, Master of Management, Afghanistan;
- Sefatullah Atayee, Banking, Afghanistan;
- Khatira Yousufi, Employee of RTA, Afghanistan;
- Yalda Mirzad , Employee of Breshna Company, Afghanistan;
- Izzatullah Sherzad, Employee, Afghanistan;
- Erfanullah Salamzai , Afghanistan;
- Naser Abdul Rahim Khil, Afghanistan;
- Ghulam Rasoul Faizi, Afghanistan;
- Dr. Mir Agha Hasan Khil, Afghanistan;
- Abdul Ghafor Muradi, Afghanistan;
- Gul M. Azhir, Afghanistan;
- Gul Ahmad Zahiryan, Afghanistan;
- Shamsul Rahman Shams, Afghanistan;
- Khaliq Stanekzai, Afghanistan;
- M. Daud Haidari, Afghanistan;
- Marhaba Subhani, Afghanistan;
- Maazullah Nasim, Afghanistan;
- Haji Mohammad Tayeb, Afghanistan;
- Ali Sina Masoumi, Afghanistan ;
- Sweeta Sadiqi Hotak, Afghanistan ;
- Khatira Anwari, Afghanistan ;
- Fatima Sharzad, Afghanistan ; Momen Shah Kakar, Afghanistan ;
- Shah Rukh Raufi, Afghanistan ;
- Hanifa Rasouli, Kabul, Afghanistan ;
- Qudsia Ebrahimi, Afghanistan ;
- Mahmood Haqiqat, Afghanistan ;
- Nasir Abdul Rahim Khan, Kabul, Afghanistan ;
- Abdul Hamid Ahmadzai, Afghanistan ;
- Sardar Khan Sirat, Afghanistan ;
- Zurmatullah Ahmadi, Afghanistan ;
- Yasar Khogyani, Afghanistan ;
- Shar Sha Lodi, Afghanistan ;
- Ahmad Shah Omar, Afghanistan ;
- M. Azam Khan Ahmad Zai, Afghanistan;
- Nadia Farooq Sharzoi, Afghanistan;
- Shar Ali Tazari, Afghanistan ;
- Mayel Aqa Hakim, Afghanistan ;
- Khatira Hesar, Afghanistan ;
- Tamim Mehraban, Afghanistan ;
- Lina Noori, Afghanistan ;
- Khubaib Ghufran, Afghanistan ;
- M. Yasin Farahmand, Afghanistan ;
- Dr. Mir M. Ayoubi, Afghanistan ;
- Dr. Namatullah Nabawi, Afghanistan ;
- Abozar Zazai, Afghanistan ;
- Atiqullah Rahimi, Afghanistan ;
- Fahim Ahmad Sultan, Afghanistan ;
- Humaira Farhangyar, Afghanistan ;
- Imam M. Wrimaj, Afghanistan ;
- Masoud Ashna, Afghanistan ;
- Dr. Yahia Baiza, Afghanistan ;
- Dr. Besmila, Afghanistan ;
- Ehsan Shorish, Germany;
- Irshad, Omer, Afghanistan;
- Musa Noorzai, Afghanistan;
- Lida Noori Nazhand, Afghanistan;
- Dr. Abdul Masood Panah, Afghanistan;
- Gholam Sachi Hassanzadah, Afghanistan;
- Dr. Sayed Ali Eqbal, Afghanistan;
- Hashmatullah Atmar, Afghanistan;
- Ahmad Matin Safi, Afghanistan;
- Ahmad Helmand, Afghanistan;
- Ehsanullah Helmand, Afghanistan;
- Izazatullah Sherzad, Afghanistan;
- Hafizullah Omarzai, Afghanistan;
- Hedayatullah Hilal, Afghanistan;
- Edris Ramez, student, Afghanistan;
- Amina Saadaty, Afghanistan;
- Muska Hamidi, Afghanistan;
- Raihana Ahmadi, Afghanistan;
- Zuhal Sherzad, Afghanistan;
- Meelad Ahmad, Afghanistan;
- Devah Kubra Falcone, Germany;
- Maryam Baburi, Germany;
- Suraya Paikan, Afghanistan;
- Abdul Fatah Ahmadzai, Afghanistan ;
- Dr. Mohammad Zalmai, Afghanistan ;
- Hashmatullah Parwarni, Afghanistan ;
- Asadullah, Afghanistan;
- Hedayat ullah Hillal, Afghanistan;
- Najibullah Zazai, Afghanistan;
- M. Yousuf Ahmadi, Afghanistan;
- Ahmad Reshad Reka, Afghanistan;
- Sayed Ahmad Arghandiwal, Afghanistan;
- Nooria Noozai, Afghanistan;
- Eng. Fahim Osmani, Afghanistan;
- Wafiullah Maaraj, Afghanistan;
- Roya Shujaee, Afghanistan;
- Shakira Shujaee, Afghanistan ;
- Adina Ranjbar, Afghanistan;
- Ayesha Shafiq, Afghanistan;
- Hajira Mujadidi, Afghanistan ;
- Abdul Zahir Shekib, Afghanistan;
- Zuhra Mohammad Zai, Afghanistan;
- Razia Ghaws, Afghanistan;
- Abdul Sabor Mubariz, Afghanistan;
- Abdul Khaliq Ferdows, Afghanistan;
- Abdul Shakoor Salangi, Afghanistan;
- Nasir Ahmad Basharyar, Afghanistan;
- Mohammad Mukhtar Sharifi, Afghanistan;
- Mukhtar Ahmad Haqtash, Afghanistan;
- Yousuf Amin Zazai, Afghanistan;
- Zakiri Sahib, Afghanistan;
- Mirwais Ghafori, Afghanistan;
- Nesar Rahmani, Afghanistan;
- Shar M. Amir Zadah, Afghanistan;
- Yasin Farahmand, Afghanistan;
- Faizul Haq Faizan, Afghanistan;
- Khaibar Sarwary, Afghanistan;
- Ali Sina Masoumi, Afghanistan;
- Hamidullah Akhund Zadah, Afghanistan;
- Dr. Benish, Afghanistan;
- Hayatullah Fazel, Afghanistan;
- Faizullah Habibi, Afghanistan;
- Abdul Hamid Lyan, Afghanistan;
- Abdul Qayoum Qayoum Zadah, Afghanistan;
- Qazi Qudratullah Safi, Afghanistan;
- Noor Agha Haqyar, Afghanistan;
- Maryan Aiany, Afghanistan;
B. FROM ABROAD
- Odile Mojon, Schiller Institute, Paris, France ;
- Johanna Clerc, Choir Conductor, Schiller Institute Chorus, France ;
- Sébastien Perimony, Africa Department, Schiller Institute, France ;
- Christine Bierre, Journalist, Chief Editor of Nouvelle Solidarité, monthly, France ;
- Marcia Merry Baker, agriculture expert, EIR, Co-Editor, USA ;
- Bob Van Hee,Redwood County Minnesota Commissioner, USA ;
- Dr. Tarik Vardag, Doctor in Natural Sciences (RER), Business Owner, Germany;
- Richard Freeman, Department of Physical Economy, Schiller Institute, USA ;
- Liliana Gorini, chairwoman of Movisol and singer, Italy;
- Ulrike Lillge,Editor Ibykus Magazine, Berlin, Germany ;
- Michelle Rasmussen, Vice President, Schiller Institute in Denmark, amateur musician;
- Feride Istogu Gillesberg, Vice President, Schiller Institute in Denmark;
- Jason Ross, Science Department, Schiller Institute, USA ;
- Dennis Small, Director of the Economic Department, Schiller Institute, USA ;
- Robert “Bob” Baker, Agriculture Commission, Schiller Institute, USA ;
- Dr. Wolfgang Lillge, Medical Doctor, Editor, Fusion Magazine, Berlin, Germany ;
- Ulf Sandmark, Vice-Chairman of the Belt and Road Institute, Sweden ;
- Mary Jane Freeman, Schiller Institute, USA ;
- Hussein Askary, South West Asia Coordinator, Schiller Institute, Sweden ;
- David Dobrodt, EIR News, USA ;
- Klaus Fimmen, 2nd Vice-Chairman of the Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Büso) party, Germany;
- Christophe Lamotte, Consulting Engineer, France ;
- Richard Burden, EIR production staff, USA ;
- Rolf Gerdes, Electronic Engineer, Germany;
- Marcella Skinner, USA ;
- Delaveau Mathieu, Farm Worker, France ;
- Shekeba Jentsch, StayIN, Board, Germany;
- Bernard Carail, retired Postal Worker, France ;
- Etienne Dreyfus, Social Activist, France ;
- Harrison Elfrink, Social Activist, USA ;
- Jason Seidmann,USA ;
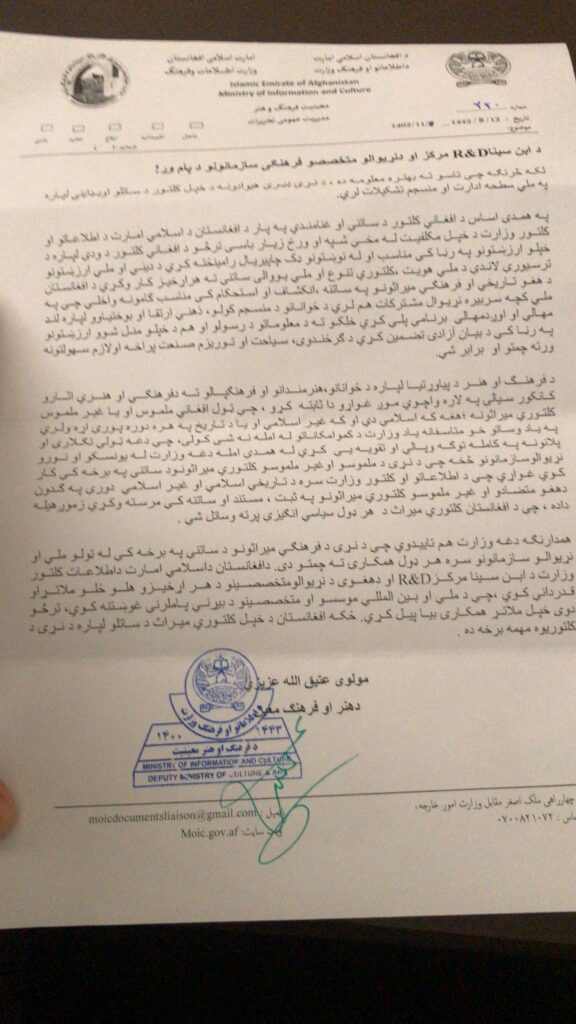
Letter of the minister of Information and Culture
Since Western researchers, based on what happened in the past, wondered about the current Afghan government’s actual policy on the issue of preservation of cultural and historical heritage, the Ibn-e-Sina Research and Development Center questioned the relevant authorities in Kabul.
At the end of January 2024, the Minister of Arts and Culture, in an hand-signed letter, provided them (and the world) with the following response, which completely clarifies the matter.
Transcript below, bold as in the original.
Islamic Emirate of Afghanistan
Ministry of Information and Culture
Letter N° 220, Jan. 31, 2024
To the attention of Ibn-e-Sina R&D Centre, International experts and cultural organizations and to those it concerns:
The ministry of Information and culture of the Emirate of Afghanistan (IEA) has, among others, the following tasks in its portfolio:
–To establish a suitable environment for the growth of genuine Afghan culture;
–To protect national identity, cultural diversity, and national unity;
–To preserve tangible and intangible cultural heritage;
–To support the development of creativities, initiatives and activities of various segments of the society in general and of the Afghan youth in particular;
–To support the freedom of speech;
–Development of tourism industry;
–Introduction and presentation of Afghan culture regionally and internationally, to transform Afghanistan into an important cultural hub and crossroads in the near future.
We would like to confirm that with preservation of tangible and intangible cultural heritage we mean all Afghan cultural heritage belonging to all periods of history, whether it belongs to Islamic or non/pre-Islamic periods of history.
This ministry expresses its concerns that due to insufficient means it is not able to preserve the Afghan cultural heritage sufficiently.
Therefore this ministry asks UNESCO and other international organizations, working on preservation of the world’s tangible and intangible cultural heritage, to support Afghanistan in preservation of its tangible and intangible cultural heritage, including the ones belonging to Islamic and non/pre-Islamic periods of its history. The cultural heritage of Afghanistan does deserve to be preserved without any political motivations.
Besides, this ministry also confirms it is ready for all kind of cooperation with all national and international organizations, working on preservation of world cultural heritage.
The ministry of Information and culture of the Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) supports and appreciates all efforts of the Ibn-e-Sina R&D centre and their international experts in appealing for urgent attention of national and international organizations and experts to resume their support and cooperation with Afghanistan to preserve its cultural heritage, an important part of world cultural and historical heritage.
Sincerely,
Mowlavi Atiqullah Azizi
Deputy Minister of Culture and Art
moicdocymentsliaison@gmail.com
Afghanistan : « Le pays des 1000 cités d’or » et l’histoire d’Aï Khanoum



Invité par le Centre de recherche et de développement Ibn-e-Sina en tant que représentant de l’Institut Schiller, Karel Vereycken est intervenu le 7 novembre à la conférence sur la reconstruction du pays.
Son propos introductif, devant un groupe de travail composé d’historiens, d’archéologues et de membres de l’Académie des sciences d’Afghanistan, a donné lieu à une longue après-midi d’échanges sur le rôle de l’art, la méthodologie scientifique et les combats à mener pour sortir l’Afghanistan de son isolement et préserver un héritage culturel qui certes est afghan, mais appartient à toute l’humanité.
Parler de la culture d’un pays étranger est toujours une chose difficile, surtout si l’on n’en connaît pas la langue et si l’on n’a pas pu séjourner et voyager dans le pays pendant de longues périodes. Par conséquent, je ne peux que vous offrir mes impressions de l’extérieur et commenter ce que j’ai découvert dans des livres. Vous allez donc m’aider en me corrigeant et en me signalant ce qui a échappé à mon attention.
L’Afghanistan est un pays fascinant. Sa réputation de « tombeau des Empires » a capté mon imagination. Récemment, votre pays s’est émancipé de l’occupation américaine et de l’OTAN. Une poignée de combattants déterminés a mis en déroute un immense empire déjà en train de s’autodétruire. 34 ans plus tôt, le pays avait chassé l’occupant russe, après avoir résisté à l’Empire britannique au cours des trois guerres anglo-afghanes du XIXe siècle (1839-42, 1878-80 et 1919), alors que Londres, engagé dans le « Grand Jeu » (Great Game), tentait d’empêcher la Russie d’accéder aux mers chaudes.
Pour éviter d’être colonisé à la fois par la Russie et la Grande-Bretagne, l’Afghanistan a même courageusement refusé d’avoir des chemins de fer, ce qui explique qu’il n’existe aujourd’hui que 300 km de voies ferrées, une situation bien sûr inacceptable aujourd’hui.
Cette capacité de résistance et ce sentiment de dignité découlent, j’en suis convaincu, du fait que votre pays a su faire siennes les diverses influences qui s’y sont rencontrées. Voilà ce qui est devenu au fil des siècles le socle d’une forte identité afghane, totalement à l’opposé de l’étiquette tribale que les colonisateurs cherchent à lui coller.
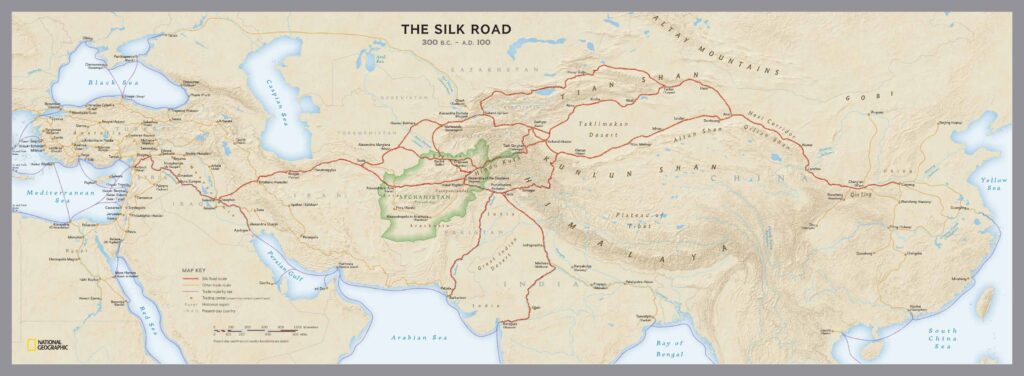
J’aborderai uniquement, aujourd’hui, l’influence grecque, qui s’est avérée majeure à partir du moment où Alexandre le Grand traverse le Hindou Kouch, en 329 av. JC.
Dès lors, des dizaines de milliers de colons grecs, appelés Ioniens, s’installent en Asie centrale.
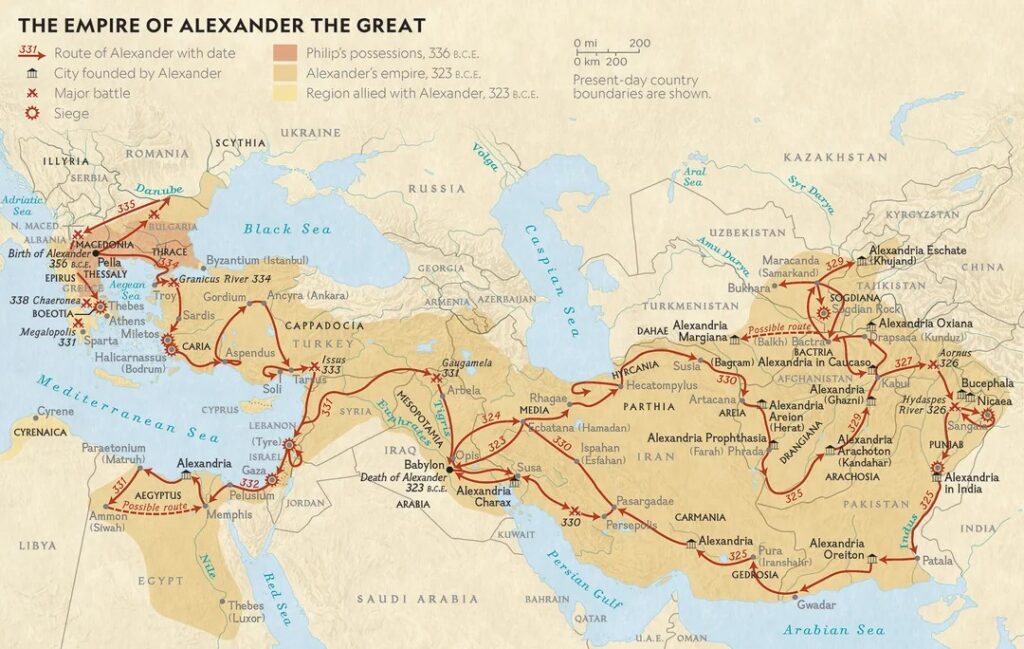
Sous le règne de ses successeurs concurrents, l’immense empire d’Alexandre le Grand se décompose en plusieurs entités et royaumes.
En 256 av. JC, Diodote Ier Soter fonde en Afghanistan le royaume gréco-bactrien, connu sous le nom de « Bactriane », dont le territoire englobe une grande partie de l’Afghanistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan actuels, ainsi que certaines parties de l’Iran et du Pakistan. L’influence grecque y perdure au moins jusqu’à l’arrivée de l’Islam au VIIIe siècle.
La Bactriane
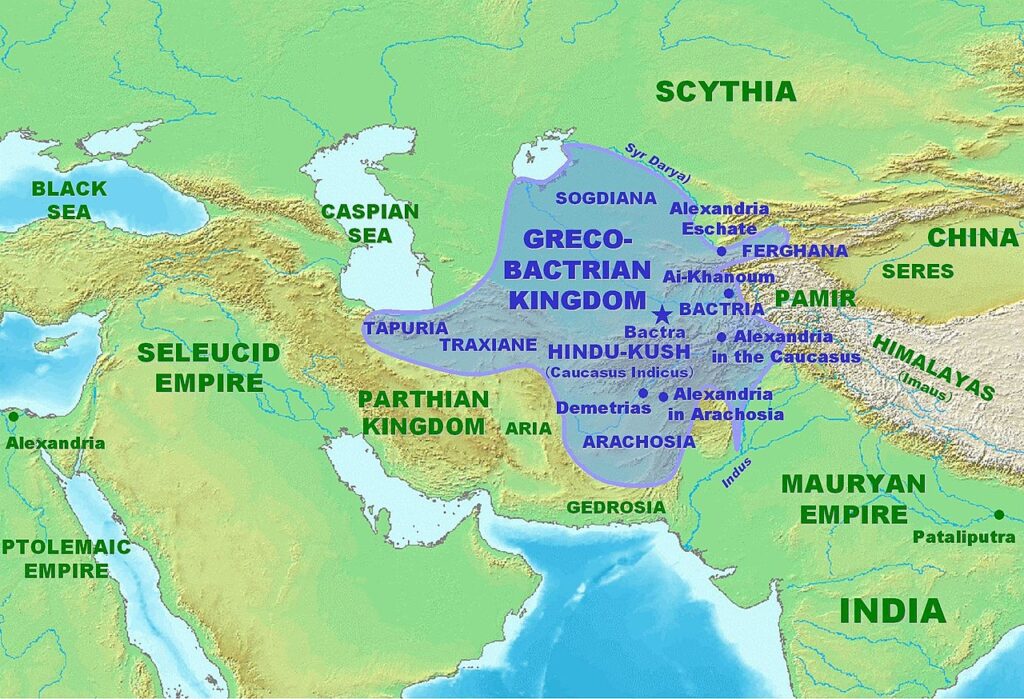
De nombreuses fouilles archéologiques confirment un développement urbain, économique, social et culturel remarquable.
Strabon (64 av. JC – 24 après JC), comme d’autres historiens grecs, qualifiait déjà la Bactriane de « Terre des mille cités », une terre que tous les écrivains, anciens et modernes, louaient pour la douceur de son climat et sa fertilité, car « la Bactriane produit tout, sauf de l’huile d’olive. »
Pour le naturaliste romain Pline l’Ancien (23 – 79 après JC), en Bactriane,
« les grains de blé poussent si gros qu’un seul grain est aussi gros que nos épis. »
Sa capitale Bactres (aujourd’hui Balkh, proche de Mazâr-e Charîf au nord de l’Afghanistan), « Mère des cités », figure parmi les villes les plus riches de l’Antiquité.


C’est là qu’Alexandre le Grand épouse Roxana (« Petite étoile ») et adopte l’habit perse pour pacifier son Empire. C’est également là que naîtra le père du grand médecin et philosophe Ibn Sina (Avicenne), avant de s’installer à Boukhara (Ouzbékistan).
Au fil du temps, la Bactriane sera le creuset de cultures et de civilisations où se mêlent, sur le plan artistique, architectural et religieux, traditions grecques et cultures locales.
Si le grec y est la langue de l’administration, les langues locales y foisonnent. Rien que les noms des villes démontrent la prédominance de la culture hellénique.
Ainsi, Ghazni s’appelle « Alexandrie en Opiana », Bagram « Alexandrie au Caucase », Kandahar « Alexandrie Arachosia », Hérat « Alexandria Ariana », etc., et la liste ne s’arrête pas là.

La ville de Gonur Depe (actuellement au Turkménistan, au nord de Mary, l’ancienne Merv), capitale du Royaume de Margiane, est un autre exemple de ce qu’on s’accorde maintenant à appeler la « Culture de l’Oxus »)
Aï Khanoum, la grecque

Si certaines villes ne font que changer de nom, d’autres sont construites ex nihilo. C’est le cas d’Aï Khanoum (« Dame Lune » en ouzbek), cité érigée au confluent du grand fleuve Amou Daria (l’Oxus des Grecs) et de la rivière Kokcha.
En 1961, le roi d’Afghanistan (Mohammed Zahir Shah), voulant marquer son indépendance vis-à-vis des Soviétiques et des Américains, invite la France à participer aux fouilles.
C’est le Département des archéologues français en Afghanistan (DAFA) qui met au jour les vestiges d’un immense palais dans la ville basse, ainsi qu’un grand gymnase, un théâtre pouvant accueillir 6000 spectateurs, un arsenal et deux sanctuaires.
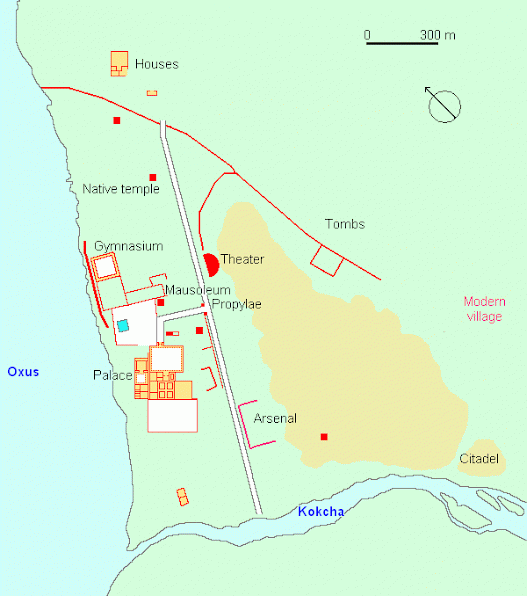
Entourée de terres agricoles bien irriguées, la ville elle-même était divisée entre une ville basse et une acropole de 60 mètres de haut.
Bien qu’elle n’est pas située sur une route commerciale majeure, Aï Khanoum commande l’accès aux mines du Hindou Koush. De vastes fortifications, continuellement entretenues et améliorées, entourent la ville.
Un monument au cœur de la ville y présente une stèle inscrite en grec avec une longue liste de maximes incarnant les idéaux de la vie grecque. Celles-ci sont copiées de Delphes et se terminent par :
« Dès l’enfance, apprends les bonnes manières ;
dans la jeunesse, maîtrise tes passions ;
dans la vieillesse, sois de bon conseil ;
dans la mort, n’aie aucun regret. »
L’architecture du site indique que les colons grecques y vivent en bonne entente avec les populations locales. Elle est très grecque mais intègre en même temps diverses influences artistiques et éléments culturels que les Ioniens ont pu observer au cours de leur voyage du bassin méditerranéen à l’Asie centrale. Par exemple, ils utilisent les styles néo-babylonien et achéménide pour la construction de leurs cours.
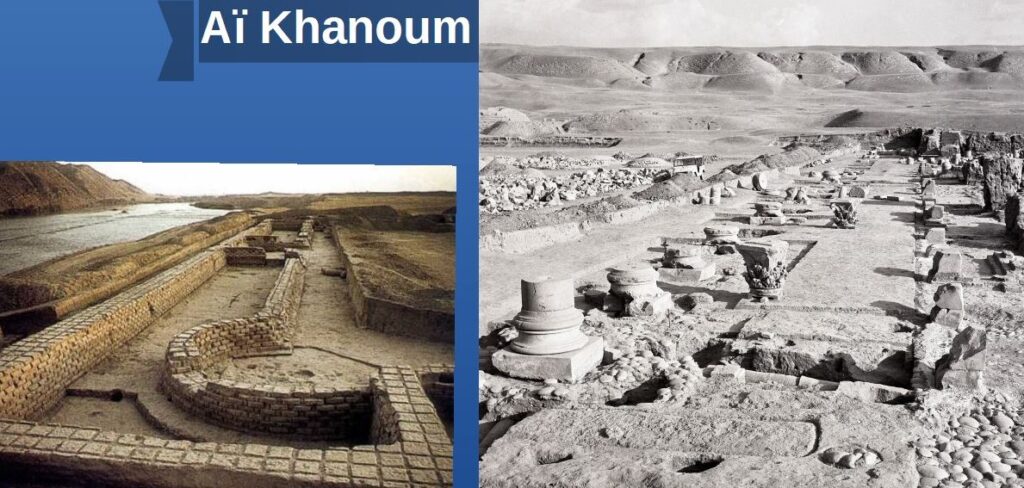
Shortugai et la Civilisation de la vallée de l’Indus

La date précise des premières fondations d’Aï Khanoum reste inconnue.
A une jetée de là, Shortugai, avant-poste commercial et minier de la fameuse civilisation de l’Indus (dite « harappéenne ») qui, au IIIe millénaire avant notre ère, était à l’avant-garde sur le plan de l’irrigation et de la maîtrise de l’eau. (voir notre article)
Des scientifiques de l’Institut indien de technologie de Kharagpur et du Service archéologique d’Inde ont publié le 25 mai 2016, dans la revue Nature, les fruits d’une recherche qui permettrait de dater la civilisation harappéenne d’au moins 8000 ans avant JC et non 5500 ans, comme on le croyait jusqu’à présent. Cette découverte majeure signifierait qu’elle serait encore plus ancienne que les civilisations mésopotamienne et égyptienne.
Shortugai est construite avec des briques standardisées typiques de la vallée de l’Indus. Des sceaux de la civilisation de la vallée de l’Indus ont également été trouvés sur d’autres sites archéologiques d’Afghanistan.
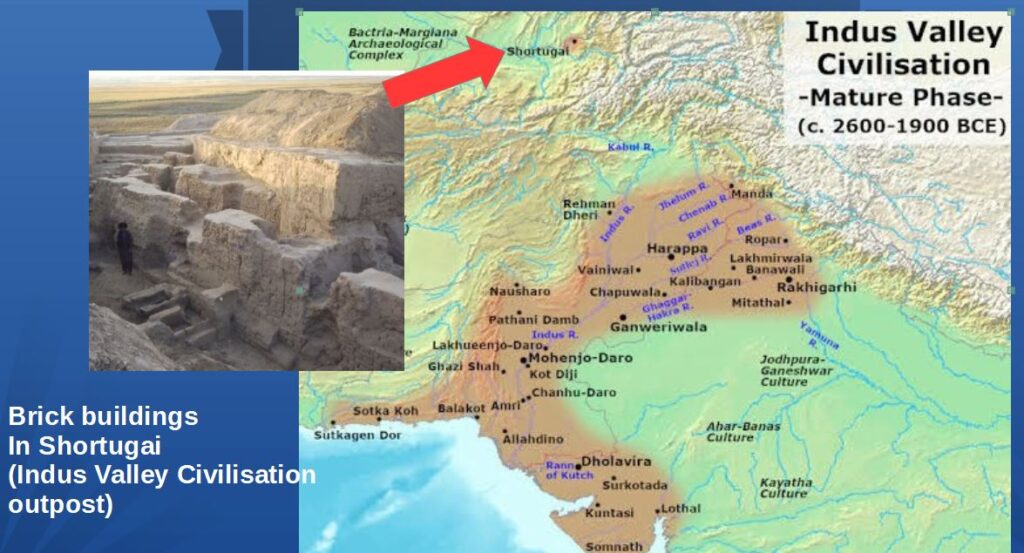
Pendant plusieurs siècles, Shortugai a fonctionné comme un site minier exceptionnel pour l’extraction de l’étain (un minerai indispensable pour la fabrication du bronze), de l’or et du fameux lapis-lazuli, cette pierre précieuse bleue qui, avec l’or, habille de sa splendeur la tombe du pharaon égyptien Toutankhamon et d’autres tombes religieuses majeures en Mésopotamie (Irak).
Les données archéologiques démontrent que Shortugai commerçait avec ses voisins d’Aï Khanoum et construisit les premiers systèmes d’irrigation de la région, une spécialité de la civilisation de la vallée de l’Indus.
Bien des sites restent inexplorés en Afghanistan, pays où les guerres, les occupations étrangères et les pillages ont perturbé ou rendu impossible les recherches archéologiques.
Voici quelques-unes des découvertes de la DAFA, dont certaines restent exposées au Musée national de Kaboul.
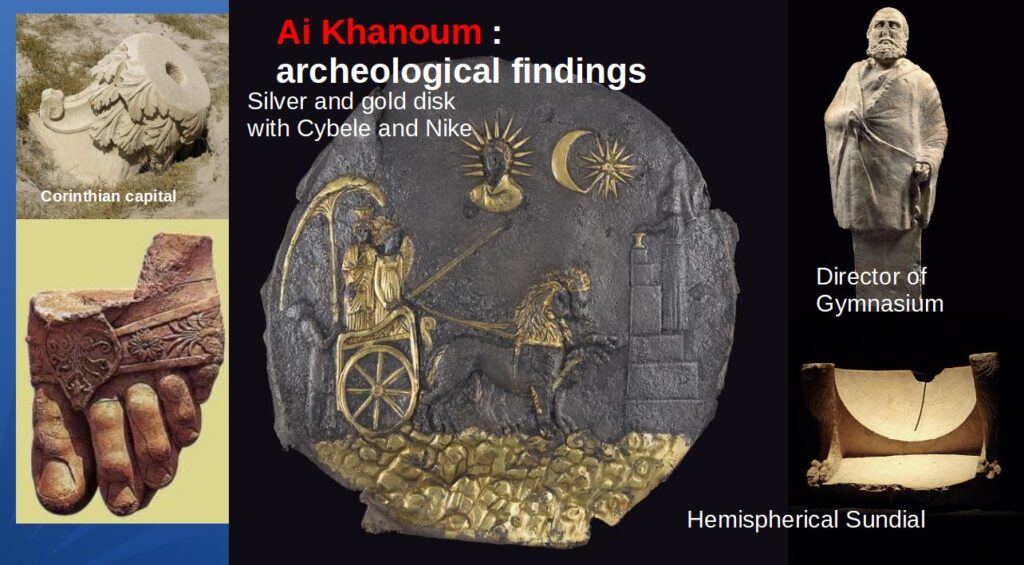

Relations avec l’Inde

Ce qu’on a trouvé à Aï Khanoum, les pièces de monnaie, les objets et les céramiques, notamment d’origine indienne, témoigne qu’il s’agissait d’une importante plaque tournante du commerce avec l’Inde.
En 258 avant notre ère, Ashoka le Grand, souverain de l’empire Maurya (l’État dominant en Inde), fait ériger ce que l’on appelle « l’Edit grec d’Ashoka à Kandahar », une inscription rupestre bilingue, en grec et en araméen. Une autre inscription d’Ashoka était rédigée uniquement en grec.
Le contenu même de ces édits donne également une indication claire du niveau des échanges entre l’Inde et le monde hellénistique. Par exemple, dans son XIIIe édit, Ashoka, faisant preuve d’érudition, énumère avec précision tous les souverains du monde hellénistique de son époque.
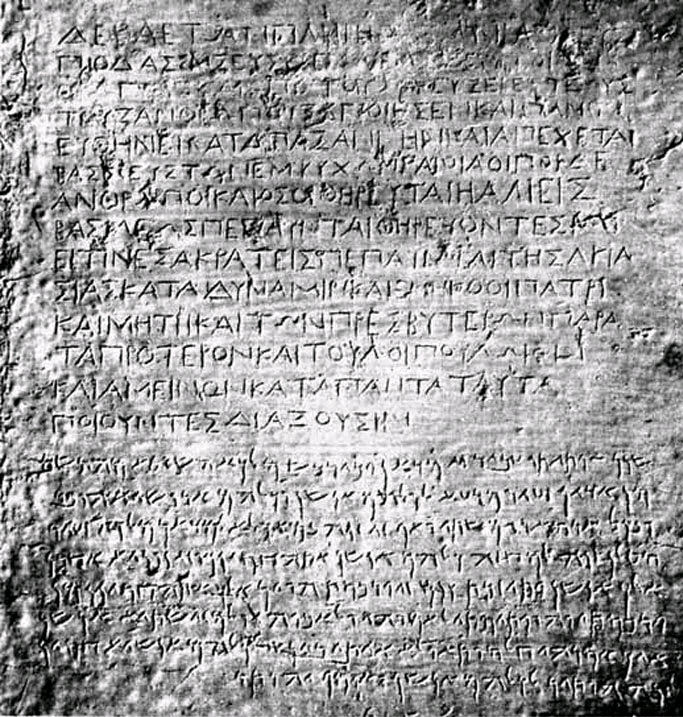
Relations avec la Chine
Outre son interaction avec le sous-continent indien, la Bactriane établira des contacts avec une puissance située encore plus à l’est : la Chine.
À la fin du IIe siècle avant JC, Zhang Qian, diplomate et explorateur de la dynastie Han, arrive en Bactriane. Le récit de sa visite, y compris son étonnement d’y trouver des marchandises chinoises sur les marchés (acquises via l’Inde), ainsi que ses voyages dans le reste de l’Asie centrale, sont conservés dans les œuvres de l’historien Sima Qian.

À son retour en Chine, Zhang Qian informe l’empereur de l’existence de civilisations urbaines sophistiquées en Asie centrale : le Dayuan (vallée de la Ferghana), la Bactriane (Afghanistan) et la Partie (nord-est du plateau iranien).
Les découvertes de Zhang Qian incitent l’empereur à envoyer des émissaires chinois en Asie centrale pour y favoriser le commerce avec la Chine. Certains historiens n’hésitent pas à qualifier cette décision de l’Empereur chinois de « naissance de la Route de la soie ».
Déclin et chute

Une grande partie des ruines actuelles d’Aï Khanoum datent de l’époque d’Eucratides Ier (172-145 av. JC), qui a considérablement réaménagé la ville et l’a peut-être rebaptisée Eucratideia, d’après son nom.
Il fut assassiné en 145 av. JC. par son fils. Un an plus tard, le royaume s’effondre face à l’invasion des nomades.
Aï Khanoum est pillée une première fois en 145 av. JC par les Sakas, des tribus iraniennes d’origine scythe, suivis quinze ans plus tard par les nomades chinois Yuezhi.
Le « complexe du trésor » d’Aï Khanoum montre des signes de pillage lors de deux assauts, à quinze ans d’intervalle. D’après des témoins oculaires, certaines villes se sont arrangées avec les envahisseurs et organisèrent une coexistence pacifique. Les villes qui ont résisté, comme Aï Khanoum, ont été pillées et incendiées.
L’empire Kouchan

Les nomades chinois Yuezhi se sédentarisent et créent au début du Ier siècle l’Empire kouchan, qui englobe une grande partie de ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde du Nord.
Son territoire s’étend de l’Asie centrale et du Gandhara (frontière occidentale actuelle du Pakistan) à Pataliputra, dans la plaine du Gange (Inde d’aujourd’hui). La capitale principale de son empire était située à Purushapura (aujourd’hui Peshawar au Pakistan).

C’est sous le règne de Kanishka le Grand (vers 127-150) que l’Empire kouchan deviendra célèbre pour ses réalisations militaires, politiques et spirituelles. Kanishka échange des ambassadeurs avec l’empereur romain Marc Aurèle (161-180) et l’empereur Han de Chine. Il noue des contacts diplomatiques avec la Perse sassanide et le royaume d’Aksoum (Yémen et Arabie saoudite d’aujourd’hui).
Si la dynastie kouchane reprend la tradition gréco-bactrienne, elle se forge peu à peu sa propre identité.
Les artistes kouchans enrichirent la sculpture bouddhique en donnant à Bouddha la forme humaine, innovation qui fut la plus importante de l’époque.
En 127, Kanishka remplace le grec par le bactrien, une langue moyenne iranienne utilisant l’alphabet grec.
Le bouddhisme
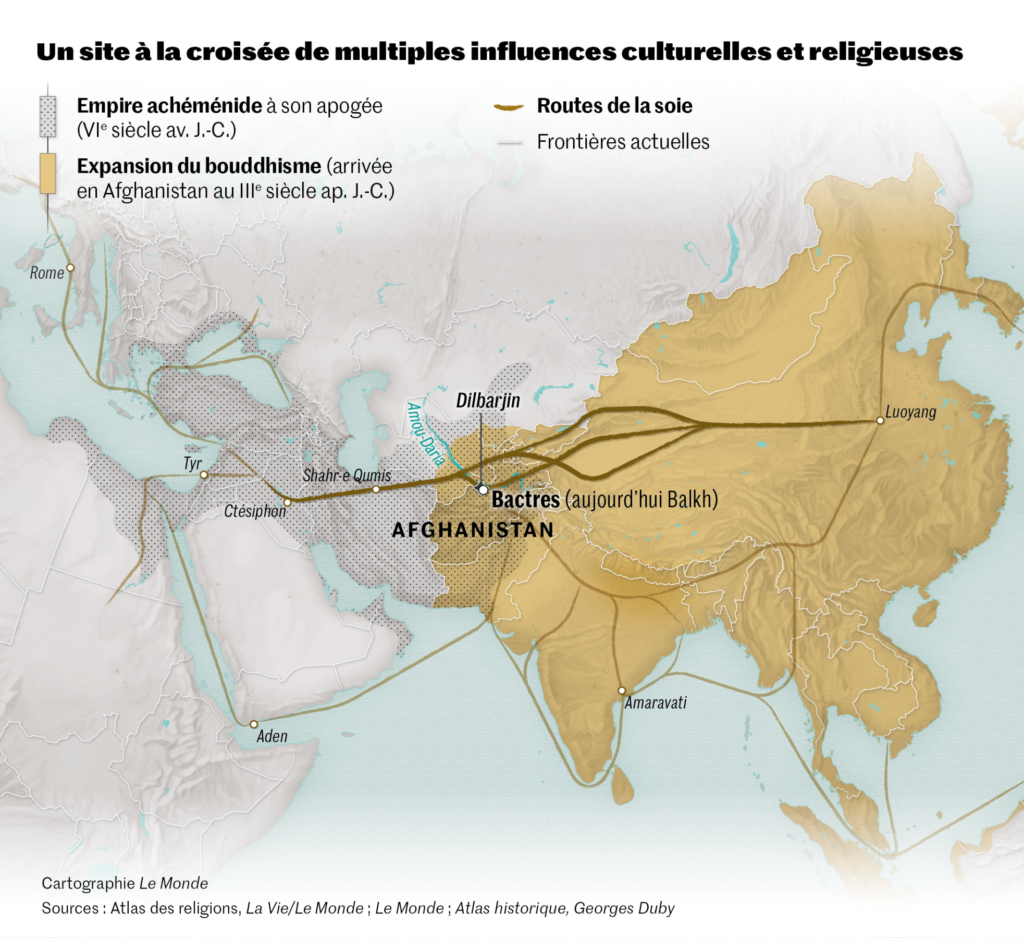
Les Kouchans joueront également un rôle majeur dans la transmission du bouddhisme. Le rayonnement de cette religion venue des rives du Gange favorisera celui des Routes de la soie.
Dans le domaine de la religion, les Kouchans, initialement attirés par l’hindouisme, joueront un rôle majeur dans la transmission du bouddhisme mahayana du Gandhara vers la Chine, l’Asie centrale et même le Sri Lanka, favorisant ainsi l’expansion de la route de la soie.
Tous ces facteurs ont inauguré une période de paix relative de 200 ans, connue comme la « Pax Kouchana ».
À partir du milieu du IIIe siècle après JC, l’Empire kouchan, affaibli, commence à se désintégrer. Dans sa partie occidentale, il passe sous le contrôle des Kushanshahs, c’est-à-dire les Indo-Sassanides (perses), progressivement supplantés au nord par les Hephtalites (appelés également les « Huns blancs » ou « Huns iraniens ») venus de la steppe d’Asie centrale.
Le bouddhisme connaît néanmoins une période de grande prospérité, comme l’illustrent les descriptions du moine chinois Xuanzang du VIIe siècle ainsi que la construction des statues géantes de bouddhas dans la vallée de Bamiyan en Afghanistan.

L’Islam
Après avoir conquis l’Iran, l’islam pénètre l’Afghanistan par le nord. Il n’y a pas de preuve d’un rejet massif de la nouvelle religion, sauf dans des régions isolées. Cependant, la volonté de rester indépendants des gouverneurs nommés par Damas (Omeyyades) puis par Bagdad (Abassides) se manifeste rapidement. C’est même à partir d’une province couvrant une partie du nord de l’Afghanistan, le Khorasan, que se répand initialement une partie de l’insurrection contre les Omeyyades pour les remplacer par le califat abbasside d’Haroun-al-Rachid, plus humaniste, et la création de Bagdad (voir notre article).
À partir de la fin du Xe siècle, une dynastie d’origine turque, les Ghaznévides, bâtit autour de leur capitale Ghazni (Afghanistan) un vaste sultanat qui s’étend jusqu’en Inde et fonde une communauté musulmane durable.


Leur influence culturelle se mesure par la beauté de l’architecture qu’ils nous ont laissée, mais aussi par le patronage qu’ils accordèrent au grand poète épique Ferdowsi (940-1025), à qui l’on doit la grande épopée nationale en langue persane, le Shahnameh : Le livre des rois.
Les Ghaznévides ont été suivis par une nouvelle dynastie, les Ghorides, originaire de la partie centrale de l’Hindou Kouch. C’est à eux que l’on doit l’impressionnant minaret de Jam.
Ce riche patrimoine culturel, qui a jeté les bases de leur identité et qui a donné sa dignité au peuple afghan, a été ignoré, détruit par les guerres successives, pillé et saccagé.
Fortement combattu par les talibans au pouvoir à Kaboul, ISIS, Daech et d’autres groupes terroristes, dont certains encouragés en sous-main par des agences de renseignement occidentales se sont livrés à un pillage à échelle quasi-industrielle du patrimoine culturel afghan. Pour eux, la revente d’objets d’art et d’antiquités est une des principales sources de revenus.
Recommandations
Aujourd’hui, le temps est venu d’un nouveau départ. L’Afghanistan peut changer complètement son image dans le monde, qui a été polluée par des adversaires et des ennemis qui veulent maintenir l’Afghanistan comme une zone de non-développement pour leur propre grand jeu géopolitique.
Ma proposition pour renouveler la contribution de l’Afghanistan à la culture mondiale est simple.
Avec Mes Aynak, qui signifie « petite mine », située à 35 km au sud de Kaboul, l’Afghanistan dispose du deuxième plus grand gisement de cuivre au monde. Alors que la Chine et les autres pays du BRICS ont besoin de ce métal précieux pour leur développement industriel, la mine offrira un revenu substantiel dont l’Afghanistan a un besoin urgent pour reconstruire le pays.
Le 25 mai 2008, Ibrahim Adel, ministre des Mines, et Shen Heting, directeur général de MCC, l’actionnaire majoritaire du consortium MCC-Jiangxi Copper MJAM, ont signé le contrat minier de Mes Aynak.
Ce contrat décrivait les conditions du premier grand projet minier et du plus important investissement étranger en Afghanistan. Cependant, suite à des incidents de sécurité qui ont créé d’importants problèmes d’insécurité, et sous la pression des puissances étrangères, le projet a été bloqué.

Paradoxalement, cela a donné aux archéologues le temps de mettre au jour sur le site minier une zone de 40 ha d’une valeur culturelle exceptionnelle de classe mondiale, principalement un vaste complexe de monastères bouddhistes, comprenant des stupas (temples), des peintures murales, des sculptures et des centaines d’artefacts archéologiques, etc.
Même si le contrat (fichier pdf) a pu être modifié depuis 2008, on ne peut que constater que le contrat initial contient une série d’aspects potentiellement très intéressants, à la fois pour la Chine mais surtout pour l’Afghanistan lui-même.
- EXPORTER DU MÉTAL, PAS DU MINERAI
De même que la Bolivie ne veut pas exporter du lithium (matière première) mais des batteries (produit fini transformé à haute valeur ajoutée), l’Afghanistan ne veut pas exporter du minerai de cuivre mais du cuivre métal. Pour atteindre cet objectif, le contrat prévoit la construction d’une fonderie sur le site.
Paragraphe IV, 33 : « Afin de respecter son engagement envers le gouvernement de financer, construire et exploiter une fonderie en Afghanistan, la MCC a demandé au gouvernement de lui donner accès à des gisements de phosphates, de calcaire et de quartz qu’elle pourra utiliser dans le cadre du projet Aynak. » - ACHATS LOCAUX
Paragraphe VII, 38 : « MCC s’efforce d’acheter des biens et des services en Afghanistan s’ils sont disponibles. » - MAIN-D’ŒUVRE LOCALE
Paragraphe VIII, 39, a : « MCC emploie du personnel afghan, dans toute la mesure du possible. » - APPROVISIONNEMENT EN EAU
Paragraphe IV, 32 : « MCC s’est engagée auprès du gouvernement à construire des puits d’approvisionnement en eau et des systèmes de canalisation … pour répondre aux besoins en eau douce du projet. La MCC s’est également engagée à réutiliser et à recycler l’eau de traitement dans la mesure du possible. » - CENTRALE AU CHARBON
Paragraphe IV, 31 : « MCC s’est engagée auprès du ministère des Mines à construire … une centrale au charbon d’une capacité de 400 mégawatts pour fournir de l’énergie électrique au projet et à Kaboul. » - CHEMIN DE FER
Paragraphe IV, 30 : « MCC s’est engagée à construire un chemin de fer associé au projet ». - LOGEMENT
Paragraphe IV, 24 : « MCC doit fournir des logements de qualité et en quantité suffisante à ses salariés et à leurs familles immédiates, à un prix de location raisonnable. » - SOINS MÉDICAUX
Paragraphe IV, 25 : « MCC fournira des soins médicaux gratuits à tous ses salariés et à leurs familles… et établira, dotera en personnel et entretiendra des dispensaires, des cliniques et des hôpitaux en nombre suffisant … » - ÉCOLES
Paragraphe IV, 26 : « MCC doit fournir gratuitement un enseignement primaire et secondaire adéquat aux enfants de tous les salariés et résidents de la zone entourant Aynak. » - CADRE DE VIE
Paragraphe IV, 27 : « MCC construira et financera le fonctionnement de centres d’activités récréatives adéquats tels que des gymnases et des terrains de sport. … En outre, il construira un marché/une zone commerciale. » - RELIGION
Paragraphe IV, 28 : « MCC respectera et protégera les convictions religieuses du peuple afghan. »
Le monde serait stupéfait en constatant que l’Afghanistan mobilise ses meilleurs architectes et urbanistes pour construire une nouvelle ville à Mes Aynak qu’il baptisera poétiquement, l’« Aï Khanoum du XXIe siècle ».
A Kaboul, un archéologue de premier plan qui travaille sur le site depuis une décennie, m’a confié avec une joie non-dissimulée que, suite à d’intenses discussions en octobre dernier entre les autorités afghanes et l’entreprise chinoise, une issue heureuse a été trouvée.
A l’heure actuelle, dit-il, les deux parties ont convenu de préserver, non plus une infime partie du site archéologique (la partie centrale avec les temples bouddhistes), mais l’ensemble des vestiges historiques du site en surface. A en croire mon interlocuteur, la décision est prise que l’ensemble du site sera désormais exclusivement exploité par la technique d’exploitation minière souterraine. N’en déplaise à la presse occidentale, le sauvetage de Mes Aynak révèle au monde le vrai visage du nouveau gouvernement afghan.
Il rendra également pensable, d’ici un certain temps, la reconstruction des bouddhas géants de la vallée de Bamiyan, l’un de 55 mètres et l’autre de 38 mètres, détruits en 2001. Plusieurs experts, lors de colloques récents de l’UNESCO, ont précisé que les difficultés techniques ne sont pas insurmontables, les bouddhas étant fabriqué en stuc. Le soi-disant « danger » que les sculptures soient considérées comme « fausses » n’a aucun sens, tant que l’intention d’atteindre un bien supérieur par leur reconstruction est réelle.
La « Proposition technique pour la revitalisation des statues du Bouddha de Bâmiyân » de 2017, élaborée par le département d’architecture de l’université japonaise Mukogawa Women’s University, mérite d’être examinée. Sans doute pourra-t-on faire mieux, mais elle a le mérite d’exister. Des chercheurs chinois se disent également prêts à donner un coup de main.
Rappelons que le monde compte 620 millions de bouddhistes qui considèrent Bamiyan comme une partie de leur culture et pourraient envisager de venir en Afghanistan pour mieux comprendre leur propre histoire.
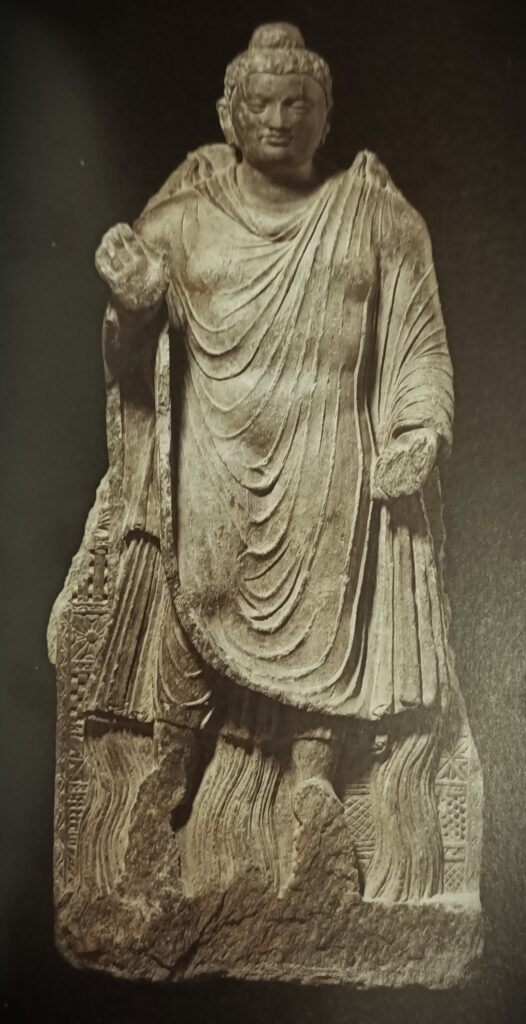
Si l’Afghanistan indiquait clairement au monde qu’il a décidé de renforcer ses activités économiques et minières tout en protégeant, notamment grâce à l’aide généreuse de la Chine, le patrimoine culturel mondial sur son sol, il apparaîtra aux yeux de tous ce qu’il est désormais aujourd’hui : une force du bien, de la tolérance et de la paix dans le monde, en cohérence avec sa propre identité et son histoire.
L’Afghanistan apparaîtra comme le « Bouddha de feu » (IIe-IIIe siècle) du Musée national de Kaboul, où l’on voit la réponse donnée par Bouddha à un défi lancé par des hérétiques selon lequel il ne pouvait pas faire de miracles.
Connu sous le nom de « miracles jumeaux », on y voit Bouddha confiant avec des flammes sortant de ses épaules et des cours d’eau de ses pieds ! En altérant ces deux flux, dit la légende, Bouddha a même fait apparaître un arc-en-ciel !
En augmentant sa production d’énergie et en gérant d’une façon plus intelligence ses ressources en eau, l’Afghanistan démontrera, j’en suis convaincu, sa splendide force spirituelle !
Merci à tous et j’ouvre le débat à vos questions.
How Jacques Cœur put an end to the Hundred Years’ War


has much to inspire us today.
Without waiting for the end of the Hundred Years’ War (1337-1453), Jacques Cœur, an intelligent and energetic man of whom no portrait or treatise exists, decided to rebuild a ruined, occupied and tattered France.
Not only a merchant, but also a banker, land developer, shipowner, industrialist and master of mines in Forez, Jacques Coeur was a contemporary of Joan of Arc (1412-1431), who lived in 1429 in Coeur’s native city of Bourges.

First and foremost, he entered into collaboration with some of the humanist popes of the Renaissance, patrons of the scientific genius Nicolaus Cusanus and the painter Piero della Francesca. With Europe threatened with implosion and chaos, their priority was to put an end to interminable warfare and unify Christendom.
Secondly, following in the footsteps of Saint-Louis (King Louis IX), Cœur was one of the first to fully assume France’s role as a naval power. Finally, thanks to an intelligent foreign exchange policy and by taking advantage of the maritime and overland Silk Roads of his time, he encouraged international trade. In Bruges, Lyon and Geneva, he traded silk and spices for cloth and herring, while investing in sericulture, shipbuilding, mining and steelmaking.
Paving the way for the reign of Louis XI, and long before Jean Bodin, Barthélémy de Laffemas, Sully and Jean-Baptiste Colbert, his mercantilism heralded the political economy concepts later perfected by the German-American economist Friedrich List or the first American Secretary of the Treasury, Alexander Hamilton.
We will concentrate here on his vision of man and economy, leaving aside important subjects such as the trial against him, his relationship with Agnès Sorel and Louis XI, to which many books have been dedicated.

Jacques Cœur (1400-1454) was born in Bourges, where his father, Pierre Cœur, was a merchant pelletier. Of modest income, originating from Saint-Pourçain, he married the widow of a butcher, which greatly improved his status, as the butchers’ guild was particularly powerful.
The Hundred Years’ War

The early XVth century was not a particularly happy time. The « Hundred Years’ War » pitted the Armagnacs against the Burgundians allied with England. As with the great systemic bankruptcy of the papal bankers in 1347, farmland was plundered or left fallow.
While urbanization had thrived thanks to a productive rural world, the latter was deserted by farmers, who joined the hungry hordes populating towns lacking water, hygiene and the means to support themselves. Epidemics and plagues became the order of the day; cutthroats, skinners, twirlers and other brigands spread terror and made real economic life impossible.
Jacques Cœur was fifteen years old when one of the French army’s most bitter defeats took place in France. The battle of Agincourt (1415) (Pas-de-Calais), where French chivalry was routed by outnumbered English soldiers, marked the end of the age of chivalry and the beginning of the supremacy of ranged weapons (bows, crossbows, early firearms, etc.) over melee (hand-to-hand combat). A large part of the aristocracy was decimated, and an essential part of the territory fell to the English. (see map)
King Charles VII

In 1418, the Dauphin, the future Charles VII (1403-1461), as he is known thanks to a painting by the painter Jean Fouquet, escaped capture when Paris was taken by the Burgundians. He took refuge in Bourges, where he proclaimed himself regent of the kingdom of France, given the unavailability of his insane father (King Charles VI), who had remained in Paris and fallen to the power of John the Fearless, Duke of Burgundy.
The dauphin probably instigated the latter’s assassination on the Montereau bridge on September 10, 1419. By his ennemies, he was derisively nicknamed « the little King of Bourges ». The presence of the Court gave the city a boost as a center of trade and commerce.
Considered one of the most industrious and ingenious of men, Jacques Coeur married in 1420 Macée de Léodepart, daughter of a former valet to the Duke of Berry, who had become provost of Bourges.
As his mother-in-law was the daughter of a master of the mints, Jacques Coeur’s marriage in 1427 left him, along with two partners, in charge of one of the city’s twelve exchange offices. His position gave rise to much jealousy. After being accused of not respecting the quantity of precious metal contained in the coins he produced, he was arrested and sentenced in 1428, but soon benefited from a royal pardon.
Yolande d’Aragon
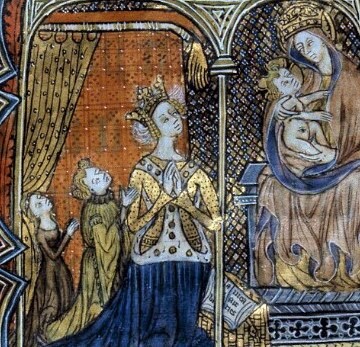
Although the Treaty of Troyes (1420) disinherited the dauphin from the kingdom of France in favor of a younger member of the House of Plantagenets, Charles VII nonetheless proclaimed himself King of France on his father’s death on October 21, 1422.
The de facto leader of the Armagnac party, retreating south of the Loire, saw his legitimacy and military situation considerably improved thanks to the intervention of Joan of Arc (1412-1431), operating under the benevolent protection of an exceptional world-historic person: the dauphin’s mother-in-law Yolande of Aragon (1384-1442), Duchess of Anjou, Queen of Sicily and Naples (Note 1).
Backed and guided by Yolande, Jeanne helped lift the siege of Orléans and had Charles VII crowned King of France in Reims in July 1429. In the mean time Yolande d’Aragon established contacts with the Burgundians in preparation for peace, and picked Jacques Coeur to be part of the Royal Court (Note 2).
The contemporary chronicler Jean Juvenal des Ursins (1433–44), Bishop of Beauvais described Yolande as « the prettiest woman in the kingdom. » Bourdigné, chronicler of the house of Anjou, says of her: « She who was said to be the wisest and most beautiful princess in Christendom. » Later, King Louis XI of France recalled that his grandmother had « a man’s heart in a woman’s body. »
A twentieth-century French author, Jehanne d’Orliac wrote one of the few works specifically on Yolande, and noted that the duchess remains unappreciated for her genius and influence in the reign of Charles VII. « She is mentioned in passing because she is the pivot of all important events for forty-two years in France », while « Joan [of Arc] was in the public eye only eleven months. »
Journey to the Levant
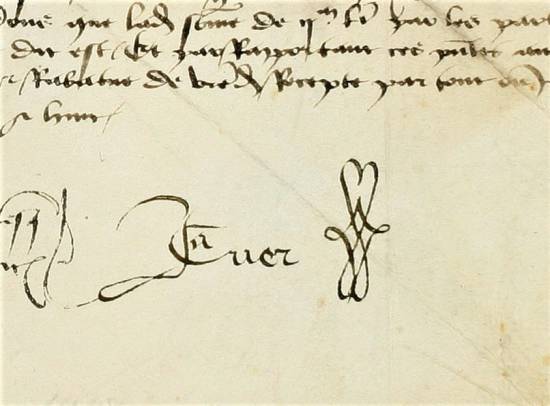
In 1430, Jacques Cœur, already renowned as a man « full of industry and high gear, subtle in understanding and high in comprehension; and all things, no matter how high, knowing how to lead by his work » (Note N° 3), with Barthélémy and Pierre Godard, two Bourges notables, set up,
« a company for all types of merchandise, especially for the King our lord, my lord the Dauphin and other lords, and for all other things for which they could provide proof ».
In 1431, Joan of Arc was handed over to the English by the Burgundians and burned alive at the stake in Rouen. One year later, in 1432, Jacques Cœur went to the Levant. A diplomat and humanist, Cœur went as an observer of customs as well as economic and political life.
His ship coasted from port to port, skirting the Italian coast as closely as possible, before rounding Sicily and arriving in Alexandria, Egypt. At the time, Alexandria was an imposing city of 70,000 inhabitants, bustling with thousands of Syrian, Cypriot, Genoese, Florentine and Venetian ships.

In Cairo, he discovered treasures arriving from China, Africa and India via the Red Sea. Around the Sultan’s Palace, Armenian, Georgian, Greek, Ethiopian and Nubian merchants offered precious stones, perfumes, silks and carpets. The banks of the Nile were planted with sugar cane and the warehouses full of sugar and spices.
Selling Silver at the Price of Gold

To understand Jacques Coeur’s financial strategy, a few words about bimetallism. At the time, unlike in China, paper money was not widely used. In the West, everything was paid for in metal coins, and above all in gold.
According to Herodotus, Croesus issued silver and pure gold coins in the 6th century BC. Under the Roman Empire, this practice continued. However, while gold was scarce in the West, silver-lead mines were flourishing.
Added to this, in the Middle Ages, Europe saw a considerable increase in the quantities of silver coinage in circulation, thanks to new mines discovered in Bohemia. The problem was that in France, national production was not sufficient to satisfy the needs of the domestic market. As a result, France was obliged to use its gold to buy what was lacking abroad, thus driving gold out of the country.
According to historians, during his trip to Egypt, Coeur observed that the women there dressed in the finest linens and wore shoes adorned with pearls or gold jewels. What’s more, they loved what was fashionable elsewhere, especially in Europe. Coeur was also aware of the existence of poorly exploited silver and copper mines in the Lyonnais region and elsewhere in France.
Historian George Bordonove, in his book Jacques Coeur, trésorier de Charles VII (Jacques Coeur, treasurer of Charles VII), reckons that Coeur was quick to note that the Egyptians « strangely preferred silver to gold, bartering silver for equal weight ». whereas in Europe, the exchange rate was 15 volumes of silver for one volume of gold !
In other words, he realized that the region « abounded in gold », and that the price of silver was very advantageous. The opportunity to enrich his country by obtaining a « golden » price for the silver and copper extracted from the French mines must have seemed obvious to him
What’s more, in China, only payments in silver were accepted. In other words, the Arab-Muslim world had gold, but lacked silver for its trade with the Far East, hence its huge interest in acquiring it from Europe…
Lebanon, Syria and Cyprus

Cœur then travels via Beirut to Damascus in Syria, at the time by far the biggest center of trade between East and West.
The city is renowned for its silk damasks, light gauze veils, jams and rose essences. Oriental fabrics were very popular for luxury garments.
Europe was supplied with silk and gold muslin from Mosul, damasks with woven motifs from Persia or Damascus, silks decorated with baldacchino figures, sheets with red or black backgrounds adorned with blue and gold birds from Antioch, and so on.
The « Silk Road » also brought Persian carpets and ceramics from Asia. The journey continues to another of the Silk Roads’ great maritime warehouses: Cyprus, an island whose copper had offered exceptional prosperity to the Minoan, Mycenaean and Phoenician civilizations.
The best of the West was bartered here for indigo, silk and spices.
Genoa and Venice
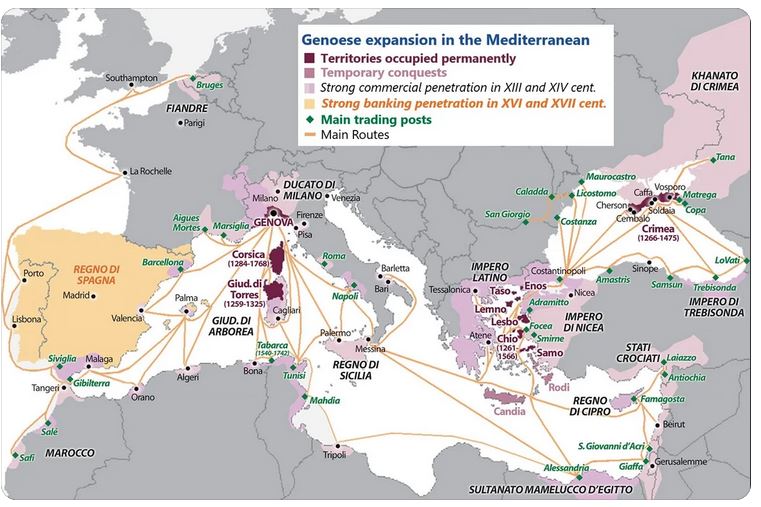
During his voyage, Coeur also discovered the maritime empires of Venice and Genoa, each enjoying the protection of a Vatican dependent on these financial powers.
The former, to justify their lucrative trade with the Muslims, claimed that « before being Christian », they were Venetians…
Like the British Empire, the Venetians promoted total free trade to subjugate their victims, while applying fierce dirigisme at home and prohibitive taxes to others. Any artist or person divulging Venetian know-how suffered terrible consequences.
Venice, outpost of the Byzantine Empire and supplier to the Court of Constantinople, a city of several million inhabitants, developed fabric dyeing, manufactured silks, velvets, glassware and leather goods, not to mention weapons. Its arsenal employs 16,000 workers.
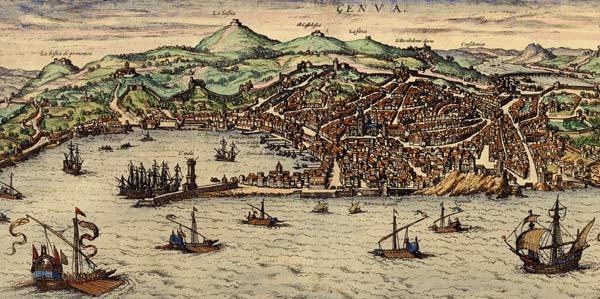
Its rival, Genoa, with its highly skilled sailors and cutting-edge financial techniques, had colonized the Bosphorus and the Black Sea, from where treasures from Persia and Muscovy flowed. They also shamelessly engaged in the slave trade, a practice they would pass on to the Spanish and especially the Portuguese, who held a monopoly on trade with Africa.
Avoiding direct confrontation with such powers, Cœur kept a low profile. The difficulty was threefold: following the war, France was short of everything! It had no cash, no production, no weapons, no ships, no infrastructure!
So much so, in fact, that Europe’s main trade route had shifted eastwards. Instead of taking the route of the Rhône and Saône rivers, merchants passed through Geneva, and up the Rhine to Antwerp and Bruges. Another difficulty was soon added: a royal decree prohibited the export of precious metals! But what immense profits the Kingdom could draw from the operation.
The Oecumenial Councils

On his return from the Levant, France’s history accelerated. While preparing the economic reforms he wanted, Jacques Cœur also became involved in the major issues of the day. Through his brother Nicolas Cœur, the future bishop of Luçon, he played an important role in the process initiated by the humanists to unify the Western Church in the face of the Turkish threat.
Since 1378, there had been two popes, one in Rome and the other in Avignon. Several councils attempted to overcome the divisions. Nicolas Cœur attended them. First there was the Council of Constance (1414 to 1448), followed by the Council of Basel (1431), which, after a number of interruptions, was transferred to Florence (1439), establishing a doctrinal « union » between the Eastern and Western churches with a decree read out in Greek and Latin on July 6, 1439, in the cathedral of Santa Maria del Fiore, i.e. under the dome of Florence’s dome, built by Brunelleschi.

The central panel of the Ghent polyptych (1432), painted by the diplomatic painter Jan Van Eyck on the theme of the Lam Gods (the Lamb of God or Mystic Lamb), symbolizes the sacrifice of the Son of God for the redemption of mankind, and is capable of reuniting a church torn apart by internal differences. Hence the presence, on the right, of the three popes, here united before the Lamb. Van Eyck also painted portraits of Cardinal Niccolo Albergati, one of the instigators of the Council of Florence, and Chancellor Rolin, one of the architects of the Peace of Arras in 1435.
The Peace treaty of Arras
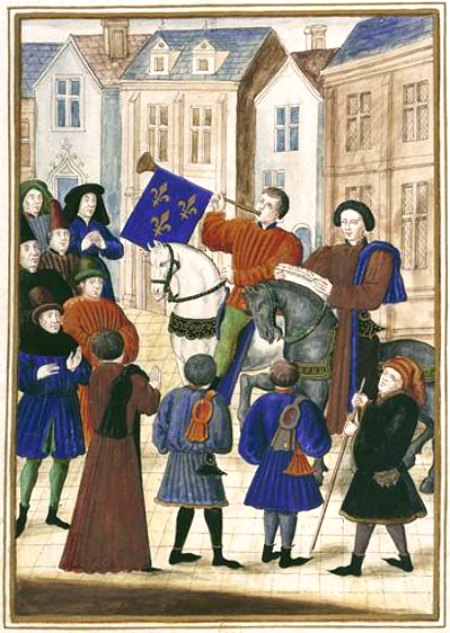
To achieve this, the humanists concentrated on France. First, they were to awaken Charles VII. After the victories won by Joan of Arc, wasn’t it time to win back the territories lost to the English?
However, Charles VII knew that peace with the English depended on reconciliation with the Burgundians. He therefore entered into negotiations with Philip the Good, Duke of Burgundy.
The latter no longer expected anything from the English, and wished to devote himself to the development of his provinces. For him, peace with France was a necessity. He therefore agreed to treat with Charles VII, paving the way for the Arras Conference in 1435.
This was the first European peace conference. In addition to the Kingdom of France, whose delegation was led by the Duke of Bourbon, Marshal de La Fayette and Constable Arthur de Richemont, and Burgundy, led by the Duke of Burgundy himself and Chancellor Rolin, it brought together Emperor Sigismund of Luxembourg, Mediator Amédée VIII of Savoy, an English delegation, and representatives of the kings of Poland, Castile and Aragon.
Although the English left the talks before the end, thanks to the skill of the scholar Aeneas Silvius Piccolomini, at that cardinal of Cyprus (and futur Pope Pius II) and spokesman for the Council of Basel, the signing of the Treaty of Arras in 1435 led to a peace agreement between the Armagnacs and the Burgundians, the first step towards ending the Hundred Years’ War.
In the meantime, the Council of Basel, which had opened in 1431, dragged on but came to nothing, and on September 18, 1437, Pope Eugene IV, advised by cardinal philosopher Nicolaus Cusanus and arguing the need to hold a council of union with the Orthodox, transferred the Council from Basel to Ferrara and then Florence. Only the schismatic prelates remained in Basel. Furious, they « suspended » Eugene IV and named the Duke of Savoy, Amédée VIII, Felix V, as the new pope. This « anti-pope » won little political support. Germany remained neutral, and in France, Charles VII confined himself to implementing many of the reforms decreed in Basel by the Pragmatic Sanction of Bourges on July 13, 1438.
King’s Treasurer and Great State Servant

In 1438, Cœur became Argentier de l’Hôtel du roi. L’Argenterie was not concerned with the kingdom’s finances. Rather, it was a sort of commissary responsible for meeting all the needs of the sovereign, his servants and the Court, for their daily lives, clothing, armament, armor, furs, fabrics, horses and so on.
Cœur was to supply the Court with everything that could neither be found nor manufactured at home, but which he could bring in from Alexandria, Damascus and Beirut, at the time major nodal points of the Silk Road by land and sea, where he set up his commercial agents, his « facteurs » (manufacturers).
Following this, in 1439, after having been appointed Master of the Mint of Bourges, Jacques Cœur became Master of the Mint in Paris, and finally, in 1439, the King’s moneyer. His role was to ensure the sovereign’s day-to-day expenses, which involved making advances to the Treasury and controlling the Court’s supply channels.
Then, in 1441, the King appointed him commissioner of the Languedoc States to levy taxes. Cœur often imposed taxes without ever undermining the productive reconstruction process. And in times of extreme difficulty, he would even lend money, at low, long-term rates, to those who had to pay it.
Ennobled, Coeur became the King’s strategic advisor in 1442. He acquired a plot of land in the center of Bourges to build his « grant’maison », currently the Palais Jacques Coeur. This magnificent edifice, with fireplaces in every room and an oven supplying the rest and bath room with hot water, has survived the centuries, although Coeur rarely had the occasion to live there.
Coeur is a true grand state servitor, with broad powers to collect taxes and negotiate political and economic agreements on behalf of the king. Having reached the top, Coeur is now in the ideal position to expand his long-cherished project.
Rule over Finance
On September 25, 1443, the Grande Ordonnance de Saumur, promulgated at Jacques Coeur’s instigation, put the state’s finances on a sounder footing.
As Claude Poulain recounts in his biography of Jacques Coeur:
« In 1444, after affirming the fundamental principle that the King alone had the right to levy taxes, but that his own finances should not be confused with those of the kingdom, a set of measures was enacted that affected the French at every level. »
These included: « Commoners owning noble fiefs were obliged to pay indemnities; nobles who had received seigneuries previously belonging to the royal domain would henceforth be obliged to share in the State’s expenses, on pain, once again, of seizure; finally, the kingdom’s financial services were organized, headed by a budget committee made up of high-ranking civil servants, ‘Messieurs des Finances’. »
In clear, the nobility was henceforth obliged to pay taxes for the Common Good of the Nation !
The King’s Council of 1444, headed by Dunois, was composed almost exclusively, not of noblement but of commoners (Jacques Coeur, Jean Bureau, Étienne Chevalier, Guillaume Cousinot, Jouvenel des Ursins, Guillaume d’Estouteville, Tancarville, Blainville, Beauvau and Marshal Machet). France recovered and enjoyed prosperity.
If France’s finances recovered, besides « taxing the rich », it was above all thanks to strategic investments in infrastructure, industry and trade. The revival of business activity enabled taxes to be brought in. In 1444, he set up the new Languedoc Parliament in conjunction with the Archbishop of Toulouse and, on behalf of the King, presided over the Estates General.
Master Plan
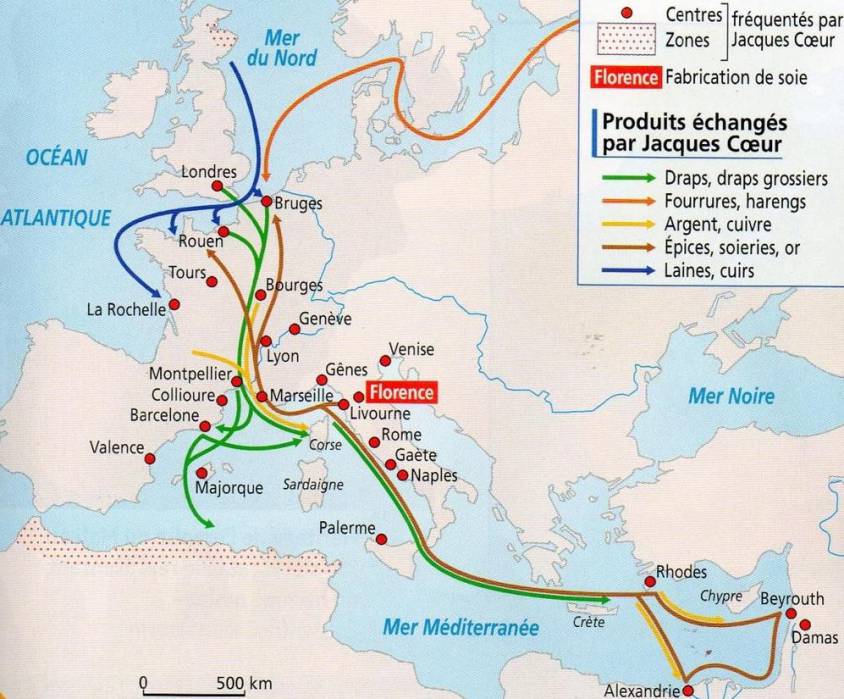
In reality, Jacques Cœur’s various operations, sometimes mistakenly considered to be motivated exclusively by his own personal greed, formed part of an overall plan that today we would describe as « connectivity » and at the service of the « physical economy ».
The aim was to equip the country and its territory, notably through a vast network of commercial agents operating both in France and abroad from the major trading cities of Europe (Geneva, Bruges, London, Antwerp, etc.), the Levant (Beirut and Damascus) and North Africa (Alexandria, Tunis, etc.), in order to promote win-win trade. ), to promote win-win trade, while reinvesting part of the profits in improving national productivity: mining, metallurgy, arms, shipbuilding, training, ports, roads, rivers, sericulture, textile spinning and dyeing, paper, etc.
Mining
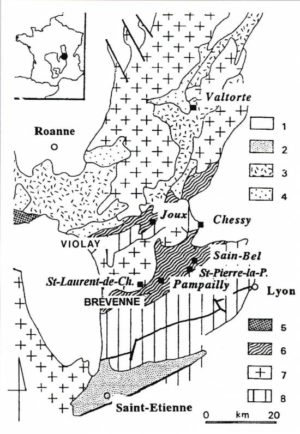
Of special interest were the silver mines of Pampailly, in Brussieu, south of l’Arbresle and Tarare, 25 kilometers west of Lyon, acquired and exploited as early as 1388 by Hugues Jossard, a Lyonnais jurist. They were very old, but their normal operation had been severely disrupted during the war. In addition, there were the Saint-Pierre-la-Palud and Joux mines, as well as the Chessy mine, whose copper was also used for weapons production.
Jacques Cœur made them operational. Near the mines, « martinets » – charcoal-fired blast furnaces – transformed the ore into ingots. Cœur brought in engineers and skilled workers from Germany, at the time a region far ahead of us in this field. However, without a pumping system, mining was no picnic.
Under Jacques Cœur’s management, the workers benefited from wages and comforts that were absolutely unique at the time. Each bunk had its own feather bed or wool mattress, a pillow, two pairs of linen sheets and blankets, a luxury that was more than unusual at the time. The dormitories were heated.
High quality food was provided to the laborers: bread containing four-fifths wheat and one-fifth rye, plenty of meat, eggs, cheese and fish, and desserts included exotic fruits such as figs and walnuts. A social service was organized: free hospitalization, care provided by a surgeon from Lyon who kept accident victims « en cure ». Every Sunday, a local priest came to celebrate a special mass for the miners. On the other hand, workers were subject to draconian discipline, governed by fifty-three articles of regulation that left nothing to chance.
The Ports of Montpellier and Marseille

On his return from the Levant in 1432, Jacques Coeur chose to make Montpellier the nerve center of his port and naval operations.
In principle, Christians were forbidden to trade with Infidels. However, thanks to a bull issued by Pope Urban V (1362-1370), Montpellier had obtained the right to send « absolved ships » to the East every year. Jacques Cœur obtained from the Pope that this right be extended to all his ships. Pope Eugene IV, by derogation of August 26, 1445, granted him this benefit, a permission renewed in 1448 by Pope Nicholas V.

At the time, only Montpellier, in the middle of the east-west axis linking Catalonia to the Alps (the Roman Domitian Way) and whose outports were Lattes and Aigues-Mortes, had a hinterland with a network of roads that were more or less passable, an exceptional situation for the time.
In 1963, it was discovered that at the site of the village of Lattes (population 17,000), 4 km south of today’s Montpellier and on the River Lez, there had been an Etruscan port city called Lattara, considered by some to be the first port in Western Europe. The city was built in the last third of the VIth century BC. A city wall and stone and brick houses were built. Original objects and graffiti in Etruscan – the only ones known in France – have suggested that Etrurian brokers played a role in the creation and rapid urbanization of the settlement.

Trading with the Greeks and Romans, Lattara was a very active Gallic port until the 3rd century AD. Then maritime access changed, and the town fell into a state of numbness.
In the 13th century, under the impetus of the Guilhem family, lords of Montpellier, the port of Lattes was revitalized, only to regain its splendor when Jacques Cœur set up his warehouses there in the 15th century.
As for the port of Aigues-Mortes, built from top to bottom by Saint-Louis in the XIIIth century for the crusades, it was also one of the first in France. To connect the two, Saint-Louis dug the canal known as « Canal de la Radelle » (today’s Canal de Lunel), which ran from Aigues-Mortes across the Lake of Mauguio to the port of Lattes. Cœur restored this river-port complex to working order, notably by building Port Ariane in Lattes.
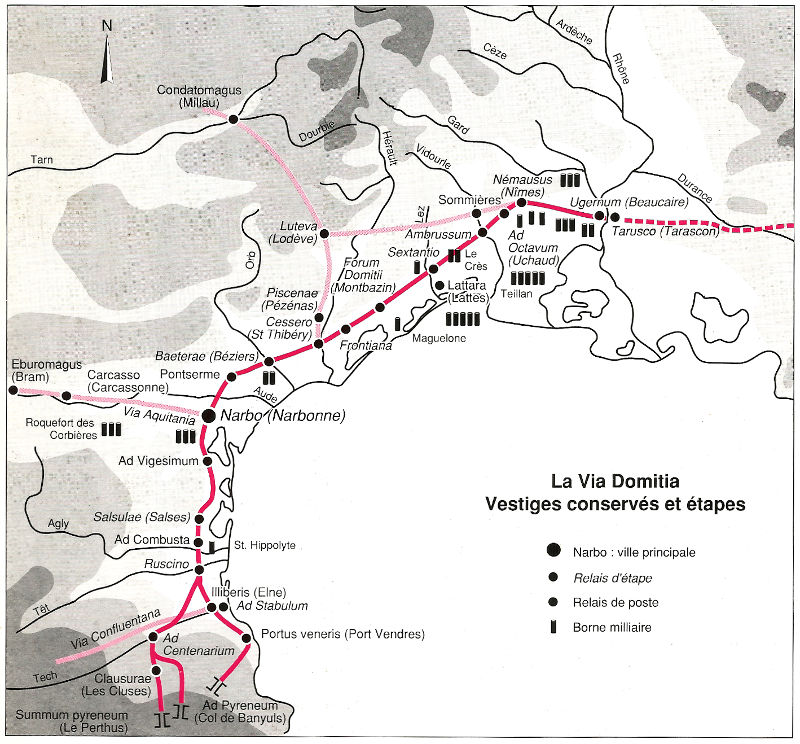
Over the following centuries, these disparate elements of canals and water infrastructure will become an efficient network built around the Canal du Rhône à Sète, a natural extension of the « bi-oceanic » Canal du Midi (between the Meditteranean and the Atlantic) begun by Jean-Baptiste Colbert (see map).
Coeur had the local authorities involved in his project, shaking Montpellier out of its age-old lethargy. At the time, the town had no market or covered sales buildings. Also lacking were moneychangers, shipowners and other cloth merchants.


In Montpellier, an entire district of merchants and warehouses was erected him, the Great Merchants Lodge, modeled on those in Perpignan, Barcelona and Valencia.
Numerous houses in Béziers, Vias and Pézenas also belonged to him, as did residences in Montpellier, including the Hôtel des Trésoriers de France, which, it is said, was topped by a tower so high that Jacques Cœur could watch his ships arrive at the nearby Port of Lattes.
And yet, as an old merchant and industrial city, Montpellier had long been home to Italians, Catalans, Muslims and Jews, who enjoyed a tolerance and understanding that was rare at the time. It’s easy to see why François Rabelais felt so at home here in the XVIth century.
Port of Marseille
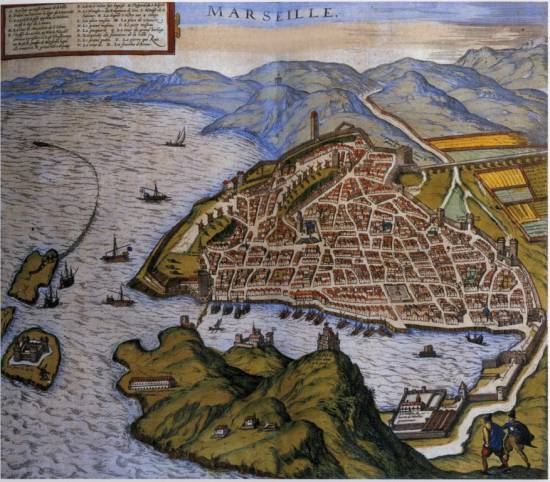
The hinterland was rich and industrious. It produced wine and olive oil, in other words, exportable goods. Its workshops produced leather, knives, weapons, enamels and, above all, drapery.
From 1448 onwards, faced with the limitations of the system and the constant silting-up of the port infrastructure, Coeur moved one of his agents, the navigator and diplomat Jean de Villages, his nephew by marriage, to the neighboring port of Marseille, at that time outside the Kingdom, to the home of King René d’Anjou, where port operations were easier, a deep harbor protected from the Mistral by hills and a port equipped with waterfront shops and storehouses. The boost that Jacques Coeur gave to Montpellier’s port Lattes, Jean de Villages, on Coeur’s behalf, immediately gave to Marseille.
Shipbuilding
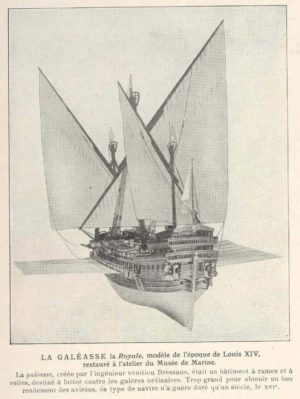
Good ports mean ocean-going ships! Hence at that time, the best France could do was build a few river barges and fishing boats.
To equip himself with a fleet of ocean-going vessels, Cœur ordered a « galéasse » (an advanced model of the ancient three-masted « galley », designed primarily for boarding) from the Genoa arsenals.
The Genoese, who saw only immediate profit in the project, soon discovered that Coeur had had the shapes and dimensions of their ship copied by local carpenters in Aigues Mortes!
Furious, they landed at the shipyard and took it back, arguing that Languedoc merchants had no right to fit out ships and trade without the prior approval of the Doge of Venice!

Stained glass window of a ship (a caraque) in the Palais de Jacques Cœur in Bourges.
After complicated negotiations, but with the support of Charles VII, Coeur got his ship back. Cœur let the storm pass for a few years. Later, seven great ships would leave the Aigues-Mortes shipyard, including « La Madeleine » under the command of Jean de Villages, a great sailor and his loyal lieutenant.
Judging by the stained-glass window and bas-relief in the Palais de Coeur in Bourges, these were more like caraques, North Sea vessels with large square sails and much greater tonnage than galleasses. But that’s not all!
Having understood perfectly well that the quality of a ship depends on the quality of the wood with which it is built, Cœur, with the authorization of the Duke of Savoy, had his wood shipped from Seyssel. The logs were floated down the Rhône, then sent to Aigues-Mortes via the canal linking the town to the river.
The crews
One last problem remained to be solved: that of crews. Jacques Cœur’s solution was revolutionary: on January 22, 1443, he obtained permission from Charles VII to forcibly embark, in return for fair wages, the « idle vagabonds and caimans » who prowled the ports.
To understand just how beneficial such an institution was at the time, we need to remember that France was being laid to waste by bands of plunderers – the routiers, the écorcheurs, the retondeurs – thrown into the country by the Hundred Years’ War. As always, Coeur behaves not only according to his own personal interests, but according to the general interests of France.
Connecting France to the Silk Road

Now with financial clout, ports and ships at his disposal, Cœur organized win-win commercial exchanges and, in his own way, involved France in the land and Maritime Silk Road of the time. First and foremost, he organized « détente, understanding and cooperation » with the countries of the Levant.
After diplomatic incidents with the Venetians had led the Sultan of Egypt to confiscate their goods and close his country to their trade, Jacques Coeur, a gentleman but also in charge of a Kingdom that remained dependent on Genoa and Venice for their supplies of arms and strategic raw materials, had his agents on site mediating a happy end to the incident.
Seeing other potential conflicts that could disrupt his strategy, and possibly inspired by Admiral Zheng He‘s great Chinese diplomatic missions to Africa from 1405 onwards, he convinced the king to send an ambassador to Cairo in the person of Jean de Villages, his loyal lieutenant.
The latter handed over to the Sultan the various letters he had brought with him. Flattered, the Sultan handed him a reply to King Charles VII:
« Your ambassador, man of honor, gentleman, whom you name Jean de Villages, came to mine Porte Sainte, and presented me your letters with the present you mandated, and I received it, and what you wrote me that you want from me, I did.
« Thus I have made a peace with all the merchants for all my countries and ports of the navy, as your ambassador knew to ask of me… And I command all the lords of my lands, and especially the lord of Alexandria, that he make good company with all the merchants of your land, and on all the others having liberty in my country, and that they be given honor and pleasure; and when the consul of your country has come, he will be in favor of the other consuls well high…
« I send you, by the said ambassador, a present, namely fine balsam from our holy vine, a beautiful leopard and three bowls (cups) of Chinese porcelain, two large dishes of decorated porcelain, two porcelain bouquets, a hand-washer, a decorated porcelain pantry, a bowl of fine green ginger, a bowl of almond stones, a bowl of green pepper, almonds and fifty pounds of our fine bamouquet (fine balsam), a quintal of fine sugar. Dieu te mène à bon sauvement, Charles, Roy de France. »
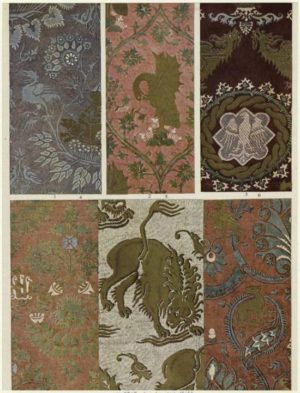
To the Orient, Coeur exported furs, leathers and, above all, cloth of all kinds, notably Flanders cloth and Lyon canvas. His « factors » also offered Egyptian women dresses, coats, headdresses, ornaments and jewels from our workshops. Then came basketry from Montpellier, oil, wax, honey and flowers from Spain for the manufacture of perfumes.
From the Near East, he received animal-figured silks from Damascus (Syria), fabrics from Bukhara (Uzbekistan) and Baghdad (Iraq); velvet; wines from the islands; cane sugar; precious metals; alum; amber; coral; indigo; coral; indigo from Baghdad; madder from Egypt; shellac; perfumes made from the essence of the flowers he exported; spices – pepper, ginger, cloves, cinnamon, jams, nutmegs, etc. – and more.
From the Far East, by the Red Sea or by caravans from the Euphrates and Turkestan, came to him: gold from Sudan, cinnamon from Madagascar, ivory from Africa, silks from India, carpets from Persia, perfumes from Arabia – later evoked by Shakespeare in Macbeth – precious stones from India and Central Asia, lapis lazuli from Afghanistan, pearls from Ceylon, porcelain and musk from China, ostrich feathers from the black Sudan.
Manufactures
As we saw in the case of mining, Coeur had no hesitation in attracting foreigners with valuable know-how to France to launch projects, implement innovative processes and, above all, train personnel. In Bourges, he teamed up with the Balsarin brothers and Gasparin de Très, gunsmiths originally from Milan. After convincing them to leave Italy, he set up workshops in Bourges, enabling them to train a skilled workforce. To this day, the Bourges region remains a major center of arms production.
In the early days of printing in Europe, Coeur bought a paper mill in Rochetaillée, on the Saône near Lyon.
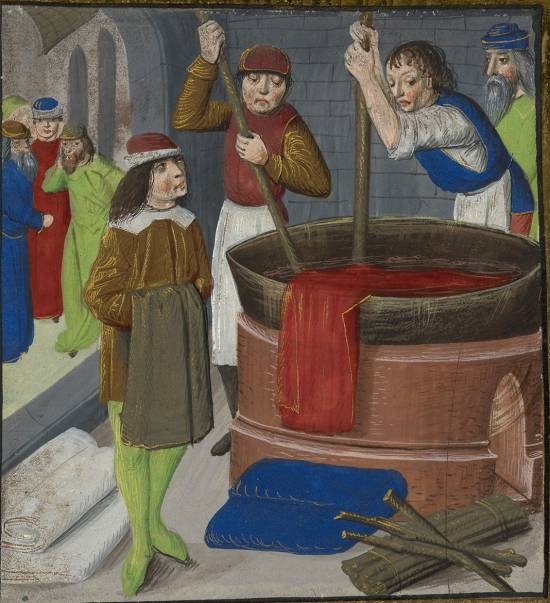
In Montpellier, he took an interest in the dyeing factories, once renowned for their cultivation of madder, a plant that had become acclimatized in the Languedoc region.
It’s easy to understand why Cœur had his agents buy indigo, kermes seeds and other coloring substances. The aim was to revive the manufacture of cloth, particularly scarlet cloth, which had previously been highly sought-after.
With this in mind, he built a fountain, the Font Putanelle, near the city walls, to serve the population and the dyers.
In Montpellier, he also teamed up with Florentine charterers based in the city, for maritime expeditions.
Through their intermediary, Coeur personally traveled to Florence in 1444, registering both his associate Guillaume de Varye and his own son Ravand as members of the « Arte della Seta » (silk production corporation), the prestigious Florentine guild whose members were the only ones authorized to produce silk in Florence.
Coeur engaged in joint ventures, as he often did in France, this time with Niccolo Bonnacorso and the Marini brothers (Zanubi and Guglielmo). The factory, in which he owned half the shares, manufactured, organized and controlled the production, spinning, weaving and dyeing of silk fabrics.
It is understood that Coeur was also co-owner of a gold cloth factory in Florence, and associated in certain businesses with the Medici, Bardi and Bucelli bankers and merchants. He was also associated with the Genevese and Bruges families.
Going International
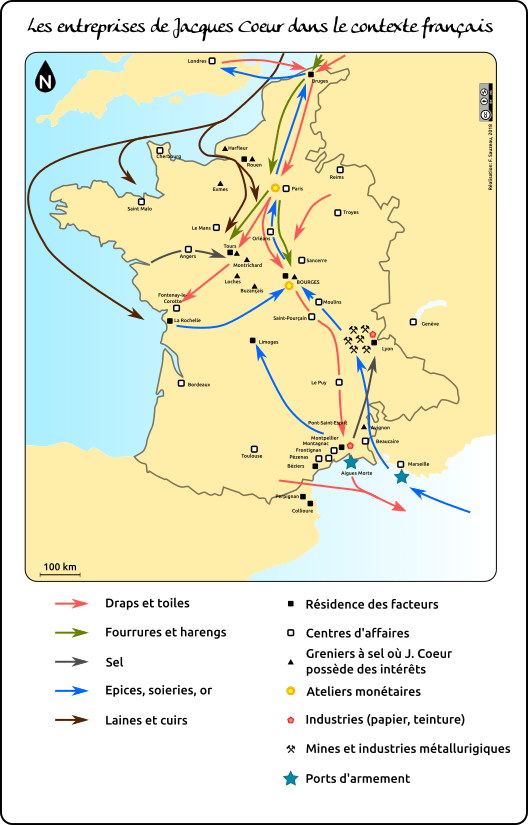
Jacques Coeur organized a vast distribution network to sell his goods in France and throughout Europe. At a time when passable roads were extremely rare, this was no easy task. Most roads were little more than widened paths or poorly functioning tracks dating back to the Gauls.
Cœur, who had his own stables for land transport, renovated and expanded the network, abolished internal tolls on roads and rivers, and re-established the collection (abandoned during the Hundred Years’ War) of taxes (taille, fouage, gabelle) to replenish public finances.
Jacques Cœur’s network was essentially run from Bourges. From there, on the French level, we could speak of three major axes: the north-south being Bruges-Montpellier, the east-west being Lyon-Tours. Added to this was the old Roman road linking Spain (Barcelona) to the Alps (Briançon) via Languedoc.
From Bourges, for example, the Silverware, which served the Court, was transferred to Tours. This was only natural, since from 1444 onwards, Charles VII settled in a small castle near Tours, Plessis-les-Tours. So it was at the Argenterie de Tours that the exotic products the Court was so fond of were stocked. This did not prevent the goods from being shipped on to Bruges, Rouen or other towns in the kingdom.
Counters also existed in Orléans, Loches, Le Mans, Nevers, Issoudun and Saint-Pourçain, birthplace of the Coeur family, as well as in Fangeaux, Carcassonne, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Thouars, Saumur, Angers and Paris.
Orléans and Bourges stocked salt from Guérande, the Vendée marshes and the Roche region. In Lyon, salt from the Camargue and Languedoc saltworks. River transport (on the Loire, Rhône, Saône and Seine rivers) doubled the number of road carts.

Jacques Coeur revived and promoted trade fairs. Lyon, with its rapid growth, geographic location and proximity to silver-lead and copper mines, was a particularly active trading post. Goods were shipped to Geneva, Germany and Flanders.
Montpellier received products from the Levant. However, trading posts were set up all along the coast, from Collioure (then in Catalonia) to Marseille (at the home of King René d’Anjou), and inland as far as Toulouse, and along the Rhône, in particular at Avignon and Beaucaire.
A trading post was set up in La Rochelle for the salt trade, certainly with a view to expanding maritime traffic. Jacques Cœur also had « factors » in Saint-Malo, Cherbourg and Harfleur. After the liberation of Normandy, these three centers grew in importance, and were joined by Exmes. In the north-east, Reims and Troyes are worth mentioning. They manufactured cloth and canvas. Abroad, Geneva was a first-rate trading post, as the city’s fairs and markets had already acquired an international character.
Coeur also had a branch in Bruges, bringing back spices and silks from the Levant, and shipping cloth and herring from there.

The fortunes of Bruges, like many other towns in Flanders, came from the cloth industry. The city flourished, and the power of its cloth merchants was considerable. In the 15th century, Bruges was one of the lungs of the Hanseatic League, which brought together the port cities of northern Europe.
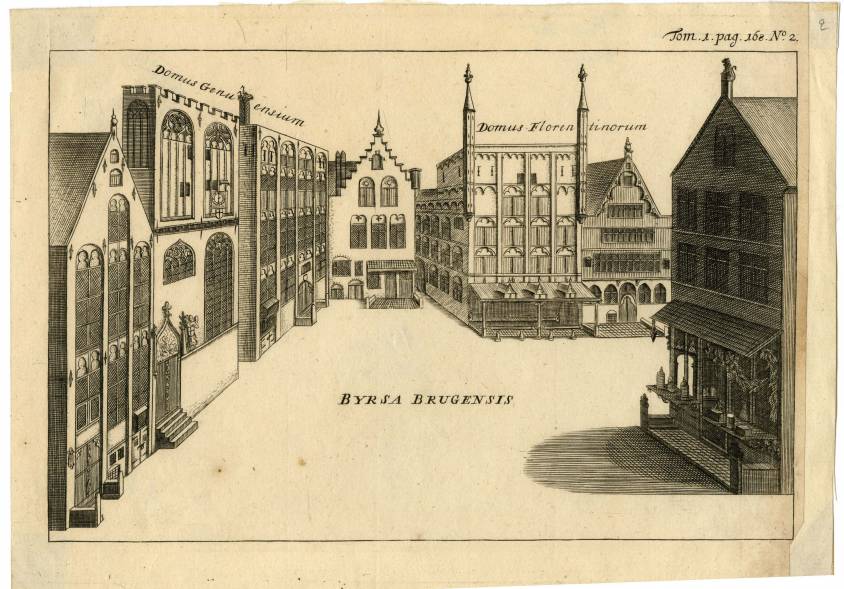

It was in Bruges that business relations were handled, and loan and marine insurance contracts drawn up. After cloth, it was the luxury industries that ensured its prosperity, with tapestries. By land, it took less than three weeks to get from Bruges to Montpellier via Paris.
Between 1444 and 1449, during the Truce of Tours between France and the English, Jacques Coeur tried to build peace by forging trade links with England.
Coeur sent his representative Guillaume de Mazoran. His other trusted associate, Guillaume de Varye, began trading in sheets from London in February 1449. He also bought leather, cloth and wool in Scotland. Some went to La Rochelle, others to Bruges.
Internationally, Coeur continued to expand, with branches in Barcelona, Naples, Genoa (where a pro-French party was formed) and Florence.
At the time of his arrest in 1451, Jacques Coeur had at least 300 « factors » (associates, commercial agents, financial representatives and authorized agents), each responsible for his own trading post in his own region, but also running « factories » on the spot, promoting meetings and exchanges of know-how between all those involved in economic life. Several thousand people associated and cooperated with him in business.
The Military Reform that saved the Nation
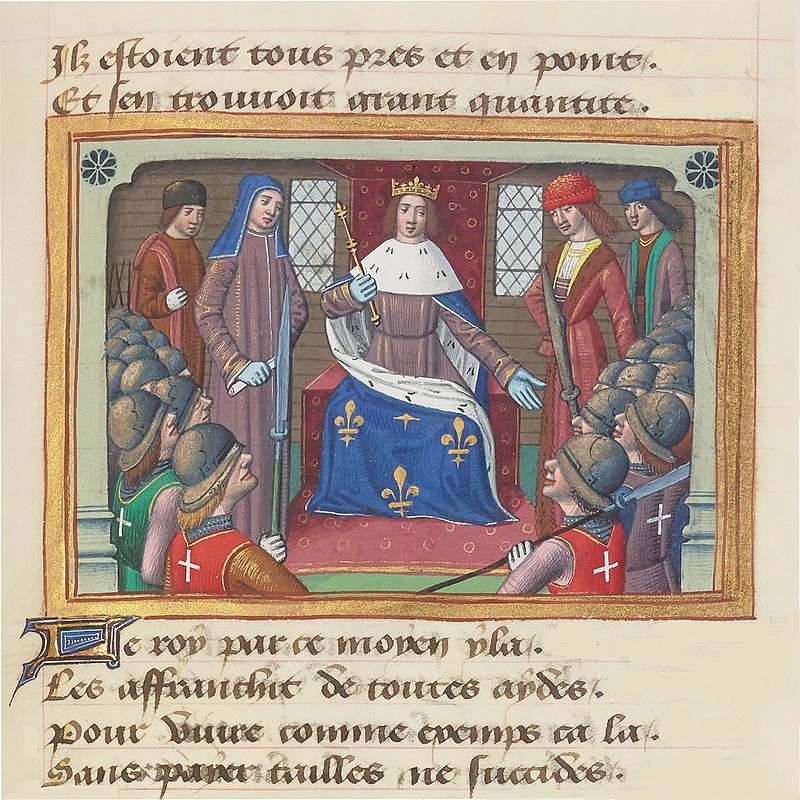
Cœur used the profits from this lucrative business to serve his country. When in 1449, at the end of the truce, the English troops were left to their own devices, surviving by pillaging the areas they occupied, Agnès Sorel, the king’s mistress, Pierre de Brézé, the military leader, and Jacques Cœur, encouraged the king to launch a military offensive to finally liberate the whole country.
Coeur declared bluntly:
« Sire, under your shadow, I acknowledge that I have great proufis and honors, and mesme, in the land of the Infidels, for, for your honor, the souldan has given me safe-conduct to my galleys and factors… Sire, what I have, is yours. »
We’re no longer in 1435, when the king didn’t have a kopeck to face strategic challenges. Jacques Coeur, unlike other great lords, according to a contemporary account,
« spontaneously offered to lend the king a mass of gold, and provided him with a sum amounting, it is said, to around 100,000 gold ecus to use for this great and necessary purpose ».
Under the advice of Jacques Coeur and others, Charles VII was to carry out a decisive military reform.
On November 2, 1439, at the Estates General that had been meeting in Orleans since October of that year, Charles VII ordered a reform of the army following the Estates General’s complaint about the skinners and their actions.
As Charles V (the Wise) had tried to do before him, he set up a system of standing armies that would engage these flayers full-time against the English. The nobility got in the king’s way. In fact, they often used companies of skinners for their own interests, and refused to allow the king alone to be responsible for recruiting the army.
In February 1440, the king discovered that the nobles were plotting against him. Contemporaries named this revolt the Praguerie, in reference to the civil wars in Prague’s Hussite Bohemia.
Yolande d’Aragon passed away in November 1442, but Jacques Coeur would continue pressuring the King to go ahead with the required reforms.
Following the Truce of Tours in 1444, an ordinance was issued on May 26 announcing no general demobilization should occur; instead, the best of the larger units were reconstituted as “companies of the King’s ordinance » (Compagnies d’Ordonnance),” which were standing units of cavalry well selected and well equipped; they served as local guardians of peace at local expense. This consisted of some 10,000 men organized into 15 Ordonnance companies, entrusted to proven captains. These companies were subdivided into detachments of ten to thirty lances, which were assigned to garrisons to protect the towns’ inhabitants and patrol the countryside. In a territory similarly patrolled by the forerunners of our modern gendarmerie, robbery and plunder quickly ceased.
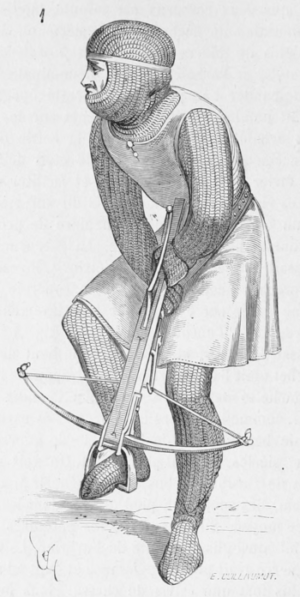
Although still a product of the nobility, this new military formation was the first standing army at the disposal of the King of France. Previously, when the king wished to wage war, he called upon his vassals according to the feudal custom of the ban. But his vassals were only obliged to serve him for forty days. If he wished to continue the war, the king had to recruit companies of mercenaries, a plague against which Machiavelli would later warn his readers. When the war ended, the mercenaries were dismissed. They then set about plundering the country. This is what happened at the start of the Hundred Years’ War, after the victories of Charles V and Du Guesclin.
Then, with the Ordinance of April 8, 1448, the Francs-Archers corps was created. The model for the royal « francs archiers » was probably taken from the militia of archers that the Dukes of Brittany had been raising, by parish, since 1425.
The Ordinance stipulated that each parish or group of fifty or eighty households had to arm, at its own expense, a man equipped with bow or crossbow, sword, dagger, jaque and salad, who had to train every Sunday in archery. In peacetime, he stays at home and receives no pay, but in wartime, he is mobilized and receives 4 francs a month. The Francs-Archers thus formed a military reserve unit with a truly national character.
As writes the Encyclopedia Brittanica:
« With the creation of the “free archers” (1448), a militia of foot soldiers, the new standing army was complete. Making use of a newly effective artillery, its companies firmly in the king’s control, supported by the people in money and spirit, France rid itself of brigands and Englishmen alike. »
At the same time, artillery grandmaster Gaspard Bureau and his brother Jean (Note N° 4) developed artillery, with bronze cannons capable of firing cast-iron cannonballs, lighter hand cannons, the ancestors of the rifle, and very long cannons or couleuvrines that could be dragged on wagons and taken to the battlefield.
As a result, when the time came to go on the offensive, the army went into battle. From all over the country, the Francs-Archers, made up of commoners trained in every region of France rather than nobles, began to converge on the north.
The war was on, and this time, « the gale changed sides ». The merciless French army, armed to the highest standards, pushed its opponents to the limit. This was particularly true at the Battle of Formigny near Bayeux, on April 15, 1450. It was a kind of Azincourt in reverse, with English losses amounting to 80% of the forces engaged, with 4,000 killed and 1,500 taken prisoner. At last, towns and strongholds returned to the Kingdom!
Helping a Humanist Pope
As mentioned above, the Council of Basel had ended in discord. On the one hand, with the support of Charles VII and Jacques Coeur, Eugene IV was elected Pope in Rome in 1431. On the other, in Basel, an assembly of prelates meeting in council sought to impose themselves as the sole legitimate authority to lead Christendom. In 1439, the Council declared Eugene IV deposed and appointed « his » own pope: the Duke of Savoy, Amédée VIII, who had abdicated and retired to a monastery. He became pope under the name of Felix V.
His election was based solely on the support of theologians and doctors of the universities, but without the support of a large number of prelates and cardinals.
In 1447, King Charles VII commissioned Jacques Coeur to intervene for Eugene IV’s return and Felix V’s renunciation. With a delegation, he went to Lausanne to meet Felix V. While the talks were going well, Eugene IV died. As Felix V saw no further obstacles to his pontificate, the Pontifical Council in Rome quickly proceeded to elect a new pope, the humanist scholar Nicholas V (Tommaso Parentucelli).
To make France’s case to him, Charles VII sent Jacques Coeur at the head of a large delegation. Before entering the Eternal City, the French formed a procession.
The parade was sumptuous: more than 300 horsemen, dressed in bright, shimmering colors, bearing weapons and glittering jewels, mounted on richly caparisoned horses, dazzled and impressed the whole of Rome, except for the English, who saw themselves doubled by the French to serve the Pope’s mission.
From the very first meeting, Nicholas V was charmed by Jacques Coeur. Slightly ill, Coeur was treated by the pope’s physician. Thanks to information obtained from the Pontiff, notably on the limits of concessions to be made, Coeur’s delegation subsequently obtained the withdrawal of Felix V, with whom Coeur remained on good terms.

Nicholas V, it should be remembered, was a happy exception. Nicknamed the « humanist pope », he knew Leonardo Bruni (Note N° 5), Niccolò Niccoli (Note N° 6) and Ambrogio Traversari (Note N° 7) in Florence, in the entourage of Cosimo de’ Medici.
With the latter and Eugenio IV, whose right-hand man he was, Nicholas V was one of the architects of the famous Council of Florence, which sealed a « doctrinal union » between the Western and Eastern Churches. (Note N° 8)
Elected pope, Nicholas V considerably increased the size of the Vatican Library. By the time of his death, the library contained over 16,000 volumes, more than any other princely library.
He welcomed the erudite humanist Lorenzo Valla to his court as apostolic notary. Under his patronage, the works of Herodotus, Thucydides, Polybius and Archimedes were reintroduced to Western Europe. One of his protégés, Enoch d’Ascoli, discovered a complete manuscript of Tacitus’ Opera minora in a German monastery.
In addition to these, he called to his court a whole series of scholars and humanists: the scholar and former chancellor of Florence Poggio Bracciolini, the Hellenist Gianozzo Manetti, the architect Leon Battista Alberti, the diplomat Pier Candido Decembrio, the Hellenist Giovanni Aurispa, the cardinal-philosopher Nicolas de Cues, founder of modern science, and Giovanni Aurispa, the first to translate Plato’s complete works from Greek into Latin.
Nicholas V also made gestures to his powerful neighbors: at the request of King Charles VII, Joan of Arc was rehabilitated.
Later, when he sought refuge in Rome, Jacques Coeur was received by Nicholas V as if he was a member of his family.
The Coup d’Etat against Jacques Coeur
Jacques Coeur’s adventurous life ended as if in a cloak-and-dagger novel. On July 31, 1451, Charles VII ordered his arrest and seized his possessions, from which he drew one hundred thousand ecus to wage war.
The result was one of the most scandalous trials in French history. The only reason for the trial was political. The hatred of the courtiers, especially the nobles, had built up. By making each of them a debtor, Coeur, believing he had made allies of them, made terrible enemies. By launching a number of national products, he undermined the financial empires of Genoa, Venice and Florence, which eternally sought to enrich themselves by exporting their products, notably silk, to France.
One of the most relentless, Otto Castellani, a Florentine merchant, treasurer of finances in Toulouse but based in Montpellier, and one of the accusers whom Charles VII appointed as commissioner to prosecute Jacques Coeur, practiced black magic and pierced a wax figure of the silversmith with needles!
Lastly, Charles VII undoubtedly feared collusion between Jacques Coeur and his own son, the Dauphin Louis, future Louis XI, who was stirring up intrigue after intrigue against him.
In 1447, following an altercation with Agnès Sorel, the Dauphin had been expelled from the Court by his father and would never see him again. Jacques Cœur lent money to the Dauphin, with whom he kept in touch through Charles Astars, who looked after the accounts of his mines.
« Trade with infidels », « Lèse majesté », « export of metals », and many other pretexts, the reasons put forward for Jacques Coeur’s trial and conviction are of little interest. They are no more than judicial window-dressing. The proceedings began with a denunciation that was almost immediately found to be slanderous.

A certain Jeanne de Mortagne accused Jacques Coeur of having poisoned Agnès Sorel, the king’s mistress and favorite, who died on February 9, 1450. This accusation was implausible and devoid of any serious foundation; for, having placed all her trust in Jacques Coeur, she had just appointed him as one of her three executors.
Coeur is imprisoned for a dozen equally questionable reasons. When he refused to admit what he was accused of, he was threatened with « the question » (torture). Confronted by the executioners, the accused, trembling with fear, claims that he « relies » on the words of the commissioners charged with breaking him.
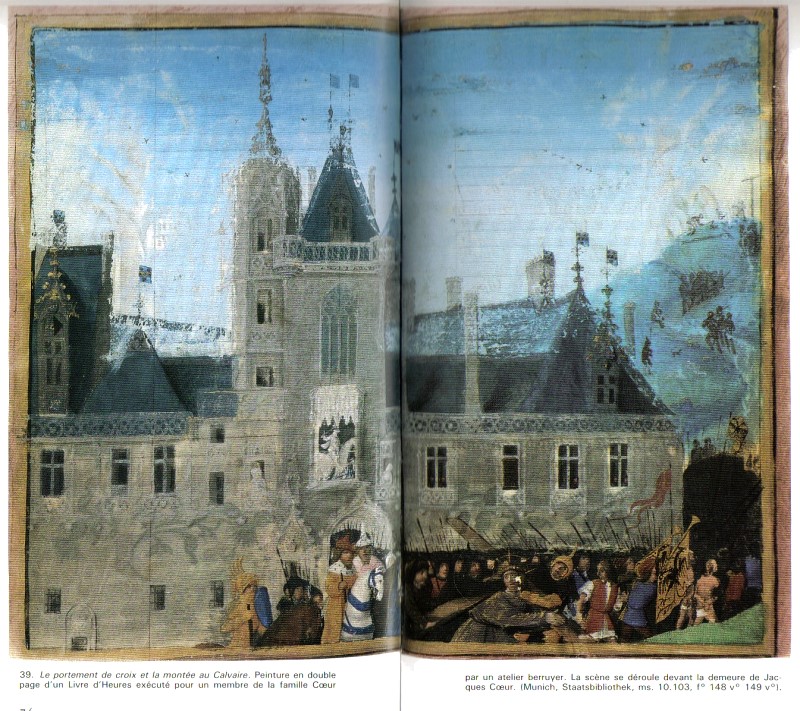
His condemnation came on the same day as the fall of Constantinople, May 29, 1453. Only the intervention of Pope Nicholas V saved his life. With the help of his friends, he escaped from his prison in Poitiers, and took the route of the convents, including Beaucaire, to Marseille for Rome.
Pope Nicholas V welcomed him as a friend. The pontiff died and was succeeded by his successor. Jacques Cœur chartered a fleet in the name of his illustrious host, and set off to fight the infidels. Jacques Coeur, we are told, died on November 25, 1456 on the island of Chios, a Genoese possession, during a naval battle with the Turks.
The great King Louis XI, unloved son of Charles VII, as evidenced by his ordinances in favor of the productive economy, would continue the recovery of France begun by Jacques Coeur. Many of Coeur’s collaborators soon entered his service, including his son Geoffroy, who, as cupbearer, became Louis XI’s most trusted confidant.
Charles VII, by letters patent dated August 5, 1457, restored to Ravant and Geoffroy Coeur a small portion of their father’s property. It was only under Louis XI that Geoffroy obtained the rehabilitation of his father’s memory and more complete letters of restitution.
NOTES:
- During the five years between Joan of Arc’s first appearances and her departure for Chinon, several people attached to the Court stayed in Lorraine, including René d’Anjou, the youngest son of Yolande d’Aragon. While Charles VII remained undecided, his mother-in-law welcomed La Pucelle with maternal solicitude, opening doors for her and lobbying the king until he deigned to receive her. During the Poitiers trial, when Jeanne’s virginity had to be verified, she presided over the council of matrons in charge of the examination. She also provided financial support, helped her gather her equipment, provided safe stopping points on the road to Orléans, and gathered food and relief supplies for the besieged. To this end, she did not hesitate to open her purse wide, even going so far as to sell her jewelry and golden tableware. Yolande’s support was rewarded on April 30, 1429 with the liberation of Orléans, followed on July 17 by the King’s coronation in Reims. Although many of her contemporaries praised her simplicity, her closeness to her subjects and the warmth of her court, Yolande d’Aragon was a stateswoman. And whatever sympathy she may have felt for her protégée, she would not hesitate to abandon her to her sad fate when her warlike impulses no longer accorded with her own political objectives : to negociate a peaceful alliance with the Duchy of Burgundy. The Duchess knew how to be implacable, and like her comrades-in-arms, the Church and the King himself, she abandoned La Pucelle to the English, to Cauchon, to her trial and to the stake. For more: Gérard de Senneville, Yolande d’Aragon : La reine qui a gagné la guerre de Cent Ans, Editions Perrin)
- Georges Bordonove, Jacques Coeur, trésorier de Charles VII, p. 90, Editions Pygmalion, 1977).
- Description given by the great chronicler of the Dukes of Burgundy, Georges Chastellain (1405-1475), in Remontrances à la reine d’Angleterre.
- Jean Bureau was Charles VII’s grand master of artillery. On the occasion of his coronation in 1461, Louis XI knighted him and made him a member of the King’s Council. Louis XI stayed at Jean Bureau’s Porcherons house in northwest Paris after his solemn entry into the capital. Jean Bureau’s daughter Isabelle married Geoffroy Coeur, son of Jacques.
- Leonardo Bruni succeeded Coluccio Salutati as Chancellor of Florence, having joined his circle of scholars, which included Poggio Bracciolini and the erudite Niccolò Niccoli, to discuss the works of Petrarch and Boccaccio. Bruni was one of the first to study Greek literature, and contributed greatly to the study of Latin and ancient Greek, offering translations of Aristotle, Plutarch, Demosthenes, Plato and Aeschylus.
- Niccolò Niccoli built up one of the most famous libraries in Florence, and one of the most prestigious of the Italian Renaissance. He was assisted by Ambrogio Traversari in his work on Greek texts (a language he did not master). He bequeathed this library to the Florentine Republic on condition that it be made available to the public. Cosimo the Elder de’ Medici was entrusted with implementing this condition, and the library was entrusted to the Dominican convent of San Marco. Today, the library is part of the Laurentian Library.
- Prior General of the Camaldolese Order, Ambrogio Traversari was, along with Jean Bessarion, one of the authors of the decree of church union. According to the Urbino court historian Vespasiano de Bisticci, Traversari gathered in his convent at San Maria degli Angeli near Florence. There, Traversari brought together the heart of the humanist network: Nicolaus Cusanus; Niccolo Niccoli, who owned an immense library of Platonic manuscripts; Gianozzi Manetti, orator of the first Oration on the Dignity of Man; Aeneas Piccolomini, the future Pope Pius II; and Paolo dal Pozzo Toscanelli, the physician-cartographer and future friend of Leonardo da Vinci, whom Piero della Francesca also frequented.
- Philosophically speaking, reminding the whole of Christendom of the primordial importance of the concept of the filioque, literally « and of the son », meaning that the Holy Spirit (divine love) came not only from the Father (infinite potential) but also from the Son (its realization, through his son Jesus, in whose living image every human being had been created), was a revolution. Man, the life of every man and woman, is precious because it is animated by a divine spark that makes it sacred. This high conception of each individual was reflected in the relationship between human beings and their relationship with nature, i.e., the physical economy.
« Mutual tuition »: historical curiosity or promise of a better future?
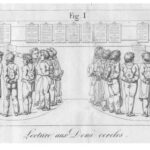

By Karel Vereycken, July 2023, PARIS.
1. Introduction
2. Learning and teaching at the same time, a precious joy
3. Precedents:
A. In India
B. In France
4. Gaspard Monge’s brigades
5. Andrew Bell
6. Joseph Lancaster
7. Mutual Tuition, how it works
A. The class room
B. Teachers and monitors
C. A day at a mutual school
D. Progress according to each pupil’s knowledge
E. Tools
F. Command
8. Bellists vs. Lancasterians
9. France adopting Mutual Tuition
10. Lazare Carnot takes the helm
11. Mutual tuition and choral music
12. The rue Saint-Jean-de-Beauvais pilot project
13. Jomard, Choron, Francœur and elementary knowledge
14. Going Nationwide
15. Critique
16. Mechanistic drift?
17. Death of mutual tuition in France
18. Conclusion
19. Short list of books and texts consulted
« Answer, my friends: it must be sweet for you
To have as your only mentors children like yourselves;
Their age, their mood, their pleasures are your own;
And these victors of one day, tomorrow vanquished by others,
Are, in turn, adorned with modest ribbons,
Your equals in your games, your masters on the benches.
Mute, eyes fixed on your happy emulators,
You are not distracted by the fear of ferulas;
Never an avenging whip, frightening your spirits,
Makes you forget what they taught you;
I listen badly to a fool who wants me to fear him,
And I know much better what a friend teaches me. »
Victor Hugo, Discours sur les avantages de l’Enseignement mutuel, 1817.
1. Introduction
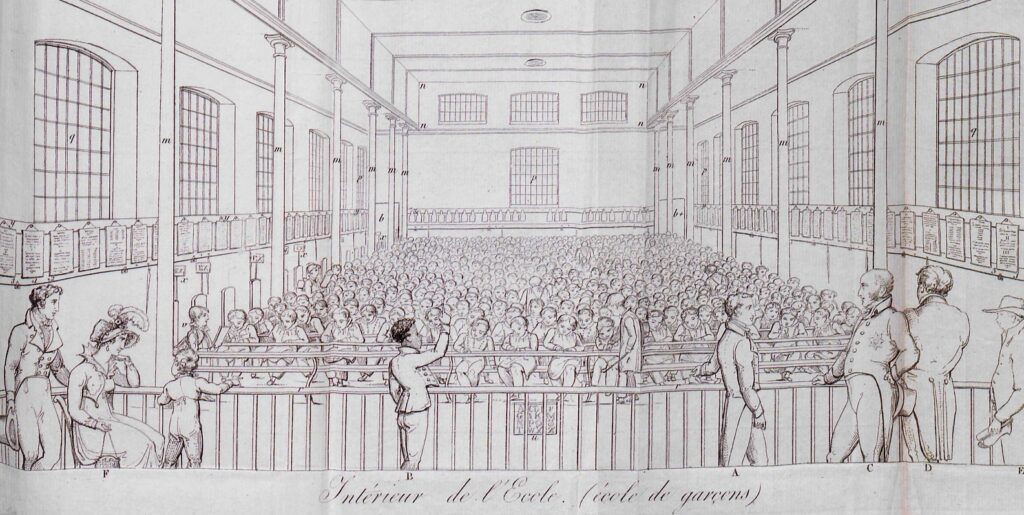
Teaching reading and writing to 1,000 children in the same room, without a teacher, without school books, without paper and ink, is clearly impossible. And yet, it has been imagined and put into practice with great success!
Shh! we mustn’t talk about it, because it could give some people ideas, and not just in emerging countries!
That such a challenge could be taken up could only worry the oligarchy and its servants, who since the dawn of time have been mandated to train an « elite » (the high priests of knowledge, « experts » and other know-it-alls) who reproduce in a vacuum at the top, while ensuring that the great mass of people below are educated just enough to be able to deliver parcels, pay their taxes, abide by the rules defined by the top, and above all, not make (too) much of a mess.
And yet, as Hippolyte Carnot, Minister of Public Instruction in the Second Republic, understood long before us, without a republican education – in other words, without genuine citizen training from kindergarten onwards – universal suffrage often becomes a tragic farce capable of producing monsters.
In the early 19th century, « mutual tuition », (sometimes referred to as the English Monitorial System, also known as Madras System or Lancasterian System), spread like wildfire across Europe and then the rest of the world including the United States of America.
If the teacher addresses a single pupil, it’s the individual mode (as in the case of the preceptor); if he addresses an entire class, it’s the simultaneous mode; if he instructs some children to teach others, it’s the mutual mode. The combination of simultaneous and mutual modes is called mixed mode.
Mutual tuition quickly fell victim to personal quarrels and ideological, political and religious issues. In France, it was seen as an aggression by religious congregations who practiced « simultaneous teaching », codified as early as 1684 by Jean-Baptiste de La Salle : classes by age, division by level, fixed and individual places, strict discipline, repetitive and simultaneous work supervised by an inflexible master.
With the formation of small groups where pupils teach each other and move around the classroom, mutual teaching immediately gave rise, rather foolishly, to the fear of an ass-over-head world straight out of a Hieronymus Bosch painting. What kind of world are we in if the pupil teaches the teacher? the child the parent? the faithful the priest? the citizen the government ! Without a clear leader, aren’t we lost ?
In 1824, Pope Leo XII (not to be confused with the benevolent Leo XIII), the « Pope of the Holy Alliance », a fierce supporter of order and suspect of a vast Protestant plot against the Vatican, forbade such teaching, believing it to « weaken the authority » of both teachers and political and religious authorities.
In France, where in the years following the 1830 revolution over 2,000 mutual schools existed, mainly in towns, in competition with denominational schools, François Guizot, Louis-Philippe’s minister and initially a promoter of broad public education, had them closed down.
2. Learning and teaching at the same time,
a precious joy

Today, « tutoring » is enjoying a revival in the context of school and vocational training. It is a process of « assistance by more experienced subjects to less experienced subjects, likely to enrich the latter’s acquisitions ».
Tutoring between children, in particular between children of different ages, is encouraged from nursery school right through to university, with the institutionalization of methodological tutoring at undergraduate level. Since the 1980s, elementary and secondary schools in France and abroad have seen the development of numerous tutoring experiments.
In reality, tutoring is no more than the pale heir to the mutual tuition system developed in England and then France in the 19th century.
Hence, the future of humanity depends on an exclusively human faculty: the discovery of new universal physical principles, often totally beyond the limits of our sensory apparatus, enabling Man to increase his capacity to transform the universe to qualitatively improve his lot and that of his environment. A discovery is never the result of the sum or average of opinions, but of an individual, perfectly sovereign act. Are we able to organize our society so that this « sacred » creative principle is cherished, respected and cultivated in any newborn child?
Because, without the socialization of this discovery, it will be useless. The history of mankind is therefore, by its very nature, the history of « mutual tuition ».

Is not the greatest pleasure of those who have just made a discovery – and this is natural for children – to share, with a view to a shared future, not only what he or she has just discovered, but the joy and beauty that every scientific breakthrough represents? And when those who discover teach and those that teach, discover, the pleasure is immense. So let’s give our professional teachers the time they need to make discoveries, for the quality of their teaching will be enhanced!
Precedents:
A. In India
In 1623, the Italian explorer Pietro Della Valle (1586-1652), after a trip to « Industan » (India), in a letter dispatched from Ikkeri (a town in south-west India), reports having seen boys teaching each other how to read and write using singing :

« In order to inculcate it perfectly in their memory, to repeat the previous lessons that had been prescribed to them, lest they forget them, one of them would sing in a certain musical tone a line from the lesson, such as two and two make four. After all, it’s easy to learn a song.
« While he sang this part of the lesson to learn it better, he wrote it down at the same time, not with a pen, nor on paper. But to spare him and not spoil it unnecessarily, they marked the characters with their fingers on the same floor where they were sitting in a circle, which they had covered for this purpose with very loose sand. After the first of these children had written in this way while singing, the others sang and wrote the same thing all together
« (…) When I asked them who (…) corrected them when they missed, given that they were all schoolboys, they answered me very reasonably, that it was impossible that a single difficulty should stop them all, four at the same time, without being able to overcome it and that for the subject they always practiced together so that if one missed, the others would be his teachers.«
In Della Valla‘s report, we can already identify some of the basic principles of mutual tuition, notably the simultaneous learning of reading and writing, the use of sand for writing exercises to avoid wasting paper, which is scarce and very expensive, a group lesson given by a teacher, followed by work in sub-groups in which pupils learn to self-regulate, and finally, an integration of knowledge which, thanks to the use of song, will facilitate memorization.
B. In France

In Lyon, the priest Charles Démia, was one of the precursors of mutual tuition, which he put into practice in the « petites écoles » for poor children he founded and theorized as early as 1688. According to the Nouveau dictionnaire de pédagogie et de l’instruction primaire:
« Démia introduced what later came to be known as mutual tuition into the classroom: he recommended that a certain number of officers be chosen from among the most capable and studious pupils, some of whom, under the name of intendants and decurions, would be responsible for supervision, while the others would have to have the master’s lessons repeated, correct pupils when they made mistakes, guide the hesitant hand of ‘young writers’, etc. » In order to make simultaneous teaching possible, Démia’s idea of ‘mutual teaching’ was based on the principle of ‘teaching to one another’. To make simultaneous teaching possible, the author of the regulations divides the school into eight classes, to be taught in turn by the master; each of these classes can be subdivided into bands ».
In Paris, as early as 1747, mutual education was practiced with great success in a school of over 300 pupils, established by M. Herbault, at the Hospice de la Pitié, in favor of the children of the poor. Unfortunately, the experiment did not survive its founder.
In 1772, the ingenious charity of Chevalier Paulet conceived and carried out the project of applying a similar method to the education of a large number of children, left without support in society by the death of their parents.
4. Gaspard Monge’s « brigades »
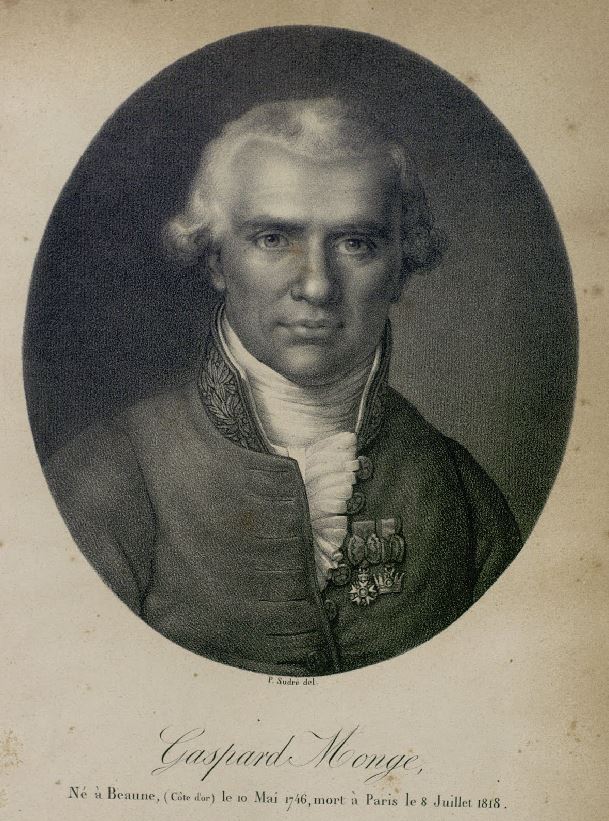
Finally, as recounted in his biography of Gaspard Monge by his most brilliant pupil, the astronomer François Arago (1786-1853), himself a close friend of Alexander von Humboldt, it was at the École Polytechnique that Monge perfected his own system of mutual tuition and tutoring.
Finding it unacceptable to have to wait three years for the first engineers to graduate from the Ecole Polytechnique, Monge decided to speed up student training by organizing « revolutionary courses », an accelerated training program lasting three months for those in charge of teaching to the others. To achieve this, he perfected the concept of « chefs de brigades », a technique he had already successfully tested at the Mézières engineering school.


François Arago:
« The brigade leaders, always working with small groups of students in separate rooms, were to have the extremely important task of ironing out difficulties as they arose. Never had a more skilful combination been devised to remove any excuse for mediocrity or laziness.
« This creation belonged to Monge. At Mézières, where the engineering students were divided into two groups of ten, and where, in fact, our colleague acted for some time as permanent brigade leader for both divisions, the presence in the classrooms of a person who was always in a position to overcome objections had produced results that were too fortunate for this former repetiteur, in drafting the developments attached to Fourcroy’s report, not to try to endow the new school with the same advantages.
« Monge did more; he wanted the 23 sections of 16 students each, of which the three divisions were to be composed, to have their brigade leader, as in ordinary times, following the revolutionary lessons, and at the opening of the courses of the three degrees. In a word, he wanted the School, at its beginning, to function as if it had already been in existence for three years.
« Here’s how our colleague achieved this seemingly unattainable goal. It was decided that 25 students, chosen by competitive examination from among the 50 candidates who had received the best marks from the admission examiners, would become brigade leaders of three divisions of the school, after receiving special instruction separately. In the mornings, the 50 young people, like all their classmates, attended revolutionary classes; in the evenings, they were brought together at the Hôtel Pommeuse, near the Palais-Bourbon, and various teachers prepared them for the functions they were destined to perform. Monge presided over this scientific initiation with infinite kindness, ardor and zeal. The memory of his lessons remains indelible in the minds of all those who benefited from them.
Arago then quotes Edme Augustin Sylvain Brissot (1786-1819), son of the famous abolitionist, , one of the 50 students, who reported : « It was there that we began to get to know Monge, this man so kind to youth, so devoted to the propagation of science. Almost always in our midst, he followed lessons in geometry, analysis and physics with private discussions where we found even more to gain. He became a friend to each and every one of the students at the Ecole provisoire, joining in the efforts he was constantly provoking, and applauding, with all the vivacity of his character, the successes of our young minds ».
While mutual teaching is fully practiced, the total dedication of a master as devoted as Monge completes what otherwise becomes nothing more than a « system ».
5. Andrew Bell
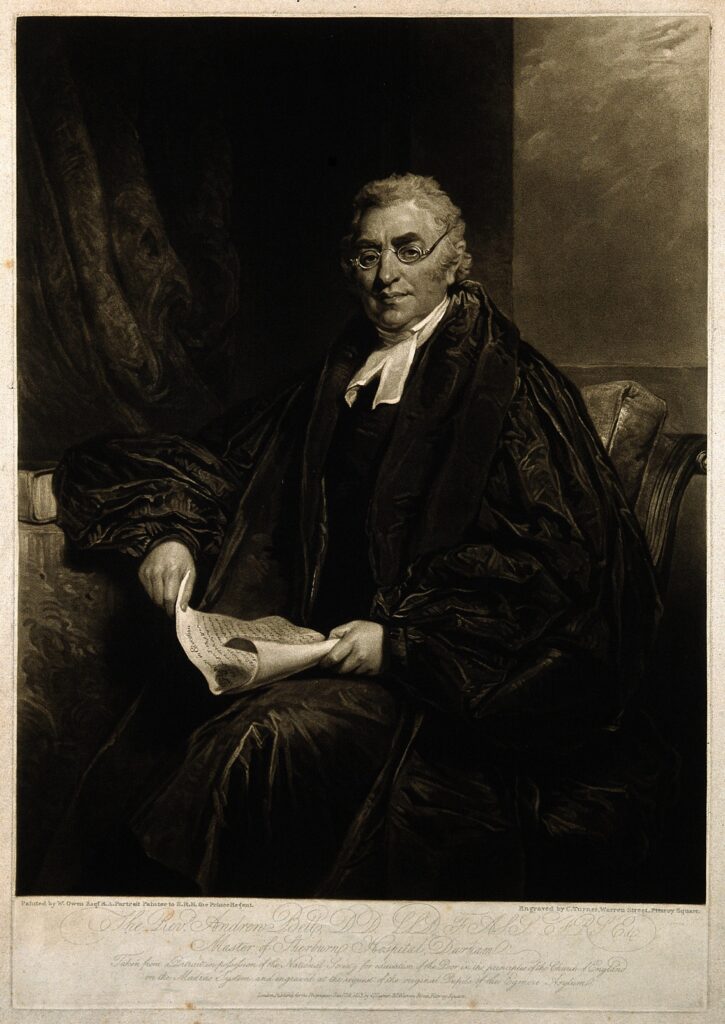
It was a Scotsman, the Anglican clergyman Andrew Bell (1753-1832), who claimed the paternity of mutual tuition, which he theorized and practiced in India, at the head of the Egmore Military Asylum for Orphans (Eastern India), an institution created in 1789 to educate and instruct the orphans and destitute sons of the European officers and soldiers of the Madras army.
After 7 years there, Bell returned to London and, in 1797, wrote a report to the East India Company (his employer in Madras) on the incredible benefits of his invention.
Russian physician, naturalist and inventor Iosif Khristianovich (Joseph) Hamel (1788-1862), a member of the Russian Academy of Sciences, was commissioned by Alexander I, Emperor of Russia, to write a full report on this new type of education, which was then being discussed throughout Europe.

In Der Gegenseitige Unterricht (1818), he reports what Bell wrote in one of his writings: « It happened at this time, that one morning as I was taking my usual walk, I passed a school of young Malabar children, and saw them busy writing on the ground. The idea immediately occurred to me that perhaps the children at my school could be taught the letters of the alphabet by tracing on the sand. I immediately went home and ordered the teacher of the last class to carry out what I had just arranged. Fortunately, the order was very poorly received; for if the master had complied to my satisfaction, it is possible that all further development would have been stopped, and with it the very principle of mutual education… »
Mutual education was coldly received in England, but eventually won over Samuel Nichols, one of the school leaders at St. Botolph’s Aldgate, London’s oldest Anglican Protestant parish. Bell’s precepts were implemented with great success, and his method was taken up by Dr. Briggs when he opened an industrial school in Liverpool.
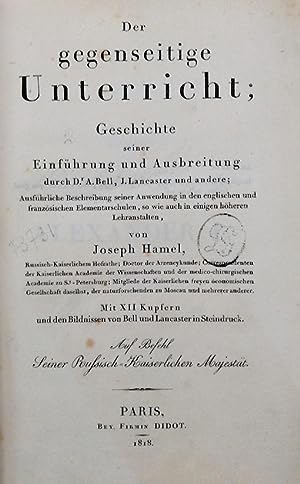
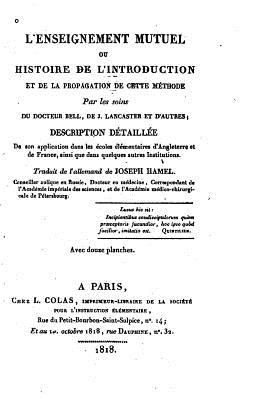

6. Joseph Lancaster

In England, it was Joseph Lancaster (1778-1838), a twenty-year-old London schoolteacher, who seized upon the new way of teaching, perfected it and generalized it on a large scale. (See text of his 1810 booklet)
In 1798, he opened an elementary school for poor children in Borough Road, one of London’s poorest suburbs. Education was not yet totally free, but it was 40% cheaper than other schools in the capital. Lacking money, Lancaster did everything in his power to drive down the costs of what was becoming a veritable « system »: use of sand and slate instead of ink and paper (Erasmus of Rotterdam reported in 1528 that in his day, people wrote with a kind of awl on tables covered in fine dust); boards reproducing the pages of school books hung on the walls to avoid having to buy books; auxiliary teachers replaced by pupils to avoid paying salaries; increase in the number of pupils per class.

By 1804, his school had 700 pupils, and twelve months later, a thousand. Lancaster, getting deeper and deeper into debt, opened a school for 200 girls. To escape his creditors, Lancaster left London in 1806, and on his return was jailed for debt. Two of his friends, dentist Joseph Foxe and straw hat maker William Corston, repaid his debt and founded with him « The Society for the Promotion of the Lancasterian System for the Education of the Poor ».
Other Quakers stepped in with support, notably abolitionist William Wilberforce (1759-1833), whom the french sculptor David d’Angers depicted alongside Condorcet and Abbé Grégoire on his famous monument commemorating Gutenberg in Strasbourg.
From there, as Joseph Hamel recounts in his 1818 report, the new approach spread to the four corners of the world: England, Scotland, France, Prussia, Russia, Italy, Spain, Denmark, Sweden, Poland and Switzerland, not forgetting Senegal and several South American nations such as Brazil and Argentina and of course, the United States of America. Mutual Tuition was adopted as the official pedagogy in New York City (1805), Albany (1810), Georgetown (1811), Washington D.C. (1812), Philadelphia (1817), Boston (1824) and Baltimore (1829), and the Pennsylvania legislature considered statewide adoption.
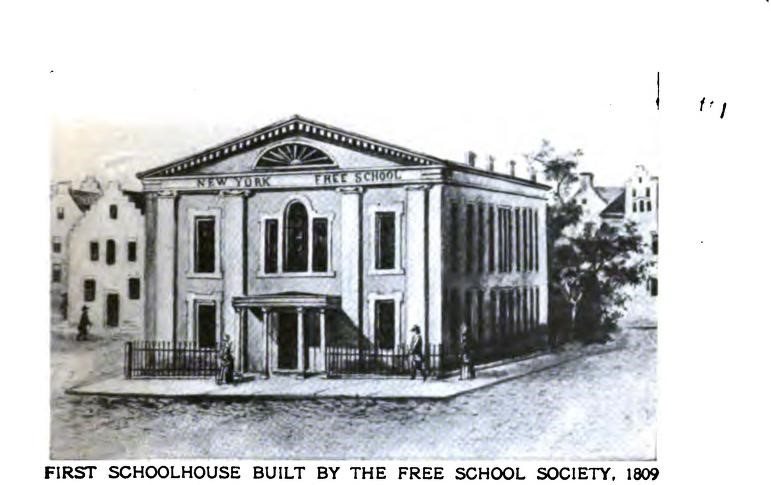
7. Mutual tuition, how does that works ?
The fundamental principle of « mutual tuition », particularly relevant to elementary school, is reciprocity of instruction between pupils, with the more able serving as teacher to the less able. From the outset, everyone progresses gradually, regardless of the number of pupils.
Bell and Lancaster, and their French disciples, postulated: the diversity of faculties, the inequality of progress, the rhythms of comprehension and acquisition. This led them to divide the school into different classes according to subjects and children’s level of knowledge, with age playing no part in this classification. Schoolchildren thus brought together take part in the same exercises. Their study program is identical in content and methods.
If the number of pupils in a division is too high in a particular subject – reading or arithmetic, for example – sub-groups are formed, which progress in parallel, while the teaching methods and materials remain identical.
So what does a school under the new system look like?
A. The classroom
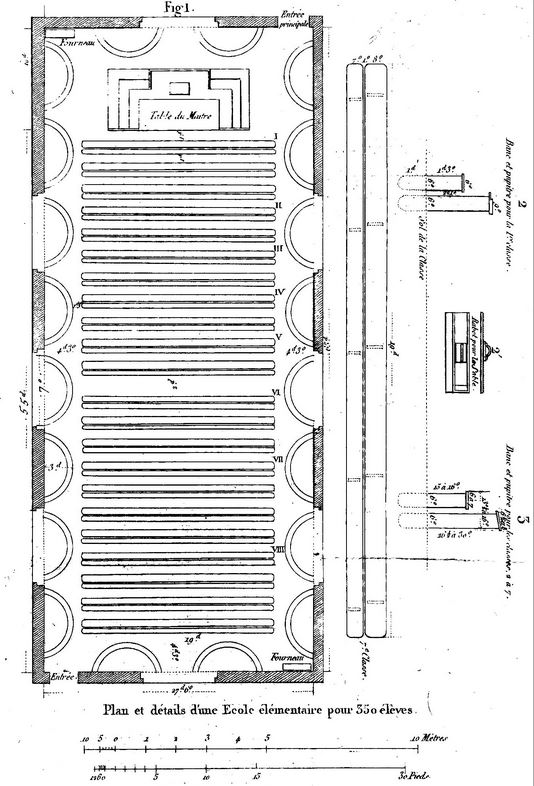
Whatever the number of pupils – around a 100 in French villages, close to a 1000 in the Lancaster school in London, 200 in Parisian schools – they are grouped together in one single rectangular room with no partitions.
Jomard, who was extraordinarily active and prolific in the early years of the mutual education system, set desirable standards for class sizes ranging from 70 to 1,000 pupils.
For 350 pupils, for example, he indicated the need for a room 18 m long by 9 m wide (graphic).
In England and the French countryside, a barn was often used for the new school. In France, a large number of religious buildings have been disused since the revolutionary period, and meet the required standards perfectly. Many mutual schools were built in these buildings.
B. « Masters » and « monitors »
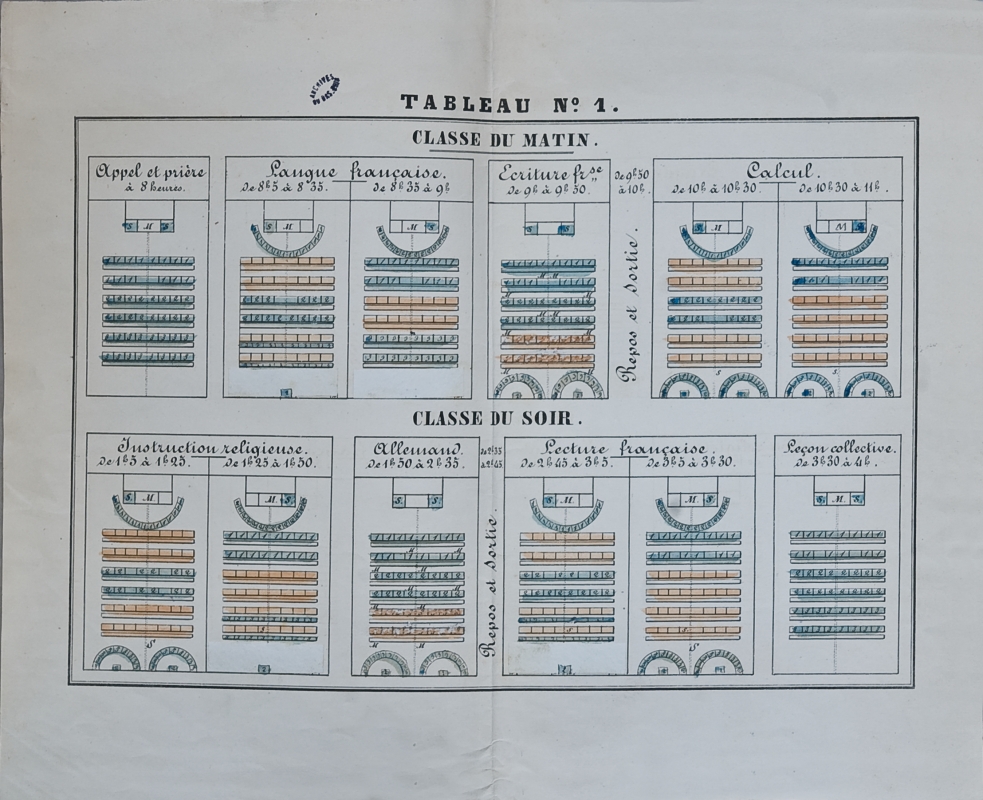
The mutual method divided responsibility for teaching between the « master » and students designated as « monitors », considered « the linchpin of the method ».
As Bally reminded us as early as 1819: « The basis of mutual teaching rests on the instruction communicated by the strongest pupils to those who are weaker. This principle, which is the merit of this method, required a very special organization to create a reasonable hierarchy, which could contribute in the most effective way to the success of all. »
Each day, in a dedicated « classroom » reserved for instructors, the master imparts knowledge and provides his assistants with technical advice on the proper application of the method. During the course of the day, he remains in charge of the 8th class, and as such is responsible for conducting their exercises. He conducts periodic, monthly or occasional examinations in the classes, and may decide to change classes. Finally, it is he who, at the final stage, distributes punishments and rewards.
C. A day at a mutual school
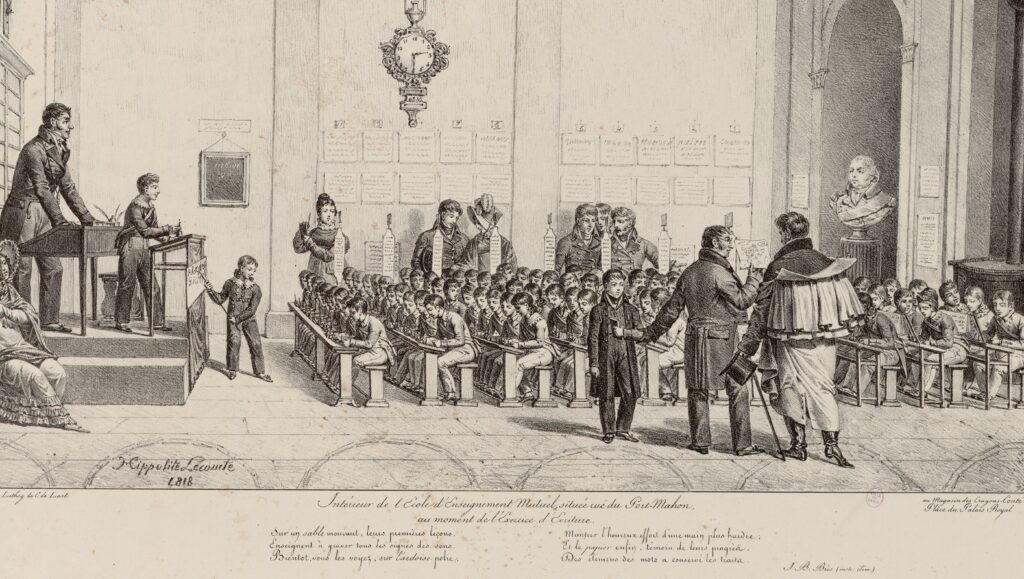
Thus, on a platform, the teacher’s desk with a large drawer where money, reward tickets, registers, writing templates, whistles and children’s notebooks are kept.
Behind the teacher, next to the clock – an essential instrument for organizing teaching life – is a blackboard on which are written sentences and writing models.
At the foot of the platform, benches are attached across the desks, of different sizes, in the middle of the room. The first tables, which are not inclined, have sand on which small children trace signs, while the other tables have slates; on the last of these there are lead inkwells and paper, and chopsticks to indicate words or letters to be read.
At the end of each table are « dictation tables » and telegraphic signals indicating the lesson’s moments, such as « COR » for « correction » or « EX » for « examination of work ». Semicircular table models were then proposed to facilitate the work of the instructors.
D. Progress according to each person’s knowledge
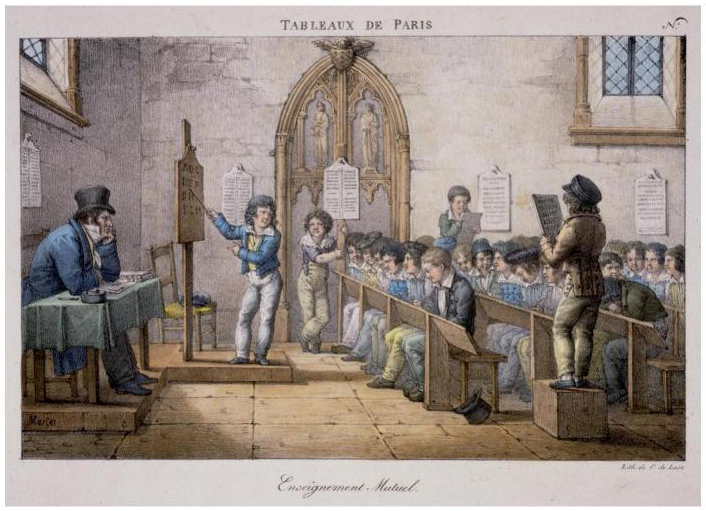
Initially, the mutual school program was limited to the 3 fundamental disciplines of reading, writing and arithmetic, and to the teaching of religion. Geography, grammar, writing, singing and linear drawing were soon added. The instrumental disciplines (music) are taught together, rather than in succession, as is customary in other schools. Pupil groupings are flexible, mobile and differentiated, depending on the nature of the subjects studied and the activities practised in the discipline.
Each subject matter taught in mutual schools is based on a precise, codified curriculum. This program is divided into 8 hierarchical levels, which must be covered in succession. Each degree is called a « class », and this is how we speak of the 8 classes of writing or arithmetic.
The term « class » refers only to acquisitions and knowledge, the 1st class being that of beginners and the 8th that of the completion of the school curriculum. The pace of learning and acquisition varies from student to student and from subject to subject.
Thus, after six months’ attendance, pupil « X » may find himself in 4th class reading, 5th class writing and 2nd class arithmetic. As we said, class assignment is decided on the basis of knowledge level, not age.
But this initial allocation is accompanied, within each class and in each subject, by the constitution of restricted groups established according to the activities to be practiced. In arithmetic, for example, written work is done on the slate. This takes place seated on benches reserved for this purpose, with a maximum of 16 to 18 students per bench, according to the standards established by Jomard.
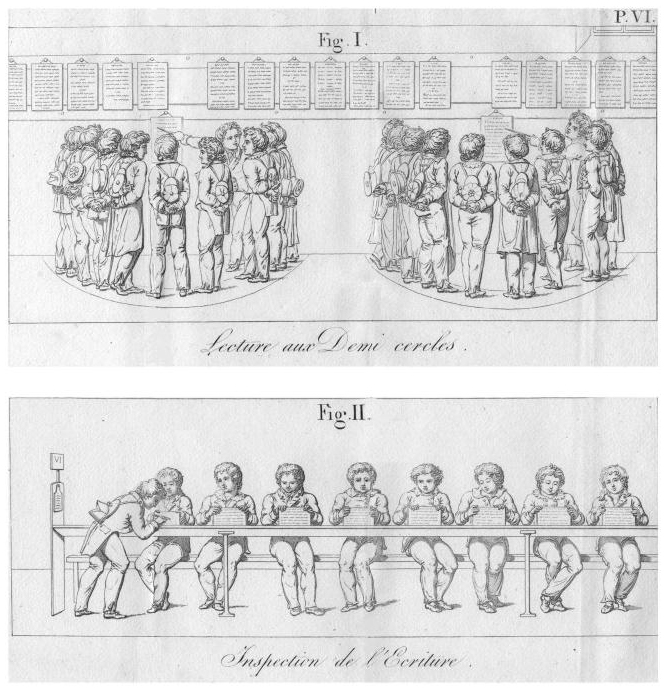
Oral exercises, in reading or arithmetic, or with the aid of a blackboard, arithmetic or linear drawing, are done standing up, in groups of no more than 9, with pupils standing side by side, forming a semi-circle. Hence the name given to this kind of activity: « circle work ».
So, in a mutual school with 36 students in 3rd arithmetic class, bench work will be done in two groups with two monitors, and blackboard exercises with 4 groups and 4 monitors. Class sizes can therefore vary from school to school and throughout the year, the only limitation being the size of the premises.
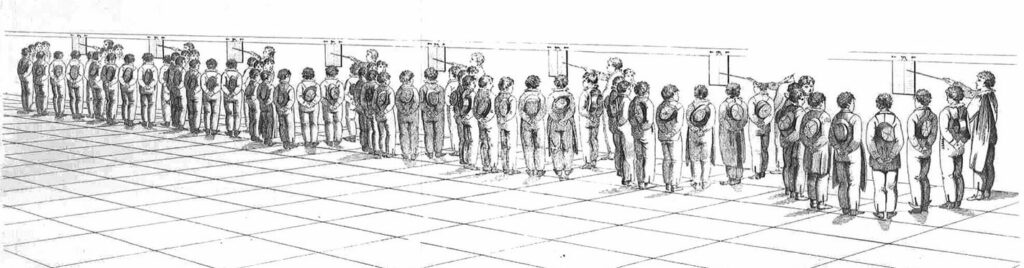
D. Tools
Low costs are one of the preoccupations of the new teaching method. Furniture was therefore very basic.
- Benches and desks are made of ordinary planks, fastened with heavy nails. The benches have no backrests: a superfluous luxury!
- The platform is clearly elevated: about 0.65 m. Several steps lead up to the teacher’s desk. The master reigns over the children’s community as much by his material position as by his personal ascendancy.
- The clock is noted as « indispensable », as teaching and maneuvers are strictly timed.
- Half-circles, also known as reading circles, give mutual schools a typical and original appearance. These are usually semi-circular iron hangers that can be raised or lowered at will. Sometimes, the materialization is simply applied to the floor: grooves, large nails or arched strips.
- Blackboards were systematically used for linear drawing and arithmetic. They are 1 m long and 0.70 m wide, with a movable meter at the top. They are placed inside each semicircle.
- Telegraphs. When work takes place at the tables, such as writing, signals are used to link and communicate between the general monitor and the individual monitors: these are the telegraphs. A planchette, attached to the upper end of a round stick 1.70 m high, is installed at the first table of each class, thanks to two holes drilled at the top and bottom of the desk. On one side is the class number (1 to 8); on the other, EX (examen), replaced around 1830 by COR (correction). These telegraphs are portable. They could be moved if the number of students increased or decreased. In this way, the master and the general monitor have the exact composition of each class and the number of tables occupied by each. As soon as an exercise is completed, the class monitor turns the telegraph and presents the EX side to the desk. All monitors do the same. The general monitor gives the order to proceed with inspection and any corrections. Once these have been completed, the class number is presented again. And the exercises resume. Next to the telegraphs are the occasional board stands.
- Monitor rods. These are used to indicate on tables the letters or words to be read, the details of operations to be carried out, and the lines to be reproduced. In rural schools, these are generally only available thanks to the good will and ingenuity of the teachers, who obtain them from nearby woods.
- Sand (for writing) and then slates are constantly used in all subjects. This was an essential innovation in the mutual mode, as other schools did not use them.
- Boards instead of books. The first reason is financial, as a single board is sufficient for up to nine pupils. But the pedagogical reasons are no less important. The format makes them easy to read and store. The concern for presentation and highlighting certain characters is accompanied by a different layout from that of the textbooks.
- Books are reserved for the eighth grade, as are nibs, ink and paper.
- Registers, currently in use, ensure sound management of the schools. One in particular deserves special mention: « Le grand livre de l’école » (the school’s ledger), which is first and foremost a registration book. It records the child’s surname, first name and age, as well as the parents’ occupation and address. The teacher enters the precise date of entry and exit of each child, in each class, including music and linear drawing.
E. Communication
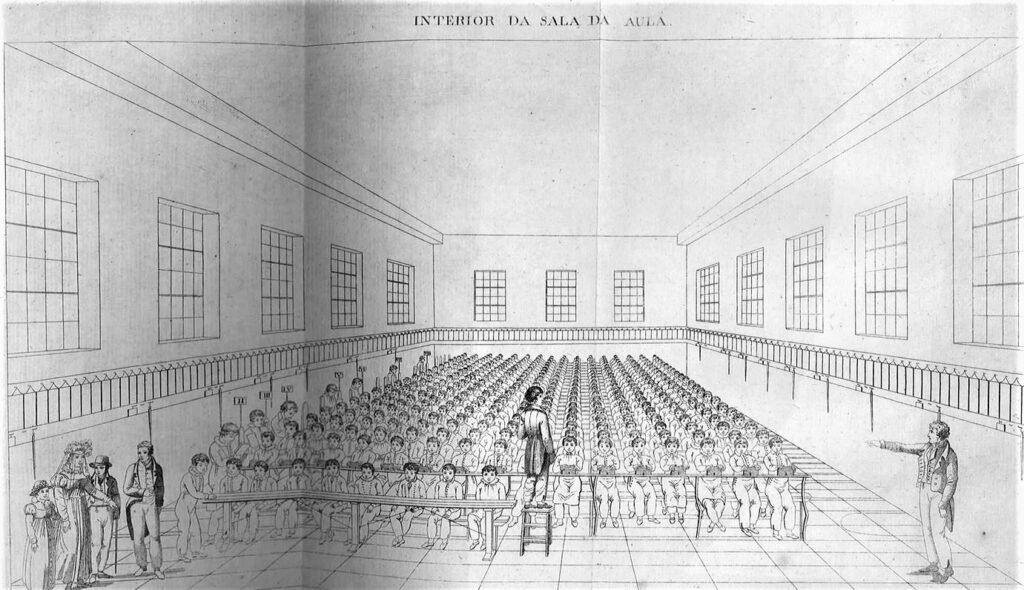
To ensure that dozens or hundreds of pupils are led and developed correctly, and to avoid wasting time, those in charge of mutual education have planned precise, rapid, immediately comprehensible orders:
- The voice is rarely used. Injunctions transmitted in this way are generally addressed to the instructors, sometimes to a specific class;
- The bell attracts attention. It precedes information or a movement to be executed;
- The whistle has a dual function. It is used to intervene in the general order of the school, « to impose silence », for example, and to signal the start or end of certain exercises during the lesson, « to have the pupils say by heart, to spell, to stop reading ». Only the teacher is authorized to use them.
- As for hand signals, they have been used extensively. Intended to evoke the act or movement to be accomplished, they attract the eye and should bring calm to the community.
« Bellists » versus « Lancasterians »
While the two schools, Bell’s and Lancaster’s, were very close to each other in terms of content, methods and organization, they clashed violently over the role and place of religious education. All other program-related differences are a matter of taste, habit or local circumstance.
As Sylvian Tinembert and Edward Pahud point out in « Une innovation pédagogique, le cas de l’enseignement mutuel au XIXe siècle » (Editions Livreo-Alphil, 2019), Lancaster, as a follower of the dissident Quaker movement,
« recognized Christianity but professed that belief belonged to the professional sphere and that each person was free in his or her convictions. He also advocates egalitarianism, tolerance and the idea that, in this country, there is such a variety of religions and sects that it is impossible to teach all doctrines. Consequently, it is necessary to remain neutral, to limit teaching to the reading of the Bible, avoiding any interpretation, and to leave fundamental religious instruction to the various churches, ensuring that pupils follow the services and teachings of the denomination to which they belong ».
Nevertheless, Bellists and Lancasterians had their differences. For the Lancasterians, Bell had invented nothing and was merely describing what he had seen in India. For the Bellists, furious that Lancaster found a positive response from certain members of the Royal family, Lancaster was portrayed as the devil, an « enemy » of the official Anglican religion, who admitted children of all origins and denominations to his schools !
9. France adopting mutuel tuition
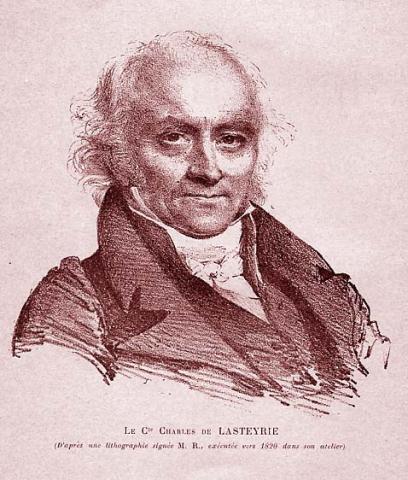

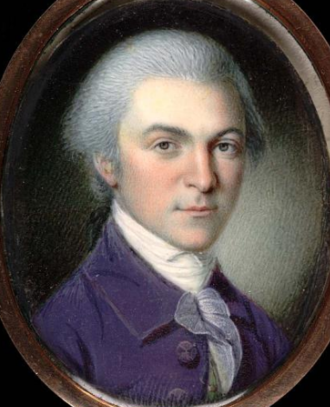
In London, the Lancaster association was joined by a number of high-ranking personalities, both English and foreign. These included Geneva physicist Marc Auguste Pictet de Rochemont (1752-1825), French paleontologist Georges Cuvier (1769-1832) and his compatriots, agronomist Charles Philibert de Lasteyrie (1759-1849) and Lancaster’s future translator into French, archaeologist Alexandre de Laborde (1773-1842).
After the peace of 1814, many countries – notably England, Prussia, France and Russia – bled dry by the Napoleonic wars, which had resulted in the loss of thousands of young teachers and qualified executives on the battlefields, made education their top priority, not least to keep up with the industrial revolution that was coming to shake them to their foundations.
Added to this is the fact that the number of orphans in Europe has become a major problem for all states, especially as the coffers are empty. To keep street children occupied, schools were needed, many of them to be built with very little money and many teachers… nonexistent. Learning of the resounding success of mutual education, several Frenchmen travelled to England to discover the new method.
Laborde brought back his « Plan d’éducation pour les enfants pauvres, d’après les deux méthodes (du docteur Bell et de M. Lancaster) », and Lasteyrie his « Nouveau système d’éducation pour les écoles primaires ». In 1815, the Duc de la Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827) published his book on Joseph Lancaster’s « Système anglais d’instruction ».
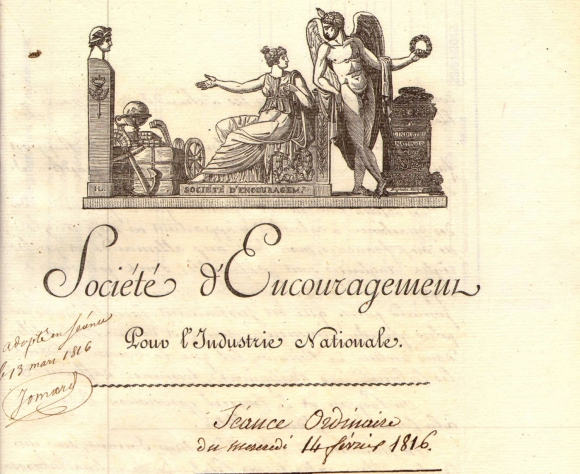
Since 1802, Paris had been home to the « Société d’encouragement pour l’industrie nationale », whose Secretary General was linguist Joseph-Marie de Gérando (1772-1842), and of whom Laborde was a founder together with Jean-Antoine Chaptal (1752-1832). Unsurprisingly, Gérando had been raised by the Oratorians and was initially destined for the Church.
On March 1, 1815, Lasteyrie, Laborde and Gérando proposed to the Société d’Encouragement the creation of a new association whose purpose would be « to gather and spread enlightenment likely to provide the lower classes of the people with the kind of intellectual and moral education most suited to their needs ».

In his report presented to the Société d’Encouragement on March 20, 1815, Gérando proposed that the newly-appointed Minister of the Interior, Lazare Carnot (During les Cents-Jour, i.e. between March 20-June 22, 1815), be asked to promote « the adoption of procedures likely to regenerate primary education in France », i.e. the system of mutual tuition.
Political and social interests were not the only ones at stake. The French economy, too, was much to benefit from the development of education. « What can we expect, » said Carnot in 1815, « if the man who drives the plough is as stupid as the horses that pull it?«
Gérando also proposed the creation of an association dedicated specifically to its propagation, underlining the advantages of the new approach: economic advantage first, since it involves « employing the children themselves, in relation to each other, as teaching aids », and that a single teacher is sufficient for 1,000 pupils; educational advantage second, since it is possible « to teach, in two years, everything that children of inferior conditions need to know, and much more than they learn today by much longer processes »; a moral and social advantage, insofar as children « are imbued from an early age with a sense of duty, a feeling that will one day guarantee their obedience to the law and their respect for the social order ».
The engineer-geographer and polytechnician Edeme-François Jomard (1777-1862), for whom the education of the people is an obligation of society towards itself, said nothing else: « How can we demand that unfortunate people, devoid of all enlightenment, know the social pact and submit to it? Or how can we, without being foolish, count on their invariable and blind submission?«
The Société d’Encouragement then validated the conclusions of its report by subscribing the sum of 500 francs in favor of the new association, and by deciding that, in addition to its moral influence, it would place at the latter’s disposal the various means of execution that might belong to it.
10. Lazare Carnot at the helm

Following the Concordat between Napoleon and the Vatican, the Emperor issued a decree on education on August 15, 1808, requiring schools to follow the « principles of the Catholic Church ».
The Frères des Ecoles Chrétiennes (Institute of the Brothers of the Christian Schools), unconditional advocates of the « simultaneous education » theorized by their founder Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), were to take charge of all primary education and train teachers.
Disbanded during the Revolution, the Brothers resumed their functions in 1810. Encouraged to develop to counter the influence of the Jesuits, authorized in 1816 to return to France, they rapidly expanded throughout France.
But the educational situation was pitiful. This is what senior French officials constantly say when they visit the territories annexed by the Empire, notably North Germany and Holland. The comparison with France makes them blush with shame.
In 1810, the naturalist Georges Cuvier wrote in his report:
« We would be hard pressed to convey the effect produced on us by the first elementary school we entered in Holland. Children, teachers, premises, methods, teaching, everything is in perfect order (…) Several prefects have assured us that we would not find a single young boy in their department today who did not know how to read and write. »
Faced with such a contrast, which was not to the conqueror’s advantage, the Imperial University, like ancient Rome, set out to teach the conquered country. In his decree of November 15, 1811, the Emperor decided:
« The council of our Imperial University will present us with a report on the part of the system established in Holland for primary instruction that would be applicable to the other departments of our Empire. »
The Emperor abdicated on April 4, 1814, before any decision had been taken to regenerate the French « petites écoles ». At least the Imperial University’s reports had exposed their misery and drawn public attention to them.
Appointed Minister of the Interior, and therefore in charge of Education during the Cents-Jours, Lazare Carnot, a co-founder of the Ecole Polytechnique, was completely convinced of the potential excellence of « mutual education ».
On April 10, 1815, he set up a Council for Industry and Charity, at whose first meeting he himself presented Gérando‘s report;
On April 27, 1815, he submitted a report to the Emperor in which he stated:

« There are 2 million children in France clamoring for primary education, and of these 2 million, some receive a very imperfect education, while others are completely deprived« .
He then recommended mutual education, whose « purpose is to give primary education the greatest degree of simplicity, rapidity and economy, while also giving it the degree of perfection suitable for the lower classes of society, and also by bringing into it everything that can give rise to and maintain in the hearts of children a sense of duty, justice, honor and respect for the established order ».
Minutes later, Lazare Carnot had the French Emperor sign the following decree:
« Article 1. – Our Minister of the Interior will call upon those persons who deserve to be consulted on the best methods of primary education. He will examine these methods, and decide on and direct the testing of those he deems to be preferable.
« Art. 2 – A primary education test school will be opened in Paris, organized in such a way as to be able to serve as a model and to become a normal school for training primary school teachers.
« Art. 3 – Once satisfactory results have been obtained from the trial school, our Minister of the Interior will propose the appropriate measures to ensure that all departments can rapidly benefit from the new methods that will have been adopted.«
For Carnot, contrary to those in the business of Philanthropy, there were not any longer poor or rich children. All citizens of the Republic required and had to be offered the best education available on Earth.
The advisory board set up by Carnot included his friends Laborde, Jomard, Abbé Gaultier, then Lasteyrie and Gérando, i.e. the very promoters or first founders of the Société en formation.
Thus, on June 17, 1815 (the eve of the defeat at Waterloo), the Société pour l’instruction élémentaire (SIE) was born, still under the impetus of Carnot, determined to win the war for education. The SIE’s first general meeting was held on the premises of the Société d’Encouragement. At its head were several protagonists of the ministerial commission: Jomard became one of the secretaries of the new society, alongside Gérando (president), Lasteyrie (vice-president) and Laborde (general secretary).
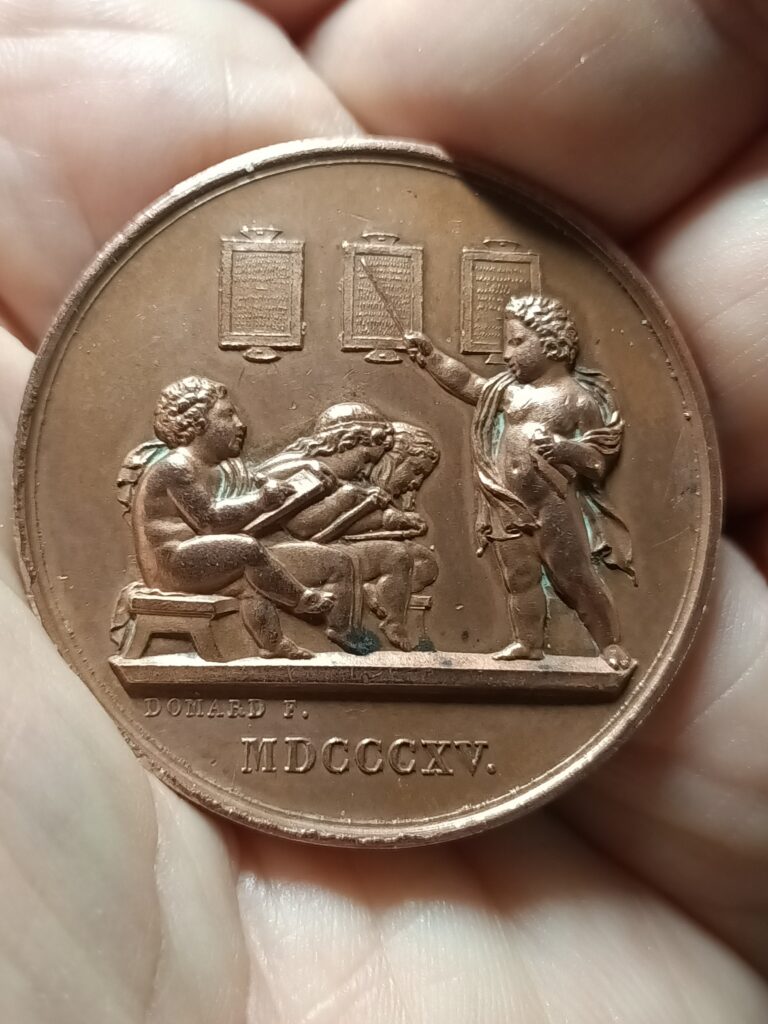

for whom Mutual Tuition was the core of their commitment to primary education.
Before the ordinance of 1816, the number of children attending « petites écoles » was 165,000 throughout France, and by the end of 1820 it had risen to 1,123,000. Almost a factor of 10!
Lazare Carnot clearly wanted to perpetuate the offensive he had launched during the Hundred Days to propagate mutual education throughout the country and, in so doing, to rapidly develop the education of all the children of the Patrie.
After its creation, subscriptions for the SIE poured in, and before long 150 names were added to those of the founders to promote and organize mutual education in France. One of these subscribers was Lazare Carnot.
In its first year of existence, the SIE attracted almost 700 members, initially teachers from the École Polytechnique (Ampère, Berthollet, Chaptal, Guyton de Morveau, Hachette, Mérimée, Thénard), and then some 30 alumni, around half of them from the first graduating class (1794) of the École Polytechnique. Among the latter were a fellow student of Jomard‘s at the geographers’ school, Louis-Benjamin Francœur, professor of higher algebra at the Paris Faculty of Science, comrades from the Egyptian campaign, and Chabrol de Volvic, prefect of the Seine since 1812.
All had but one hope: that Monge’s genial methods of brigades and mutual tuition, which had been diminished and banned once Napoleon turned Polytechnique into a mere military school under the direction of mathematician Pierre-Simon Laplace (1749-1827), could benefit the greatest number and organize a national recovery.
Based in Paris, the SIE extended its operations to the provinces, where it encouraged the founding of subsidiary companies, to which it offered « to send them teachers, to provide them with any information they might need, to give them paintings and books at cost price… ».

The SIE was also interested in education girls (art. 10). It set up a committee of ladies to look after them: president, Baroness de Gérando; vice-president, Countess de Laborde.
Beyond women, the movement spread to uneducated adults, so numerous at the time. On May 1, 1816, the Society set up a commission for the establishment of adult schools. It was also concerned with barracks, which were to be turned into military schools; prisons, especially children’s prisons; and the colored inhabitants of the colonies, who were to be regenerated by the development of education.
Finally, the members of the Society, attributing a human and general value to their mission, dreamed of founding branches abroad. In November 1818, Laborde called for the creation of a special committee to do so.
Last but not least, the Society did not limit its activities to simply creating schools, but also organized inspections and examinations. It published works (on the mutual tuition method, elementary books on reading, grammar and arithmetic). It distributed awards to the best teachers and instructors.
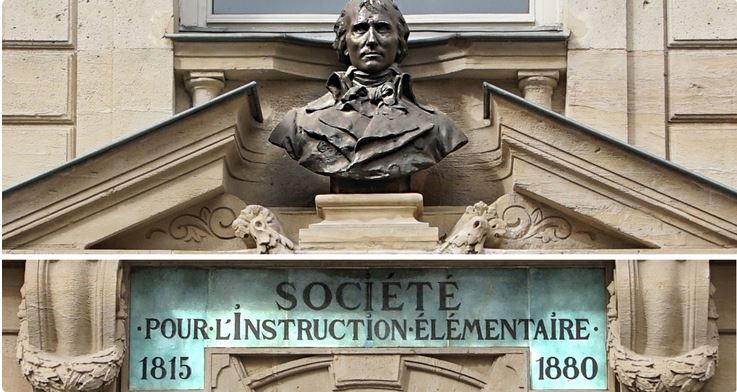
Following the promulgation of the ordinance of July 29, 1818 authorizing Caisse d’Epargne societies (Saving Banks associations), it asked teachers to entrust part of their salaries to these funds to ensure their retirement; setting an example, it deposited funds with the Caisse for the teachers of the schools it had set up.
Today, the SIE, whose head office is a specially-built building at 6, rue du Fouarre in the 5th arrondissement of Paris, remains the oldest and largest secular primary education association in France.
11. The rue Saint-Jean-de-Beauvais pilot program
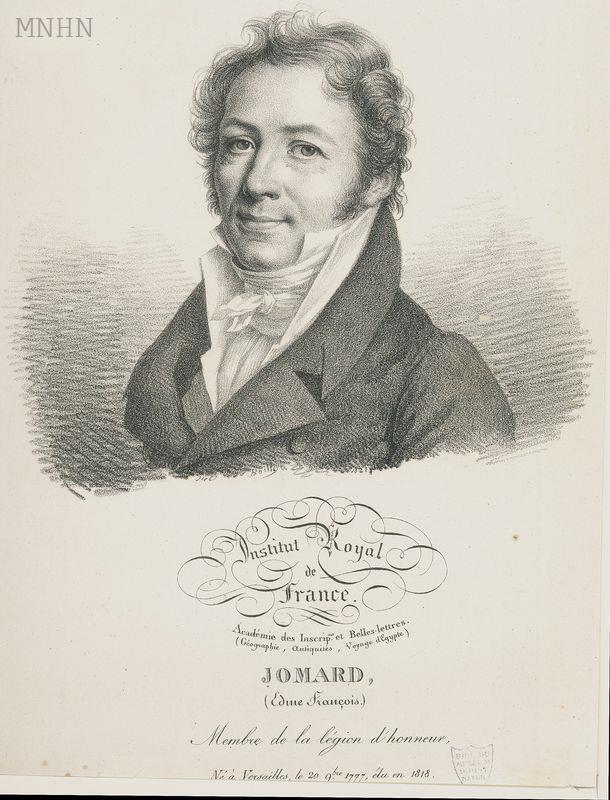
As said before, after his trip to England, Jomard, whose portrait appears in a medaillon on the façade of the SIE, also embraced the new system.
In his « reflections on the state of English industry », he wrote, after expressing his enthusiasm for various inventions observed across the Channel: « There is, however, something even more extraordinary: these are schools without teachers: nothing, however, is more real. We now know that there are thousands of children taught without a teacher, and at no cost to their families or the State: an admirable method that will soon spread to France.«
A graduate of the Ecole Polytechnique, and an exceptionnal scientist who went with Monge to Egypt, Jomard was the ideal man to oversee the material organization of the test school, in particular by arranging for furniture to be made and teaching aids to be printed in accordance with English principles. Jomard also supervised the training of a small nucleus of students – around 20 – as « monitors » before the opening of the school proper in September 1815, planned for 350 students: a modality reminiscent of the « chefs de brigade » of the first graduating class of the École polytechnique.
However, the members of the SIE soon realized that they needed to train trainers. The English therefore welcomed several Frenchmen to train them in mutual teaching. A pastor from the Cévennes, François Martin (1793-1837), after training as a « monitor » in England, was called in by Lasteyrie to run the first mutual school, which opened its doors on June 13, 1815, on rue Saint-Jean-de-Beauvais in Paris, close to Place Maubert. This was the model school that would enable other mutual schools to be opened, thanks to the training of competent « monitors ». The school was soon unable to keep up with demand from hundreds of communes, which were considering sending one of their own to be trained in the new method.
Pastor Paul-Emile Frossard, also trained by the English, took charge of a Parisian school on rue Popincourt, while Bellot ran another. In July, Martin submitted his report. The model class takes in some 15 students destined to become monitors and principals of elementary schools with up to 350 children. Martin reports that in six weeks, they read, write, calculate and « know how to execute the movements that form the gymnastic part of the new education system ».
12. Mutual tuition and music
As Christine Bierre amply documents in her article « La musique et formation du citoyen à l’ère de la Révolution française » (1990):
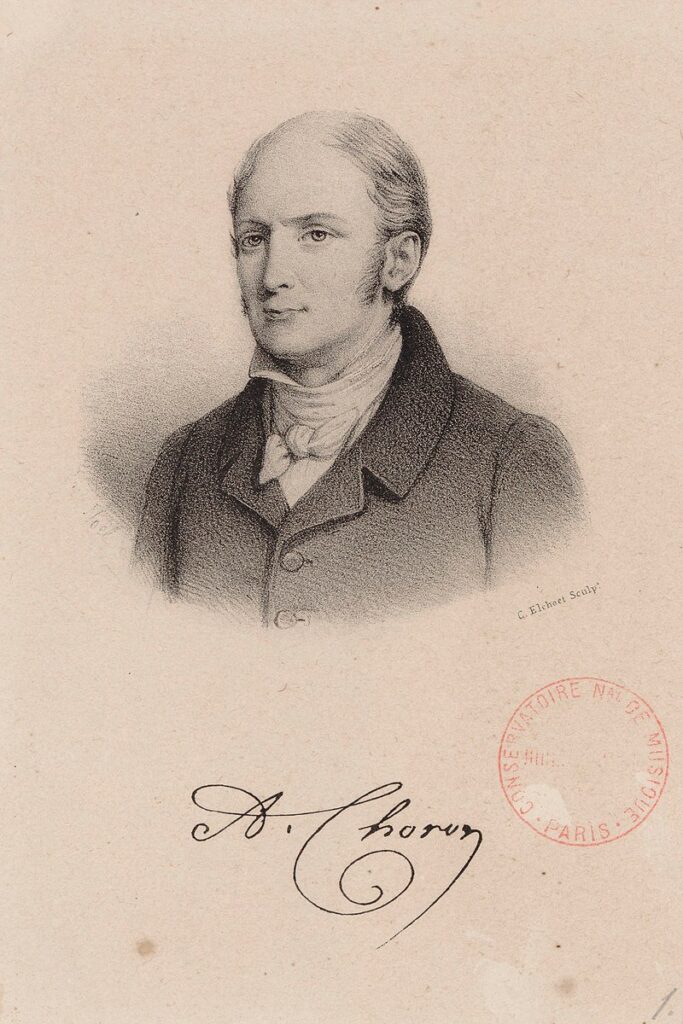
« It was at this school on rue Saint-Jean-de-Beauvais, under the direction of a Commission comprising Gérando, Jomard, Lasteyrie, Laborde and Abbé Gaultier, that the application of mutual teaching to the learning of solfeggio and singing was tested for the first time. Alexandre Choron (1771-1834), who since 1814 had opened two music schools for boys and girls, was also a member of the Commission. Not surprisingly, it was on the initiative of Baron de Gérando that the idea of introducing singing into primary education was adopted. When Monsieur le baron de Gérando proposed the introduction of elementary singing in primary schools’, says Jomard in a report presented to the Board of Directors of the Société pour l’Enseignement mutuel, ‘you were all struck by the correctness of the views developed by our colleague (…) It showed the happy influence that such a practice could have, and the real connection that exists between the proper use of song and the perfecting of morals, the ultimate goal of instruction and of all our efforts. Not only was the application of mutual instruction to music revolutionary in itself, but what was equally revolutionary was the fact that children were learning to read and write, almost as intensively. Children studied singing, for four to five hours a week! »
In fact, it was Lazare Carnot himself who wanted to introduce music into the mutual education schools. To this end, he met several times with musician Alexandre Choron (1771-1834), who brought together a number of children and had them perform in his presence several pieces learned in very few lessons. Carnot also was acquinted with Guillaume-Louis Bocquillon, known as Wilhem (1781-1842) for ten years. He saw the possibility of using him to introduce singing into schools, and together they visited the one on rue Saint-Jean-de-Beauvais, a free pilot school for mutual education in Paris open to three hundred children.
Michael Werner‘s recent article, « Musique et pacification sociale, missions fondatrices de l’éducation musicale (1795-1860) », echoes and confirms the groundbreaking research initiated by Christine Bierre in 1990.

Excerpt:
« One of the fields in which the results of mutualist pedagogy are clearly visible is musical education. Several players played a decisive role here, and deserve a brief mention.
The first is Guillaume-Louis Bocquillon, known as Wilhem (1781-1842). The son of an officer and himself from a military background, he then devoted himself to musical composition and teaching, particularly at the Lycée Napoléon (later Collège Henri-IV). His friend Pierre Jean de Béranger put him in touch with Joseph-Marie de Gérando and François Jomard, the leading lights of the SIE. Through them, he learned about mutual teaching and immediately understood the benefits of this method for musical education. In 1818, the Paris municipality allowed him to set up a first experiment at the elementary school on rue Saint-Jean-de-Beauvais. Wilhem developed a method, the necessary teaching materials (in the form of charts) and instructed the chosen student monitors. The results were, according to Jomard, spectacular. At the end of a few months’ instruction, the pupils had not only acquired the basic notions of solfeggio and musical notation, chromatic scales, intervals and measures, but were also performing collective songs in several voices (Jomard 1842: 228 ff)
This success led the SIE to propose to the Prefect and Minister of the Interior that music be introduced into the teaching of elementary schools in the city of Paris, a move officially endorsed in 1820. Wilhem himself was appointed full professor of music teaching in Paris, and music classes were introduced in many of the city’s schools, before spreading to the départements and regions. At the same time, the municipality opened two teacher-training colleges to train future singing teachers.
The second early player in the debate was the composer Alexandre Choron (1771-1834). A member, like Jomard and Francœur, of the first graduating class of the École polytechnique (1795), composer and friend of André Grétry, he had been concerned since 1805 about the decline of choral singing following the abolition of the master classes. An opponent of the Conservatoire, whose academicism and lack of interest in the teaching of choral singing he criticized, in 1812 he was entrusted by the Ministry with a mission to « reorganize the choir and the choirmasters of the churches of France ». He developed a teaching method known as the « concertante method », but also remained committed to the social vocation of choral music. Choron was also one of the founding members of the SIE in 1815, a sign of his commitment to educational issues. During the Restoration, he turned more to religious songs, which he considered to be the historical heart of choral practice. (…) Finally, with the king’s support, he founded the Institution royale de musique classique et religieuse, successfully competing with the Conservatoire in the teaching of vocal art.
For the general public, he arranged for oratorios, requiems and cantatas to be performed by singers from his school in a number of spacious churches, thus ensuring a new presence for sacred music on the Parisian stage. For some of these concerts, he sometimes mobilized student singers from elementary and poor schools, whom he never ceased to follow throughout his career. »
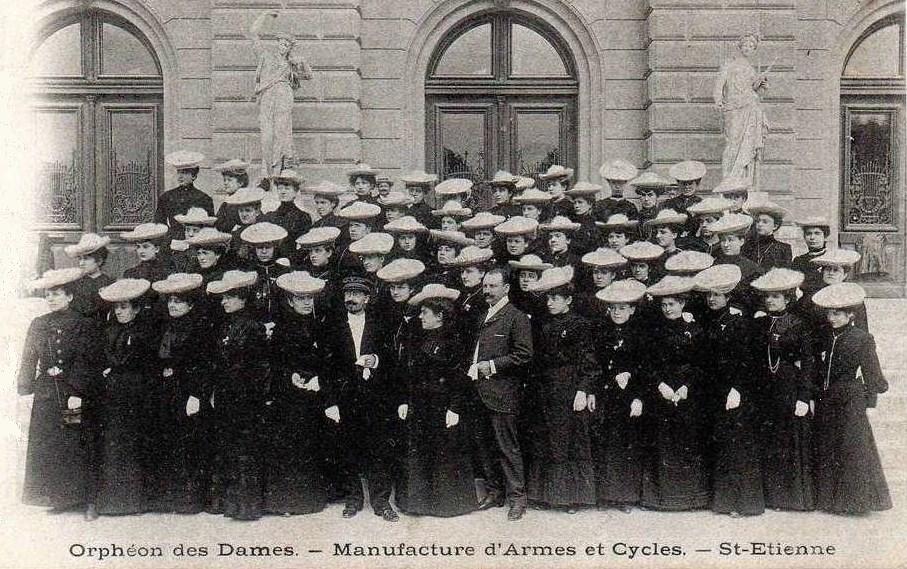
« (…) What fostered this expansion of music education for young people and the working classes from 1820 onwards was a political will shared by a broad spectrum of leaders and stakeholders. The liberals who formed the core of the SIE continued to adhere to the emancipatory mission of education set out by the Convention. By focusing on both the inner formation of the soul and the blossoming of a collective conscience, music – and singing in particular – became a prime field for popular education. Liberals therefore emphasized the moral benefits of music. Thus, in his proposal to introduce singing into elementary school, Gérando remarks:
‘Those of us who have visited Germany have been surprised to see how much simple music plays a part in popular entertainment and family pleasures, even in the poorest conditions, and have observed how salutary its influence is on morals. And Joseph d’Ortigue states lapidary: ‘A people that sings is a happy people, and therefore a moral people. This emphasis on the social benefits of musical activity fits in well with the idea of ‘universal education’, inherited from the Enlightenment and the foundation of the pedagogies of Lancaster in England or Johann Heinrich Pestalozzi in Switzerland.' »
After a trial run at the St-Jean-de-Beauvais school in 1819, singing quickly spread to all the mutual schools. Wilhem was both the creator and the architect of the development of this teaching method, which soon spread to adult and apprentice classes. Periodic meetings of children initiated into vocal music were organized. Thus was born the first French post-school organization: the Orphéon, which, after Wilhem, counted Charles Gounod and Jules Pasdeloup among its directors.
In an 1842 speech to the SIE, Hippolyte Carnot asserted that Wilhem had « elevated music to the rank of a civic institution », and that the « ennoblement » of the individual soul was to be achieved in the new collective order of the reunited nation.
13. Jomard, Choron, Francoeur and « elementary » knowledge
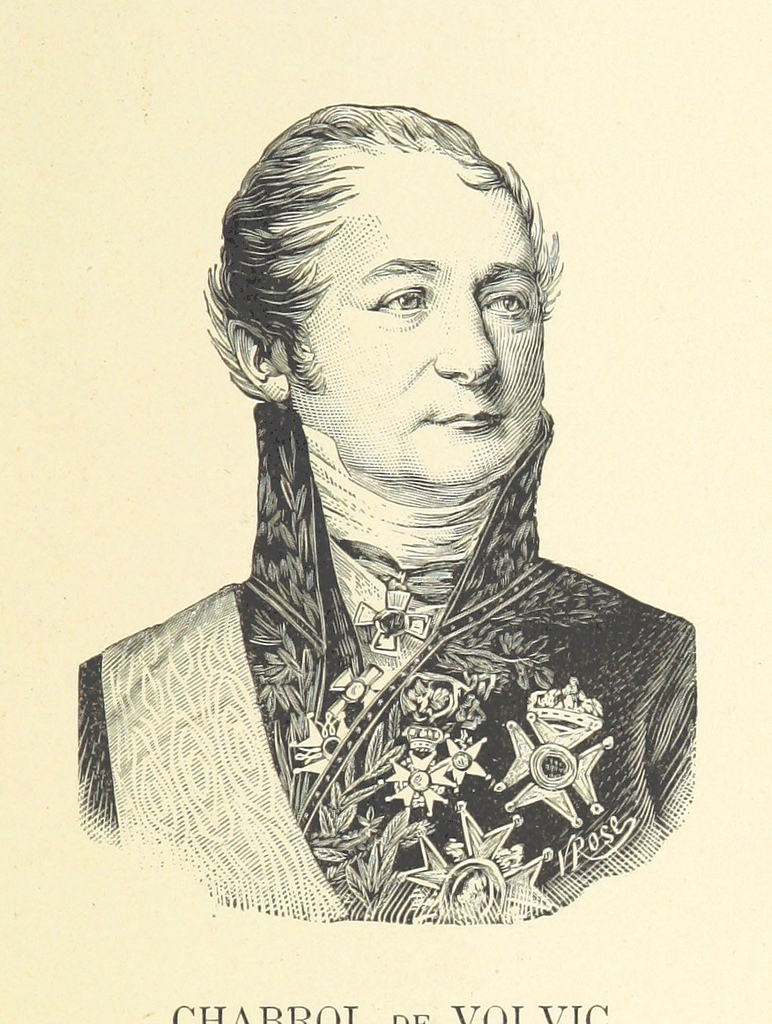
Renaud d’Enfert‘s comprehensive article, published on the website of the Société de la bibliothèque et de l’histoire de l’Ecole polytechique (SABIX), completes the picture with a close-up on the work of Jomard and Francoeur, whose portraits are featured in a medallion on the façade of the SIE headquarters on rue du Fouarre in Paris.
Right from the start of the Second Restoration, the SEI received the backing and support of the Prefect of the Seine, Gaspard de Chabrol de Volvic (1773-1843). In the summer of 1815, the latter appointed Jomard, a linguist in contact with the Humboldt brothers who had been part of the short-lived commission under Carnot and who had protected him during the Hundred Days, « head of the office of public instruction and arts », a position he held until 1823.
In a decree dated November 3, 1815, Volvic, in order to take « the necessary measures to extend the benefits of instruction to all poor families domiciled within the prefecture » and to develop « the new system of elementary instruction » throughout the Seine department, created an eleven-person committee « to extend the benefits of free education to the Seine department », and included all the influential members of the SIE (Jomard, Gérando, Laborde, Doudeauville, Lasteyrie, Gaultier, etc.). ).
In this role, Jomard was responsible for finding sites for new schools. These rapidly multiplied in and around the capital: in 1818, he counted 18 free and 32 fee-paying mutual schools covering all of the capital’s arrondissements, as well as 13 schools in the arrondissements of Sceaux and Saint-Denis. From this work, he drew up his « Abrégé des écoles élémentaires » (1816), a sort of practical guide in which he compiled everything a cityen decided to set up a mutual school needed to know about material organization.
On the pedagogical front, Jomard was the author, in 1816, of a reading method produced in collaboration with the composer and musician Alexandre Choron, who had published a method for learning to read and write as early as 1802, and Abbé Gaultier, a pedagogue who had developed a teaching method under the name of « jeux instructifs » and had traveled to London to study English methods.

Designed for the new elementary school on rue Saint-Jean-de-Beauvais, where Choron was appointed music teacher, it breaks with the traditional spelling method.
Instead of saying « b-o-n = bon », she uses the musical sounds of the language to say « b-on = bon ». In 1821-1822, Jomard also published « Arithmétique élémentaire » (Elementary Arithmetic), designed to remedy the weaknesses of Lancaster’s arithmetic method, which he accused of « making children contract a simple, routine and mechanical habit » instead of serving « to fortify their attention and train them in reasoning ». In the meantime, he and Francœur and Lasteyrie had set up a « calligraphy commission » at the SIE, to develop the principles that would guide the teaching of writing in mutual schools, a writing style intended to be « national », to replace the English models.

For his part, Louis-Benjamin Francoeur (1773-1849) provides, according to Jomard, « a long series of luminous reports on treatises on arithmetic, weights and measures, singing and musical art, drawing and geometry, which it would take far too long to relate or quote ». Filling a gap, in 1819 Francœur published « Le dessin linéaire » (Linear Drawing), a drawing method based on freehand drawing of geometric figures, which broke with traditional, academically inspired ways of teaching and learning drawing.
For Jomard and Francoeur, the idea behind « mutuel tuition » was to broaden the range of subjects taught in primary schools beyond the traditional « reading, writing and arithmetic »: in addition to drawing, also singing, gymnastics, geography and grammar now made their appearance in elementary school.
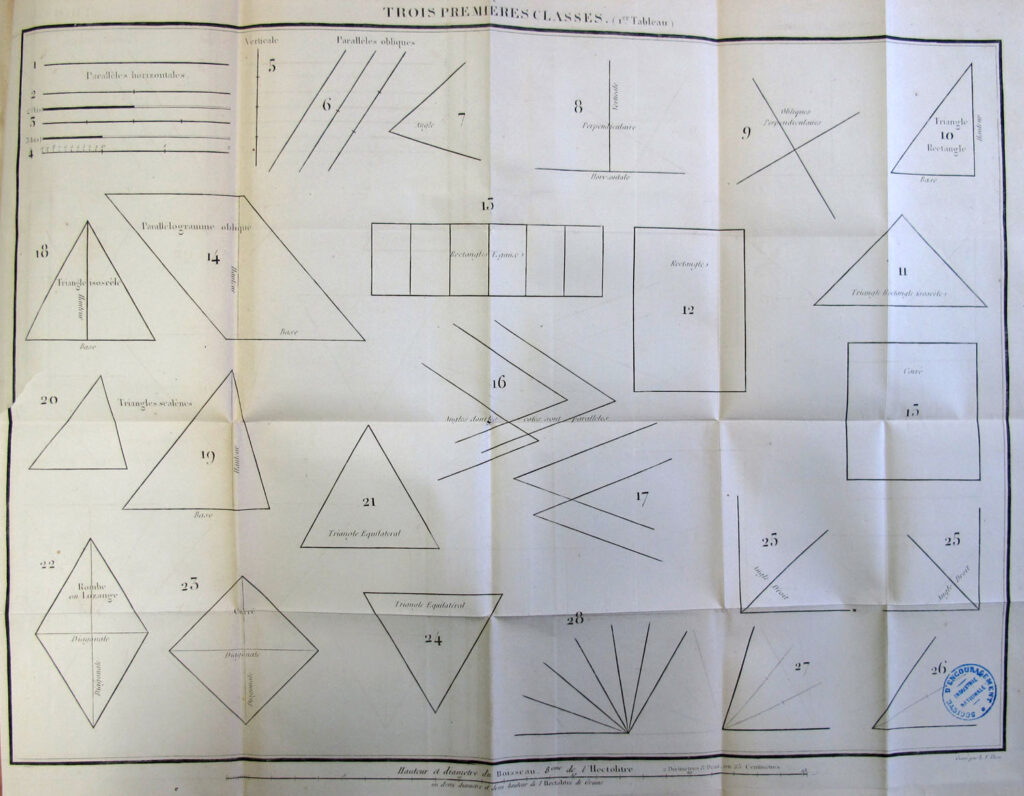
Linear drawing was nonetheless seen as an elementary skill in its own right, on a par with reading, writing and arithmetic.
Presenting Francœur‘s method to the Société d’Encouragement, Jomard declared:
« The usefulness that industry may one day derive from it is so great and so visible, that it would be superfluous to insist on it. It is not without reason that this result has been considered as precious for the people, as the knowledge of reading and writing ».
Finally, for Jomard, the widespread teaching of reading, writing, arithmetic, linear drawing and singing is the prerequisite for the scientific education of the people:
« In recent times, we have rightly insisted on the usefulness of teaching the elements of the physical and mathematical sciences to the working class. On this depends the advancement of industry and agriculture, which, despite all their progress, are still backward in many respects. It is only through the possession of these elementary notions that workers will perfect their processes, their means, their instruments and their products, and will be able to become skilful foremen and good workshop managers. But how can this be achieved when the mass of the population is still so ignorant?
How, without the art of reading and writing, could they not understand a single word of the chemical and mechanical arts, but only feel their advantage and consent to engage in arduous studies? What’s this! Fifteen million Frenchmen and more perhaps, do not know how to do the first two rules of arithmetic, and we would flatter ourselves to propagate among them the first principles of mechanics and geometry! The basis of this improvement is obviously primary education made more general or even universal ».
14. Nationwide
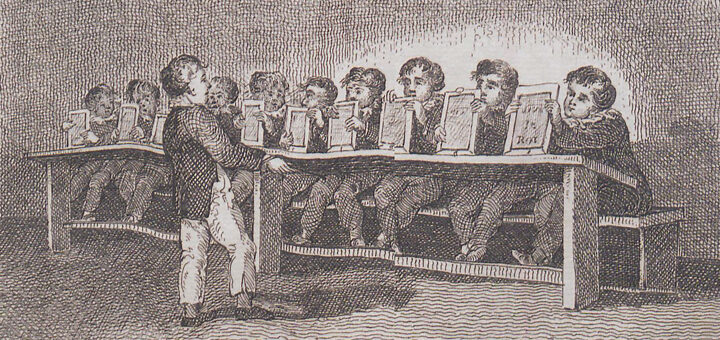
The results of mutual education are spectacular and rapid, both in terms of learning time and the quality of skills acquired. Whereas in the Lasalle Brothers’ schools it took 4 years to learn to read, this time was reduced to a year and a half in the mutuel establishments!
The enthusiastic French of 1815, with their vivid imagination, saw in this teaching system a veritable panacea. It had undeniable advantages. First of all, it was economical, requiring few teachers and enabling a considerable number of children to be taught at low cost. It is estimated that 4,000 to 5,000 fr. a year were sufficient to maintain a school of 1,000 children: 4 fr. per pupil! Education would never have been so cheap. It also ensured rapid development of primary education, since the shortage of teachers was no longer a limiting factor. With figures to back it up, it was calculated that it would only take a dozen years to extend the benefits of primary education to the whole of France!
To these indisputable advantages, the travelers of 1815 added qualitative arguments. They considered the teaching of instructors superior to that of masters: « He does not know his lesson better than the master, » wrote Laborde, « but he knows it differently ». The child instructor (monitor) takes pleasure in communicating his newly acquired knowledge to his classmates, doing his job « with as much charm as a preceptor finds it disgusting » (Laborde).
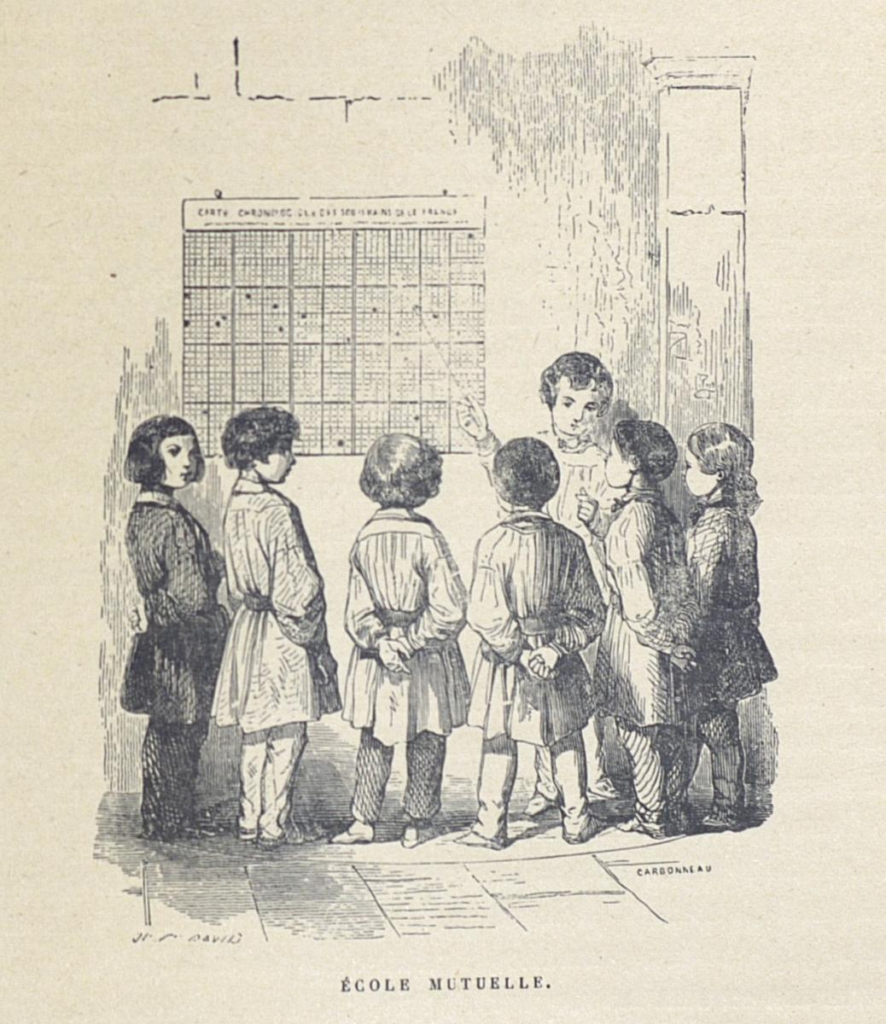
On the other hand, being a child himself, he knows better than the teacher the difficulties of the task, the pitfalls of the lesson, over which he has just stumbled. He will therefore lead his classmates more slowly, more surely, and be a better guide for them.
But teaching won’t be the only thing to benefit from the mutual system; school discipline and morals will also benefit. The child, submissive to his classmate, will obey him more readily than the teacher, since the young instructor owes his superiority solely to his own merit. Finally, the child, with his classmate who knows him well because he lives with him, will not have, as with the teacher, the resource of lying to hide his intimate thoughts or faults: and dissimulation, the social scourge that was learned from the school benches, will thus disappear from mutual establishments.
And Laborde concluded his apology for the method : in the new schools, « work is for them a game, science a struggle, authority a reward ».
The benefits of this teaching were not to be confined to the school: children returning home would in turn exert a happy influence on their parents, becoming « missionaries » of both morality and truth in their families.
Gontard wrote in 1956:
« And let no evil spirits say that these are the daydreams and utopias of idealists! There is irrefutable proof of the value of this method. Look at Scotland. At the end of the 17th century, it was a land of beggary and misery, living without law, without religion, without morals, men drinking, women blaspheming, all fighting. In 1815, thanks to the magic wand of the mutual school, Scotland became a paradise. « It is not uncommon in Scotland to find a shepherd reading Virgil… but it is almost unheard of to meet a malefactor there, »
Laborde agrees.
« Let’s develop the method in France and, by 1850, it will be a land of prosperity and happiness, from which immorality, fanaticism, revolutions and social unrest, all sons and daughters of ignorance, will be banished. »
In 1818, Joseph Hamel, in his report to the Emperor of Russia, notes:
« The method of mutual education has been introduced throughout France with a rapidity and success far greater than could reasonably be expected, and in less than three years more than 400 schools have already been founded. There is every reason to hope that, in the not-too-distant future, more than 2 million children who were still in complete ignorance will be able to receive the benefits of a free education, sufficient for their future vocation.«
Right from the start, with Carnot and a generation of brilliant scientist coming out of Polytechnique, France was giving leadership !

Amiens and the Somme department
Interesting in that regard, the following account of the adoption of mutual tuition methods in Amiens and the Somme department.
« On May 15, 1817, after much mistrust and hesitation, the Amiens town council founded a society to encourage elementary education in the department. More than ennobling the pupils’ souls, for the rector, it was a question of ‘giving the children of these workers an elementary education, [to prepare them] not only for the habit of order and subordination that is acquired in the mutual education schools and which they carry over to the workshops, but also to put them in a position to serve more usefully inside the factories, how to study the industrial processes whose preservation and improvement are so essential to national prosperity' ».
For the Rector, speed of acquisition was a guarantee of success for the new method compared to the « simultaneous method »:
« That a primary education which takes children away for whole years from work necessary for the family’s subsistence becomes for the poor a very onerous burden; but that experience teaches the father of a family that a few months will suffice to procure for his children an advantage which he has regretted so many times in the course of life not to have been able to enjoy himself, we must hope that he will not sway to make a slight sacrifice in order to obtain an important result ».

These are mainly boys’ schools. There are a few girls’ schools and evening classes for adults. They mainly catered for the children of small craftsmen: dyers, octroi clerks, innkeepers, foremen, tailors, millers, dressmakers, coopers, dressmakers, locksmiths, butchers, spinners, ironers, laborers, car loaders, carpenters, booksellers, lamplighters, cutlers, bookbinders and so on.
At its peak, in 1821, mutual education in the Somme department included not one but 25 schools, 4 of them for girls (for a fee): 4 out of 10 were located in towns. In 1833, there were 16 more. The network shrank considerably thereafter, but did not disappear altogether. The last two schools in Amiens closed their doors involuntarily in 1879, and the one in Abbeville in 1880: until then, it played an important role in preparing candidates for examinations.
The Amiens Model School – the first provincial model school – prepares future teachers for the practice of mutual education. It was founded on May 26, 1817. It welcomed over 200 pupils. By 1818, 6 teachers from the Somme had graduated. Most of the teachers from the Aisne, Oise and Pas-de-Calais departments spent some time there before taking up their duties.
In 1831, when the Prefect created the Ecole normale de garçons, it was called the « Ecole normale primaire d’enseignement mutuel ». At first, it served as a training school: student teachers were required to visit the school once a week to observe and practice the mutual teaching method.



After the government reshuffles of 1817-1818, several SIE members were appointed to important ministries: Mathieu Molé (1778-1838) to the Navy, Laurent Gouvion-Saint-Cyr (1764-1830) to the War, Elie Decazes (1780-1860) above all to the Interior, the ministry on which primary education depended. Government support became systematic.
The Minister of the Interior supported the SIE de Paris and its subsidiaries with grants for school foundations and maintenance. He invited the prefects to contribute in any way they could to the development of the method. Prefects took the initiative in setting up local companies, and lobbied local assemblies for subsidies.
A growing number of General and Municipal Councils voted to set up mutual schools. Once a school had been founded, the local authorities (prefect and mayor) visited it and presided over the prize-giving ceremony. For its part, on July 22, 1817, the Commission d’Instruction Publique, which since 1815 had replaced the Grand Master of the University, decided to establish a model mutual-education school in the chief towns of France’s twelve Academies, as a breeding ground for future teachers. Other ministers, each in their own sphere, supported the method.
Molé, in charge of the colonies, founded mutual tuition schools in Senegal.
In 1818, Gouvion-Saint-Cyr established a full-fledged « Ecole normale militaire d’enseignement mutuel » in the caserne Babylone of Paris. Each regiment in Paris and the provinces was required to send one officer and one non-commissioned officer, who would return after a few months’ training to teach the troops the benefits of primary education.
In 1817-1818, mutual tuition triumphed. An irresistible enthusiasm carried France towards it. The network of schools continued to expand. From term to term, more and more reports arrived in Paris from the provinces, counting schools and their pupils.
It was a song of victory that Jomard could sing at the SIE meeting in January 1819. Of the 81 départements in France, only 5 had no mutual school; the other 76 had 687 schools, attended by over 40,000 pupils. There were also 105 regimental schools, 5 adult schools, 4 prison schools and 2 or 3 schools in Senegal.

Exemplifying what was becoming a new Promethean paradigm of scientific optimism, on December 15, 1821, at a meeting at Paris City Hall, the Geographical Society was founded by 217 leading figures, including some of the greatest scientists of the day, such as Jomard, Champollion, Cuvier, Chaptal, Denon, Fourier, Gay Lussac, Berthollet, von Humboldt and Chateaubriand. Other illustrious members include Jean-Baptiste Charcot, Dumont d’Urville, Élisée Reclus and Jules Verne.
The collection and study of geographical data from many continents enabled certain members, such as Gustave Eiffel and Ferdinand de Lesseps, to propose major infrastructure projects, notably the Suez and Panama Canals.
15. Criticism
The first criticisms of mutual education came not from its failure, but from its success. The first « risk » was that the children, having learned too effectively and too quickly (2 to 3 times faster !), would return « to the streets » too soon, not yet being old enough to go to work!
Children weren’t « locked up » at school long enough, and so mutual education disturbed the existing social order. In 1818, the General Council of Calvados heard:
« The greatest service to be rendered to society would perhaps be to devise a method that would make instruction for the lower and indigent classes of society more difficult and time-consuming »…
The second « risk » was that, by continuing to use mutual education, these newly-educated people, mostly from the poorer classes, would become too intelligent, too « enlightened », and begin to express political or social demands, in particular that everyone should have the same rights as the better-off social classes.
Imagine the mess if the social order were challenged! French urban planner and sociologist Anne Querrien notes that, in fact, most of the organizers of the labor movement at the time came from the mutual school, where they had of course learned to read, write and count, but also to trust themselves and their comrades. The mutual school encouraged its pupils to think, and in particular to reflect on the organization of society, a society that assigned them a destiny of submission and obedience.



The influential theologian and politician Félicité Robert de Lamennais (1782-1854) said it loud and clearly :
« Lancaster-style schools are the craze of the day. All the authorities in this country, and especially the Prefect, are infatuated beyond expression. Hatred for priests has a lot to do with this mania. The fact is that everything good about this method has been practiced for over a century by the Brothers of the Christian Schools; the rest is pure charlatanism. There is talk of teaching children to read and write in four months: in the first place, this would be a great misfortune, for what can be done with such well-educated children, whose age would not yet allow them to work? Secondly, nothing could be further from the truth than these marvellous results. »
If one has « to decide between the instruction of Abbé de La Salle and that of Lancaster, the question is quite simple; it’s a question of choosing between society and anarchy ».
His brother, the vicar Jean-Marie de la Mennais (1780-1860), took the lead in what can only be described as a political witch-hunt. He said:
« Mutual education was introduced into France by Protestants during the disastrous Hundred Days. M. Carnot was then Minister of the Interior; under his auspices, the Société d’Encouragement, established to propagate this method, held its first meeting on May 16, 1815 ».
He struggled to prove that « the Lancastrian method is defective in its procedures, dangerous for religion and morals in its results » and in a brochure, De l’Enseignement mutuel, published in 1819 in Saint-Brieuc, Brittany, he vigorously attacked this teaching method.
It’s true that questioning authority and the established order is inherent to mutual education. The « simultaneous » method is based on the premise that to pass on knowledge, you need to be qualified (to be the teacher). Conversely, in the mutual school, the teacher is no longer the repository of knowledge, as each student can enlighten his or her classmates.
Another concern for the elites was that, with this method, children are merely instructed, not « educated », and no Christian moral education is imparted.
Last but not least, mutual teaching required fewer supervisors, given the pupils’ role as creators, transmitters and bearers of knowledge. Some may have feared for their jobs…
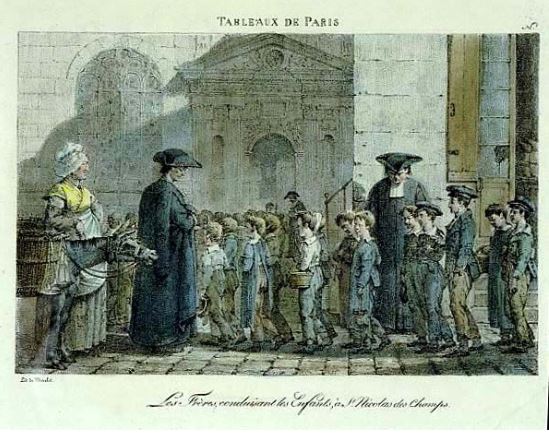
In 1818, in his report to the Emperor of Russia, Joseph Hamel told the mutualists’ main opponents, the « Brothers of the Christian Schools », that they were almost entirely unaware of what they were denouncing. Hamel also points out that there are 40,000 communes to be provided with elementary school, and that the number of Brothers‘ schools « does not amount to more than one hundred in the kingdom… ».
On the negative side, what is striking, when examining the incriminations, is that one thing is said in the morning and its opposite in the afternoon. In the morning, it’s said that mutual education blurs minds by diluting the authority of teachers; in the afternoon, it’s asserted that it overly « militarizes » education through a totally hierarchical command structure!
On the question of « morality », Lazare Carnot would never have endorsed an education that ruined the Christian spirit, let alone the notion of legitimate authority, while vigorously combating those that lacked it, such as the Monarchy of divine right or the Consulate for life imposed by Napoleon. In the same way, in the morning, the mutualist system was accused of failing to transmit Christian « morals »; in the afternoon, it was seen as a Protestant plot…
And yet, the national impulse in favor of « the fatherland » and future generations has succeeded in uniting personalities from all political and religious backgrounds in a single effort.
Cuvier (Protestant) and Gérando (Catholic), both fervent republicans and promoters of the mutual mode, as well as the Inspector General of the University, Ambroise Rendu (1778-1860, Catholic), even took part in drafting the ordinance of February 29, 1816, promulgated by Louis XVIII and the Minister of the Interior, de Vaublanc (1756-1845).
Following massive pressure from the congregations, mutualist teachers Martin, Frossard and Bellot, all Protestants, were forced to leave their school headships. Martin went on to be very useful in other European countries, notably Brussels, where in 1820 he organized a mutual school at Les Minimes.
16. Mechanistic drift?
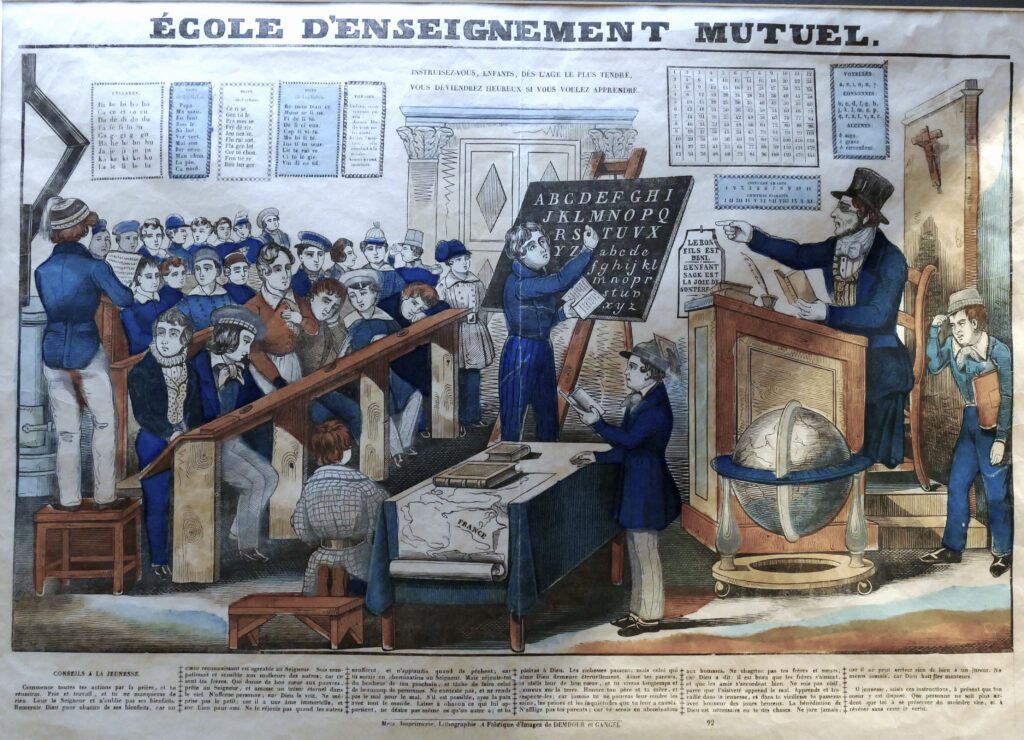
Without grasping the state of mind and enthusiasm that young polytechnicians might have had for the blossoming of an industrial culture and the wonders of machinismo, the defenders of a feudal France see only a « fundamentally mechanistic vision », when Jomard compares the mutual method to a machine, with its cogs and springs, of which the teacher is a mere operator:
« Once the school has been establisehd out and equipped with all the furniture it needs, all that remains to be done is to introduce the pupils and the teacher, and then to set in motion all the springs of this kind of mechanism, by means of the new practices ».
While Victor Hugo evoked a « happy swarm », Laborde was accused of a « mechanistic » drift when he compared the buzzing activity of pupils in English mutual schools to the noise of machines in cotton mills.
Communication, argued critiques, is « entirely mechanical and hierarchical ». It flows « only from the master or general instructor to the instructors and pupils, not in the other direction. It’s a means of action, not a means of exchange.«
Let’s face it, any pedagogical approach, no matter which one, set up as a system and postulating that it’s « enough » to apply mechanically to a human being, can be horrifying. It’s easy, then, to accuse the mutual school of all the ills from which those who accused them suffered, perhaps even more so.
At the mutual school, corporal punishment is banned. It was a courageous decision that Octave Greard was quick to point out:
« It is one of the claims of the founders of the mutual schools to public recognition that they outlawed the corporal punishments, ferulas and whips, which were still in use, and we cannot be too grateful to them for having sought to replace in the hearts of pupils the feeling of fear with the feeling of honor, or, as M. de Laborde used to say, the feeling of well-administered shame ».
Knowing the immense happiness of the thousands of children who quickly gained access to a minimum of public instruction and experienced the indescribable joy of educating their peers, one can only suspect the pen of jealous congregations behind this poem falsely lamenting the misfortune of the poor little ones:
« This system, it is said, born of Anglomania,
Contrasts horribly with our genius.
There, everything is mechanism and our sad children
Seem like a machine, in the middle of their benches;
Their absurd discipline, and no doubt fatal,
Governs even the steps, the attitude or the gesture:
Today, we can prophesy the fate
Of this automaton people thus moved by spring ».
17. Death of Mutual Tuition in France

In 1815, after Waterloo, King Louis XVIII, who had fled, returned on July 8, 1815. Unlike his brother, the future Charles X, leader of the ultra-royalists, was fully aware that the history of the Revolution could not be erased. He realized that France could no longer be a country of « subjects », and that it had become a Nation. Hence the « Constitutional Charter » he promulgated, which had the force of a constitution. In the same spirit, in view of the popularity of mutual education, he granted it favors (subsidies, creation of model schools, protection from the Ministry of the Interior).
Mutual education soon lost its protectors, as the ministerial commission created by the decree of April 27 did not survive Napoleon’s fall in June 1815.
By the autumn of 1816, criticism was pouring in from the Congregationalists. The Grand Chaplain of France, Cardinal de Talleyrand-Périgord, Archbishop of Reims (John Baptist de La Salle’s birthplace…), for his part, addressed the King to express the alarm of Catholics.
By 1820, the SIE already had a network of 1,500 mutual schools, grouping together more than 170,000 pupils thanks to an audacious collective pedagogy. However, mutualism came under fire from the ultras, who considered it too liberal, too favorable to children’s autonomy and incapable of « raising youth in religious and monarchical sentiments ».
The child who leaves this school, they say, « is a learned parrot, without religious ideas, without moral values, more dangerous than the ignorant for the political and social order, since instruction has developed new needs in him, always ready to engage in new scenes of revolution or dechristianization. Ah, Carnot, the regicidal conventionalist and patron of mutual education, knew what he was up to when he introduced it into France with the decree of 1815! »

As said earlier, in France, mutual tuition was seen as an aggression by the religious congregations who practiced « simultaneous teaching », codified as early as 1684 by Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) for Institute of the Brothers of the Christian Schools (Latin : Fratres Scholarum Christianarum; French Frères des Écoles Chrétiennes; Italian: Fratelli delle Scuole Cristiane, abbreviated FSC) : classes by age, division by level, fixed and individual places, strict discipline, repetitive and simultaneous work supervised by an inflexible master.
And the merits of the FSC’s schools and « simultaneous teaching », confirmed by centuries of experience, were considered in total opposition to those of mutual education, the « mania of the moment », and considered the work of « charlatans » speculating on primary education.
A fierce supporter of order and suspecting a vast Protestant plot against the Vatican, Pope Leo XII, the « Pope of the Holy Alliance », decided in Quod Divina Sapientia, his papal bull of August 28, 1824 (art. XXVII, 299), that « public schools of mutual instruction will be suppressed and abolished in all the Papal States. The bishops will prosecute those who continue to use this teaching method or who attempt to introduce it into their dioceses ».
In anticipation of the Papal Bull, the Ordinance of April 1824 placed mutual education in France under the strict supervision of the traditional Church, which took over the entire educational question. In August, just after Leo XII’s bull, a Ministry of « Ecclesiastical Affairs and Public Instruction » was created, a name that reflected the Church’s return to business. The accession of Charles X only exacerbated this situation. The Church of the time loved the Enlightenment, but above all it loved candlelight…

From then on, the schooling situation took a dramatic turn for the worse.
In 1828, of the 39,381 communes :
- around 24,000 had boys’ schools, catering for 1,070,000 children ;
- no more than 430,000 girls attended elementary school;
- 15,381 communes have no boys’ schools ;
- and perhaps 20,000 without girls’ schools;
- 1,680,000 boys and 2,320,000 girls attend no school at all, making a total of 4 million.
Despite an upturn between 1828 and 1829, mutuellism was rejected, its schools closed one after the other (their number fell by three-quarters compared to 1820), although the electoral weight of the ultras diminished from election to election. However, the people’s educators resisted.
In the years following the 1830 revolution, over 2,000 mutual schools were still in operation, mainly in towns, in competition with the denominational schools promoted by the regime. Officially, the mutual school was not a guarantor of morality, and was said to be « industrial » and inhumane.

Then came the famous « Guizot moment ». Although he had initially campaigned for the development of mutual education within the SIE, François Guizot (1787-1874), Louis-Philippe’s Minister of Public Instruction from 1832 onwards, gave mutual education the coup de grâce in France by having the « simultaneous » method endorsed as the only official teaching method.
Schools adopting mutual tuition were no longer subsidized, nor did they receive any support from the government or the Church. Faced with material difficulties, the majority of pupils mostly admitted free of charge had now to pay a fee. Many parents in need withdrew their children and sent them to the newly opened Brother of the Christian Schools, who had become free of charge…
The Church slanders, casts doubt on the morality of the teachers, tried to keep the children of Catholic families away from the « devil’s school », persecutes and threatens to keep them away from catechism and communion in order to break mutual tuition. Most of the teachers using that method felt obliged to bandon it and embrace the official « simultanous » method. With no more pupils, no more teachers, mutual schools gradually disappeared.
It was Guizot who put the final nail in the coffin of mutual tuition, creating the École normale des instituteurs in 1867 to train the future teachers of Jules Ferry’s school in the simultaneous method still the norm today.
The young Hippolyte Carnot also joined the SIE in order to reconnect, post mortem, with his father. In 1847, when he became Minister of Public Instruction under the Second Republic, he attempted to revive the mutual education cherished by his father Lazare Carnot, but although his work was great, his enemies were many and his term of office very short.
18. Conclusion

Education is in deep crisis. Everything that was largely accomplished by Lazare Carnot and his son Hippolyte has been systematically destroyed by the new church of our time: the financial, transhumanist and decadent oligarchy, having led the world to the brink of collapse, still determined to save its privileges by organizing the physical and moral ruin of humanity.
To rebuild an education worthy of the name, we are convinced that mutual education, provided it is adapted to our times, is an extremely promising avenue. Several African countries, currently lacking sufficient resources, are already taking inspiration from it.
Mutual tuition is not a relic of the past, but an experiment to be renewed to open the gates of the futur. For the Global South, still plagued by post-colonial exploitation, war and epidemics, education of this kind is the way to go: efficient, rapid and cheap but also humanizing and joyfull, it is the way to go.
It’s a message that Vincent Faillet, a young french teacher with a doctorate in education and training in the Paris region, who is reviving this method, cleary expresses in this video:
19. Short list of works consulted
- François Arago, Biography of Gaspard Monge, read at the Académie des Sciences, 1846.
- Joseph Hamel, L’enseignement mutuel, 1818, Paris.
- John Franklin Reigart, The Lancastrian System of Instruction in the schools of New York City, Teachers College, Columbia University, 1916.
- Sylviane Tinembart, Edward Pahud, Une innovation pédagogique, le cas de l’enseignement mutuel au XIXe siècle. Editions Livreo-Alphil, 2019, Neuchâtel, Switzerland;
- Bruno Poucet, Petite histoire de l’enseignement mutuel : l’exemple du département de la Somme, Carrefours de l’éducation, N° 27, 2009/1, pages 7 to 18;
- Michel Chalopin, L’enseignement mutuel en Bretagne, Presses Universitaires de Rennes, 2011;
- Claire Giordanengo, La grande vogue de l’enseignement mutuel, Hypotheses, Bibliothèque Diderot de Lyon;
- M. Gontard, Un aspect des luttes de partis en France au début de la Restauration : la question de l’enseignement mutuel, Revue d’Histoire du XIXe siècle – 1849, Année 1953, pp. 48-63.
- Dell Upton, Lancasterian Schools, Republican Citizenship, and the Spatial Imagination in Early Nineteenth-Century America, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 55, No. 3 (Sep., 1996), pp. 238-253,University of California Press;
- Alexis de Garaudé, Manuel de l’enseignement mutuel et populaire de la musique, 1854;
- Anne Querrien, L’école mutuelle – Une pédagogie trop efficace?, Les Empêcheurs De Penser En Rond, 2005.
- René Girard, Carnot et l’éducation populaire pendant les Cents Jours, 1907, Paris.
- Michael Werner, Musique et pacification sociale, missions fondatrices de l’éducation musicale (1795-1860) « , Gradhiva (N° 31/2020);
- Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot – 1801-1888, La liberté, l’école et la République, CNRS, Paris, 2019;
- Renaud d’Enfert, Jomard, Francœur et les autres… Des polytechniciens engagés dans le développement de l’instruction élémentaire (1815-1850), Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque et de l’Histoire de l’École polytechnique (SABIX), 2014.
Avec Leibniz et Kondiaronk, ré-inventer un monde sans oligarchie
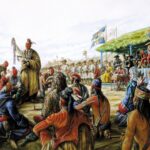
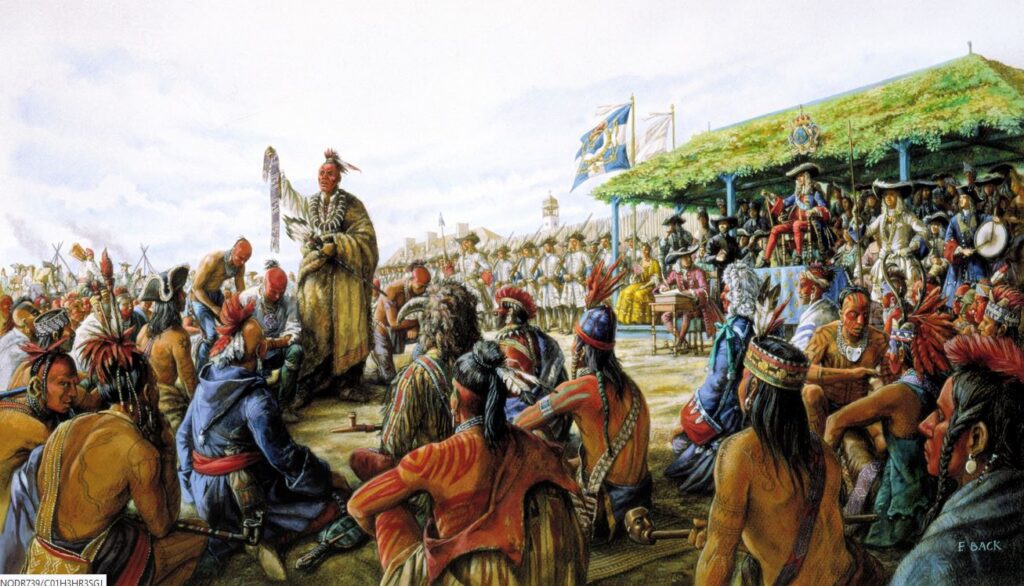
Introduction
Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice de l’Institut Schiller, dans son discours d’ouverture de la vidéoconférence de l’Institut Schiller du 22 novembre 2022, « Pour la paix mondiale – arrêtons le danger de guerre nucléaire : troisième séminaire des dirigeants politiques et sociaux du monde », a appelé les dirigeants du monde à éradiquer le principe maléfique de l’oligarchie.
L’oligarchie est définie comme une structure de pouvoir dans laquelle le pouvoir repose sur un petit nombre de personnes présentant certaines caractéristiques (noblesse, renommée, richesse, éducation ou contrôle corporatif, religieux, politique ou militaire) et qui imposent leur propre pouvoir sur celui de leur peuple.
Helga Zepp-LaRouche a précisé :
« Depuis 600 ans, il y a eu une bataille continue entre deux formes de gouvernement, entre l’État-nation souverain et la forme oligarchique de la société, vacillant d’un côté et de l’autre avec parfois une plus grande emphase dans l’une ou l’autre de ces directions. Tous les empires reposant sur le modèle oligarchique ont été orientés vers la protection des privilèges de l’élite dirigeante, tout en essayant de maintenir les masses populaires aussi arriérées que possible, parce qu’en les transformant en moutons obéissants, elles sont plus faciles à contrôler (…)«
Or, malheureusement, la plupart des citoyens du monde transatlantique et d’ailleurs vous diront que l’abolition du principe oligarchique est « une bonne idée », un « beau rêve », mais que la réalité nous dit que « ça ne peut pas arriver » pour la simple et bonne raison que « ça n’est jamais arrivé avant ».
Les sociétés, par définition, affirment-ils, sont inégalitaires. Les rois et les présidents de républiques, affirment-ils, ont pu éventuellement « prétendre » qu’ils régnaient sur les masses pour leur « bien commun », mais en réalité, pensent nos concitoyens, il s’agissait toujours du règne d’une poignée privilégiant ses propres intérêts au détriment de la majorité.
Les BRICS
Il est intéressant pour nous tous de constater que certains penseurs de premier plan impliqués dans le mouvement des BRICS tentent d’imaginer de nouveaux modes de gouvernance collective excluant les principes oligarchiques.
Par exemple, dans cette direction, l’économiste Pedro Paez, ancien conseiller du président équatorien Rafael Correa, a défendu, dans son intervention à la vidéoconférence de l’Institut Schiller les 15 et 16 avril 2023,
« un nouveau concept de monnaie fondé sur des accords monétaires de chambres de compensation pour les paiements régionaux, qui peuvent être réunis dans un système de chambre de compensation mondiale, qui pourrait également empêcher un autre type d’hégémonie unilatérale et unipolaire de se produire, comme celle qui a été établie avec Bretton Woods, et qui ouvrirait au contraire les portes à une gestion multipolaire.«
Le philosophe et théologien belge Marc Luyckx, ancien membre de la fameuse « Cellule de Prospective » de la Commission européenne de Jacques Delors, a également souligné, dans une interview vidéo sur la dédollarisation de l’économie mondiale, que les pays BRICS sont en train de créer un ordre mondial dont la nature fait qu’aucun membre de leur propre groupe ne peut devenir la puissance dominante.
Une nouvelle histoire de l’humanité
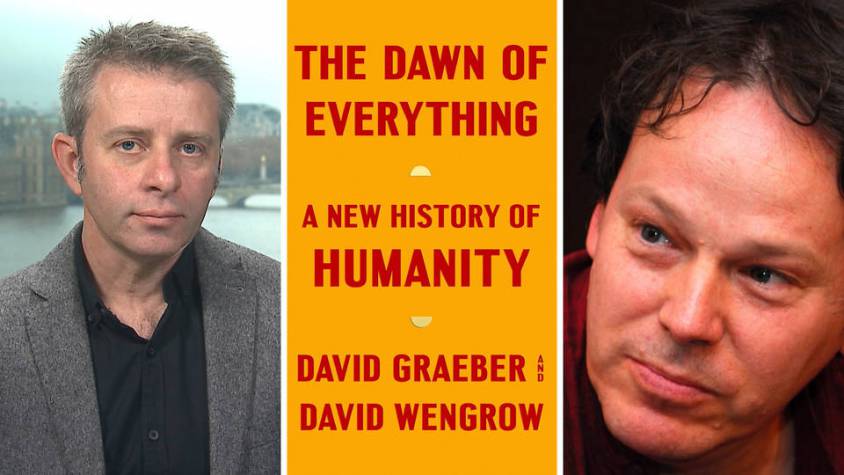
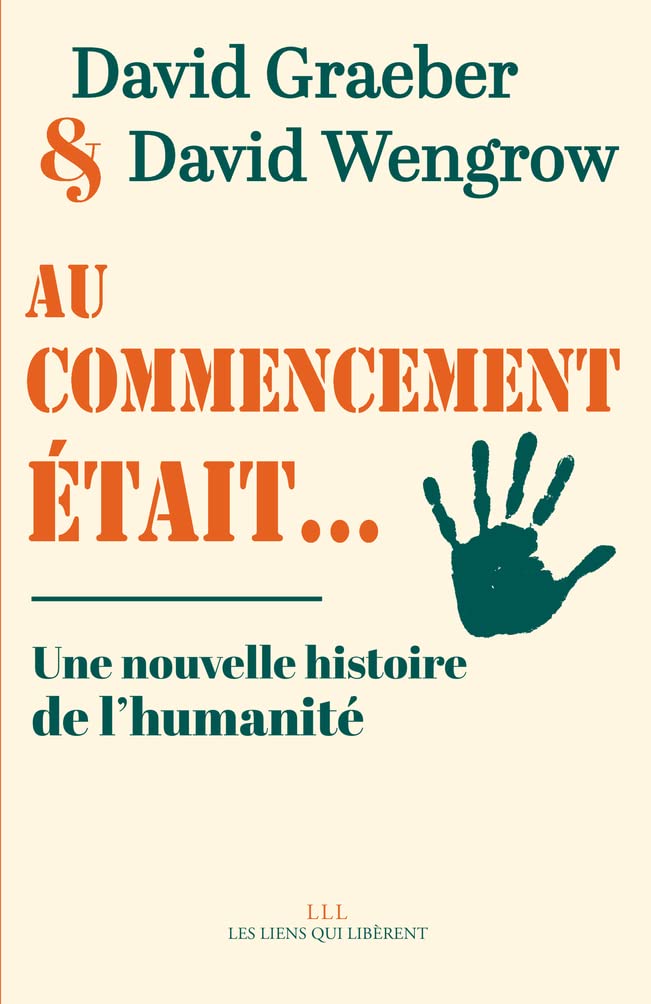
La bonne nouvelle est qu’un livre décapant de 700 pages, intitulé « Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité » (Editions Les liens qui libèrent), écrit et publié en 2021 par l’anthropologue américain David Graeber* (à droite) et le professeur britannique d’archéologie comparée David Wengrow (à gauche) de l’University College de Londres (UCL), fracasse les notions conventionnelles selon lesquelles les anciennes cultures humaines ont progressé de façon linéaire vers le modèle économique néolibéral actuel et, par conséquent, vers des niveaux élevés d’inégalité.
Mieux encore, en se fondant sur des faits concrets, le livre réfute en grande partie le « récit » selon lequel le modèle oligarchique est en quelque sorte « naturel ». Bien sûr, le principe oligarchique a souvent régné, et souvent pendant longtemps. Mais, étonnamment, le livre présente des indications accablantes et des indices archéologiques fortes permettant de croire que dans les temps anciens, certaines sociétés, mais pas toutes, ont réussi à prospérer et perdurer au fil des siècles par le biais de choix politiques totalement différents..
Par conséquent, et c’est la bonne nouvelle, si nos lointains ancêtres ont consciemment su construire des modes de gouvernance rendant impossible que des groupes minoritaires conservent une emprise hégémonique permanente et des privilèges sur la société, cela peut le refaire aujourd’hui.
Le 10e point de Helga Zepp-LaRouche

Cette question est intimement lié au 10e point soulevé par Helga Zepp-LaRouche qui, pour démontrer que toutes les sources du mal peuvent être éradiquées par l’éducation et renversées par une décision politique, affirme que l’inclination naturelle de l’homme est intrinsèquement de faire le bien.
L’existence même de précédents historiques de sociétés ayant survécu sans oligarchie pendant des centaines d’années est bien sûr la preuve « pratique » de l’inclination axiomatique de l’homme à faire le bien.
Sans surprise, certains affirment que la question du « bien » et du « mal » n’est qu’un « débat théologique », puisque les concepts de « bien » et de « mal » n’existent que pour des humains cherchant à se comparer les uns aux autres. Selon eux, personne ne se demanderai si un poisson ou un arbre est bon ou mauvais, puisqu’ils n’ont aucune forme de conscience de soi leur permettant de mesurer leurs actes et leurs actions à la lumière de leur propre nature ou à celle de l’intention de leur créateur.
Or, une partie de la « réponse biblique » à cette allégorie, à savoir si l’homme est bon ou mauvais, part du postulat que les gens « vivaient autrefois dans un état d’innocence », mais qu’ils ont succombé au péché originel. Nous nous sommes pris pour Dieu et avons été punis pour cela ; maintenant nous vivons dans un état de déchéance, tout en espérant une rédemption future.
Rousseau et Hobbes, même combat ?
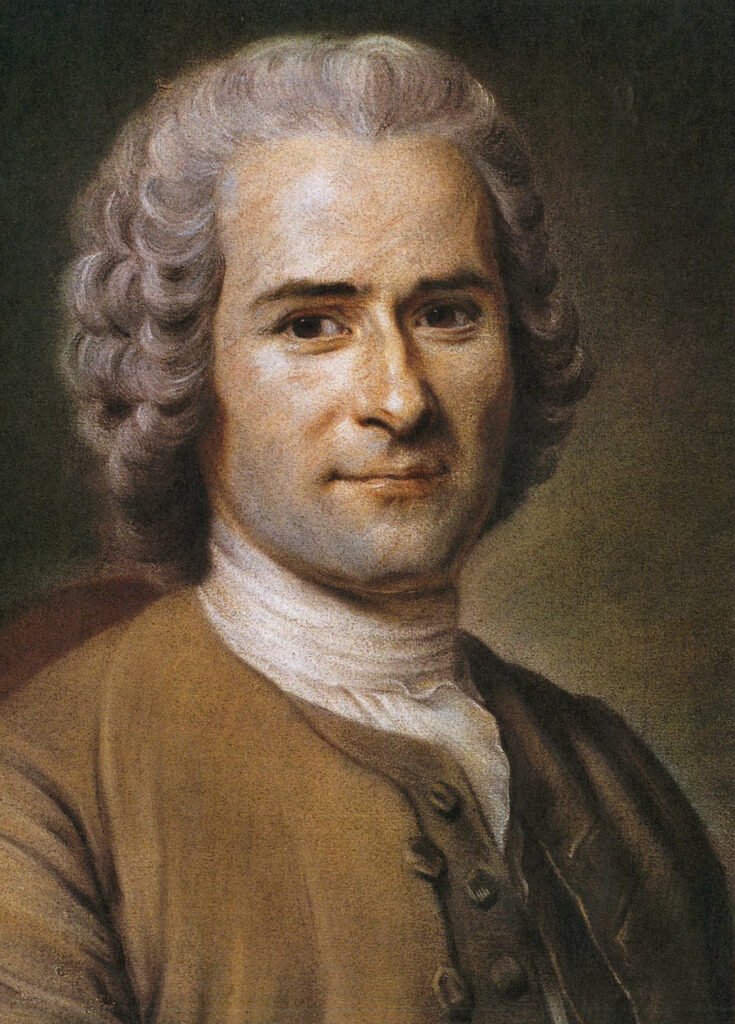
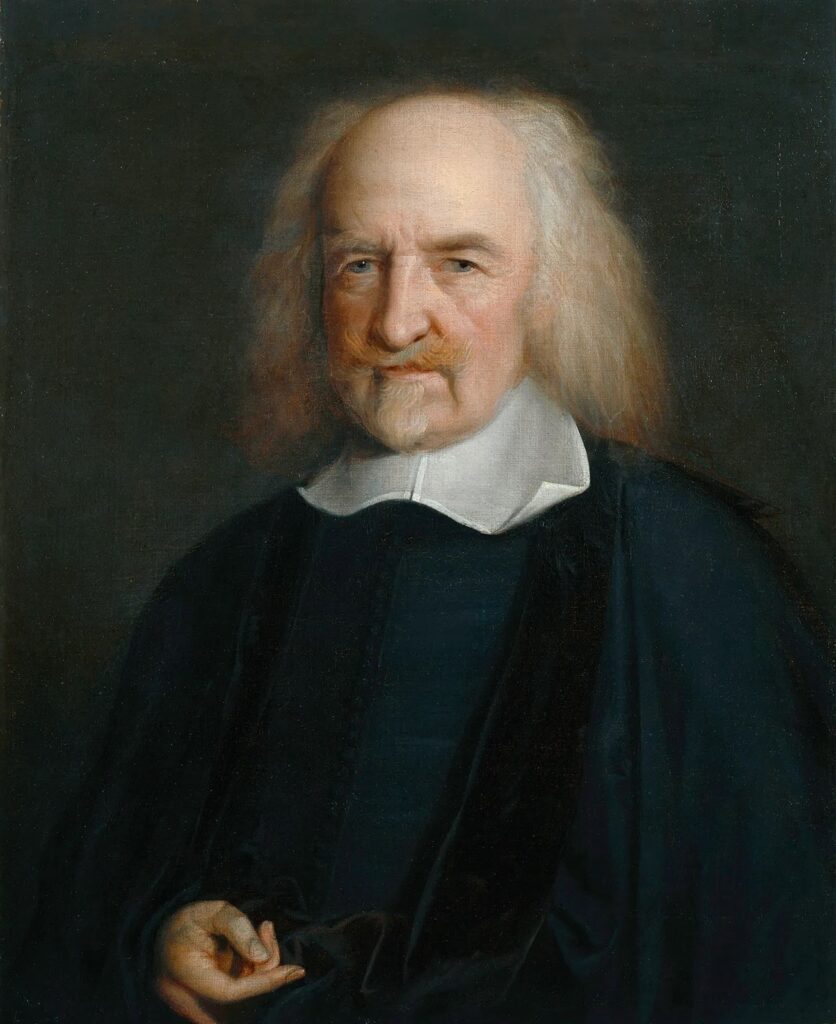
Graeber et Wengrow, en en faisant le socle de leur livre, démontrent de manière très provocante comment nous avons subi un lavage de cerveau par l’idéologie oligarchique pessimiste et destructrice, en particulier celle promue par Rousseau et Hobbes, pour qui l’inégalité est l’état naturel de l’homme, une humanité qui aurait pu éventuellement être bonne comme « un bon sauvage », avant de devenir, suite à l’apparition de l’agriculture et de l’industrie, « civilisée » et une société ne survivant que grâce à un « contrat social » (soumission volontaire du bas vers le haut) ou un Léviathan (dictature du haut vers le bas) : Écoutons les auteurs :
« Aujourd’hui, la version populaire de cette allégorie [biblique] [de l’homme chassé du jardin d’Eden] est généralement une version moderne du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, écrit par Jean-Jacques Rousseau en 1754.
« En voici la trame générale. Il fut un temps où les hommes, aussi innocents qu’au premier jour, vivaient de chasse et de cueillette au sein de tout petits groupes – des groupes qui pouvaient être égalitaires justement parce qu’ils étaient petits. Cet âge d’or pris fin avec l’apparition de l’agriculture, et surtout avec le développement des premières villes. Celles-ci marquèrent l’avènement de la ‘civilisation’ et de ‘l’Etat’, donnant naissance à l’écriture, à la science et à la philosophie, mais aussi à presque tous les mauvais côtés de l’existence humaine : le patriarcat, les armées permanentes, les exterminations de masse, sans oublier les vastes bureaucraties qui nous inondent de formulaires.
« Bien sûr, il s’agit d’une simplification très grossière, mais il semble que ce soit le récit de base qui refait surface chaque fois que quelqu’un, des psychologues du travail aux théoriciens révolutionnaires, dit quelque chose du genre ‘mais bien sûr, les êtres humains ont passé la majeure partie de leur évolution à vivre dans des groupes de dix ou vingt personnes’, ou ‘l’agriculture a peut-être été la pire erreur de l’humanité’. Et comme nous le verrons, de nombreux auteurs populaires avancent explicitement cet argument. Le problème, c’est que quiconque cherche une alternative à cette vision plutôt déprimante de l’histoire s’aperçoit rapidement que la seule proposée est encore pire : si ce n’est pas Rousseau, alors c’est Thomas Hobbes.
« Le Léviathan de Hobbes, publié en 1651, à bien des égards, fait figure de texte fondateur de la théorie politique moderne. Hobbes y soutient que, les hommes étant ce qu’ils sont —des créatures égoïstes—, l’état de nature originel n’était en aucun cas un état d’innocence. On y menait forcément une existence ’solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte’ – fondamentalement, un état de guerre, une guerre de tous contre tous. Et s’il y a eu des progrès par rapport à cet état de fait, un hobbesien dirait qu’ils sont dus en grande partie aux mécanismes répressifs dont se plaignait précisément Rousseau : les gouvernements, les tribunaux, les bureaucraties, la police. Cette vision des choses existe également depuis très longtemps. Ce n’est pas pour rien qu’en anglais, les mots ’politics’, ’polite’ et ’police’ se prononcent tous de la même façon : ils dérivent tous du mot grec polis, ou ville, dont l’équivalent latin est civitas, qui nous donne aussi ’civility’, ’civic’ et une certaine conception moderne de la ‘civilisation’.
« En vertu de cette conception, la société humaine repose sur la répression collective de nos plus bas instincts, ce qui devient d’autant plus nécessaire lorsque les hommes vivent en grand nombre en un même lieu. Le hobbesien des temps modernes dirait donc que, oui, nous avons vécu la plus grande partie de notre évolution en petits groupes, qui pouvaient s’entendre principalement parce qu’ils partageaient un intérêt commun pour la survie de leur progéniture. Mais même ces groupes n’étaient en aucun cas fondés sur l’égalité. Il y avait toujours, dans cette version, un chef ‘mâle alpha’. Les sociétés humaines n’auraient donc jamais fonctionné selon d’autres principes que la hiérarchie, la domination et l’égoïsme cynique. C’est juste que, collectivement, nous avons appris qu’il était à notre avantage de donner la priorité à nos intérêts à long terme plutôt qu’à nos instincts à court terme ; ou, mieux encore, de créer des lois qui nous obligent à confiner nos pires impulsions dans des domaines socialement utiles comme l’économie, tout en les interdisant partout ailleurs.
« Comme le lecteur peut probablement le déceler à notre ton, nous n’aimons pas beaucoup le choix entre ces deux alternatives. Nos objections peuvent être classées en trois grandes catégories. En tant que récits du cours général de l’histoire de l’humanité, ils :
1. ne sont tout simplement pas vrais ;
2. ont des implications politiques désastreuses et
3. donnent du passé une image inutilement ennuyeuse.«
Conséquence de la victoire des modèles impériaux de pouvoir politique, le seul « récit » accepté de « l’évolution » de l’homme, validant automatiquement une emprise oligarchique sur la société, est celui qui permet de « confirmer » le dogme convenu à l’avance et érigé en « vérité » immortelle ou absolue. Et toute découverte historique ou artefact contredisant ou invalidant le récit de Rousseau-Hobbes seront, considérés, au mieux, comme des anomalies.
Ouvrir les yeux
Graeber et Wengraw affirment,
« vouloir raconter une autre histoire, plus prometteuse et plus intéressante ; une histoire qui, en même temps, tient mieux compte de ce que les dernières décennies de recherche nous ont appris. Il s’agit en partie de rassembler les preuves accumulées par l’archéologie, l’anthropologie et d’autres disciplines apparentées, preuves qui permettent de rendre compte d’une manière totalement nouvelle de la façon dont les sociétés humaines se sont développées au cours des 30 000 dernières années environ. La quasi-totalité de ces recherches vont à l’encontre des idées reçues, mais trop souvent les découvertes les plus remarquables restent confinées aux travaux des spécialistes ou doivent être découvertes en lisant entre les lignes des publications scientifiques.«
Et en effet, leur regard nouveau les conduit à constater :
« qu’il il est établi aujourd’hui que les sociétés humaines avant l’avènement de l’agriculture n’étaient pas confinées à des groupuscules égalitaires. Au contraire, le monde des chasseurs-cueilleurs tel qu’il existait avant l’avènement de l’agriculture était un monde d’expériences sociales audacieuses, ressemblant bien plus à un défilé carnavalesque de formes politiques qu’aux abstractions ternes de la théorie de l’évolution. L’agriculture, quant à elle, n’a pas signifié l’avènement de la propriété privée, pas plus qu’elle n’a marqué un pas irréversible vers l’inégalité. En fait, bon nombre des premières communautés agricoles étaient relativement exemptes de rangs et de hiérarchies. Et loin de graver dans le marbre les différences de classe, un nombre surprenant des premières villes du monde étaient organisées sur des bases solidement égalitaires, sans avoir besoin de dirigeants autoritaires, de guerriers-politiciens ambitieux, ni même d’administrateurs autoritaires.«
Kondiaronk,
Leibniz et les Lumières

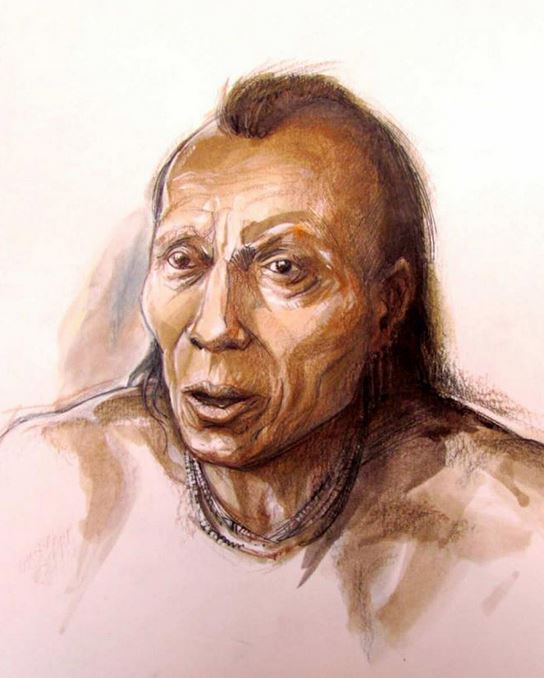
En fait, la dissertation de Rousseau, selon les auteurs, était en partie une réponse aux critiques de la civilisation européenne, qui ont commencé dans les premières décennies du XVIIIe siècle.
« Les origines de cette critique, cependant, ne se trouvent pas chez les philosophes des Lumières (bien qu’ils les aient admirés et imités au début), mais chez les commentateurs et observateurs indigènes de la société européenne, tels que l’homme d’État amérindien (Huron-Wendat) Kondiaronk », et bien d’autres encore.
Et lorsque d’éminents penseurs, comme Leibniz,
« ont exhorté leurs patriotes à adopter les modèles chinois de gestion de l’État, les historiens contemporains ont tendance à insister sur le fait qu’ils n’étaient pas vraiment sérieux.«
Pourtant, de nombreux penseurs influents du siècle des Lumières ont effectivement affirmé que certaines de leurs idées sur le thème de l’inégalité étaient directement inspirées de sources chinoises ou amérindiennes !
Tout comme Leibniz s’est familiarisé avec la civilisation chinoise grâce à ses contacts avec les missions jésuites, les idées des Indiens ont atteint l’Europe par le biais d’ouvrages tels que le rapport en soixante-et-onze volumes, Les relations des jésuites de la Nouvelle France, publié entre 1633 et 1673 et qui fit couler beaucoup d’encre.
Alors qu’aujourd’hui, nous pensons que la liberté individuelle est une bonne chose, ce n’était pas le cas des Jésuites qui se plaignaient des Indiens. Les Jésuites étaient opposés à la liberté par principe :
« C’est là, sans aucun doute, une disposition tout à fait contraire à l’esprit de la foi, qui exige que nous soumettions non seulement nos volontés, mais nos esprits, nos jugements et tous les sentiments de l’homme à une puissance inconnue des lois et des sentiments d’une nature corrompue. »
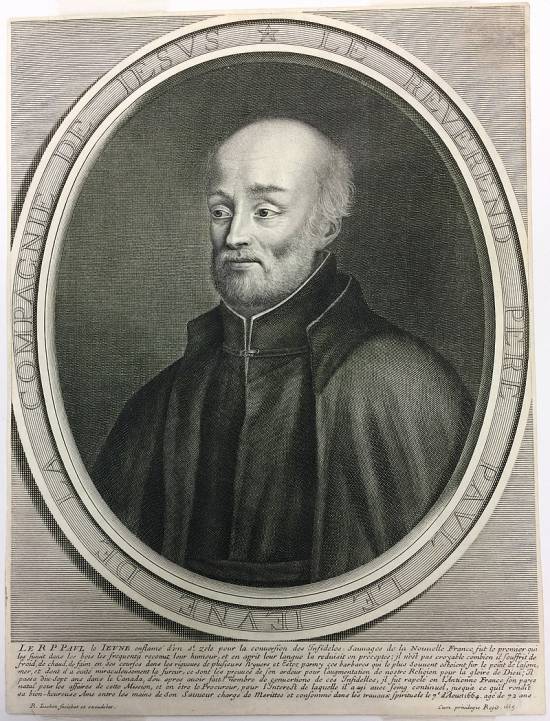
Le père jésuite Jérôme Lallemant, dont la correspondance a servi de modèle initial aux Relations des Jésuites, notait à propos des Indiens Wendats en 1644 :
« Je ne crois pas qu’il y ait peuples sur la Terre plus libre que ceux-ci, et moins capables de voir leurs volontés assujetties à quelque puissance que ce soit.«
Plus inquiétant encore, leur haut niveau d’intelligence. Le Père Paul Le Jeune, supérieur des Jésuites au Canada dans les années 1630 :
« Il n’y en a quasi point qui ne soit capable d’entretien, et ne résonne fort bien, et en bons termes, sur les choses dont il a connaissance : ce qui les forme encore dans le discours, sont les conseils qui se tiennent quasi tous les jours dans les villages en toutes occurrences. »
Ou encore, selon Lallemant :
« Je puis dire en vérité que pour l’esprit, ils n’ont rien de moins que les Européens, et demeurant dedans la France, je n’eusse jamais cru, que sans instruction la nature eût pu fournir une éloquence plus prompte et plus vigoureuse que j’en ai admiré en plusieurs Hurons, ni de plus clairvoyant dans les affaires, et une conduite plus sage dans les choses qui sont de leur usage. (Relations des Jésuites, vol. XXVIII, p. 62.) »
Certains jésuites sont allés beaucoup plus loin, notant – non sans une certaine frustration – que les « sauvages » du Nouveau Monde semblaient globalement plus intelligents que les personnes avec lesquelles ils avaient l’habitude de traiter dans leur pays.
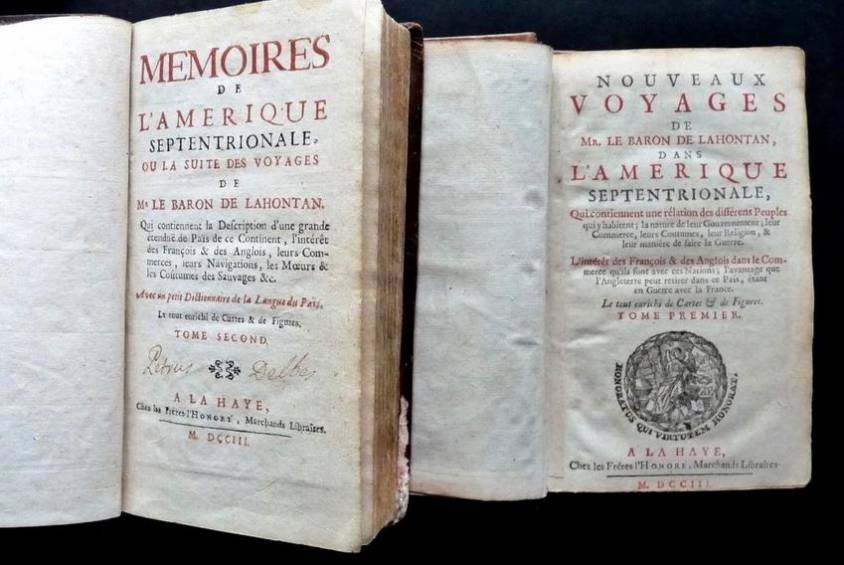
Les idées de l’homme d’État amérindien Kondiaronk (v. 1649-1701), connu sous le nom de « Le Rat » et chef du peuple amérindien Wendat (Huron) à Michilimackinac en Nouvelle-France, sont parvenues à Leibniz par l’intermédiaire d’un aristocrate français appauvri nommé Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de La Hontan, plus connu sous le nom de Lahontan (1666-1715).
En 1683, Lahontan, âgé de 17 ans, s’engage dans l’armée française et est affecté au Canada. Au cours de ses différentes missions, il parle couramment l’algonquin et le wendat et se lie d’amitié avec de nombreuses personnalités politiques autochtones, dont le brillant homme d’État wendat Kondiaronk, qui, en tant que porte-parole du Conseil (organe directeur) de la Confédération wendat, est envoyé comme ambassadeur à la cour de Louis XIV en 1691.
La Grande Paix de Montréal
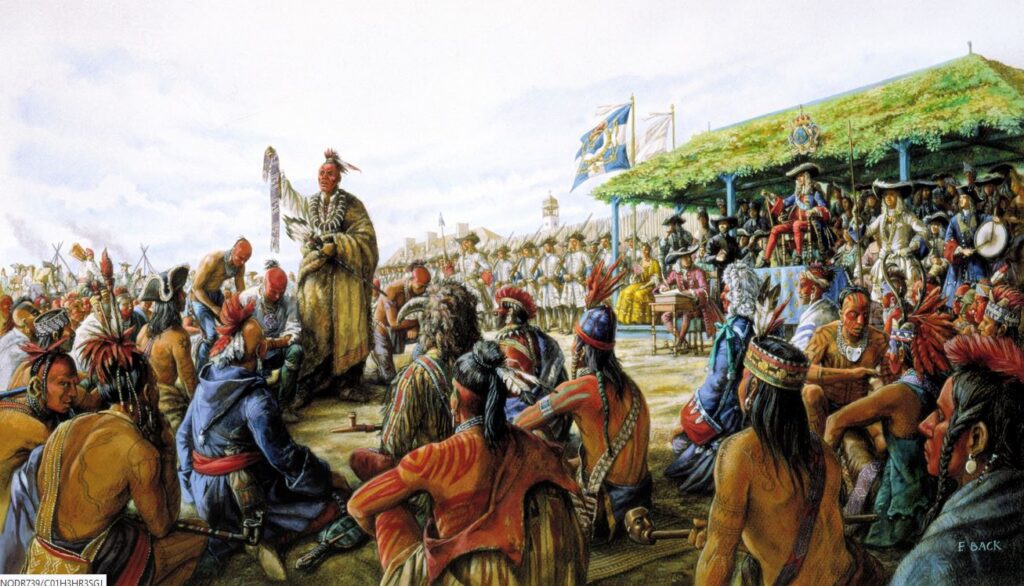
Même après avoir été trahi par les Français et obligé de mener ses propres guerres pour assurer la sécurité de ses concitoyens, Kondiaronk a joué un rôle clé dans ce que l’on appelle la « Grande Paix de Montréal » du 1er août 1701, qui a mis fin aux sanglantes guerres des Castors.
C’était en réalité des guerres par procuration entre les Britanniques et les Français, chacun d’eux utilisant les Indiens comme « chair à canon » pour leurs propres projets géopolitiques.
La France est de plus en plus acculée par les Britanniques. Ainsi, à la demande des Français, au cours de l’été 1701, plus de 1 300 Indiens, issus de quarante nations différentes, se rassemblent près de Montréal, contestant le fait que la ville soit ravagée par la grippe. Ils viennent de la vallée du Mississippi, des Grands Lacs et de l’Acadie. Beaucoup sont des ennemis de toujours, mais tous ont répondu à l’invitation du gouverneur français. Leur avenir et le destin de la colonie sont en jeu. Leur objectif est de négocier une paix globale, entre eux et avec les Français. Les négociations durent des jours et la paix est loin d’être garantie. Les chefs sont méfiants. La principale pierre d’achoppement est le retour des prisonniers capturés lors des campagnes précédentes et réduits en esclavage ou adoptés. Indiens s’attristant du décès de Kondiaronk. Sans le soutien de ce dernier, la paix est impossible. Le 1er août, gravement malade, il parle pendant deux heures en faveur d’un traité de paix qui serait garanti par les Français. Son discours émeut beaucoup de monde. La nuit suivante, Kondiaronk meurt, terrassé par la grippe à l’âge de 52 ans.
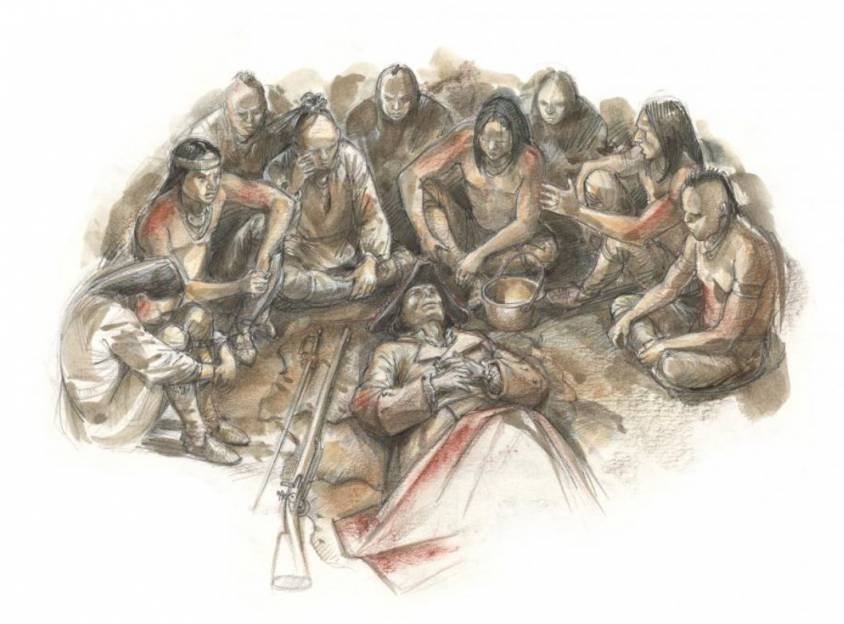
Mais le lendemain, le traité de paix est signé. Désormais, il n’y aura plus de guerre entre les Français et les Indiens. Trente-huit nations signent le traité, dont les Iroquois. Les Iroquois s’engagent à rester neutres dans tout conflit futur entre les Français et leurs anciens alliés, les colons anglais de Nouvelle-Angleterre. Kondiaronk est loué par les Français et présenté comme un « modèle » d’indigène pacifique. Les Jésuites ont immédiatement répandu le mensonge selon lequel, juste avant de mourir, il se serait « converti » à la foi catholique dans l’espoir que d’autres indigènes suivent son exemple.
Lahontan, d’Amsterdam à Hanovre
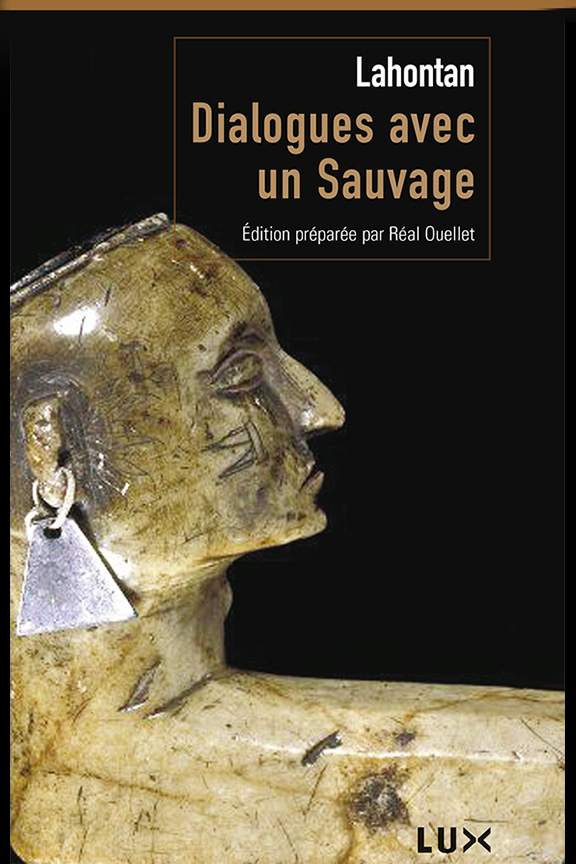
Or, à la suite de divers événements, Lahontan se retrouve à Amsterdam. Pour gagner sa vie, il écrit une série de livres sur ses aventures au Canada (« Voyages du baron de La Hontan dans l’Amérique Septentrionale, qui contiennent une relation des différents peuples qui y habitent »), dont le troisième, intitulé « Dialogue curieux entre l’auteur et un sauvage de bon sens qui a voyagé », comprend quatre dialogues avec un personnage fictif, un dénommé Adario (en réalité Kondiaronk).
Les Dialogues sont rapidement traduits en allemand, en néerlandais, en anglais et en italien. Lahontan lui-même, acquière alors une certaine célébrité, s’installe à Hanovre où il se lie d’amitié avec le grand philosophe et scientifique Wilhelm Gottfried Leibniz. (1646-1716). A l’affût de tout ce qui se discutait en Europe, le philosophe, alors âgé de 64 ans, semble avoir été mis sur la piste de Lahontan par des journalistes hollandais et allemands, mais aussi par le texte d’un obscur théologien de Helmstedt, Jonas Conrad Schramm (1675-1739), dont la conférence introductive sur « la Philosophie balbutiante des Canadiens » avait été publiée en latin en 1707. Se référant d’abord à Platon et à Aristote (qu’il abandonne presque aussitôt), Schramm s’appuie sur les Dialogues et les Mémoires de Lahontan pour montrer comment les
« barbares canadiens frappent à la porte de la philosophie mais n’y entrent pas parce qu’ils n’ont pas les moyens suffisants ou qu’ils sont enfermés dans leurs coutumes ».

Beaucoup moins borné, Leibniz voit dans Lahontan une confirmation de son propre optimisme politique qui lui permet d’affirmer que la naissance de la société ne vient pas de la nécessité de sortir d’un terrible état de guerre, comme le pensait Thomas Hobbes, mais d’une aspiration naturelle à la concorde.
Mais ce qui l’intéresse avant tout, ce n’est pas tant de savoir si les « sauvages américains » sont capables ou non de philosopher, mais s’ils vivent réellement en concorde sans gouvernement.
A son correspondant Wilhelm Bierling, qui lui demande comment les Indiens du Canada peuvent vivre « en paix bien qu’ils n’aient ni lois ni magistratures publiques », Leibniz répond :
« Il est tout à fait véridique (…) que les Américains de ces régions vivent ensemble sans aucun gouvernement mais en paix ; ils ne connaissent ni luttes, ni haines, ni batailles, ou fort peu, excepté contre des hommes de nations et de langues différentes. Je dirais presque qu’il s’agit d’un miracle politique, inconnu d’Aristote et ignoré par Hobbes.«
Leibniz, qui affirme bien connaître Lahontan, souligne qu’Adario :
« venu en France il y a quelques années et qui, quoiqu’il appartienne à la nation huronne, a jugé ses institutions supérieures aux nôtres.«
Cette conviction de Leibniz s’exprimera encore dans son Jugement sur les œuvres de M. le Comte Shaftesbury, publiées à Londres en1711 sous le titre de Characteristicks :
« Les Iroquois et les Hurons, sauvages voisins de la Nouvelle France et de la Nouvelle Angleterre, ont renversé les maximes politiques trop universelles d’Aristote et de Hobbes. Ils ont montré par une conduite surprenante, que des peuples entiers peuvent être sans magistrats et sans querelles, et que par conséquent les hommes ne sont ni assez portés par leur bon naturel, ni assez forcés par leur méchanceté à se pourvoir d’un gouvernement et à renoncer à leur liberté. Mais la rudesse de ces sauvages fait voir, que ce n’est pas tant la nécessité, que l’inclination d’aller au meilleur et d’approcher de la félicité, par l’assistance mutuelle, qui fait le fondement des sociétés et des États ; et il faut avouer que la sûreté en est le point le plus essentiel. »
Alors que ces dialogues sont souvent qualifiés de purement fictifs, Leibniz, dans une lettre à Bierling datée du 10 novembre 1719, estime que :
« Les Dialogues de Lahontan, bien qu’ils ne soient pas entièrement vrais, ne sont pas non plus complètement inventés.«
Pour Leibniz, bien sûr, les institutions politiques sont nées d’une aspiration naturelle au bonheur et à l’harmonie. Dans cette perspective, le travail de Lahontan ne contribue pas à la construction d’un nouveau savoir, il ne fait que confirmer une thèse qu’il avait déjà constituée.
Regard sur les Européens
et les Français en particulier

Ainsi, Lahontan, dans ses mémoires, raconte que des Amérindiens, comme Kondiaronk, qui avaient séjourné en France,
« nous taquinaient continuellement avec les défauts et les désordres qu’ils observaient dans nos villes, comme étant causés par l’argent. On a beau à leur donner des raisons pour leur faire connaître que la propriété des biens est utile au maintien de la société : ils se moquent de tout ce qu’on peut dire sur cela. Au reste, ils ne se querellent ni ne se battent, ni se médisent jamais les uns des autres ; ils se moquent des arts et des sciences, et ils rient de la différence de rangs qu’on observe chez nous. Ils nous traitent d’esclaves et d’âmes misérables, dont la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, alléguant que nous nous dégradons en nous soumettant à un seul homme [le Roi] qui peut tout, et qui n’a d’autre loi que son bon vouloir.«
Lahontan poursuit :
« Ils trouvent étrange que les uns aient plus de biens que les autres, et que ceux qui en ont le plus sont estimés davantage que ceux qui en ont le moins. Enfin, ils disent que le titre de sauvages, dont nous les qualifions, nous conviendrait mieux que celui d’hommes, puisqu’il n’y a rien moins que de l’homme sage dans toutes nos actions.«
Dans son dialogue avec Kondiaronk, Lahontan lui dit que si les méchants restaient impunis, nous deviendrions le peuple le plus misérable de la terre. Kondiaronk répond :
« Vous l’êtes assez déjà, je ne conçois pas que vous puissiez l’être davantage. Ô quel genre d’hommes sont les Européens ! Ô quelle sorte de créatures ! Qui font le bien par la force, et n’évitent à faire le mal que par la crainte des châtiments ? (…) Tu vois que nous n’avons point de juges ; pourquoi ? Parce que nous n’avons point de querelles ni de procès. Mais pourquoi n’avons-nous pas de procès ? C’est parce que nous ne voulons point recevoir ni connaître l’argent. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas admettre cet argent ? C’est parce que nous ne voulons pas de lois, et que depuis que le monde est monde nos pères ont vécu sans cela.«
Frère Gabriel Sagard, un frère récollet français, a rapporté que les Wendats étaient particulièrement offensés par le manque de générosité des Français les uns envers les autres :
« Ils se rendent l’hospitalité réciproque, et assistent tellement l’un l’autre qu’ils pourvoient à la nécessité de chacun, sans qu’il ait aucun pauvre mendiant parmi leurs villes et villages.Et trouvent fort mauvais entendant dire qu’il y avait en France grand nombre de ces nécessiteux et mendiants, et pensaient que cela fut faute de charité qui fut en nous, et nous en blâmaient grandement.«

L’argent, pense Kondiaronk, crée un environnement qui encourage les gens à mal se comporter :
« Plus je réfléchis à la vie des Européens et moins je trouve de bonheur et de sagesse parmi eux. Il y a six ans que je ne fais que penser à leur état. Mais je ne trouve rien dans leurs actions qui ne soit au-dessous de l’homme, et je regarde comme impossible que cela puisse être autrement, à moins que vous ne vouliez vous réduire à vivre sans le Tien ni le Mien, comme nous faisons. Je dis donc que ce que vous appelez argent est le démon des démons, le tyran des Français ; la source des maux ; la perte des âmes et sépulcre des vivants. Vouloir vivre dans les pays de l’argent et conserver son âme, c’est vouloir se jeter au fond du lac pour conserver la vie ; or ni l’un ni l’autre ne se peuvent. Cet argent est le père de la luxure, de l’impudicité, de l’artifice, de l’intrigue, du mensonge, de la trahison, de la mauvaise foi et généralement de tous les maux qui sont au monde. Le père vend ses enfants, les maris leurs femmes, les femmes trahissent leurs maris, les frères se tuent, les amis se trahissent, et tout pour l’argent. Dis-moi, je te prie, si nous avons tort après cela de ne vouloir point ni manier ni même voir ce maudit argent.«
Dans la troisième note de bas de page de son discours Sur les origines et les fondement de l’inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau, qui a inventé l’idée du « noble sauvage » supposé exister avant que l’homme ne se lance dans l’agriculture, fait lui-même référence à
« ces nations heureuses qui ne connaissent pas même le nom des vices que nous avons tant de peine à réprimer, de ces sauvages d’Amérique dont Montaigne ne balance point à préférer la simple et naturelle police, nos seulement aux lois de Platon, mais même à tout ce que la philosophie pourra jamais imaginer de plus parfait pour le gouvernement des peuples.«
Ces Européens qui refusent de rentrer

Autre observation, celle du botaniste suédois Peher Kalm qui s’étonne, en 1749 du fait qu’un grand nombre d’Européens, exposés à la vie autochtone, ne veulent pas en revenir :
« Il est également remarquable que la plus grande partie des prisonniers européens qui, à l’occasion de la guerre, ont été pris ainsi et mêlés aux Sauvages, surtout s’ils ont été pris dans leur jeune âge, n’ont jamais voulu revenir par la suite dans leur pays d’origine, bien que leurs père et mère ou leurs proches parents soient venus les voir pour tenter de les en persuader et qu’eux-mêmes aient eu toute liberté de le faire. Mais ils ont trouvé le mode de vie indépendant propre aux Sauvages préférable à celui des Européens ; ils ont adopté les vêtements indigènes et se sont conformés en tout aux Sauvages, au point qu’il est difficile de les en distinguer, si ce n’est qu’ils ont la peau et le teint légèrement plus blancs. On connaît également plusieurs exemples de Français qui ont volontairement épousé des femmes indigènes et ont adopté leur mode de vie ; par contre on n’a pas d’exemple qu’un Sauvage se soit uni à une Européenne et ait pris sa façon de vivre ; s’il lui arrive d’être fait prisonnier par les Européens au cours d’une guerre, il cherche toujours une occasion, au contraire, de retourner chez lui, même s’il a été retenu plusieurs années et a bénéficié de toutes les libertés dont un Européen peut jouir.«
Avant Lahontan :
les Utopiens de Thomas More

En 1492, comme le dit la plaisanterie, « l’Amérique découvrit Colomb, un capitaine génois perdu en mer ».
La mission qui lui avait été confiée était motivée par diverses intentions, en particulier l’idée d’atteindre, en voyageant vers l’ouest, la Chine, un continent que l’on croyait peuplé de vastes populations ignorant le message inspirant et optimiste du Christ et ayant donc un besoin urgent d’évangélisation.
Malheureusement, deux ans plus tard, un intérêt moins théologique se manifesta lorsque, le 7 juin 1494, les Portugais et les Espagnols signèrent au Vatican, sous la direction du pape Alexandre IV (Borgia), le traité de Tordesillas, partageant le monde entier entre deux empires, l’espagnol sous le contrôle de l’alliance continentale Habsbourg/Venise, et le portugais sous celui du cartel bancaire d’esclavagistes maritimes génois.
Cela n’a pas empêché, deux siècles avant Lahontan, les meilleurs humanistes européens d’élever la voix et de montrer que certains des soi-disant « sauvages » des États-Unis avaient des vertus et qualités qui méritaient absolument d’être pris en considération et éventuellement manquant chez nous en Europe.
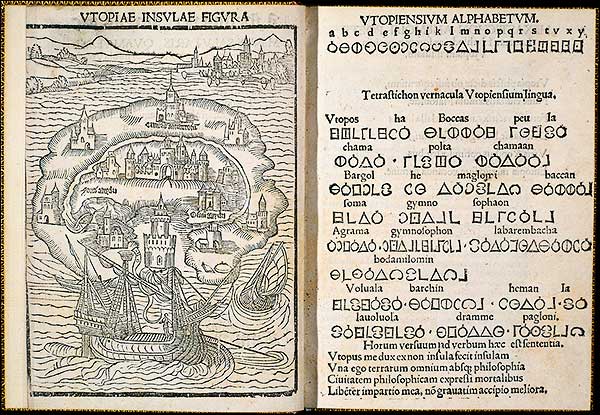
C’est le cas d’Érasme de Rotterdam et de son ami intime et collaborateur Thomas More, qui partagent ce que l’on pense être leurs opinions sur l’Amérique dans un petit livre intitulé « U-topia » (qui signifie ’quelque’ endroit), écrit en commun et publié en 1516 à Louvain.
Par instinct, les rapports qu’ils reçoivent de l’Amérique et les caractéristiques culturelles de ses indigènes, les incitent à croire qu’ils ont affaire à quelque colonie perdue de Grecs ou même au fameux continent perdu de l’Atlantide décrit par Platon à la fois dans son Timée et dans son Critias.
Dans l’Utopie de More, le capitaine portugais Hythlodée décrit une civilisation très organisée : elle possède des vaisseaux à carène plate et « des voiles faites de papyrus cousu », composée de gens qui « aiment à être renseignés sur ce qui se passe dans le monde » et qu’il « croit Grecque d’origine ».
A un moment il est dit :
« Ah ! Si je venais proposer ce que Platon a imaginé dans sa République ou ce que les Utopiens mettent en pratique dans la leur, ces principes, encore que bien supérieurs aux nôtres, et ils le sont à coup sûr, pourraient surprendre, puisque chez nous, chacun possède ses biens tandis que là, tout est mis en commun. » (pas de propriété privée)
En ce qui concerne la religion, les Utopiens (tout comme les indigènes indiens)
« ont des religions différentes mais, de même que plusieurs routes conduisent à un seul et même lieu, tous leurs aspects, en dépit de leur multiplicité et de leur variété, convergent tous vers le culte de l’essence divine. C’est pourquoi l’on ne voit, l’on entend rien dans leurs temples que ce qui s’accorde avec toutes les croyances. Les rites particuliers de chaque secte s’accomplissent dans la maison de chacun ; les cérémonies publiques s’accomplissent sous une forme qui ne les contredit en rien.«
Et même :
« Les uns adorent le soleil, d’autres la lune ou quelque planète (…) Le plus grand nombre toutefois et de beaucoup les plus sages, rejettent ces croyances, mais reconnaissent un dieu unique, inconnu, éternel, incommensurable, impénétrable, inaccessible à la raison humaine, répandu dans notre univers à la manière, non d’un corps, mais d’une puissance. Ils le nomment Père et rapportent à lui seul les origines, l’accroissement, les progrès, les vicissitudes, le déclin de toutes choses. Ils n’accordent d’honneurs divins qu’à lui seul. (…) Au reste, malgré la multiplicité de leurs croyances, les autres Utopiens tombent du moins d’accord sur l’existence d’un être suprême, créateur et protecteur du monde.«
Pas de complaisance
envers l’idéologie woke
Cela signifie-t-il que « tous les Européens étaient mauvais » et que « tous les Indiens étaient bons » ? Pas du tout ! Les auteurs ne tombent pas dans le piège des généralisations simplistes et de l’idéologie « woke » en général.
Par exemple, même avec de grandes similitudes, la différence culturelle entre les Premières Nations de la côte nord-ouest du Canada et celles de Californie était aussi grande que celle entre Athènes et Sparte dans l’antiquité grecque, la première étant une république, la seconde une oligarchie.
Différents peuples et différentes sociétés, à différentes époques, ont fait des expériences et des choix politiques différents concernant les axiomes de leur culture.
Alors qu’en Californie, des formes d’autonomie égalitaire et anti-oligarchique apparaissent, dans certaines régions du nord, c’est le régime oligarchique qui prévaut :
« de la rivière Klamath vers le nord, il existait des sociétés dominées par des aristocrates guerriers engagés dans de fréquents raids entre groupes, et dans lesquelles, traditionnellement, une partie importante de la population était constituée d’esclaves à titre onéreux. Il semble que cela ait été le cas aussi longtemps que l’on s’en souvienne. »
Les sociétés du Nord-Ouest pour le plaisir qu’elles prenaient à afficher des excès, notamment lors des fêtes connues sous le nom de potlach, qui culminaient parfois, champignons hallucinogènes aidant, avec
« le meurtre sacrificiel d’esclaves (…) À bien des égards, le comportement des aristocrates de la côte nord-ouest ressemble à celui des mafieux, avec leurs codes d’honneur stricts et leurs relations de patronage, ou à ce que les sociologues appellent les ‘sociétés de cour’ – le genre d’arrangement auquel on pourrait s’attendre, par exemple, dans la Sicile féodale, d’où la mafia a tiré bon nombre de ses codes culturels. »
La première remarque de Graeber et Wengrow est donc qu’il faut tenir compte de l’infinie diversité des sociétés humaines. Deuxièmement, au lieu de se contenter d’observer le fait, les auteurs soulignent que, très souvent, ces diversités ne résultent pas de conditions « objectives », mais de choix politiques. Cela véhicule également un message très optimiste, à savoir que des choix différents du système mondial actuel peuvent devenir réalité si les gens relèvent le défi de les changer pour le mieux.
Les premières villes du monde
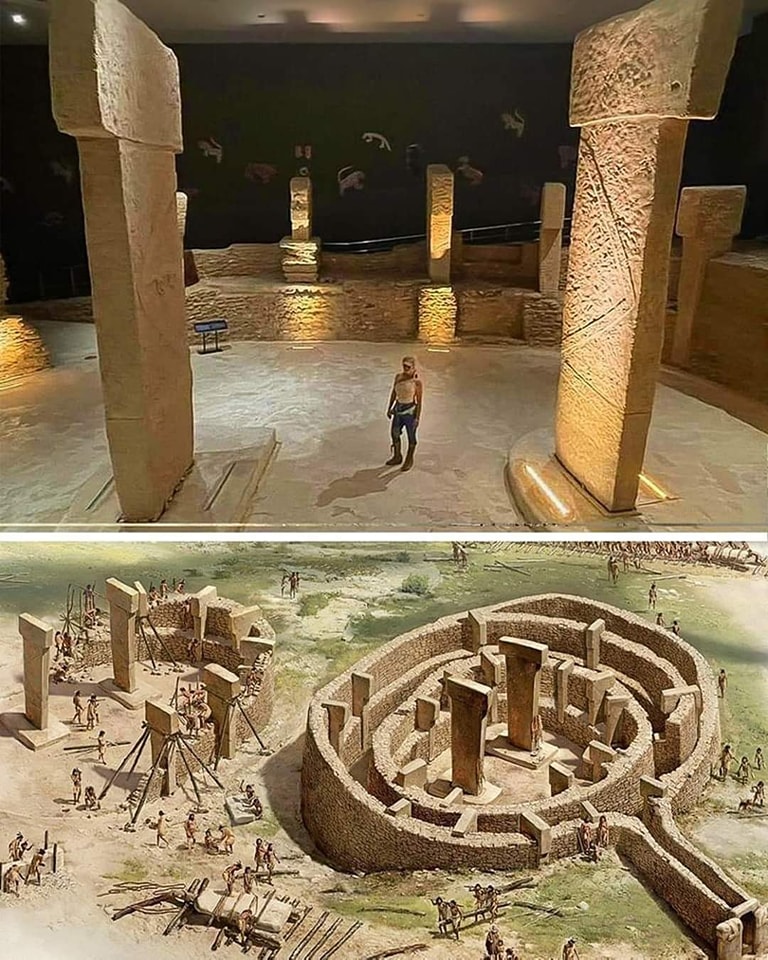
Dans la plus grande partie du livre, les auteurs décrivent la vie des chasseurs-cueilleurs qui ont vécu des milliers d’années avant la révolution agricole, mais qui ont été capables de créer d’immenses complexes urbains et qui parfois ont fini par gouverner sans oligarchie dominante.
Le livre identifie des exemples en Chine, au Pérou, dans la vallée de l’Indus (Mohenjo-Daro), en Ukraine (Talianki, Maydenetsk, Nebelivka), au Mexique (Tlaxcala), aux États-Unis (Poverty Point, Lousiane) et en Turquie (Göbekli Tepe, Catal Höyük), où l’on vivait à grande échelle au niveau de la ville (d’environ 10 000 à 6 000 ans av. J.-C.). Catal Höyük (Anatolie, Turkye) comptait jusqu’à 8000 habitants au moment de son extension maximum, entre le VIIe et le VIe millénaire avant notre ère.
Cathérine Louboutin, dans son ouvrage de la collection Découvertes Gallimard, « Au Néolithique, les premiers paysans du monde », écrivait en 1990 : « Malgré sa taille, un riche artisanat, la connaissance du métal (cuivre et plomb) et de l’irrigation, Catal Höyük ne montre aucune hiérarchie sociale et ne semble pas rassembler, pour la redistribuer, la richesse économique de la région dont elle serait le pôle majeur : ce n’est donc pas tout à fait une ville. »
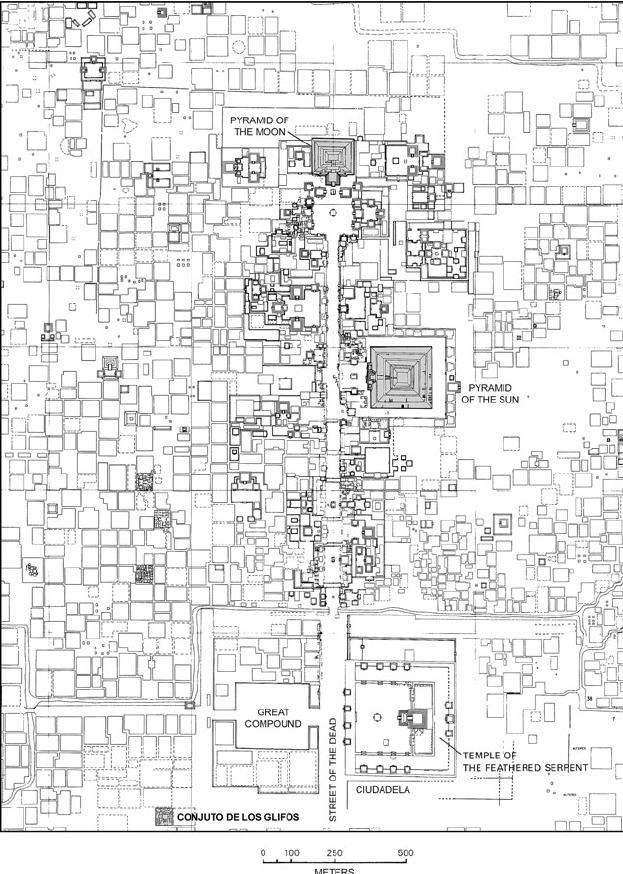
Mais ces villes n’impliquaient pas de caste dirigeante ou de classe aristocratique ; elles étaient explicitement égalitaires dans la construction de leurs maisons et dans leurs échanges commerciaux ; elles ont apporté de nombreuses innovations en matière de plomberie et de conception des rues ; et elles faisaient partie de réseaux continentaux qui partageaient les meilleures pratiques.
La révolution agricole n’a pas été une « révolution », affirme les auteurs, mais plutôt un processus de transformation continu étalé sur des milliers d’années, lorsque les chasseurs-cueilleurs ont été capables de s’organiser de manière flexible en méga-sites (quelques milliers d’habitants), organisés sans centres ni bâtiments monumentaux, mais construits avec des maisons standardisées, confortables pour la vie quotidienne, tout cela sans hiérarchies statiques, sans rois ni bureaucratie écrasante.
Un autre exemple est celui de la ville de Teotihuacán, qui a rivalisé en grandeur avec Rome entre environ 100 avant J.-C. et 600 après J.-C., où, à la suite d’une révolution politique en 300 après J.-C., une culture égalitaire s’est lancée dans un programme massif de logement social destiné à donner à tous les habitants des quartiers décents.
Conclusion
Aujourd’hui, il est très difficile pour la plupart d’entre nous d’imaginer qu’une société, une culture ou une civilisation puisse survivre pendant des siècles sans une structure de pouvoir centralisée et hiérarchisée par la force.
Pourtant, comme l’indiquent les auteurs, les preuves archéologiques, si nous sommes prêts à les regarder, nous disent le contraire. Mais sommes-nous prêts à remettre en question nos propres préjugés ?
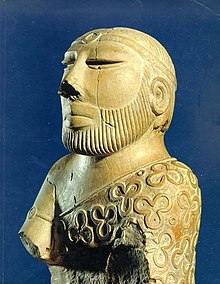
A titre d’exemple de cette cécité auto-infligée, il convient de mentionner le cas du « Roi-prêtre », une petite figure masculine représentant un homme à la barbe soignée, découverte lors des fouilles de la ville en ruines de Mohenjo-Daro (Pakistan), datant de l’âge du bronze, environ 2000 ans avant J.-C. et considérée comme « la plus célèbre sculpture en pierre » de la civilisation de la vallée de l’Indus.
Alors qu’il n’existe à Mohenjo-Daro ni palais royal, ni tombe, ni temple religieux d’aucune sorte, les archéologues britanniques ont immédiatement parlé d’un « Roi-prêtre », parce que, tout simplement, « il ne peut en être autrement ».
La lecture du livre de Graeber et Wengrow nous oblige à ajuster nos points de vue et à devenir optimistes. Ils montrent que des systèmes humains radicalement différents sont non seulement possibles, mais qu’ils ont été essayés à de nombreuses reprises par notre espèce.
Lors d’une conférence publique en 2022, Wengrow a présenté ce qu’il considère comme des leçons pour le présent politique du passé, où les êtres humains étaient beaucoup plus fluides, conscients et expérimentaux avec leurs structures sociales et économiques :
« Qu’est-ce que tous ces détails signifient ? Qu’est-ce que tout cela signifie ? À tout le moins, je dirais qu’il est un peu tiré par les cheveux de nos jours de s’accrocher à l’idée que l’invention de l’agriculture a marqué la fin d’un Eden égalitaire. Ou de s’accrocher à l’idée que les sociétés à petite échelle sont particulièrement susceptibles d’être égalitaires, alors que les sociétés à grande échelle doivent nécessairement avoir des rois, des présidents et des structures de gestion du haut vers le bas. Et il y a aussi des implications contemporaines. Prenons, par exemple, la notion courante selon laquelle la démocratie participative est en quelque sorte naturelle dans une petite communauté. Ou peut-être dans un groupe d’activistes, mais qu’elle ne peut en aucun cas s’étendre à une ville, une nation ou même une région. En fait, les preuves de l’histoire de l’humanité, si nous sommes prêts à les examiner, suggèrent le contraire. Il n’est peut-être pas trop tard pour commencer à tirer des leçons de toutes ces nouvelles preuves du passé humain, et même pour commencer à imaginer quels autres types de civilisation nous pourrions créer si nous pouvions cesser de nous dire que ce monde particulier est le seul possible.«
NOTE
*David Graeber, né le 12 février 1961 à New York (États-Unis) et mort le 2 septembre 2020 à Venise (Italie), est un anthropologue et militant anarchiste américain, théoricien de la pensée libertaire nord-américaine et figure de proue du mouvement Occupy Wall Street. Évincé de l’université Yale en 2007, David Graeber, « l’un des intellectuels les plus influents du monde anglo-saxon » selon le New York Times, est ensuite professeur à la London School of Economics. Il est notamment le théoricien du « bullshit job » et l’auteur de Dette : 5000 ans d’histoire (Debt : the First Five Thousand Years).
Christian Lévêque : l’écologie malade du « fixisme » ?


Karel Vereycken s’est entretenu fin mars 2021 avec l’écologue et hydrobiologiste Christian Lévêque, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et spécialiste des écosystèmes aquatiques. Il est également président honoraire de l’Académie d’agriculture de France et membre de l’Académie des sciences d’Outre-mer.
Parmi ses derniers écrits, nous recommandons :
- La biodiversité avec ou sans l’homme ? (Quae, 2017) ;
- La mémoire des fleuves et des rivières (Ulmer, 2019) ;
- La gestion écologique des rivières françaises – Regards de scientifiques sur une controverse (L’Harmattan, 2020, avec JP. Bravard) ;
- Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ? (Fondapol, 2021).
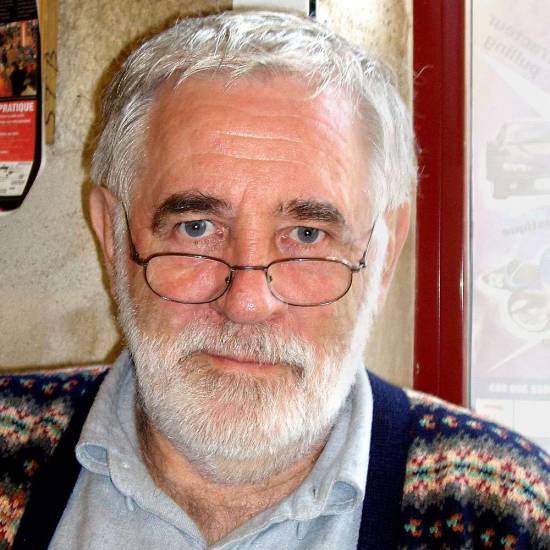
Karel Vereycken : Dans vos écrits, vous soulignez que le discours qu’on entend dans les médias sur l’écologie est plus idéologique que scientifique. Que voulez-vous dire et en quoi est-ce préoccupant ?
Christian Lévêque : La première chose qui me préoccupe dans le discours écologique, c’est qu’il s’agit d’un discours à sens unique : « L’Homme détruit la nature. » C’est un discours de mise en accusation de l’homme dans son rapport à la nature. Or, ce que je vois autour de moi, ce n’est pas tout à fait ça. Prenons le cas du parc naturel de la Camargue, qu’on présente parfois comme un pur produit de la nature. En réalité, il s’agit d’un système aménagé par l’homme pour la production de sel et la riziculture. C’est un système géré artificiellement qui est néanmoins labellisé « parc naturel ». On voit bien, avec cet exemple, que l’action de l’homme n’est pas forcément négative.
Prenons maintenant le cas du bocage normand. Une fois de plus, ce n’est pas un système naturel, mais aménagé par l’homme et l’agriculture. Il est amusant de constater que le bocage figure dans tous les livres traitant de la biodiversité comme un bel exemple de nature qu’il faut préserver. On pourrait multiplier les exemples. Je prends souvent le cas du lac du Der (lac du Der-Chantecoq, en Champagne) qui est un barrage-réservoir (de 48 km²) sur la Marne, construit il y a une trentaine d’années pour protéger Paris des crues de la Seine. Or, tout comme la Camargue, ce site a été consacré « site Ramsar » (Note 1) en matière de préservation de la nature, en particulier pour l’habitat qu’il offre aux oiseaux.
On voit donc que le « vécu des gens » (la réalité) ne correspond en rien à celle dont parlent un certain nombre de mouvements militants qui ne font qu’accuser l’homme de ravager la nature. Pour moi, il y a quelque chose de totalement incohérent dans cette démarche. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout va pour le mieux, et il y a bien entendu des contre-exemples. Mais il faut revenir à des regards plus réalistes et moins dogmatiques sur nos rapports à la nature.
Ce qui me préoccupe le plus dans leur approche, c’est cette « vision fixiste » de la nature, sous-jacente dans la plupart des discours en matière de conservation de la nature. On a l’impression qu’en créant des aires protégées, on va protéger la nature. On oublie que la nature n’arrête pas de changer et qu’une aire protégée ne protège rien dans la durée. La flore et la faune vont évoluer sous l’influence du climat par exemple. Ou sous l’influence d’espèces qui vont se naturaliser sur le site. Et les espèces que l’on cherche à protéger peuvent disparaître car les conditions écologiques ne leur seront plus favorables. Ce sont des mesures d‘urgence qui peuvent être utiles comme telles, mais ce n’est pas une assurance à long terme.
Beaucoup de projets de restauration ou d’aménagement qui cherchent à reconstituer un état écologique historique (c’était mieux avant…) oublient que l’avenir ne peut pas être le passé. Les systèmes écologiques évoluent et se modifient en permanence sur la flèche du temps.
J’avais demandé, il y a quelques années, de faire une simulation sur la remontée du niveau de la mer, dans l’estuaire de la Seine dont je m’occupais. Si la mer monte d’un mètre – ce qui est possible et probable, d’ici à la fin du siècle – vous avez la moitié de la réserve de l’estuaire de la Seine qui est sous l’eau. Et si ça monte de deux mètres, il n’y a plus de réserve du tout. Est-ce qu’on pourrait repositionner la réserve plus haut ? Comme il y a beaucoup d’urbanisation, cela posera de grandes difficultés. C’était une parenthèse pour dire que les réserves naturelles sont un peu limitées en tant que perspective historique…
Si je vous comprends bien, ces écologistes font en quelque sorte un instantané de l’évolution, qu’ils veulent geler artificiellement pour toujours ?
Lorsqu’on regarde dans le passé, comme le font les paléo-écologues, on voit bien que la nature était différente de celle d’aujourd’hui. L’Europe a connu à diverses reprises des périodes de glaciation qui ont profondément modifié la flore et la faune.
Je dis souvent : réfléchissez. Il y a 10 à 20 000 ans, le nord de l’Europe était sous les glaces ainsi que le massif alpin, et l’on était en zone de permafrost là où nous sommes aujourd’hui. Cela a beaucoup changé depuis, non ? On est passé des toundras de Sibérie à des forêts luxuriantes et la biodiversité a également beaucoup changé. Et cela, en relativement peu de temps. La flore et la faune se sont reconstituées par des migrations ou des introductions d’espèces depuis environ 10 000 ans, ce qui est récent. A l’échelle géologique ou à celle de l’évolution, c’est une goutte d’eau.
Il faut bien intégrer que la nature est dynamique. Il est illusoire de penser que l’on pourra figer cette dynamique en établissant des normes et des lois pour la protéger. J’ai conscience que c’est difficile à intégrer car nous n’aimons pas beaucoup le changement, qui est porteur d’incertitudes et donc de dangers… Pour les scientifiques, la biodiversité est le produit du changement et donc de l’adaptation permanente des espèces aux fluctuations de leurs conditions d’existence.

Les mouvements environnementalistes nous alertent sur une forte érosion de la biodiversité et certains évoquent même la menace d’une « sixième extinction de masse » provoquée par l’action humaine. Qu’en est-il ?
Tout cela est compliqué et relève pour partie de la communication de grandes ONG environnementales. Il est vrai que les hommes ont un impact, mais il faut l’évaluer raisonnablement et ne pas tomber dans des discours inflationnistes.
A ceux qui tiennent ces discours, répliquez : « Apportez-moi les données ! » Or, on a beaucoup de mal à trouver les données sur lesquelles sont basées ces assertions.
J’ai vu récemment une communication de l’International Union for the Conservation of Nature (IUCN, l’une des plus grandes associations environnementalistes) et de l’Office français de la biodiversité (OFB) sur le nombre d’espèces menacées de disparition en France, évalué à 2400 espèces. Quand vous regardez le détail, c’est une liste à la Prévert d’espèces dont certaines sont sans aucun doute en régression, il n’est pas question de le nier, et d’autres dont la présence sur la liste sert à faire du chiffre.
Deux exemples pour l’illustrer. Parmi les quelques rares espèces supposées éteintes en France, il y a trois espèces de poissons d’eau douce appartenant au groupe des corégones qui peuplent les lacs alpins. Ce groupe est connu chez les taxinomistes pour être très variable. Selon les auteurs, on distingue des dizaines d’espèces de corégones, ou seulement deux en Europe… Les trois « espèces » en question sont-elles de vraies espèces ou des écotypes ? Ce qui souligne la difficulté rarement abordée de la définition de l’espèce !
Autre exemple, on comptabilise parmi les espèces disparues ou pratiquement disparues en France, des espèces qui vivent dans des pays voisins et qui, pour des raisons diverses, font de temps à autre une incursion chez nous. Il existe ainsi sur cette liste deux espèces de poissons qui sont endémiques en Espagne, où elles sont très abondantes, mais qu’on a pu apercevoir à certains moments dans des régions frontalières en France. Ce sont des espèces qui peuvent être importées accidentellement par des oiseaux, des mammifères ou des hommes, et qui s’installent temporairement chez nous, avant de disparaître. Comptabiliser ce type d’espèces parmi les espèces en danger, c’est quand même un peu fort ! C’est ce que j’appelle faire du chiffre. On aimerait que les données qui sont diffusées par les médias fassent preuve d’une plus grande rigueur !
D’autre part, on mélange systématiquement dans ces analyses les espèces métropolitaines et les espèces ultra-marines.
C’est donc intellectuellement malhonnête…
C’est un problème de manipulation sémantique, oui. On sait que l’essentiel des disparitions d’espèces a lieu dans les îles. C’est clair, c’est net : 95 % des espèces recensées disparues sont des espèces insulaires, des îles indo-pacifiques notamment. Sur les continents, on a très, très peu d’espèces disparues à l’époque historique. Donc pratiquer l’amalgame et laisser croire que la situation est la même partout n’est pas honnête. Les problèmes sont très différents concernant l’érosion de la biodiversité sur l’île de la Réunion, à Mayotte ou en métropole.
Pour la plupart des métropolitains, la France, c’est la métropole ; il faudrait donc préciser en « France métropolitaine et ultra-marine », et distinguer ce qui concerne les îles et ce qui concerne les continents.
Le problème des îles porte sur les « espèces endémiques » (à distribution réduite, liées à un territoire). Dans ce sens, il y a des îles océaniques, mais également des îles continentales. Un lac peut être une « île continentale ». Le lac Tanganyika, en Afrique, est une île continentale dans la mesure où il n’a aucune connexion avec d’autres lacs. Dans une île, vous avez des populations (végétales et animales) qui vont évoluer de manière isolée et qui vont donner au bout d’un certain temps des espèces biologiquement différentes de celles qui existent sur les continents. En général, ces îles ont été peuplées d’espèces qui vivent sur le continent, et l’évolution a fait son œuvre.
En Corse, en Sardaigne, etc., vous avez des espèces endémiques. Si certaines sont de « vraies » espèces biologiques, il s’agit souvent de sous-espèces dont l’évolution n’est peut-être pas complètement terminée.
La faune endémique des îles a beaucoup souffert de l’introduction d’espèces domestiques (chats, chiens) et d’espèces commensales (rats), c’est incontestable. Mais ce n’est pas le cas en milieu continental. Il ne faut donc pas tout amalgamer, à moins de vouloir manipuler les chiffres pour donner l’impression qu’en métropole, il y a de nombreuses espèces qui ont disparu.
On évoque souvent le cas des insectes. Dans les années 1960, pour désigner le liquide lave-glace, on utilisait le terme « démoustiqueur », tellement on ramassait d’insectes sur le pare-brise lors des déplacements en voiture…
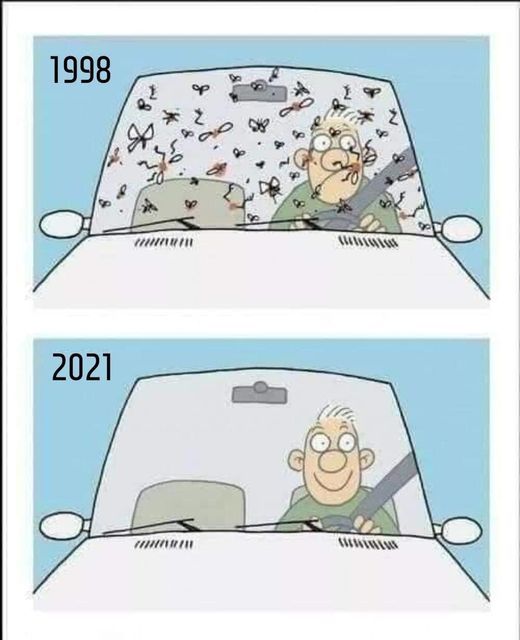
C’est vrai qu’il y a moins d’insectes, je ne le conteste pas. L’homme a forcément un impact sur son environnement. Ou alors il faut exclure l’homme comme le proposent certains, pour qui une belle nature est une nature sans l’homme. Veut-on suivre cette logique ? Ce n’est pas la mienne. Tous les animaux ont un impact sur la nature. Lorsque vous regardez les films animaliers à la télévision, il y a toujours cette pauvre lionne ou cette pauvre louve qui cherche désespérément de quoi nourrir ses petits… On voit avec plaisir et même avec soulagement la pauvre lionne tuer une antilope ou la louve tuer un chamois. C’est cruel, la nature. Ce n’est pas un monde paradisiaque. C’est un monde de rapports de force.
Pour revenir aux insectes, il faut, là encore, essayer de comprendre pourquoi, au cas par cas, certaines populations (pas toutes) sont en régression. Et si les pesticides sont au banc des accusés, ils ne sont pas les seuls coupables. Il y a les pratiques agricoles et la modification des paysages, mais aussi toutes les conséquences de l’artificialisation et des pollutions résultant de l’urbanisation.
Ce qui sous-tend vos propos, et je crois l’avoir vu dans vos écrits, c’est la notion de « co-construction » entre la civilisation humaine et la nature ?
C’est en effet ce que je dis – avec d’autres, car je ne suis pas seul dans ce domaine. La « nature » européenne est une co-construction entre les processus spontanés, c’est-à-dire la dynamique des espèces elles-mêmes, et les activités humaines. Le paysage européen, c’est le produit de l’agriculture, au sens large. Il n’y a plus rien d’originel. Mais c’est aussi de nos jours le produit de l’urbanisation. On voit bien que l’urbanisation artificialise le paysage. On n’a plus de grands espaces sans artifices.
En milieu urbain, notre « nature » est une hyper co-construction. On aménage des coins de nature en ville, des parcs, des jardins. C’est artificiel mais ces milieux hébergent également des espèces de plus en plus nombreuses qui s’adaptent à la ville. On y trouve même beaucoup d’espèces protégées.
Une vision romantique prétend que si l’homme disparaissait définitivement, la nature « reprendrait ses droits », mais on peut également craindre que cela ne soit pas forcément le cas. On peut même redouter que des formes plus primitives du vivant, du type virus « malveillants » ou autres, viennent ravager ce qui resterait.
On peut tout imaginer. Je ne suis pas hostile à ce qu’on réfléchisse à ces questions, loin de là. Je dirais que globalement, l’homme a besoin de la nature, c’est évident. Sans les ressources de la nature, il ne peut pas vivre, comme d’ailleurs beaucoup d’autres espèces. Le principe de la nature, c’est qu’il y a des mangeurs et des mangés, ne l’oublions pas. Néanmoins, la nature a existé pendant très longtemps sans l’homme. L’homme est un tout petit épisode dans l’histoire de la Terre et de la nature, en tout cas l’homme actuel. Et il y a fort à parier que si l’homme disparaît, la nature poursuivra son chemin…
Maintenant, ce qui est vrai, c’est que si l’on abandonne un certain nombre d’activités – notamment agricoles – de co-construction de la nature, les paysages vont changer. La déprise agricole (abandon et sous-utilisation à long terme des sols) entraîne ce qu’on appelle la « fermeture » des paysages. Ça veut dire que les systèmes forestiers vont prendre la place des systèmes prairiaux ouverts, ce qui provoquera un changement assez important dans les peuplements qui leur sont associés. Et l’une des raisons probables de l’érosion des populations d’oiseaux des champs en France et en Europe, dont on discute pas mal, est en partie liée à cette déprise agricole. Cela veut dire que beaucoup d’endroits qui étaient des milieux « ouverts » sont maintenant abandonnés à une forêt qui gagne du terrain en France.
Et puis il ne faut jamais oublier que l’artificialisation des sols (extension des zones habitables) progresse beaucoup. Lorsque l’on aborde le problème de la disparition des insectes (sans exclure le rôle des insecticides), il faut considérer le rôle de l’éclairage, celui des lampadaires qui tuent des quantités d’insectes. L’urbanisation détruit évidemment un certain nombre de milieux favorables aux insectes. Les pratiques agricoles, surtout avec les cultures extensives, éliminent les bosquets, etc. Je ne nie pas du tout le rôle des insecticides, mais je refuse d’en faire le seul facteur ou le bouc-émissaire de la disparition des espèces.
Derrière tout cela, je pose la question de savoir s’il est légitime ou pas que l’homme se protège des nuisances de la nature. N’a-t-on pas le droit de se protéger contre toutes ces nuisances que sont les insectes ravageurs des cultures, que sont les moustiques, que sont tous ces vecteurs de maladies, etc. ? Il y a une vraie question qui est posée… et jusqu’où aller ? Pouvons-nous imaginer des compromis et sur quelles bases ?
En plus, cette question ne se pose pas de la même façon dans les pays en voie de développement que dans les pays avancés. Lorsqu’on regarde le rôle des insectes dans la transmission des grandes maladies parasitaires, bactériennes et virales, on a un autre regard.
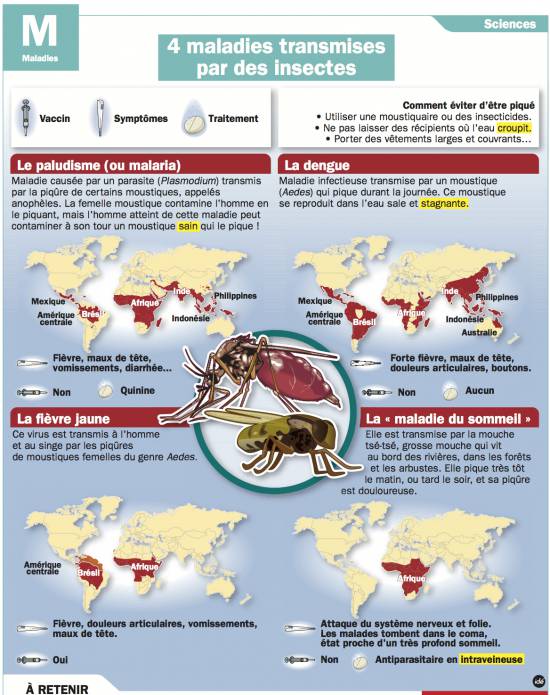
Moi, j’ai travaillé dans les pays en voie de développement. J’ai passé dix ans en Afrique et j’étais sur le terrain, pas derrière les écrans d’ordinateur d’un laboratoire français. Le discours actuel sur la biodiversité est complètement aberrant par rapport aux besoins et à la situation des pays en voie de développement.
Leur problème, ce n’est pas la conservation de la nature dans des réserves. Leur problème, c’est aussi de se protéger de la nature et de ses nuisances. Je dis bien aussi… car évidemment, ils ont aussi besoin de protéger leurs ressources.
Cette question des deux visages de la nature m’est particulièrement chère car dans le monde vécu des citoyens, la nature est une source inépuisable de nuisances (maladies, ravageurs de cultures, aléas climatiques, etc.). Mais les conservationnistes refusent d’en parler pour ne pas écorner cette image d’Epinal d’une nature bucolique assiégée par l’homme, qui est leur fonds de commerce !
Conservation de l’homme !
Ce n’est pas une guerre de tranchées, mais tout de même, ce n’est pas du tout la vision bucolique et idyllique que les « bobos » ont actuellement de la nature. Ça c’est vraiment un regard de pays riche.
Ce que vous avancez me semble très important. Pourtant, votre discours, sans être marginal, n’est pas médiatisé et reste très éloigné du discours dominant. Pourquoi y a-t-il tant de scientifiques qui s’adonnent à ce catastrophisme ?
C’est aussi une question que je me pose. Je me suis plusieurs fois étonné que mes collègues puissent avaliser des informations du type « 1 million d’espèces menacées de disparition », sans disposer des données permettant d’étoffer une telle affirmation ni savoir comment on l’a calculé. En principe, il existe une déontologie scientifique. Les scientifiques doivent parler de choses qui sont vérifiées, ou mettre des informations sur la table pour qu’on puisse en discuter. Or, on ne trouve nulle part de quelle manière ces chiffres ont été obtenus. Les affirmations de ce type qui tournent en boucle sur internet et sur les réseaux sociaux ne sont pas sourcées.
J’étais interrogé par l’hebdomadaire Le Point (20 février 2021) sur la question du WWF qui annonce, dans son rapport Planète vivante (Edition 2020) que 68 % des vertébrés ont disparu entre 1970 et 2016.
Manque de chance, il y a deux articles scientifiques qui, en s’appuyant sur les mêmes bases de données que le WWF, sortent des chiffres totalement différents. En gros, oui, il y a des espèces dont les populations sont en forte régression, c’est incontestable, on parle des lions, on parle des girafes, etc. Mais il y a également des populations qui sont en expansion et ça, on n’en parle jamais, de même qu’on ne parle jamais de l’évolution qui est en cours. On parle toujours de la disparition des espèces, mais quand on fait des analyses génétiques des populations, on s’aperçoit que l’évolution est toujours en cours. Vous avez des différences génétiques dans un même bassin fluvial, entre populations de poissons d’une même espèce à quelques dizaines de kilomètres de distance. L’évolution, c’est de l’adaptation, Les espèces sont en permanence en train de s’adapter. Quand vous introduisez une espèce américaine dans un lac européen, au bout de quelques décennies, elle se différencie de l’espèce d’origine et peut devenir une nouvelle espèce biologique.
Lors de conférences visant à populariser l’idée de la « grande réinitialisation » (Great Reset), c’est-à-dire le verdissement de la finance mondiale pour « sauver le climat », on a pu voir, à la fin de la grande session réunissant la fine fleur des financiers à Londres, le 11 novembre 2020, Greenpeace présenter la bande annonce de son film « Our Planet, Too Big too fail »…
Je sais…
On peut donc croire qu’il existe un lobby de la finance verte qui a bien besoin de ce genre de propagande…

Il y a « une machine à cash », pour dire les choses simplement. Si vous présentez un programme de recherche dans lequel vous dites « je veux montrer tout l’intérêt de la préservation du bocage et de sa transformation historique, soulignant le rôle positif de l’homme », alors vous ne trouverez absolument aucun financement. En revanche, si vous jouez le chercheur pyromane et que vous criez au feu : « Ah, les espèces invasives, ah, le changement climatique ! ça va tout transformer, ça va tout détruire ! »
Ça marche très bien au niveau des médias, ça marche très bien, hélas, au niveau d’un bon nombre de nos concitoyens, et là, vous allez obtenir des crédits, car vous allez dire « donnez-moi de l’argent, je vais vous apporter la solution ». Cela ressemble fort à ce qu’on appelait au Moyen-Âge le régime des indulgences (Note 2), lorsque l’Eglise disait « donnez-nous de l’argent, et votre âme sera sauvée ! »
C’est ce que dit le WWF : « Donnez-nous de l’argent et on va sauver la planète ! » Ça dure depuis des décennies sans que la question de l’érosion de la biodiversité soit réglée pour autant.
C’est pas mal, les indulgences vertes !
Tout cela crée une sorte de doxa. On se renvoie la balle, on fait de la surenchère. On a une « érosion sans précédent » mais qui n’est pas documentée. On se monte le bourrichon d’une certaine manière, mais ça rapporte – de la notoriété, parce qu’on passe dans les médias, et de l’argent parce que vous allez sauver le monde. Qui va dire le contraire ? On est dans un grand jeu de rôle.
Cela me conduit à la dernière question à laquelle vous avez déjà répondu en partie. Aux politiques, vous dites « regardez les chiffres et ne répondez pas aux images et aux émotions ». Existe-t-il des domaines de recherche prometteurs permettant de clarifier ce débat ?
Pour clarifier ce débat, il faudra d’abord que les politiques soient à l’écoute, ce qui n’est pas forcément le cas. C’est une question pour laquelle je n’ai pas de réponse définitive. Je ne suis pas un gourou. Je ne dis pas « il n’y a qu’à… » ou « il faut qu’on… ».
Lorsque je parle de préserver la diversité biologique, je souligne qu’il faut le faire dans un contexte qui dépasse la seule vision naturaliste. Il y a la nature « objet » et la nature vécue… et on ne peut pas parler de la préserver sans tenir compte des paramètres sociaux en matière d’usages et de santé.

Revenons au lac du Der, qui est devenu une zone de protection pour les oiseaux. Une zone humide, un peu marécageuse, ce n’est pas compliqué à faire. Vous creusez un trou, vous y mettez de l’eau, et au bout d’un an ou deux, vous aurez une belle zone humide. La nature fait très bien les choses et il y a naturellement des échanges importants d’espèces d’un endroit à un autre par le biais des oiseaux, des mammifères, du vent, etc. Si vous avez la chance d’avoir un jardin, faites un trou et mettez de l’eau. Après quelques semaines vous verrez que la vie s’y est bien installée.
Oui, le vivant est conquérant !
Il y a eu des expériences intéressantes de création de marais au nord de Paris, dans le Parc départemental du Sausset (93), par un collègue qui est urbaniste. Au début, des paysagistes y ont mis des plantes. Quelques années après, tout cela avait disparu et l’endroit était envahi par une végétation spontanée de zones humides. A tel point que cette zone est devenue un centre d’attraction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Le public appréciait ce coin de nature sauvage… en milieu urbain.
C’est une chose qui a été déterminante dans ma réflexion, pour dire qu’effectivement l’action de l’homme n’est pas systématiquement négative. Mais ce qui était fait initialement pour distraire le public est devenu une réserve ornithologique fermée au public !
Comme je l’ai développé dans certains articles, on n’est pas obligé d’avoir une vision monolithique des choses. J’aborde souvent ces questions du point de vue des rapports nature-société. Si les hommes ont envie, quelque part, de coins de nature protégée, parce que ça leur fait plaisir, et parce qu’ils y trouvent un intérêt, pourquoi pas ? On n’est pas pour autant obligé de faire de la France tout entière une réserve naturelle ! On doit réfléchir sur la base d’un compromis entre différentes attentes des citoyens et des usages de la biodiversité.
Entre 100 % parking et 100 % réserve naturelle, il y a de la marge…

On parle actuellement de 30 % d’aires protégées (terrestres et maritimes), et certains conservationnistes disent que ce n’est pas assez, qu’il faudrait passer à 50 %. Mais où va-t-on mettre les hommes, là-dedans ? On va les mettre dans des réserves indiennes ? Ça, on ne le dit pas… C’est bien le problème, et c’est irresponsable.
Si l’on revient aux pays en voie de développement, lorsqu’on parle de 30 ou 50 % d’aires protégées alors que leur population est en forte augmentation, va-t-on y faire des zones hyper-peuplées et d’autres hyper-dépeuplées ? Tout ça pour qu’on puisse admirer une belle nature dans les zones protégées alors que les hommes crèvent de faim à côté ? Vous avez lu le livre Le colonialisme vert de Guillaume Blanc ? Lisez-le.
J’ai vécu ça en partie. J’ai connu les zones protégées en Afrique de l’Ouest, elles n’ont pas résisté longtemps lorsqu’il y a eu des révoltes sociales. C’étaient des réserves de viande de brousse. C’est un peu différent en Afrique de l’Est, où c’est devenu en réalité du grand business. Pourquoi pas !
Pour protéger les animaux, certains sont près à abattre les hommes dans ces réserves…
Abattre est peut-être un peu fort (mais c’est vrai au sujet des braconniers…), mais les expulser sans aucun doute. C’est ce que fait le WWF. C’est ce que dit Blanc également et ce comportement a été dénoncé dans des articles parus dans Le Monde diplomatique.
Oui, la télévision néerlandaise y a également consacré un reportage extrêmement documenté.
On peut accepter que dans certains pays comme la France, on crée des réserves dans des endroits où il n’y a personne. C’est le cas du parc du Mercantour. Mais il est vrai aussi que nous avons des parcs régionaux qui essaient d’associer protection et activités humaines, avec un certain succès.
Ou le retour des haies ?
On peut replanter des haies, et c’est ce que l’on fait à petite échelle, mais c’est encore assez anecdotique. Une haie, ce n’est pas que de l’aubépine, c’est aussi des arbres, et il faut du temps. Il y a en théorie des choses simples à faire pour recréer l’hétérogénéité des habitats. Au lieu d’avoir d’immenses étendues de champs labourés, on peut reconstituer quelques bosquets, ce qui serait certainement très positif pour la biodiversité.
Cela offre un plus pour les oiseaux…
Ce sont les arbres qui sont importants pour beaucoup d’oiseaux. Il est également clair qu’il faut réduire les pollutions, mais celles de toute nature, et pas seulement les pesticides. Les pollutions lumineuses, ça existe, et l’on pense que pour les insectes et les oiseaux, cela joue un rôle actuellement. Il y a des scientifiques qui semblent disposer de données pour le prouver. On voit bien qu’il y a des choses à faire, mais ce n’est pas forcément la révolution.
C’est en « co-construisant » avec la nature et en se posant la question : qu’est-ce qu’on veut comme nature ? Ce qui nous amène à prendre en compte non seulement des facteurs écologiques, mais également des facteurs économiques et sanitaires. Je ne suis pas sûr que les citoyens soient prêts à accepter le retour des moustiques, par exemple. Mais je respecte aussi les choix de nature éthique. Encore faut-il qu’ils ne deviennent pas exclusifs.
Aujourd’hui, dès qu’il y a un coq qui chante ou des grenouilles qui croassent, on appelle la police et on exige que le maire du village soit fusillé !
Ce qui compte, c’est de rechercher des solutions au cas par cas, qui ne seront pas les mêmes partout. En évitant les excès et les attitudes trop dogmatiques. Mais à certains moments, il faut aussi savoir trancher. Ça c’est de la politique, pas de la science.
C’est pour cela que le concept de co-construction est vraiment la chose à faire connaître.
Il faut tenir compte, selon les endroits, du contexte écologique, économique, sociologique, etc. Il faut tenir également compte des changements dans la société. Au XIXe siècle, la préoccupation majeure était de survivre. L’agriculture ne produisait pas assez, les gens crevaient de faim dans certains endroits. Il fallait donc produire. On ne se posait pas la question de la protection de la nature. Aujourd’hui, c’est la même chose dans les pays en voie de développement.
Je ne sais pas si vous avez vu le cri d’alarme lancé par Jean-Christophe Debar, de la FARM (Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde). Car il y a toute une offensive européenne en cours, au nom du Green New Deal, contre la viande, accusée d’être en grande partie responsable des émissions de gaz à effet de serre.
C’est ce que l’on dit… encore faut-il faire des évaluations honnêtes de ces émissions.
On a vu alors des gens sortir leur calculette pour évaluer comment réduire de moitié l’élevage. Face à cela, M. Debar met en garde qu’imposer des baisses de rendement risque d’obliger à doubler les surfaces à cultiver. En gros, cela équivaut à raser les forêts pour faire du bio… Ils se trouvent pris dans leurs propres paradoxes.
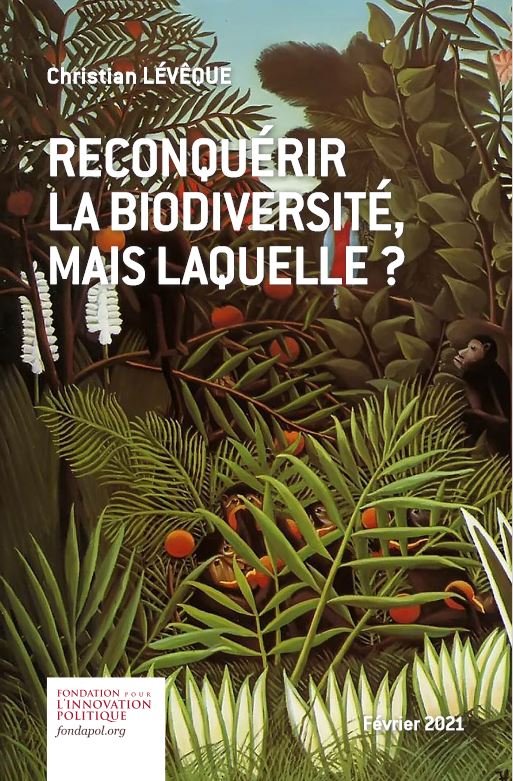
Pour produire la même chose en bio, cela demande 30 à 50 % plus de terres qu’en traditionnel. Je ne défends pas forcément le traditionnel, mais c’est un fait. A partir de là, on peut discuter. On peut certainement faire du bio dans certains endroits, mais dans l’état actuel, le bio est plus consommateur d’espaces. Moi je développe une autre idée. Je vis dans un pays où il y a encore du bocage (zone d’élevage). Eh bien, si l’on supprime la viande, qu’est-ce qu’il va devenir, ce bocage ? Ça va s’emboiser : friche, bois… ou ça va faire de belles zones industrielles pour centres commerciaux, ou des centres de loisirs. Donc, si on mange moins de viande, on va modifier nos paysages et sa biodiversité, ce qui montre la complexité des phénomènes et la limite des raisonnements « y’a qu’à, faut qu’on ».
On veut faire de nos agriculteurs de simples « capteurs de carbone ». Ils ne seront plus rémunérés pour les aliments qu’ils produisent, mais pour leur gestion de champs considérés comme des puits de carbone… La question est de savoir ce qui capte le plus de CO2 : une friche, une forêt ou un champ cultivé ?
Cela dépend des cultures et de ce qu’on intègre comme éléments de calcul. Vous parlez des émissions de gaz à effet de serre. On accuse les vaches.
Cependant, un des grands émetteurs de méthane, ce sont les zones humides… Les « feux follets », vous connaissez ? C’est du méthane. Avec la décomposition de la matière organique, il y a émission de méthane.
Pourtant on protège les zones humides, c’est un grand enjeu de conservation, n’est-ce pas ? Mais personne ne veut parler de la production de méthane par les zones humides… Les ONG montent au créneau quand on leur dit ça.
Ségolène Royal serait mécontente de vous entendre !

C’est pourtant évident. J’ai assisté à une séance de l’Académie de l’agriculture où on a parlé de l’émission de méthane par le rot des vaches. J’ai demandé à quoi ça correspond par rapport aux émissions des zones humides ? Silence… Il existe aussi des données démontrant que le permafrost qui se dégèle émet des quantités considérables de méthane. Il faut dire ces choses. On s’amuse avec le rot des vaches, mais est-ce le fond du problème ? On amuse la galerie, en réalité…
Ne pensez-vous pas qu’il est temps de former à nouveau des écologues et des biologistes prêts à aller sur le terrain pour y faire des relevés, plutôt que de tout miser sur des modélisations informatiques ?
C’est un des grands problèmes de l’écologie actuellement. Récolter des données, aller sur le terrain, ça coûte cher, ce n’est pas valorisant au niveau des publications, et c’est parfois sportif ! Pour ces différentes raisons, l’écologie est en partie devenue une science spéculative. Dans son bureau, on fait de l’écologie théorique sur ordinateur avec des « modèles » et on sort ensuite de grandes théories qui ne sont pas validées par les données de terrain.
Pour moi, l’écologie est avant tout une science d’observation ! le modèle est un outil qui aide à traiter ses informations. Ce n’est pas une fin, et encore moins un moyen de se substituer au terrain. Ou alors on en reste à la vision fixiste de l’écologie et on croit que le vivant se conforme aux théories que l’on a imaginées. Comment prendre en compte la variabilité et les aléas dans des modèles déterministes ? Le modèle auquel on accorde un crédit prédictif est l’antithèse de la démarche adaptative.
Un mot pour conclure ?
A mon sens, il est urgent que « l’écologie » (et pas l’écologisme) fasse sa révolution copernicienne. L’écologie est née autour de l’objectif d’identifier les lois qui régulent la nature.
C’était le but recherché au début du XXe siècle : découvrir les lois de la nature. Avec l’arrière-pensée que si l’on connaissait les lois, on pourrait agir sur la nature. Tout comme on avait trouvé les lois des orbites planétaires et de la gravité avec Copernic et Newton, on espérait trouver des lois définissant le fonctionnement général de la nature. Avec le temps, on s’est aperçu qu’il n’y avait pas (ou très peu) de lois pouvant expliquer le fonctionnement général de la nature, mais beaucoup de situations particulières (la contingence). La seule grande loi est celle qui montre que la distribution des espèces à la surface du globe dépend du climat et de la géomorphologie. A part cela, chaque système écologique est relativement différent et fonctionne d’une manière différente. Il faut donc éviter les généralisations et les globalisations, comme le font les mouvements militants et les ONG lorsqu’ils parlent d’érosion de la biodiversité. On l’a vu à propos de la différence entre les espèces continentales et les espèces insulaires.
Et surtout, il faut se mettre dans la perspective que la nature, ça bouge, ce n’est pas en équilibre, ce n’est pas stable, et que penser la préserver dans des réserves ou à travers des lois normatives, c’est un peu de la fiction.
Ils font la même erreur sur le climat en évoquant une température globale de la planète…
Oui, ils appellent cela la « température moyenne » pour l’ensemble du globe. J’ai dit une fois, par boutade, « qu’est-ce que c’est, cette connerie ? » Ça signifie quoi, une moyenne globale ? On voit bien que ce n’est pas si simple au niveau de la planète. Il y a à la fois des réchauffements et des refroidissements, des canicules et des vagues de froid, etc. Il en est de même pour la biodiversité, elle n’est pas la même partout.
Chaque région a son histoire climatique, géologique et anthropique. On dit que l’écologie est contingente, c’est-à-dire qu’un système écologique est le produit d’une histoire et d’un contexte local. La globalisation masque cette hétérogénéité qui est pourtant la caractéristique du vivant. Chaque système a son mode de fonctionnement, ce qui rend bien entendu difficile les généralisations. Les forêts méditerranéennes ne sont pas les forêts bretonnes, ni les forêts tropicales, et ça ne fonctionne pas de façon identique. La vie, c’est avant tout la diversité et l’hétérogénéité, c’est l’adaptation aux conditions locales…
Cela veut dire que l’écologie doit s’inscrire dans une perspective dynamique et non pas statique. Pour moi, c’est le fond du problème. On manque encore d’outils pour prendre en compte la dynamique des écosystèmes. On manque aussi d’informations sur leur évolution sur le temps long. On a longtemps pensé qu’un système écologique fonctionnait comme une machine dans laquelle toutes les espèces avaient leur rôle. Ce concept que l’on a qualifié de déterministe était pratique, car il donnait l’illusion que l’on pouvait gérer la nature si on en connaissait les lois de fonctionnement.
Depuis, on s’est rendu compte, à la suite des travaux du paléontologue S. Gould, par exemple, et ceux des généticiens, que le hasard jouait un rôle considérable dans la dynamique du vivant. Le vivant n’est pas le monde physique et il n’obéit pas aux mêmes lois.
Mais reconnaître le rôle du hasard (ou des aléas), c’est ouvrir la porte à l’incertitude, et on a du mal à y souscrire car ça rend difficile la prévision. Les gestionnaires sont alors démunis en matière d’anticipation. Mais on continue à faire comme si on pouvait prévoir le futur, avec ces nouveaux astrologues que sont les modélisateurs qui entretiennent l’illusion que le futur est prévisible… et donc maîtrisable !
Il faut dire clairement que l’on ne sait pas prévoir. Il faut le marteler car en réalité, ce que nous pouvons faire de mieux, c’est de nous adapter. C’est cette thématique d’une gestion adaptative qu’il faut promouvoir, bien différente de la gestion normative que nous pratiquons, qui consiste à établir des normes pour appliquer des lois qui n’ont aucune signification dans des systèmes dynamiques.
On en est, hélas, à une sorte de retour à une pensée moyenâgeuse. On fait tout un foin sur la complexité du monde, mais en fin de compte, c’est le rasoir d’Ockham, on adopte un truc simplet.
En effet, le public veut les explications les plus simples possibles. On est resté sur la logique : une cause, un effet. On a du mal à penser que dans un système écologique, un effet peut avoir plusieurs causes qui s’additionnent ou se compensent. On oublie aussi qu’une cause peut mettre beaucoup de temps avant d’avoir un effet. Les sécheresses cumulées sont l’une des causes du dépérissement des arbres.
Comme vous l’avez dit, on cherche des « effets de com’ ». Tout ce qui est ambigu, métaphorique, paradoxal ou réellement hypothétique, est écarté.
La complexité, on a du mal à l’intégrer. C’est pourquoi on opte pour les idées simples et le plus souvent fausses. Il n’est pas évident de résumer des phénomènes aussi complexes que les dynamiques naturelles. Et puis, il faut bien l’admettre, beaucoup de citoyens sont ravis quand on donne dans le catastrophisme. La preuve, c’est que ça marche au niveau du temps d’écoute des émissions radio ou télé. Et les ouvrages de collapsologie se vendent bien.
Soyons plus positifs. Ce qui fait l’intérêt de l’écologie de nos jours, ce n’est pas de faire la liste des notices nécrologiques, mais de redonner une vision positive et opérationnelle des relations homme-nature. Sans nier, bien évidemment, qu’elles ne sont pas toujours très cordiales, on doit aussi reconnaître que dans certaines régions du monde, les hommes ont co-construit une nature qui répond à leurs besoins de sécurité physique et alimentaire.
Et cette nature à l’exemple de celle que nous connaissons en Europe, n’est pas pour autant un champ de ruines. Ce n’est pas en stigmatisant continuellement le rôle de l’homme et en prédisant l’apocalypse que l’on mobilisera les citoyens. Il faut redonner de l’espoir, réenchanter la nature, comme le disait Serge Moscovici.
Et l’écologie scientifique doit apporter son concours à la reconstruction de rapports moins dogmatiques avec la nature, en montrant qu’il y a aussi des « lendemains qui chantent ». Ce qui suppose de réviser sérieusement les concepts fondateurs et de s’affranchir des discours militants basés sur des considérations idéologiques.
Je retiens votre image d’« indulgence verte ». D’ailleurs, lorsqu’on regarde les formulaires de don de certaines ONG militantes, on constate qu’ils vous demandent de leur léguer votre héritage. On culpabilise les gens à mort, et ensuite, pour pouvoir accéder au paradis par un petit chemin vert, ils vous disent « confiez-nous votre fortune ».
Il serait intéressant de savoir comment fonctionnent réellement ces organisations qui prétendent défendre la nature. Ce sont des multinationales qui brassent beaucoup d’argent. Ce que je sais, c’est que le niveau des rémunérations que touchent les milliers de « spécialistes » et d’employés de ces grands organismes sont supérieurs aux salaires des scientifiques français.
Il y a un combat d’idées à mener, et nous sommes très content que vous le meniez. Nous essayons, nous, de notre côté, d’y apporter notre pierre.

C’est un combat qu’on ne peut pas mener tout seul. Discuter de la doxa dominante est compliqué, on a du mal à se faire entendre, on a l’impression de ne pas être écouté. Mais on s’aperçoit aussi que les lignes commencent à bouger.
Ainsi, j’ai participé par visioconférence à une réunion du Sénat sur la « continuité écologique » des rivières en France.
Je vous rappelle qu’il y a quelques années, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et l’Office français de la biodiversité (OFB) avaient décidé que pour restaurer l’état écologique des rivières françaises, il fallait détruire tous les « seuils » [3], c’est-à-dire détruire tous les moulins, en quelque sorte. En clair, éliminer toutes les constructions qui pouvaient entraver la circulation de l’eau des rivières, afin de permettre à certaines espèces (en réalité une poignée) de remonter le cours de la rivière pour se reproduire.
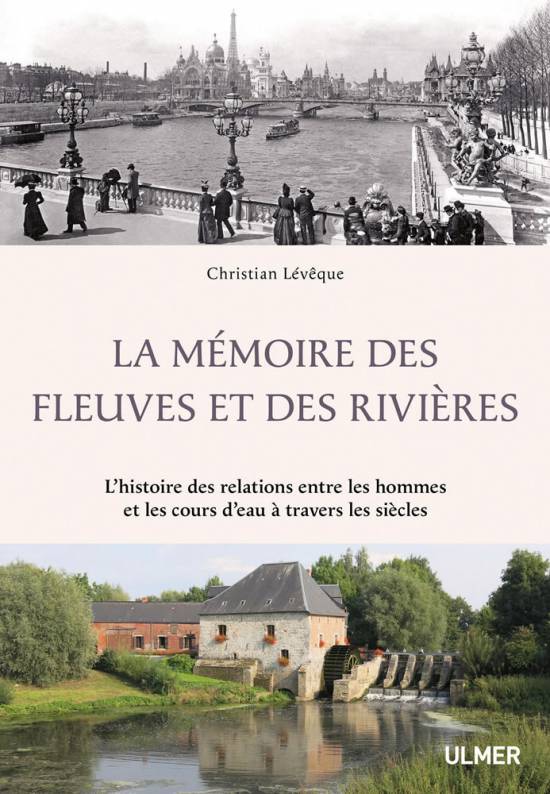
Il y a eu pas mal d’actions très contestées et les propriétaires de moulins ont beaucoup manifesté. On est ici typiquement confronté à la fausse bonne idée, car la raréfaction des poissons migrateurs dans nos cours d’eau résulte de multiples causes, comme nous l’avons vu plus haut, notamment la qualité de l’eau, mais aussi l’endiguement des cours.
Avec un collègue géographe et d’autres auteurs, nous avons écrit un livre sur la restauration écologique des rivières, qui est paru l’année dernière.
Apparemment, cela a fait bouger un peu les lignes et on est en train d’évoluer vers l’abandon de ces mesures technocratiques consistant à supprimer systématiquement tous les seuils, qui, en outre, ne semblent pas donner les résultats escomptés mais détruisent un patrimoine. Il faut voir les choses au cas par cas et discuter de mesures alternatives avec les propriétaires. Il y a des politiques qui commencent à évoluer.
Je ne suis donc pas pessimiste, ce qui m’encourage à poursuivre ce combat d’idées.
NOTES:
- En 1971, lors d’une conférence à Ramsar, en Iran, 18 pays ont signé une convention sur la protection des zones humides, « importantes, en raison des fonctions écologiques et hydrologiques qu’elles remplissent, pour la conservation de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine ».
- Au Moyen Âge, l’Église catholique permettait à ses fidèles d’acheter en argent bien sonnant des indulgences, lesquelles devaient réduire, selon le montant accumulé, le temps qu’on devait passer au purgatoire après sa mort pour expier ses péchés. C’était fort commode pour les vilains qui avaient les moyens de s’offrir un peu plus de péchés que la moyenne. Bien avant Luther, l’humaniste Erasme de Rotterdam fut le premier à s’insurger contre cette pratique. KV.
- Le mot « seuil » désigne tout ouvrage fixe ou partiellement mobile, construit dans le lit mineur d’un cours d’eau et qui le barre en partie ou en totalité. On en recense plus de 60 000 en France.
La paix de Westphalie, une réorganisation financière mondiale

par Karel Vereycken, Paris, France.

En 1648, après cinq ans de négociations, conduites notamment par le diplomate français Abel Servien sur les instructions du Cardinal Mazarin, était signée la « Paix de Westphalie » mettant fin à la guerre de Trente Ans. Bien avant la charte de l’ONU, 1648 fera de la souveraineté nationale, du respect mutuel et du principe de non-ingérence les fondements du droit international. La République des Pays-Bas et la Confédération helvétique sont reconnues et de nombreux traités bilatéraux de paix mettent fin aux conflits.
Mais ce n’est pas tout. Un lecteur attentif de ces traités de paix découvre que l’engagement de chacune des parties, qui consiste à prendre en considération « l’avantage d’autrui » autant, sinon plus, que le sien, se traduit par des actes concrets jetant les bases d’un nouvel ordre financier et économique international.
L’article 1 énonce le principe philosophique fondamental sur lequel repose la paix :
Qu’il y ait une paix chrétienne et universelle, et une amitié perpétuelle, vraie et sincère, entre [liste des parties renonçant au combat] ; et que cette paix et cette amitié soient observées et promues avec une telle sincérité et un tel zèle, que chaque partie s’efforce de procurer le bénéfice, l’honneur et l’avantage d’autrui ; et qu’ainsi, de tous côtés, ils puissent voir cette paix et cette amitié dans l’Empire romain, et le Royaume de France prospérer, en entretenant un bon et fidèle voisinage.
L’article 2 décrit ensuite le type de « réinitialisation » dont nous avons si urgemment besoin aujourd’hui :
Il y aura d’un côté et de l’autre un oubli, une amnistie ou un pardon perpétuel de tout ce qui a été commis depuis le début de ces troubles, en quelque lieu ou de quelque manière que les hostilités aient été pratiquées, de telle sorte qu’aucun acteur, sous quelque prétexte que ce soit, ne puisse pratiquer aucun acte d’hostilité, entretenir aucune inimitié ou causer aucun trouble ; (…) tout ce qui s’est passé d’un côté et de l’autre, aussi bien avant que pendant la guerre, en paroles, écrits et actions outrageantes, en violences, hostilités, dommages et dépenses, sans aucun respect pour les personnes ou les choses, sera entièrement aboli de telle sorte que tout ce qui pourrait être exigé ou prétendu par l’un et l’autre à ce sujet sera enseveli dans un oubli éternel.
Pendant des décennies, la plupart des belligérants de la guerre de Trente Ans se sont mutuellement infligés des dommages inouïs, essentiellement pour pouvoir rembourser leurs dettes avec le butin de leurs pillages et de leurs conquêtes, afin de satisfaire une minuscule oligarchie financière qui prêtait aussi généreusement aux uns qu’aux autres. C’est cet asservissement par la dette que le traité propose d’« ensevelir dans un oubli éternel ».
Ainsi, avant même de régler les disputes et les revendications territoriales, le traité s’attelle à créer les conditions mettant fin à la ruine financière dans laquelle tous se trouvaient plongés.
Les dettes, intérêts, obligations, rentes et créances financières impayables, insoutenables et illégitimes, explicitement identifiés comme alimentant une dynamique de guerre perpétuelle, sont examinés, triés et réorganisés, le plus souvent par l’annulation des dettes (articles 13 et 35, 37, 38 et 39), par des moratoires ou un rééchelonnement selon des échéanciers précis (article 69).
L’article 40 conclut que ces annulations s’appliqueront « à la réserve toutefois des sommes de deniers, qui durant la guerre ont été fournies de bon cœur et à bonne intention pour d’autres, afin de détourner les plus grands périls et dommages dont ils étoient menacez. » (Impliquant que ces dettes devront être honorées.)
Enfin, regardant vers l’avenir et pour faire en sorte que « le commerce refleurisse », le traité abolit de nombreux péages et octrois « inusités » et « privés », obstacles aux échanges des biens physiques et des savoirs-faire et donc du développement mutuel. (Art. 69).
Dans le texte :
- Art. 13 : « Le Seigneur Électeur de Bavière renoncera entièrement pour lui, ses héritiers et successeurs à la dette de treize millions, et à toute prétention sur la haute Autriche, et incontinent après la publication de la paix donnera à sa Majesté Impériale les actes obtenus sur cela pour être cassez et annullez. »
- Art. 35 : « La pension annuelle que le bas Marquisat avoit accoutumé de payer au haut Marquisat, soit en vertu du présent Traité entièrement supprimée, abolie et annullée, sans que doresnavant on puisse prétendre ou exiger pour ce sujet aucune chose, ni pour le passé, ni pour l’avenir. »
- Art. 37 : « Que les contracts, échanges, transactions, obligations, et promesses illicitement extorquez par force ou par menaces des États ou des sujets, (…) comme aussi les actions rachetées et cédées soient abolies et annullées ; en sorte qu’il ne sera permis à personne d’intenter aucun procès ou actions pour ce sujet. »
- Art. 38 : « Que si les débiteurs ont extorqué des créanciers par force ou par crainte les actes de leurs obligations, tous ces actes seront restituez, les actions sur ce demeurant en leur entier. »
- Art. 39 : « Que si l’une ou l’autre des parties qui sont en guerre, ont extorqué par violence, en haine des créanciers, des dettes causées pour achat, pour vente, pour revenus annuels, ou pour quelqu’autre cause que ce soit, il ne sera décerné aucune exécution contre les débiteurs qui allégueront, et s’offriront de prouver qu’on leur aura véritablement fait violence, et qu’ils ont payé réellement et de fait, si non après que ces exceptions auront été décidées en pleine connoissance de cause. Que le procès qui sera sur ce commencé, sera fini dans l’espace de deux ans à compter dez la publication de la paix, faute de quoi il sera imposé perpétuel silence aux débiteurs contumax. »
- Art. 40 : « Mais les procès qui ont été jusques-ici intentés contre eux de cette sorte ; ensemble les transactions, et les promesses faites pour la restitution future des créanciers, seront abolies et annullez ; à la réserve toutefois des sommes de deniers, qui durant la guerre ont été fournies de bon cœur et à bonne intention pour d’autres, afin de détourner les plus grands périls et dommages dont ils étoient menacez. »
- Art. 68 : « Quant à la recherche d’un moyen équitable et convenable, par lequel la poursuite des actions contre les débiteurs ruinez par les calamitez de la guerre, ou chargez d’un trop grand amas d’intérêts, puisse être terminée avec modération, pour obvier à de plus grans inconveniens qui en pourroient naître, et qui seroient nuisibles à la tranquillité publique, Sa Majesté Imperiale aura soin (…) »
- Art. 69 : « Et d’autant qu’il importe au public que la paix étant faite, le commerce refleurisse de toutes parts on est convenu à cette fin que les tributs, et péages, comme aussi les abus de la bulle Brabantine et les représailles et arrêts qui s’en seront ensuivis, avec les certifications étrangères, les exactions, les détentions, de même les frais excessifs des postes, et toutes autres charges, et empêchemens inusitez du commerce et de la navigation qui ont été nouvellement introduits à son préjudice et contre l’utilité publique çà et là dans l’Empire, à l’occasion de la guerre, par une authorité privée, contre tous droits et privilèges, sans le consentement de l’Empereur et des Électeurs de l’Empire, seront tout-à-fait ôtez ; en sorte que l’ancienne sûreté, la jurisdiction et l’usage tels qu’ils ont été longtemps avant ces guerres, y soient rétablis et inviolablement conservez aux Provinces, aux ports et aux rivières. »