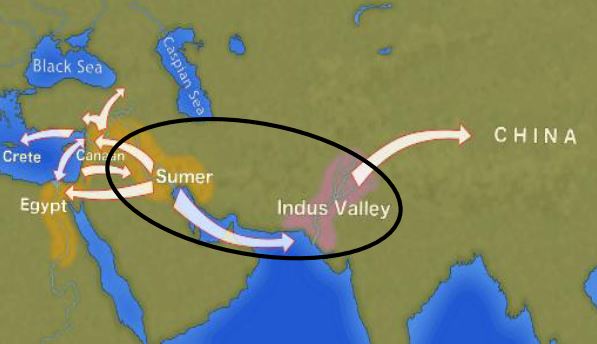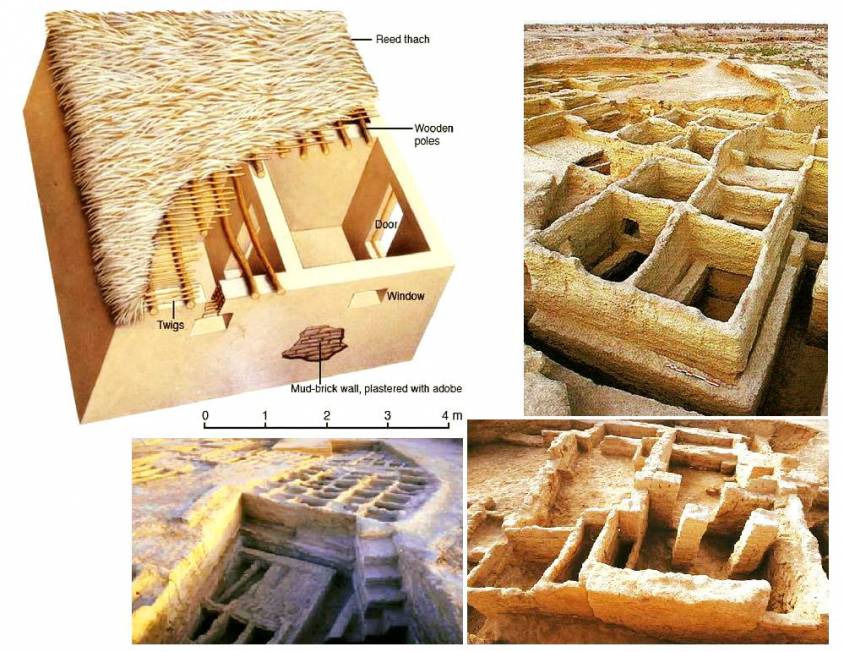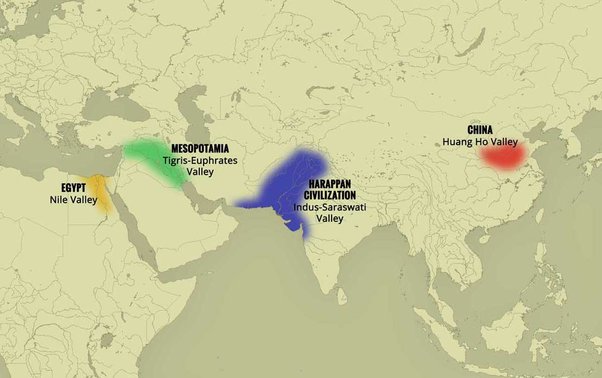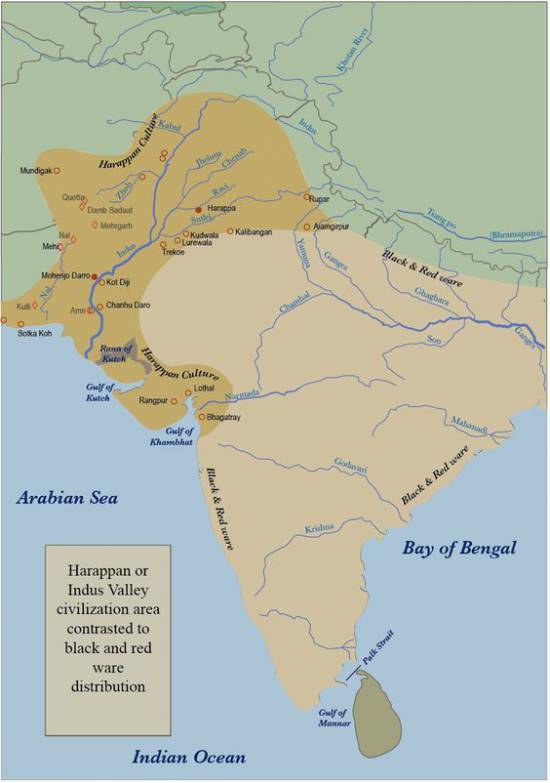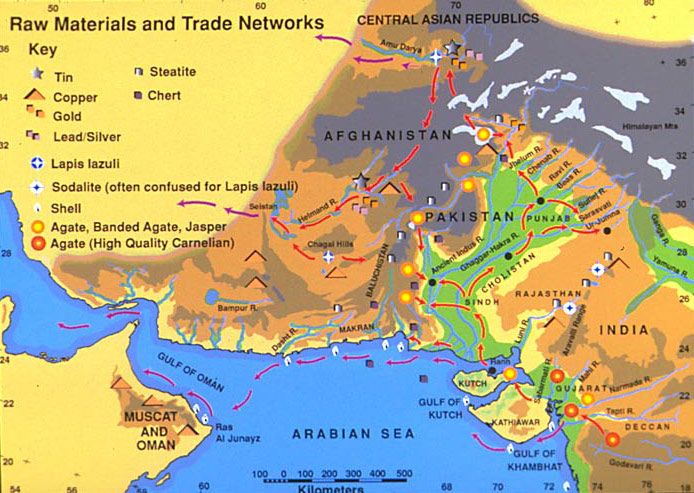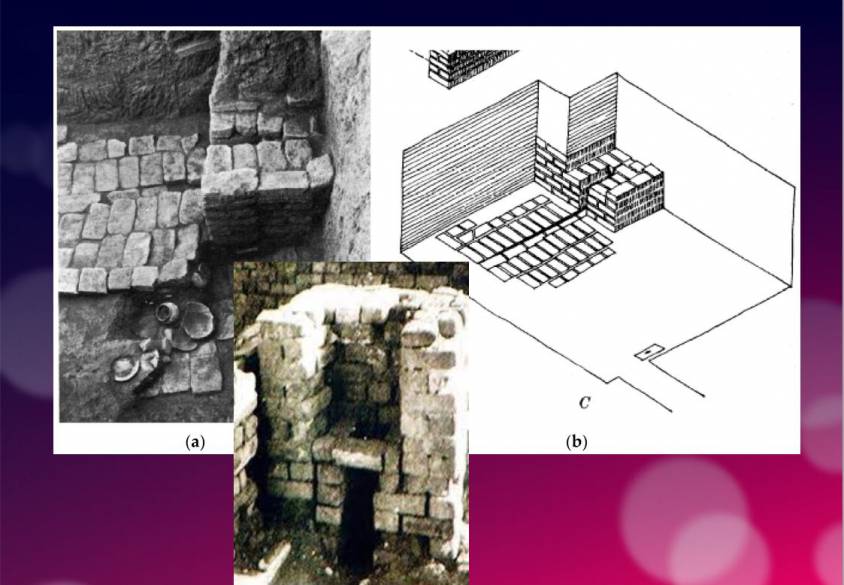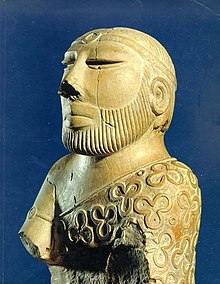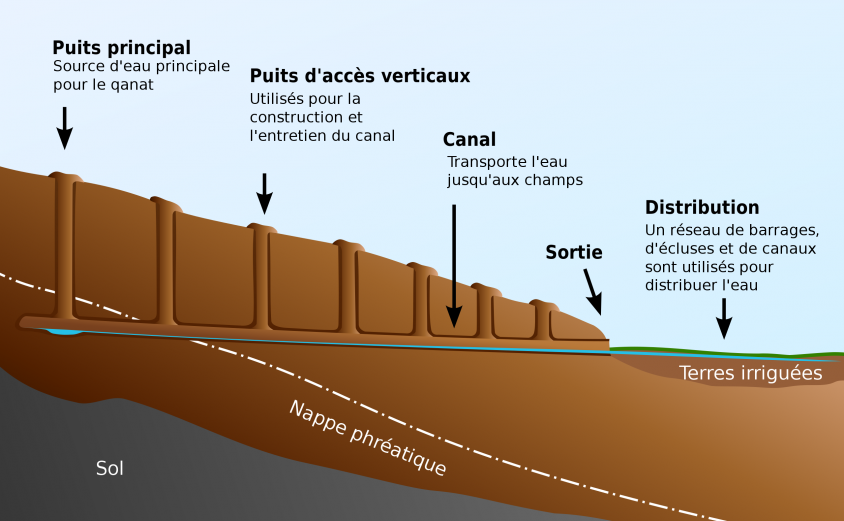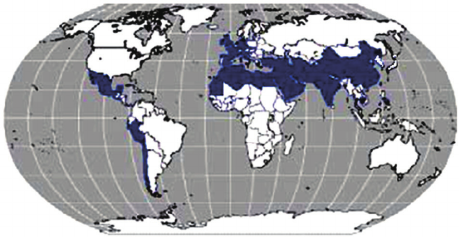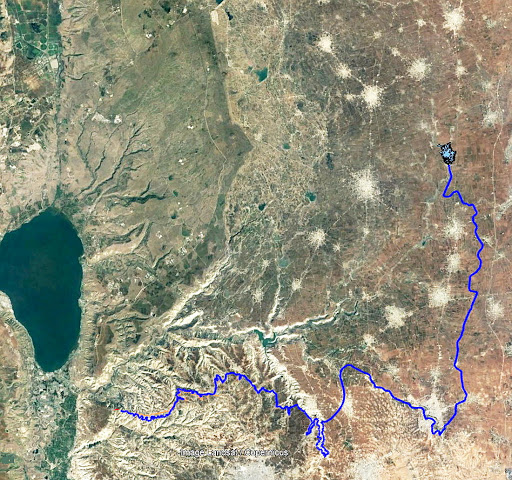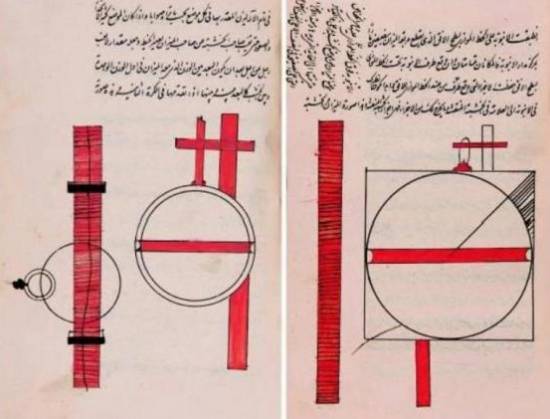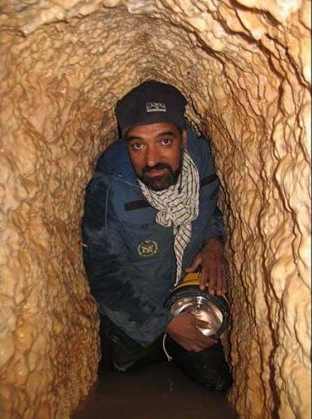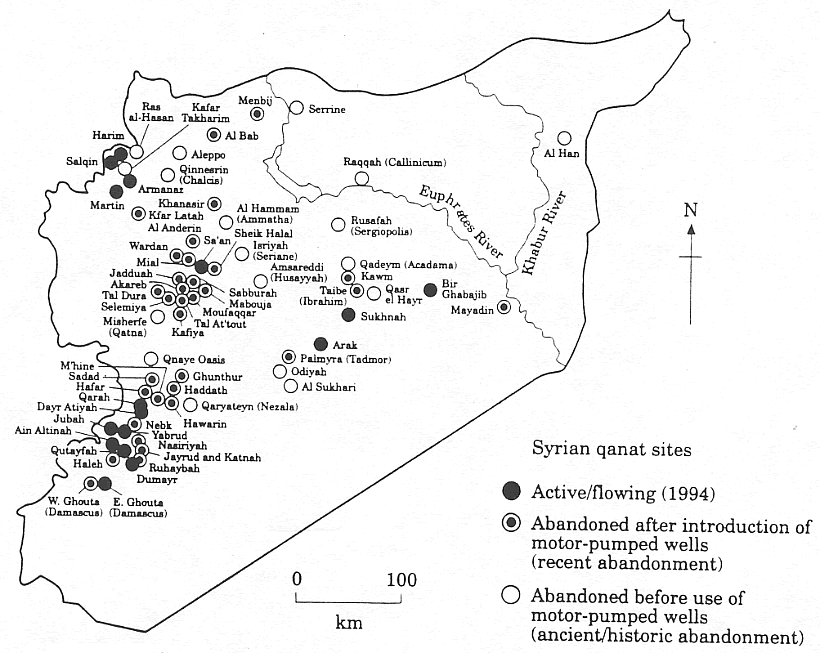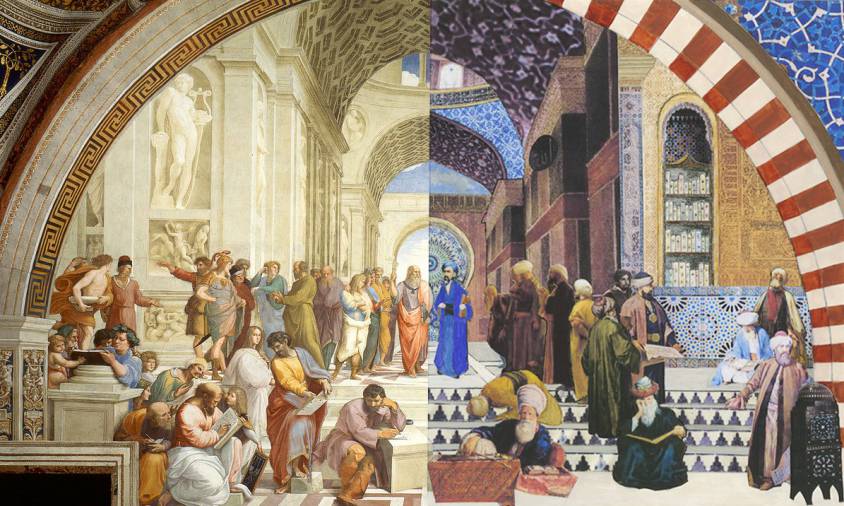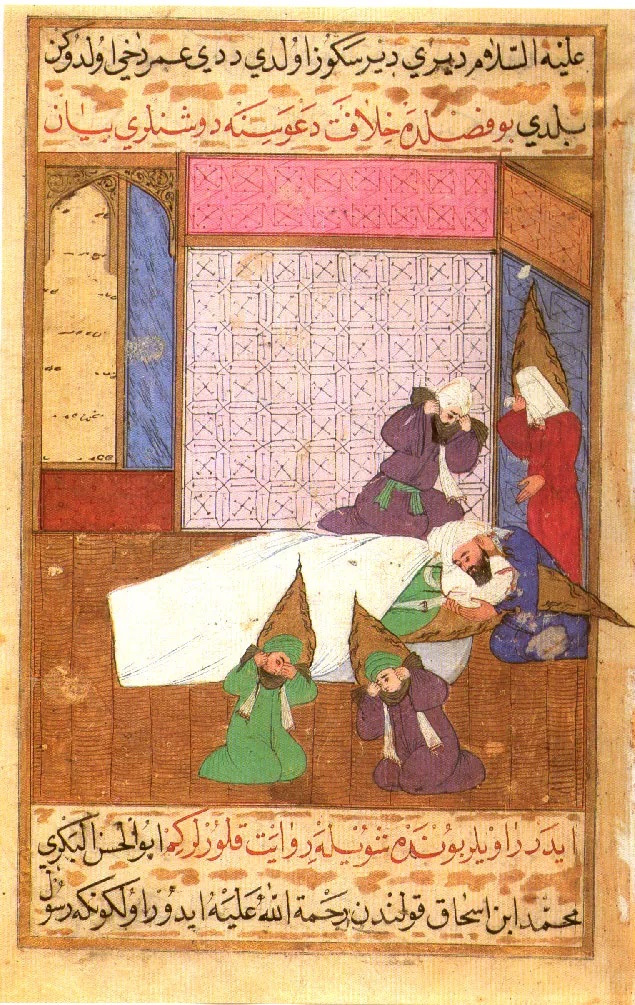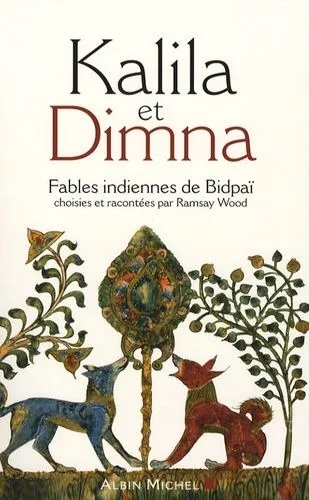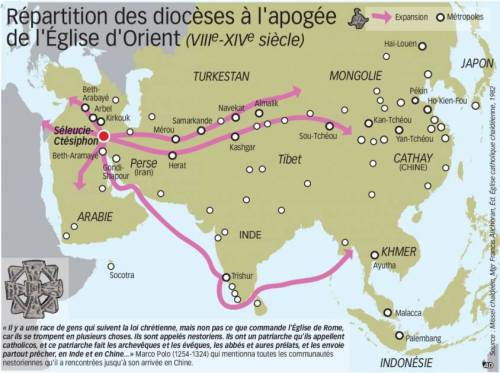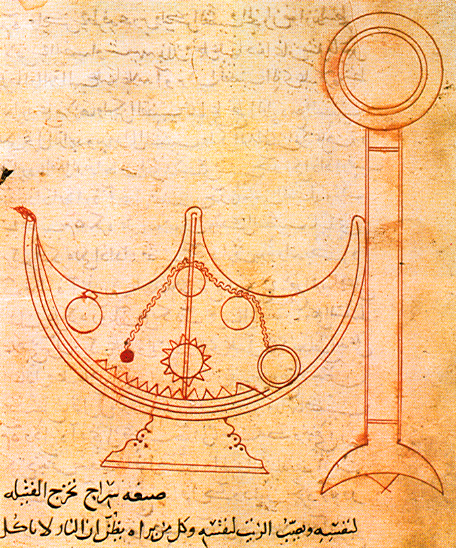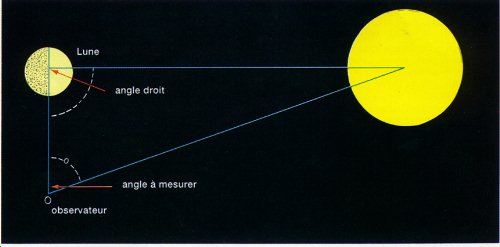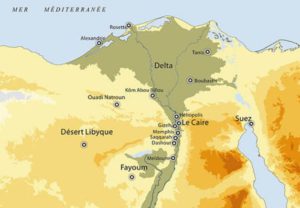Étiquette : Egypte
The science of Oases, from the Indus Valley to Persian qanats


Presentation of Karel Vereycken at the first panel discussion of the « Water for Peace » seminar organized by the Schiller Institute on January 9, 2024 in Paris.

While the dog was domesticated as early as 15,000 years BC, we associate the first human activities aimed at managing water with the Neolithic period, which began around 10,000 BC.
It is thought to be the moment at which mankind moved from a « tribal subsistence economy of hunter-gatherers » to agriculture and animal husbandry, giving rise to villages and cities, where pottery, weaving, metallurgy and the arts would start blooming.
Key to this, the domestication of animals. The goat was domesticated around 11,000 BC, the cow around 9,000 BC, the sheep around -8,000 BC, and finally the horse around 2,200 BC in the steppes of Ukraine.

The oldest archaeological sites showing agricultural activities and irrigation techniques were discovered in the Indus Valley and the « Fertile Crescent ».
The site of Mehrgarh, in the Indus Valley, now Pakistan Balochistan, discovered in 1974 by François and Cathérine Jarrige, two French archaeologists, demonstrates important agricultural practices from 7000 BC onward.
Cotton, wheat and barley were grown, and beer was brewed. Cattle, sheep and goats were raised. But Mehrgarh was much more than that.

Contradicting the linear « developmental » schema, since we’re in the middle of the Neolithic, Mehrgarh is also home to the oldest pottery in South Asia and, above all, to the “Mehrgahr amulet”, the oldest bronze object casted with the « lost-wax » method.
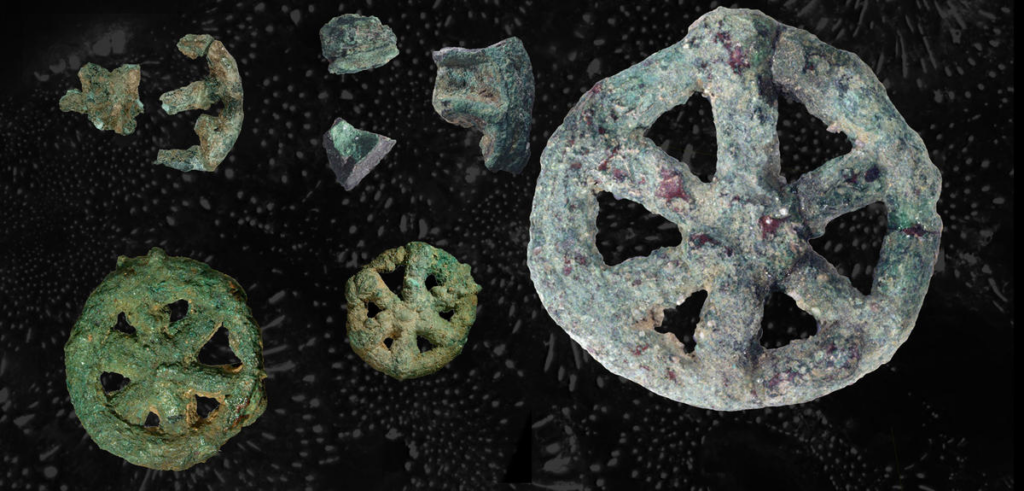
The first seals made of terracotta or bone and decorated with geometric motifs were found here.
On the technological side, tiny bow drills were used, possibly for dental treatment, as evidenced by the pierced teeth of some skeletons found on site.
At the same time, or shortly afterwards, around 6000 B.C., Mesopotamia, between the Tigris and Euphrates rivers, witnessed rapid urban development in terms of demographics, institutions, agriculture, techniques and trade.
A veritable « fertile crescent » emerged in the region stretching from Sumer to Egypt, passing through the whole of Mesopotamia and the Levant, i.e. Syria and the Jordan Valley.
Irrigation
Whether in the Indus Valley, Mesopotamia or Egypt, the earliest irrigation techniques are nothing but retaining as much water as possible when Mother Nature has the sweet kindness to offer it to mankind.
Rainwater was collected in cisterns and, as much as possible, when snowmelt or monsoon rains swell the rivers, the objective was to amplify and steer seasonal « flooding » by canals and trenches carrying the water as far away as possible to areas to be cultivated, while at the same time protecting crops.
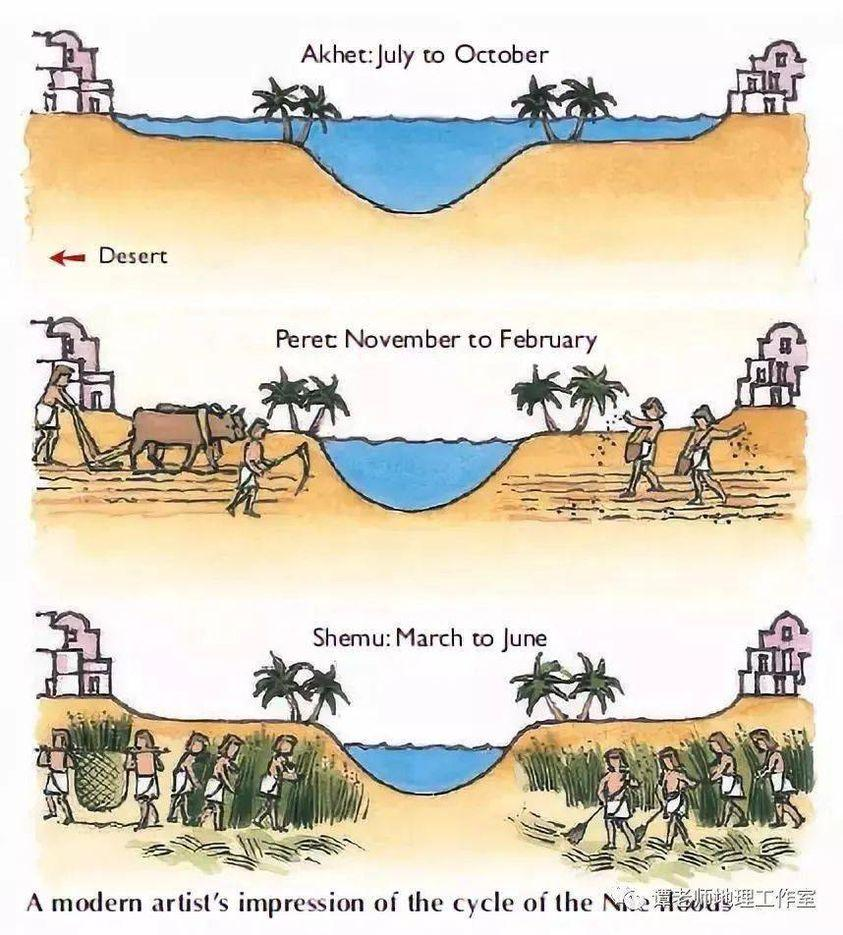
In Egypt, for example, where the Nile rises by around 8 meters, the water brings not only moisture but also silt to the soil near the river, providing crops with the nutrients they need to grow and thus maintain the soil’s fertility.
While the Egyptians complained about the harsh labor condition of their farmers, for the Greek historian Herodotus, this was the place in the world where work was least arduous. Of Egypt he says:
“Its soil is black and crumbly, made of silt and alluvium brought from Ethiopia by the river. Certainly, these people are today, of all the human race in Egypt as elsewhere, those who go to the least trouble to obtain their crops.
« They don’t bother to plough and weed. When the river has come of its own accord to water their fields and, its task done, has withdrawn, each man sows his land and lets the pigs loose: by trampling, the beasts sink the seeds into the earth, and the man has only to wait for the harvest.”
In Mehrgarh, where agriculture was born from 7000 BC, the work was indeed far more demanding.
However, the drainage system around the village and the rudimentary dams to control water-logging indicate that the inhabitants understood most of the basic principles involved. The cultivation of cotton, wheat and barley, as well as the domestication of animals, show that they were also familiar with canals and irrigation systems.
Constantly refined, this know-how enabled the civilization of the Indus Valley to create great cities that impress us by their modernity, notably Harappa and Mohenjo Daro, a city of 40,000 inhabitants with a public bath in its center, not a palace.

Pioneers of modern hygiene, these towns were equipped with small containers where residents could deposit their household waste.
Anticipating our « all-to-the-sewer » systems imagined in the early XVIth century by Leonardo da Vinci, for example in his plans for the new french capital of Romorantin, many towns had public water supplies as well as an ingenious sewage system.
In the port city of Lothal (now India), for example, many homes had private brick bathrooms and latrines. Wastewater was evacuated via a communal sewage system leading either to a canal in the port, or to a soaking pit outside the city walls, or to buried urns equipped with a hole for the evacuation of liquids, which were regularly emptied and cleaned.
Excavations at the Mohenjo Daro site reveal the existence of no fewer than 700 brick wells, houses equipped with bathrooms and individual and collective latrines.
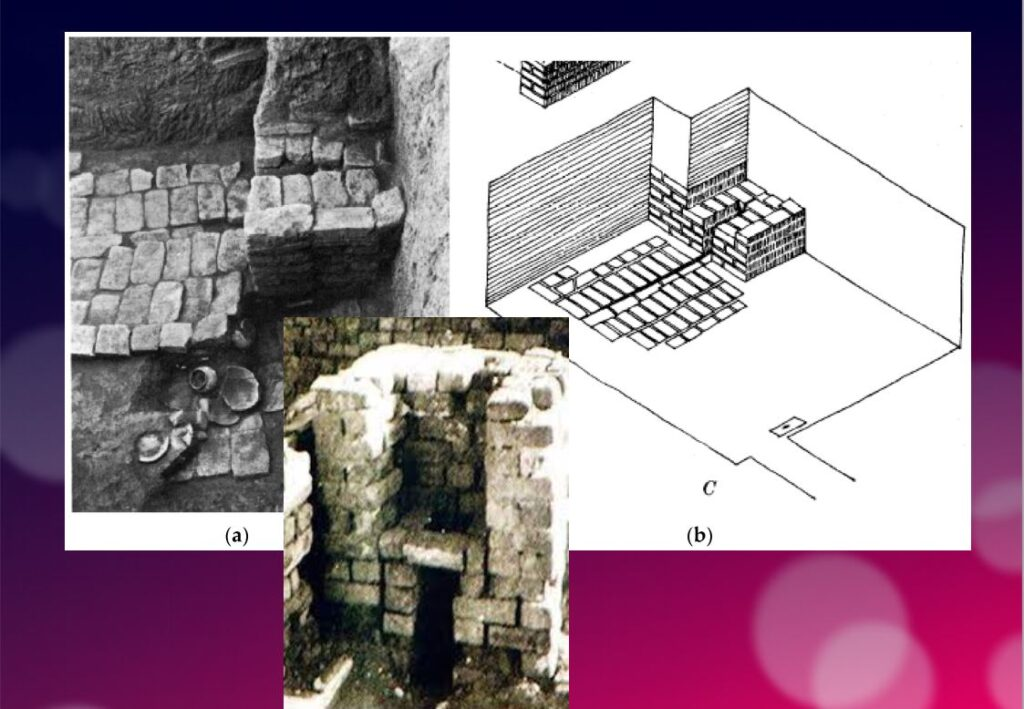
Many of the city’s buildings had two floors or more. Water trickled down from cisterns installed on the roofs was channeled through closed clay pipes or open gutters that emptied into the covered sewers beneath the street.

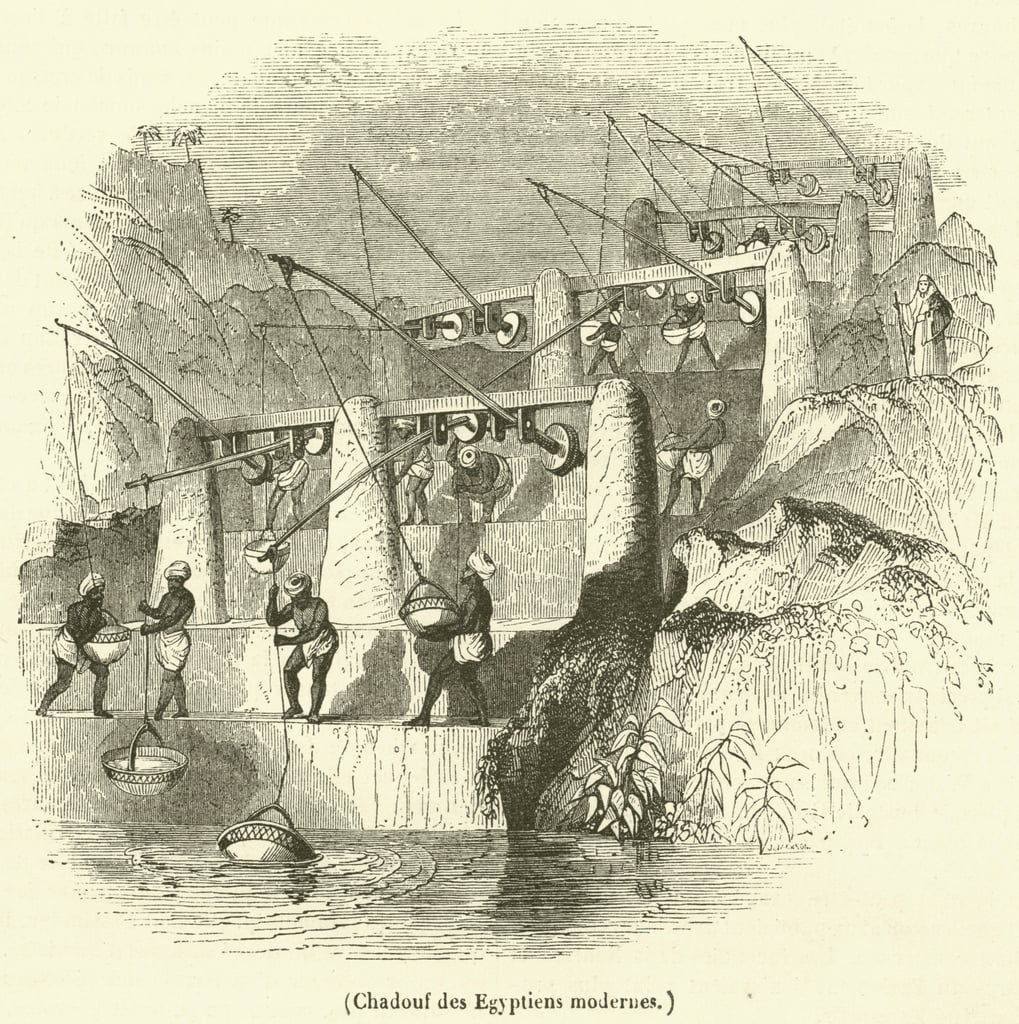
This hydraulic and sanitary know-how was passed on to the civilization of Crete, the mother of Greece, before being implemented on a large scale by the Romans.
It was forgotten with the collapse of the Roman Empire, only to return during the Renaissance.

The first human contributions were aimed at maximizing water reservoirs and their gravity-flow capacity. To achieve this, it was necessary to transfer water from a lower level to higher ground and build « water towers ».
To this end, the Mesopotamian « chadouf » was widely used in Egypt, followed by the « Archimedean screw ».
Next came the « saquia » or « Persian wheel », a geared wheel driven by animal power, and finally the « noria », the best-known water-drawing machine, powered by the river itself.
Persian qanats
Before Alexander the Great, Persia’s Achaemenid Empire (6th century BC) developed the technique of underground qanats or underground aqueducts. This « draining gallery” cut into the rock or built by man, is one of the most ingenious inventions for irrigation in arid and semi-arid regions.
Whatever displeases our environmentalist friends, it’s not nature that magically produces « oases » in the desert.
It’s a scientific man who digs a drainage gallery from a water table close enough to the ground surface, or sometimes from an aquifer that flows into the desert.
On the website of ArchéOrient, archaeologist Rémy Boucharlat, Director of Emeritus Research at the French CNRS, an expert on Iran, explains:
« Whatever the origin of the water, deep or shallow, the gallery construction technique is the same. The first step is to identify the presence of the water, either its underflow near a river, or the presence of a deeper water table on a foothill, which requires the science and experience of specialists.
A motherwell reaches the upper part of this layer or water table, which indicates the depth at which the gallery should be dug. The slope of the gallery must be very shallow, less than 2‰, to ensure a calm and regular flow of water, and to gradually lead the water to the surface, at a gradient much lower than the slope of the piedmont.
The gallery is then excavated, not from the mother well, as it would be flooded immediately, but from downstream, from the arrival point. The pipe is first dug as an open trench, then covered, and finally gradually tunnelled into the ground.
Shafts are dug from the surface at regular intervals, between 5 and 30 m depending on the nature of the terrain, to evacuate soil and provide ventilation during excavation, and to mark the direction of the tunnel.”
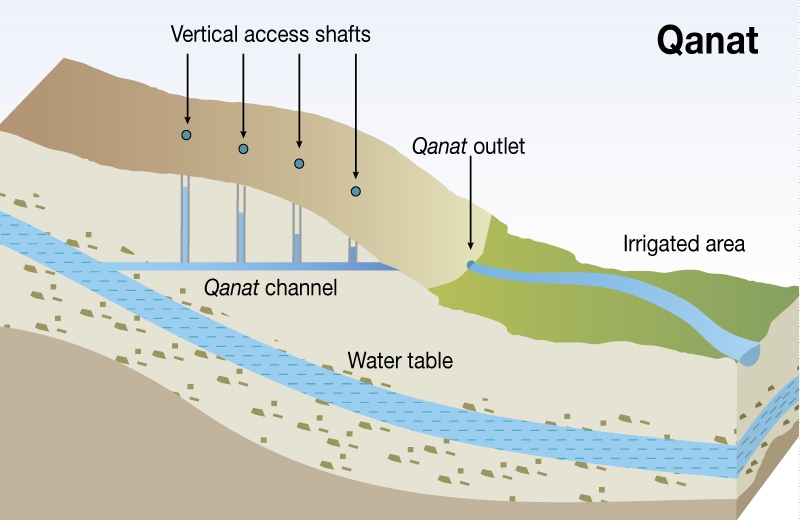
Historically, the majority of the populations of Iran and other arid regions of Asia and North Africa depended on the water supplied by qanats; settlement areas thus corresponded to the places where their construction was possible.
The technique offers a significant advantage: as the water moves through an underground conduit, not a drop of water is lost through evaporation.
This technique spread throughout the world under various names: qanat and kareez in Iran, Syria and Egypt, kariz, kehriz in Pakistan and Afghanistan, aflaj in Oman, galeria in Spain, kahn in Balochistan, kanerjing in China, foggara in North Africa, khettara in Morocco, ngruttati in Sicily, bottini in Siena, etc.).
Improved by the Greeks and amplified by the Etruscans and the Romans, the qanats technique was carried by the Spaniards across the Atlantic to the New World, where numerous underground canals of this type still operate in Peru, Chile and western Mexico.
After Alexander the Great, Bactria, covering parts of today’s Uzbekistan, Turkmenistan and the northern part of Afghanistan, was even known as the « Oasis civilization » or the “Land of a 1000 Golden Cities”.
Iran boasts it had the highest number of qanats in the world, with approximately 50,000 qanats covering a total length of 360,000 km, about 9 times the circumference of the Earth !
Thousands of them are still operational but increasingly destabilized by erratic well digging and demographic overconcentration.
Shared responsability
In 1017, the Baghdad-based hydrologist Mohammed Al-Karaji provided a detailed description of qanat construction and maintenance techniques, as well as legal considerations about the collective management of wells and pipes.
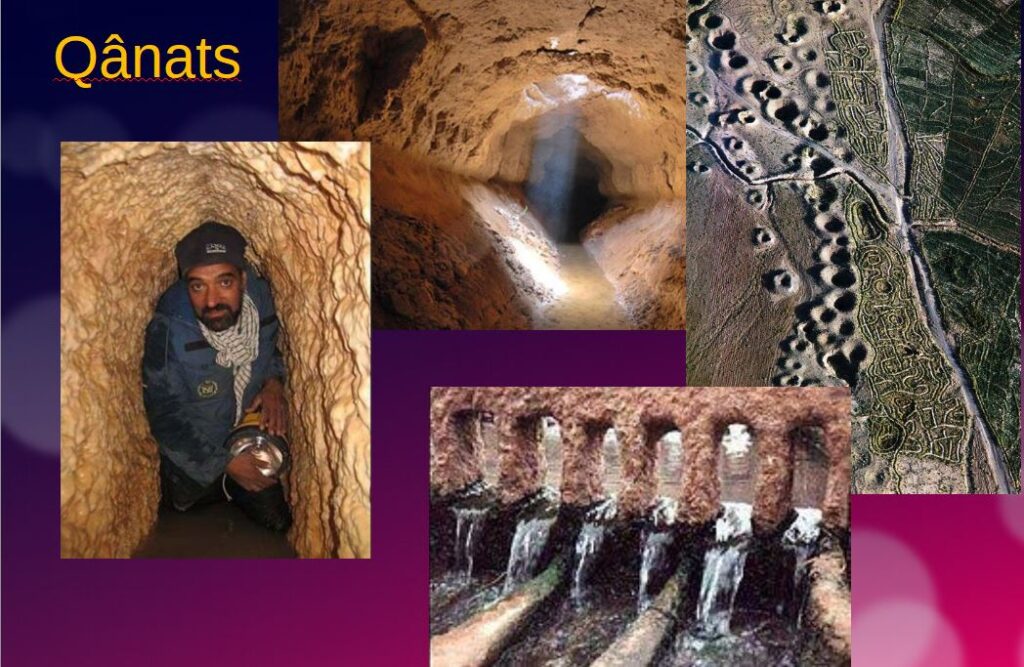
While each qanat is designed and supervised by a mirab (dowser-hydrologist and discoverer), building a qanat is a collective task that takes several months or years for a village or group of villages. The absolute necessity of collective investment in the infrastructure and its maintenance calls for a superior notion of the common good, an indispensable complement to the notion of private property that rains and rivers are not accustomed to respecting.
In North Africa, the management of water distributed by a khettara (the local name for qanâts) is governed by traditional distribution norms known as « water rights ».
Originally, the volume of water granted per user was proportional to the work involved in building the khettara, and translated into an irrigation period during which the beneficiary could use all the khettara’s flow for his or her fields. Even today, when the khettara has not dried up, this rule of water rights still applies, and a share can be bought or sold. The size of each family’s fields to be irrigated must also be taken into account
All of this demonstrates that good cooperation between man and nature can do miracles if man decides so.
Thank you for your attention and questions welcome!

How Jacques Cœur put an end to the Hundred Years’ War


has much to inspire us today.
Without waiting for the end of the Hundred Years’ War (1337-1453), Jacques Cœur, an intelligent and energetic man of whom no portrait or treatise exists, decided to rebuild a ruined, occupied and tattered France.
Not only a merchant, but also a banker, land developer, shipowner, industrialist and master of mines in Forez, Jacques Coeur was a contemporary of Joan of Arc (1412-1431), who lived in 1429 in Coeur’s native city of Bourges.

First and foremost, he entered into collaboration with some of the humanist popes of the Renaissance, patrons of the scientific genius Nicolaus Cusanus and the painter Piero della Francesca. With Europe threatened with implosion and chaos, their priority was to put an end to interminable warfare and unify Christendom.
Secondly, following in the footsteps of Saint-Louis (King Louis IX), Cœur was one of the first to fully assume France’s role as a naval power. Finally, thanks to an intelligent foreign exchange policy and by taking advantage of the maritime and overland Silk Roads of his time, he encouraged international trade. In Bruges, Lyon and Geneva, he traded silk and spices for cloth and herring, while investing in sericulture, shipbuilding, mining and steelmaking.
Paving the way for the reign of Louis XI, and long before Jean Bodin, Barthélémy de Laffemas, Sully and Jean-Baptiste Colbert, his mercantilism heralded the political economy concepts later perfected by the German-American economist Friedrich List or the first American Secretary of the Treasury, Alexander Hamilton.
We will concentrate here on his vision of man and economy, leaving aside important subjects such as the trial against him, his relationship with Agnès Sorel and Louis XI, to which many books have been dedicated.

Jacques Cœur (1400-1454) was born in Bourges, where his father, Pierre Cœur, was a merchant pelletier. Of modest income, originating from Saint-Pourçain, he married the widow of a butcher, which greatly improved his status, as the butchers’ guild was particularly powerful.
The Hundred Years’ War

The early XVth century was not a particularly happy time. The « Hundred Years’ War » pitted the Armagnacs against the Burgundians allied with England. As with the great systemic bankruptcy of the papal bankers in 1347, farmland was plundered or left fallow.
While urbanization had thrived thanks to a productive rural world, the latter was deserted by farmers, who joined the hungry hordes populating towns lacking water, hygiene and the means to support themselves. Epidemics and plagues became the order of the day; cutthroats, skinners, twirlers and other brigands spread terror and made real economic life impossible.
Jacques Cœur was fifteen years old when one of the French army’s most bitter defeats took place in France. The battle of Agincourt (1415) (Pas-de-Calais), where French chivalry was routed by outnumbered English soldiers, marked the end of the age of chivalry and the beginning of the supremacy of ranged weapons (bows, crossbows, early firearms, etc.) over melee (hand-to-hand combat). A large part of the aristocracy was decimated, and an essential part of the territory fell to the English. (see map)
King Charles VII

In 1418, the Dauphin, the future Charles VII (1403-1461), as he is known thanks to a painting by the painter Jean Fouquet, escaped capture when Paris was taken by the Burgundians. He took refuge in Bourges, where he proclaimed himself regent of the kingdom of France, given the unavailability of his insane father (King Charles VI), who had remained in Paris and fallen to the power of John the Fearless, Duke of Burgundy.
The dauphin probably instigated the latter’s assassination on the Montereau bridge on September 10, 1419. By his ennemies, he was derisively nicknamed « the little King of Bourges ». The presence of the Court gave the city a boost as a center of trade and commerce.
Considered one of the most industrious and ingenious of men, Jacques Coeur married in 1420 Macée de Léodepart, daughter of a former valet to the Duke of Berry, who had become provost of Bourges.
As his mother-in-law was the daughter of a master of the mints, Jacques Coeur’s marriage in 1427 left him, along with two partners, in charge of one of the city’s twelve exchange offices. His position gave rise to much jealousy. After being accused of not respecting the quantity of precious metal contained in the coins he produced, he was arrested and sentenced in 1428, but soon benefited from a royal pardon.
Yolande d’Aragon

Although the Treaty of Troyes (1420) disinherited the dauphin from the kingdom of France in favor of a younger member of the House of Plantagenets, Charles VII nonetheless proclaimed himself King of France on his father’s death on October 21, 1422.
The de facto leader of the Armagnac party, retreating south of the Loire, saw his legitimacy and military situation considerably improved thanks to the intervention of Joan of Arc (1412-1431), operating under the benevolent protection of an exceptional world-historic person: the dauphin’s mother-in-law Yolande of Aragon (1384-1442), Duchess of Anjou, Queen of Sicily and Naples (Note 1).
Backed and guided by Yolande, Jeanne helped lift the siege of Orléans and had Charles VII crowned King of France in Reims in July 1429. In the mean time Yolande d’Aragon established contacts with the Burgundians in preparation for peace, and picked Jacques Coeur to be part of the Royal Court (Note 2).
The contemporary chronicler Jean Juvenal des Ursins (1433–44), Bishop of Beauvais described Yolande as « the prettiest woman in the kingdom. » Bourdigné, chronicler of the house of Anjou, says of her: « She who was said to be the wisest and most beautiful princess in Christendom. » Later, King Louis XI of France recalled that his grandmother had « a man’s heart in a woman’s body. »
A twentieth-century French author, Jehanne d’Orliac wrote one of the few works specifically on Yolande, and noted that the duchess remains unappreciated for her genius and influence in the reign of Charles VII. « She is mentioned in passing because she is the pivot of all important events for forty-two years in France », while « Joan [of Arc] was in the public eye only eleven months. »
Journey to the Levant
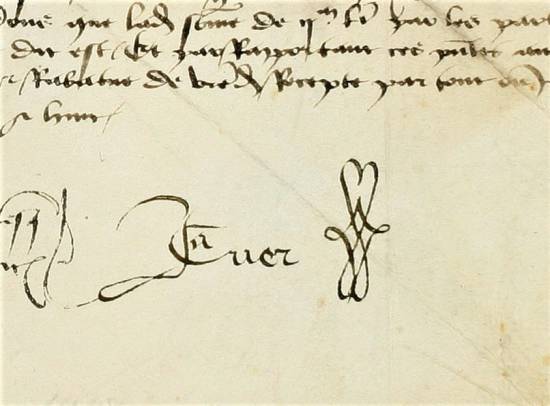
In 1430, Jacques Cœur, already renowned as a man « full of industry and high gear, subtle in understanding and high in comprehension; and all things, no matter how high, knowing how to lead by his work » (Note N° 3), with Barthélémy and Pierre Godard, two Bourges notables, set up,
« a company for all types of merchandise, especially for the King our lord, my lord the Dauphin and other lords, and for all other things for which they could provide proof ».
In 1431, Joan of Arc was handed over to the English by the Burgundians and burned alive at the stake in Rouen. One year later, in 1432, Jacques Cœur went to the Levant. A diplomat and humanist, Cœur went as an observer of customs as well as economic and political life.
His ship coasted from port to port, skirting the Italian coast as closely as possible, before rounding Sicily and arriving in Alexandria, Egypt. At the time, Alexandria was an imposing city of 70,000 inhabitants, bustling with thousands of Syrian, Cypriot, Genoese, Florentine and Venetian ships.

In Cairo, he discovered treasures arriving from China, Africa and India via the Red Sea. Around the Sultan’s Palace, Armenian, Georgian, Greek, Ethiopian and Nubian merchants offered precious stones, perfumes, silks and carpets. The banks of the Nile were planted with sugar cane and the warehouses full of sugar and spices.
Selling Silver at the Price of Gold

To understand Jacques Coeur’s financial strategy, a few words about bimetallism. At the time, unlike in China, paper money was not widely used. In the West, everything was paid for in metal coins, and above all in gold.
According to Herodotus, Croesus issued silver and pure gold coins in the 6th century BC. Under the Roman Empire, this practice continued. However, while gold was scarce in the West, silver-lead mines were flourishing.
Added to this, in the Middle Ages, Europe saw a considerable increase in the quantities of silver coinage in circulation, thanks to new mines discovered in Bohemia. The problem was that in France, national production was not sufficient to satisfy the needs of the domestic market. As a result, France was obliged to use its gold to buy what was lacking abroad, thus driving gold out of the country.
According to historians, during his trip to Egypt, Coeur observed that the women there dressed in the finest linens and wore shoes adorned with pearls or gold jewels. What’s more, they loved what was fashionable elsewhere, especially in Europe. Coeur was also aware of the existence of poorly exploited silver and copper mines in the Lyonnais region and elsewhere in France.
Historian George Bordonove, in his book Jacques Coeur, trésorier de Charles VII (Jacques Coeur, treasurer of Charles VII), reckons that Coeur was quick to note that the Egyptians « strangely preferred silver to gold, bartering silver for equal weight ». whereas in Europe, the exchange rate was 15 volumes of silver for one volume of gold !
In other words, he realized that the region « abounded in gold », and that the price of silver was very advantageous. The opportunity to enrich his country by obtaining a « golden » price for the silver and copper extracted from the French mines must have seemed obvious to him
What’s more, in China, only payments in silver were accepted. In other words, the Arab-Muslim world had gold, but lacked silver for its trade with the Far East, hence its huge interest in acquiring it from Europe…
Lebanon, Syria and Cyprus

Cœur then travels via Beirut to Damascus in Syria, at the time by far the biggest center of trade between East and West.
The city is renowned for its silk damasks, light gauze veils, jams and rose essences. Oriental fabrics were very popular for luxury garments.
Europe was supplied with silk and gold muslin from Mosul, damasks with woven motifs from Persia or Damascus, silks decorated with baldacchino figures, sheets with red or black backgrounds adorned with blue and gold birds from Antioch, and so on.
The « Silk Road » also brought Persian carpets and ceramics from Asia. The journey continues to another of the Silk Roads’ great maritime warehouses: Cyprus, an island whose copper had offered exceptional prosperity to the Minoan, Mycenaean and Phoenician civilizations.
The best of the West was bartered here for indigo, silk and spices.
Genoa and Venice
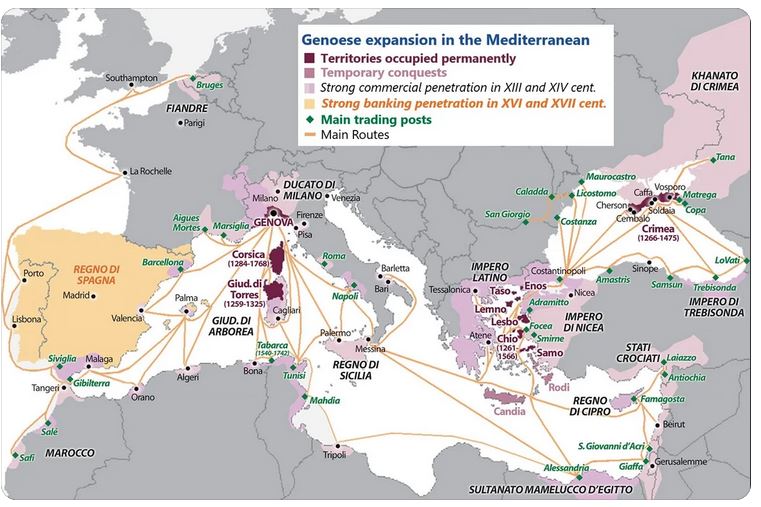
During his voyage, Coeur also discovered the maritime empires of Venice and Genoa, each enjoying the protection of a Vatican dependent on these financial powers.
The former, to justify their lucrative trade with the Muslims, claimed that « before being Christian », they were Venetians…
Like the British Empire, the Venetians promoted total free trade to subjugate their victims, while applying fierce dirigisme at home and prohibitive taxes to others. Any artist or person divulging Venetian know-how suffered terrible consequences.
Venice, outpost of the Byzantine Empire and supplier to the Court of Constantinople, a city of several million inhabitants, developed fabric dyeing, manufactured silks, velvets, glassware and leather goods, not to mention weapons. Its arsenal employs 16,000 workers.

Its rival, Genoa, with its highly skilled sailors and cutting-edge financial techniques, had colonized the Bosphorus and the Black Sea, from where treasures from Persia and Muscovy flowed. They also shamelessly engaged in the slave trade, a practice they would pass on to the Spanish and especially the Portuguese, who held a monopoly on trade with Africa.
Avoiding direct confrontation with such powers, Cœur kept a low profile. The difficulty was threefold: following the war, France was short of everything! It had no cash, no production, no weapons, no ships, no infrastructure!
So much so, in fact, that Europe’s main trade route had shifted eastwards. Instead of taking the route of the Rhône and Saône rivers, merchants passed through Geneva, and up the Rhine to Antwerp and Bruges. Another difficulty was soon added: a royal decree prohibited the export of precious metals! But what immense profits the Kingdom could draw from the operation.
The Oecumenial Councils

On his return from the Levant, France’s history accelerated. While preparing the economic reforms he wanted, Jacques Cœur also became involved in the major issues of the day. Through his brother Nicolas Cœur, the future bishop of Luçon, he played an important role in the process initiated by the humanists to unify the Western Church in the face of the Turkish threat.
Since 1378, there had been two popes, one in Rome and the other in Avignon. Several councils attempted to overcome the divisions. Nicolas Cœur attended them. First there was the Council of Constance (1414 to 1448), followed by the Council of Basel (1431), which, after a number of interruptions, was transferred to Florence (1439), establishing a doctrinal « union » between the Eastern and Western churches with a decree read out in Greek and Latin on July 6, 1439, in the cathedral of Santa Maria del Fiore, i.e. under the dome of Florence’s dome, built by Brunelleschi.

The central panel of the Ghent polyptych (1432), painted by the diplomatic painter Jan Van Eyck on the theme of the Lam Gods (the Lamb of God or Mystic Lamb), symbolizes the sacrifice of the Son of God for the redemption of mankind, and is capable of reuniting a church torn apart by internal differences. Hence the presence, on the right, of the three popes, here united before the Lamb. Van Eyck also painted portraits of Cardinal Niccolo Albergati, one of the instigators of the Council of Florence, and Chancellor Rolin, one of the architects of the Peace of Arras in 1435.
The Peace treaty of Arras

To achieve this, the humanists concentrated on France. First, they were to awaken Charles VII. After the victories won by Joan of Arc, wasn’t it time to win back the territories lost to the English?
However, Charles VII knew that peace with the English depended on reconciliation with the Burgundians. He therefore entered into negotiations with Philip the Good, Duke of Burgundy.
The latter no longer expected anything from the English, and wished to devote himself to the development of his provinces. For him, peace with France was a necessity. He therefore agreed to treat with Charles VII, paving the way for the Arras Conference in 1435.
This was the first European peace conference. In addition to the Kingdom of France, whose delegation was led by the Duke of Bourbon, Marshal de La Fayette and Constable Arthur de Richemont, and Burgundy, led by the Duke of Burgundy himself and Chancellor Rolin, it brought together Emperor Sigismund of Luxembourg, Mediator Amédée VIII of Savoy, an English delegation, and representatives of the kings of Poland, Castile and Aragon.
Although the English left the talks before the end, thanks to the skill of the scholar Aeneas Silvius Piccolomini, at that cardinal of Cyprus (and futur Pope Pius II) and spokesman for the Council of Basel, the signing of the Treaty of Arras in 1435 led to a peace agreement between the Armagnacs and the Burgundians, the first step towards ending the Hundred Years’ War.
In the meantime, the Council of Basel, which had opened in 1431, dragged on but came to nothing, and on September 18, 1437, Pope Eugene IV, advised by cardinal philosopher Nicolaus Cusanus and arguing the need to hold a council of union with the Orthodox, transferred the Council from Basel to Ferrara and then Florence. Only the schismatic prelates remained in Basel. Furious, they « suspended » Eugene IV and named the Duke of Savoy, Amédée VIII, Felix V, as the new pope. This « anti-pope » won little political support. Germany remained neutral, and in France, Charles VII confined himself to implementing many of the reforms decreed in Basel by the Pragmatic Sanction of Bourges on July 13, 1438.
King’s Treasurer and Great State Servant

In 1438, Cœur became Argentier de l’Hôtel du roi. L’Argenterie was not concerned with the kingdom’s finances. Rather, it was a sort of commissary responsible for meeting all the needs of the sovereign, his servants and the Court, for their daily lives, clothing, armament, armor, furs, fabrics, horses and so on.
Cœur was to supply the Court with everything that could neither be found nor manufactured at home, but which he could bring in from Alexandria, Damascus and Beirut, at the time major nodal points of the Silk Road by land and sea, where he set up his commercial agents, his « facteurs » (manufacturers).
Following this, in 1439, after having been appointed Master of the Mint of Bourges, Jacques Cœur became Master of the Mint in Paris, and finally, in 1439, the King’s moneyer. His role was to ensure the sovereign’s day-to-day expenses, which involved making advances to the Treasury and controlling the Court’s supply channels.
Then, in 1441, the King appointed him commissioner of the Languedoc States to levy taxes. Cœur often imposed taxes without ever undermining the productive reconstruction process. And in times of extreme difficulty, he would even lend money, at low, long-term rates, to those who had to pay it.
Ennobled, Coeur became the King’s strategic advisor in 1442. He acquired a plot of land in the center of Bourges to build his « grant’maison », currently the Palais Jacques Coeur. This magnificent edifice, with fireplaces in every room and an oven supplying the rest and bath room with hot water, has survived the centuries, although Coeur rarely had the occasion to live there.
Coeur is a true grand state servitor, with broad powers to collect taxes and negotiate political and economic agreements on behalf of the king. Having reached the top, Coeur is now in the ideal position to expand his long-cherished project.
Rule over Finance
On September 25, 1443, the Grande Ordonnance de Saumur, promulgated at Jacques Coeur’s instigation, put the state’s finances on a sounder footing.
As Claude Poulain recounts in his biography of Jacques Coeur:
« In 1444, after affirming the fundamental principle that the King alone had the right to levy taxes, but that his own finances should not be confused with those of the kingdom, a set of measures was enacted that affected the French at every level. »
These included: « Commoners owning noble fiefs were obliged to pay indemnities; nobles who had received seigneuries previously belonging to the royal domain would henceforth be obliged to share in the State’s expenses, on pain, once again, of seizure; finally, the kingdom’s financial services were organized, headed by a budget committee made up of high-ranking civil servants, ‘Messieurs des Finances’. »
In clear, the nobility was henceforth obliged to pay taxes for the Common Good of the Nation !
The King’s Council of 1444, headed by Dunois, was composed almost exclusively, not of noblement but of commoners (Jacques Coeur, Jean Bureau, Étienne Chevalier, Guillaume Cousinot, Jouvenel des Ursins, Guillaume d’Estouteville, Tancarville, Blainville, Beauvau and Marshal Machet). France recovered and enjoyed prosperity.
If France’s finances recovered, besides « taxing the rich », it was above all thanks to strategic investments in infrastructure, industry and trade. The revival of business activity enabled taxes to be brought in. In 1444, he set up the new Languedoc Parliament in conjunction with the Archbishop of Toulouse and, on behalf of the King, presided over the Estates General.
Master Plan
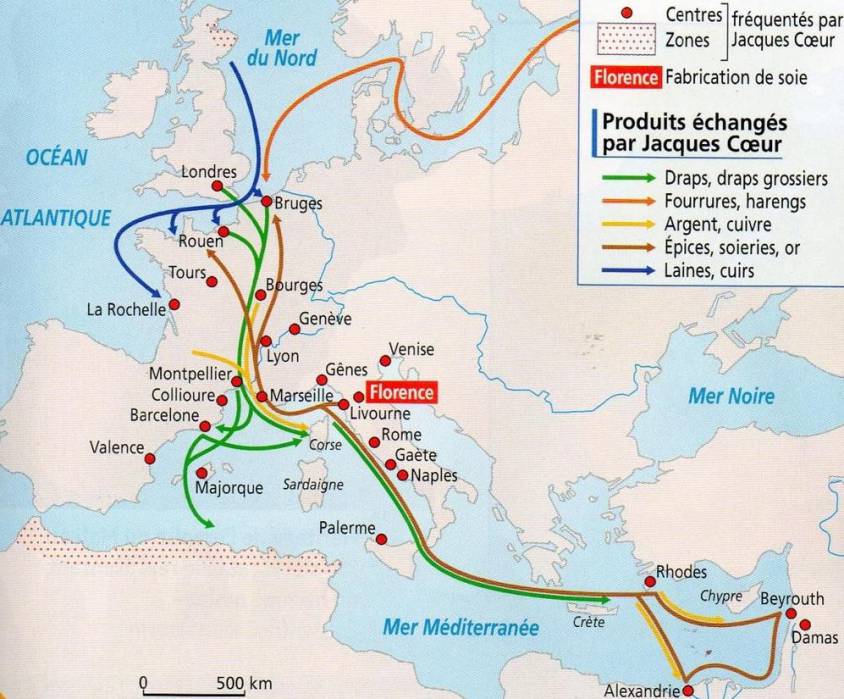
In reality, Jacques Cœur’s various operations, sometimes mistakenly considered to be motivated exclusively by his own personal greed, formed part of an overall plan that today we would describe as « connectivity » and at the service of the « physical economy ».
The aim was to equip the country and its territory, notably through a vast network of commercial agents operating both in France and abroad from the major trading cities of Europe (Geneva, Bruges, London, Antwerp, etc.), the Levant (Beirut and Damascus) and North Africa (Alexandria, Tunis, etc.), in order to promote win-win trade. ), to promote win-win trade, while reinvesting part of the profits in improving national productivity: mining, metallurgy, arms, shipbuilding, training, ports, roads, rivers, sericulture, textile spinning and dyeing, paper, etc.
Mining
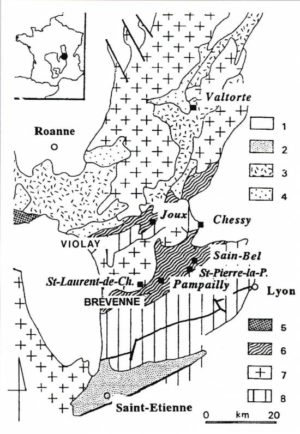
Of special interest were the silver mines of Pampailly, in Brussieu, south of l’Arbresle and Tarare, 25 kilometers west of Lyon, acquired and exploited as early as 1388 by Hugues Jossard, a Lyonnais jurist. They were very old, but their normal operation had been severely disrupted during the war. In addition, there were the Saint-Pierre-la-Palud and Joux mines, as well as the Chessy mine, whose copper was also used for weapons production.
Jacques Cœur made them operational. Near the mines, « martinets » – charcoal-fired blast furnaces – transformed the ore into ingots. Cœur brought in engineers and skilled workers from Germany, at the time a region far ahead of us in this field. However, without a pumping system, mining was no picnic.
Under Jacques Cœur’s management, the workers benefited from wages and comforts that were absolutely unique at the time. Each bunk had its own feather bed or wool mattress, a pillow, two pairs of linen sheets and blankets, a luxury that was more than unusual at the time. The dormitories were heated.
High quality food was provided to the laborers: bread containing four-fifths wheat and one-fifth rye, plenty of meat, eggs, cheese and fish, and desserts included exotic fruits such as figs and walnuts. A social service was organized: free hospitalization, care provided by a surgeon from Lyon who kept accident victims « en cure ». Every Sunday, a local priest came to celebrate a special mass for the miners. On the other hand, workers were subject to draconian discipline, governed by fifty-three articles of regulation that left nothing to chance.
The Ports of Montpellier and Marseille

On his return from the Levant in 1432, Jacques Coeur chose to make Montpellier the nerve center of his port and naval operations.
In principle, Christians were forbidden to trade with Infidels. However, thanks to a bull issued by Pope Urban V (1362-1370), Montpellier had obtained the right to send « absolved ships » to the East every year. Jacques Cœur obtained from the Pope that this right be extended to all his ships. Pope Eugene IV, by derogation of August 26, 1445, granted him this benefit, a permission renewed in 1448 by Pope Nicholas V.

At the time, only Montpellier, in the middle of the east-west axis linking Catalonia to the Alps (the Roman Domitian Way) and whose outports were Lattes and Aigues-Mortes, had a hinterland with a network of roads that were more or less passable, an exceptional situation for the time.
In 1963, it was discovered that at the site of the village of Lattes (population 17,000), 4 km south of today’s Montpellier and on the River Lez, there had been an Etruscan port city called Lattara, considered by some to be the first port in Western Europe. The city was built in the last third of the VIth century BC. A city wall and stone and brick houses were built. Original objects and graffiti in Etruscan – the only ones known in France – have suggested that Etrurian brokers played a role in the creation and rapid urbanization of the settlement.

Trading with the Greeks and Romans, Lattara was a very active Gallic port until the 3rd century AD. Then maritime access changed, and the town fell into a state of numbness.
In the 13th century, under the impetus of the Guilhem family, lords of Montpellier, the port of Lattes was revitalized, only to regain its splendor when Jacques Cœur set up his warehouses there in the 15th century.
As for the port of Aigues-Mortes, built from top to bottom by Saint-Louis in the XIIIth century for the crusades, it was also one of the first in France. To connect the two, Saint-Louis dug the canal known as « Canal de la Radelle » (today’s Canal de Lunel), which ran from Aigues-Mortes across the Lake of Mauguio to the port of Lattes. Cœur restored this river-port complex to working order, notably by building Port Ariane in Lattes.
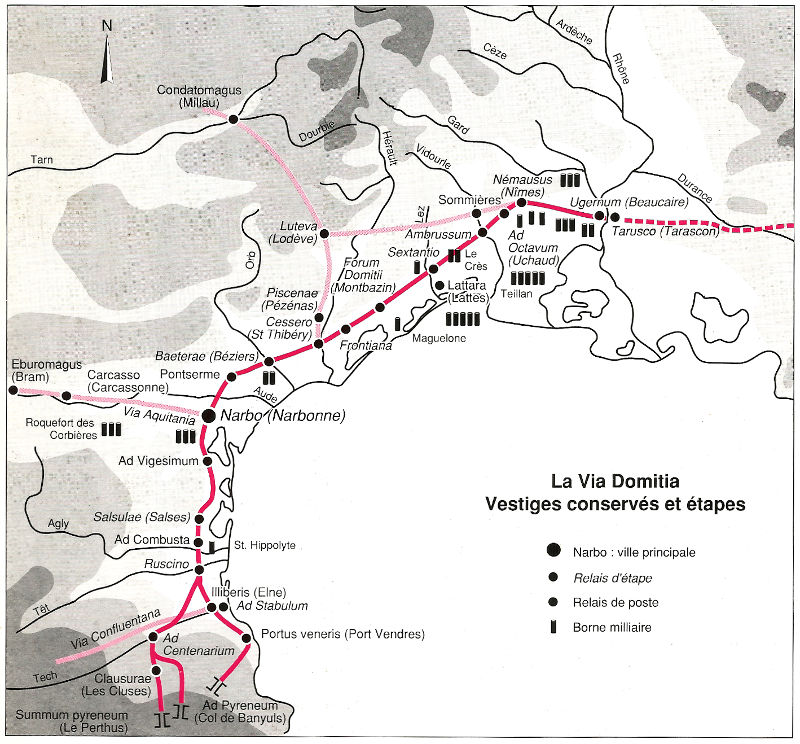
Over the following centuries, these disparate elements of canals and water infrastructure will become an efficient network built around the Canal du Rhône à Sète, a natural extension of the « bi-oceanic » Canal du Midi (between the Meditteranean and the Atlantic) begun by Jean-Baptiste Colbert (see map).
Coeur had the local authorities involved in his project, shaking Montpellier out of its age-old lethargy. At the time, the town had no market or covered sales buildings. Also lacking were moneychangers, shipowners and other cloth merchants.


In Montpellier, an entire district of merchants and warehouses was erected him, the Great Merchants Lodge, modeled on those in Perpignan, Barcelona and Valencia.
Numerous houses in Béziers, Vias and Pézenas also belonged to him, as did residences in Montpellier, including the Hôtel des Trésoriers de France, which, it is said, was topped by a tower so high that Jacques Cœur could watch his ships arrive at the nearby Port of Lattes.
And yet, as an old merchant and industrial city, Montpellier had long been home to Italians, Catalans, Muslims and Jews, who enjoyed a tolerance and understanding that was rare at the time. It’s easy to see why François Rabelais felt so at home here in the XVIth century.
Port of Marseille

The hinterland was rich and industrious. It produced wine and olive oil, in other words, exportable goods. Its workshops produced leather, knives, weapons, enamels and, above all, drapery.
From 1448 onwards, faced with the limitations of the system and the constant silting-up of the port infrastructure, Coeur moved one of his agents, the navigator and diplomat Jean de Villages, his nephew by marriage, to the neighboring port of Marseille, at that time outside the Kingdom, to the home of King René d’Anjou, where port operations were easier, a deep harbor protected from the Mistral by hills and a port equipped with waterfront shops and storehouses. The boost that Jacques Coeur gave to Montpellier’s port Lattes, Jean de Villages, on Coeur’s behalf, immediately gave to Marseille.
Shipbuilding
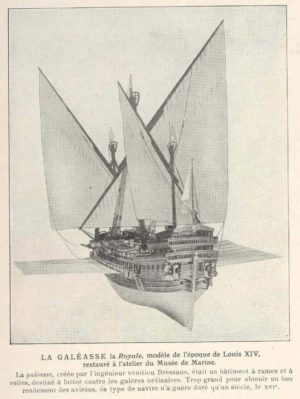
Good ports mean ocean-going ships! Hence at that time, the best France could do was build a few river barges and fishing boats.
To equip himself with a fleet of ocean-going vessels, Cœur ordered a « galéasse » (an advanced model of the ancient three-masted « galley », designed primarily for boarding) from the Genoa arsenals.
The Genoese, who saw only immediate profit in the project, soon discovered that Coeur had had the shapes and dimensions of their ship copied by local carpenters in Aigues Mortes!
Furious, they landed at the shipyard and took it back, arguing that Languedoc merchants had no right to fit out ships and trade without the prior approval of the Doge of Venice!

Stained glass window of a ship (a caraque) in the Palais de Jacques Cœur in Bourges.
After complicated negotiations, but with the support of Charles VII, Coeur got his ship back. Cœur let the storm pass for a few years. Later, seven great ships would leave the Aigues-Mortes shipyard, including « La Madeleine » under the command of Jean de Villages, a great sailor and his loyal lieutenant.
Judging by the stained-glass window and bas-relief in the Palais de Coeur in Bourges, these were more like caraques, North Sea vessels with large square sails and much greater tonnage than galleasses. But that’s not all!
Having understood perfectly well that the quality of a ship depends on the quality of the wood with which it is built, Cœur, with the authorization of the Duke of Savoy, had his wood shipped from Seyssel. The logs were floated down the Rhône, then sent to Aigues-Mortes via the canal linking the town to the river.
The crews
One last problem remained to be solved: that of crews. Jacques Cœur’s solution was revolutionary: on January 22, 1443, he obtained permission from Charles VII to forcibly embark, in return for fair wages, the « idle vagabonds and caimans » who prowled the ports.
To understand just how beneficial such an institution was at the time, we need to remember that France was being laid to waste by bands of plunderers – the routiers, the écorcheurs, the retondeurs – thrown into the country by the Hundred Years’ War. As always, Coeur behaves not only according to his own personal interests, but according to the general interests of France.
Connecting France to the Silk Road

Now with financial clout, ports and ships at his disposal, Cœur organized win-win commercial exchanges and, in his own way, involved France in the land and Maritime Silk Road of the time. First and foremost, he organized « détente, understanding and cooperation » with the countries of the Levant.
After diplomatic incidents with the Venetians had led the Sultan of Egypt to confiscate their goods and close his country to their trade, Jacques Coeur, a gentleman but also in charge of a Kingdom that remained dependent on Genoa and Venice for their supplies of arms and strategic raw materials, had his agents on site mediating a happy end to the incident.
Seeing other potential conflicts that could disrupt his strategy, and possibly inspired by Admiral Zheng He‘s great Chinese diplomatic missions to Africa from 1405 onwards, he convinced the king to send an ambassador to Cairo in the person of Jean de Villages, his loyal lieutenant.
The latter handed over to the Sultan the various letters he had brought with him. Flattered, the Sultan handed him a reply to King Charles VII:
« Your ambassador, man of honor, gentleman, whom you name Jean de Villages, came to mine Porte Sainte, and presented me your letters with the present you mandated, and I received it, and what you wrote me that you want from me, I did.
« Thus I have made a peace with all the merchants for all my countries and ports of the navy, as your ambassador knew to ask of me… And I command all the lords of my lands, and especially the lord of Alexandria, that he make good company with all the merchants of your land, and on all the others having liberty in my country, and that they be given honor and pleasure; and when the consul of your country has come, he will be in favor of the other consuls well high…
« I send you, by the said ambassador, a present, namely fine balsam from our holy vine, a beautiful leopard and three bowls (cups) of Chinese porcelain, two large dishes of decorated porcelain, two porcelain bouquets, a hand-washer, a decorated porcelain pantry, a bowl of fine green ginger, a bowl of almond stones, a bowl of green pepper, almonds and fifty pounds of our fine bamouquet (fine balsam), a quintal of fine sugar. Dieu te mène à bon sauvement, Charles, Roy de France. »

To the Orient, Coeur exported furs, leathers and, above all, cloth of all kinds, notably Flanders cloth and Lyon canvas. His « factors » also offered Egyptian women dresses, coats, headdresses, ornaments and jewels from our workshops. Then came basketry from Montpellier, oil, wax, honey and flowers from Spain for the manufacture of perfumes.
From the Near East, he received animal-figured silks from Damascus (Syria), fabrics from Bukhara (Uzbekistan) and Baghdad (Iraq); velvet; wines from the islands; cane sugar; precious metals; alum; amber; coral; indigo; coral; indigo from Baghdad; madder from Egypt; shellac; perfumes made from the essence of the flowers he exported; spices – pepper, ginger, cloves, cinnamon, jams, nutmegs, etc. – and more.
From the Far East, by the Red Sea or by caravans from the Euphrates and Turkestan, came to him: gold from Sudan, cinnamon from Madagascar, ivory from Africa, silks from India, carpets from Persia, perfumes from Arabia – later evoked by Shakespeare in Macbeth – precious stones from India and Central Asia, lapis lazuli from Afghanistan, pearls from Ceylon, porcelain and musk from China, ostrich feathers from the black Sudan.
Manufactures
As we saw in the case of mining, Coeur had no hesitation in attracting foreigners with valuable know-how to France to launch projects, implement innovative processes and, above all, train personnel. In Bourges, he teamed up with the Balsarin brothers and Gasparin de Très, gunsmiths originally from Milan. After convincing them to leave Italy, he set up workshops in Bourges, enabling them to train a skilled workforce. To this day, the Bourges region remains a major center of arms production.
In the early days of printing in Europe, Coeur bought a paper mill in Rochetaillée, on the Saône near Lyon.

In Montpellier, he took an interest in the dyeing factories, once renowned for their cultivation of madder, a plant that had become acclimatized in the Languedoc region.
It’s easy to understand why Cœur had his agents buy indigo, kermes seeds and other coloring substances. The aim was to revive the manufacture of cloth, particularly scarlet cloth, which had previously been highly sought-after.
With this in mind, he built a fountain, the Font Putanelle, near the city walls, to serve the population and the dyers.
In Montpellier, he also teamed up with Florentine charterers based in the city, for maritime expeditions.
Through their intermediary, Coeur personally traveled to Florence in 1444, registering both his associate Guillaume de Varye and his own son Ravand as members of the « Arte della Seta » (silk production corporation), the prestigious Florentine guild whose members were the only ones authorized to produce silk in Florence.
Coeur engaged in joint ventures, as he often did in France, this time with Niccolo Bonnacorso and the Marini brothers (Zanubi and Guglielmo). The factory, in which he owned half the shares, manufactured, organized and controlled the production, spinning, weaving and dyeing of silk fabrics.
It is understood that Coeur was also co-owner of a gold cloth factory in Florence, and associated in certain businesses with the Medici, Bardi and Bucelli bankers and merchants. He was also associated with the Genevese and Bruges families.
Going International
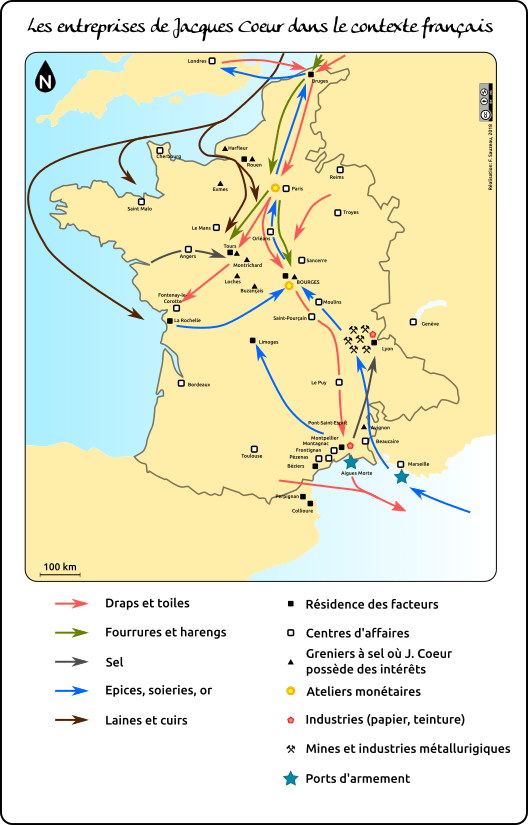
Jacques Coeur organized a vast distribution network to sell his goods in France and throughout Europe. At a time when passable roads were extremely rare, this was no easy task. Most roads were little more than widened paths or poorly functioning tracks dating back to the Gauls.
Cœur, who had his own stables for land transport, renovated and expanded the network, abolished internal tolls on roads and rivers, and re-established the collection (abandoned during the Hundred Years’ War) of taxes (taille, fouage, gabelle) to replenish public finances.
Jacques Cœur’s network was essentially run from Bourges. From there, on the French level, we could speak of three major axes: the north-south being Bruges-Montpellier, the east-west being Lyon-Tours. Added to this was the old Roman road linking Spain (Barcelona) to the Alps (Briançon) via Languedoc.
From Bourges, for example, the Silverware, which served the Court, was transferred to Tours. This was only natural, since from 1444 onwards, Charles VII settled in a small castle near Tours, Plessis-les-Tours. So it was at the Argenterie de Tours that the exotic products the Court was so fond of were stocked. This did not prevent the goods from being shipped on to Bruges, Rouen or other towns in the kingdom.
Counters also existed in Orléans, Loches, Le Mans, Nevers, Issoudun and Saint-Pourçain, birthplace of the Coeur family, as well as in Fangeaux, Carcassonne, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Thouars, Saumur, Angers and Paris.
Orléans and Bourges stocked salt from Guérande, the Vendée marshes and the Roche region. In Lyon, salt from the Camargue and Languedoc saltworks. River transport (on the Loire, Rhône, Saône and Seine rivers) doubled the number of road carts.

Jacques Coeur revived and promoted trade fairs. Lyon, with its rapid growth, geographic location and proximity to silver-lead and copper mines, was a particularly active trading post. Goods were shipped to Geneva, Germany and Flanders.
Montpellier received products from the Levant. However, trading posts were set up all along the coast, from Collioure (then in Catalonia) to Marseille (at the home of King René d’Anjou), and inland as far as Toulouse, and along the Rhône, in particular at Avignon and Beaucaire.
A trading post was set up in La Rochelle for the salt trade, certainly with a view to expanding maritime traffic. Jacques Cœur also had « factors » in Saint-Malo, Cherbourg and Harfleur. After the liberation of Normandy, these three centers grew in importance, and were joined by Exmes. In the north-east, Reims and Troyes are worth mentioning. They manufactured cloth and canvas. Abroad, Geneva was a first-rate trading post, as the city’s fairs and markets had already acquired an international character.
Coeur also had a branch in Bruges, bringing back spices and silks from the Levant, and shipping cloth and herring from there.

The fortunes of Bruges, like many other towns in Flanders, came from the cloth industry. The city flourished, and the power of its cloth merchants was considerable. In the 15th century, Bruges was one of the lungs of the Hanseatic League, which brought together the port cities of northern Europe.
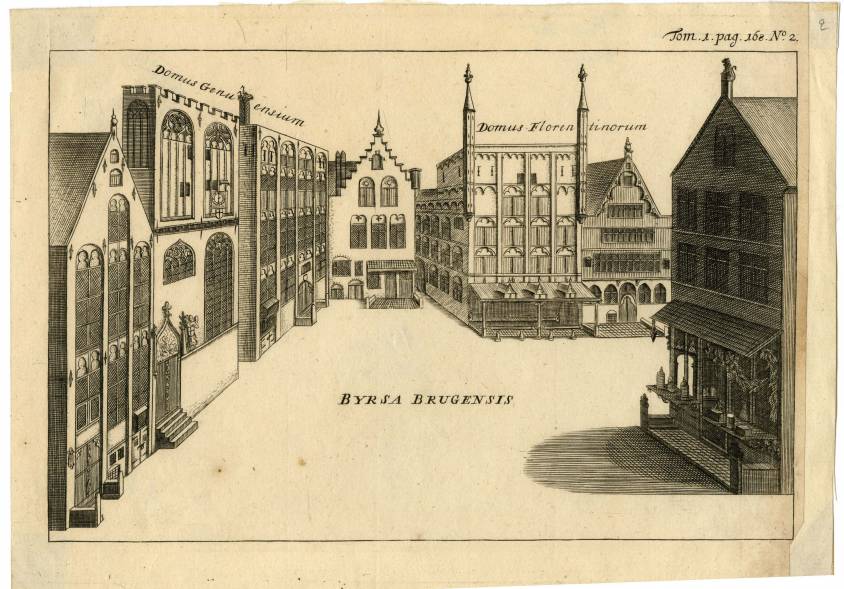

It was in Bruges that business relations were handled, and loan and marine insurance contracts drawn up. After cloth, it was the luxury industries that ensured its prosperity, with tapestries. By land, it took less than three weeks to get from Bruges to Montpellier via Paris.
Between 1444 and 1449, during the Truce of Tours between France and the English, Jacques Coeur tried to build peace by forging trade links with England.
Coeur sent his representative Guillaume de Mazoran. His other trusted associate, Guillaume de Varye, began trading in sheets from London in February 1449. He also bought leather, cloth and wool in Scotland. Some went to La Rochelle, others to Bruges.
Internationally, Coeur continued to expand, with branches in Barcelona, Naples, Genoa (where a pro-French party was formed) and Florence.
At the time of his arrest in 1451, Jacques Coeur had at least 300 « factors » (associates, commercial agents, financial representatives and authorized agents), each responsible for his own trading post in his own region, but also running « factories » on the spot, promoting meetings and exchanges of know-how between all those involved in economic life. Several thousand people associated and cooperated with him in business.
The Military Reform that saved the Nation
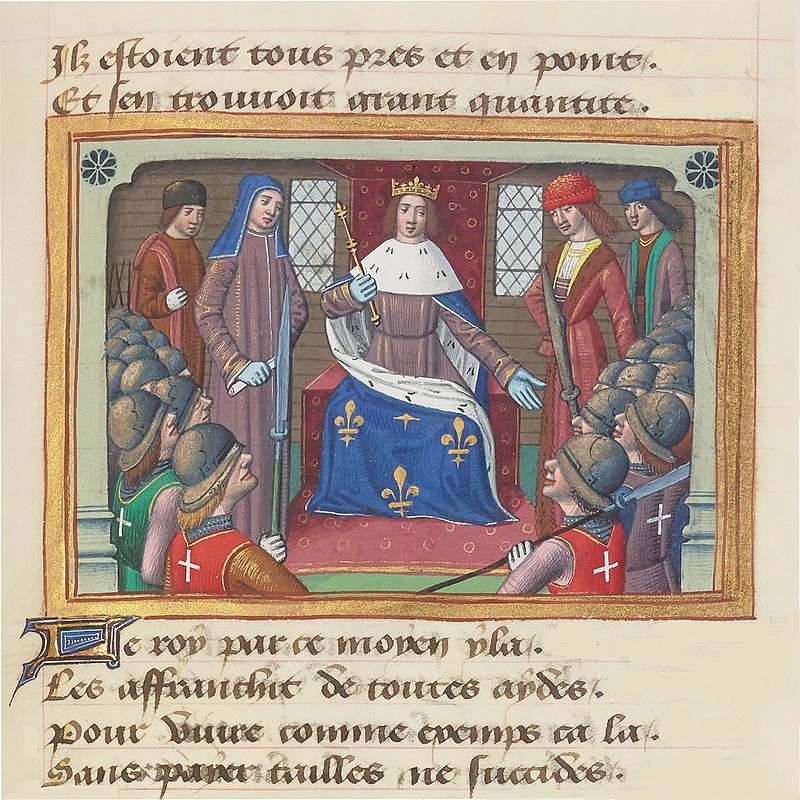
Cœur used the profits from this lucrative business to serve his country. When in 1449, at the end of the truce, the English troops were left to their own devices, surviving by pillaging the areas they occupied, Agnès Sorel, the king’s mistress, Pierre de Brézé, the military leader, and Jacques Cœur, encouraged the king to launch a military offensive to finally liberate the whole country.
Coeur declared bluntly:
« Sire, under your shadow, I acknowledge that I have great proufis and honors, and mesme, in the land of the Infidels, for, for your honor, the souldan has given me safe-conduct to my galleys and factors… Sire, what I have, is yours. »
We’re no longer in 1435, when the king didn’t have a kopeck to face strategic challenges. Jacques Coeur, unlike other great lords, according to a contemporary account,
« spontaneously offered to lend the king a mass of gold, and provided him with a sum amounting, it is said, to around 100,000 gold ecus to use for this great and necessary purpose ».
Under the advice of Jacques Coeur and others, Charles VII was to carry out a decisive military reform.
On November 2, 1439, at the Estates General that had been meeting in Orleans since October of that year, Charles VII ordered a reform of the army following the Estates General’s complaint about the skinners and their actions.
As Charles V (the Wise) had tried to do before him, he set up a system of standing armies that would engage these flayers full-time against the English. The nobility got in the king’s way. In fact, they often used companies of skinners for their own interests, and refused to allow the king alone to be responsible for recruiting the army.
In February 1440, the king discovered that the nobles were plotting against him. Contemporaries named this revolt the Praguerie, in reference to the civil wars in Prague’s Hussite Bohemia.
Yolande d’Aragon passed away in November 1442, but Jacques Coeur would continue pressuring the King to go ahead with the required reforms.
Following the Truce of Tours in 1444, an ordinance was issued on May 26 announcing no general demobilization should occur; instead, the best of the larger units were reconstituted as “companies of the King’s ordinance » (Compagnies d’Ordonnance),” which were standing units of cavalry well selected and well equipped; they served as local guardians of peace at local expense. This consisted of some 10,000 men organized into 15 Ordonnance companies, entrusted to proven captains. These companies were subdivided into detachments of ten to thirty lances, which were assigned to garrisons to protect the towns’ inhabitants and patrol the countryside. In a territory similarly patrolled by the forerunners of our modern gendarmerie, robbery and plunder quickly ceased.

Although still a product of the nobility, this new military formation was the first standing army at the disposal of the King of France. Previously, when the king wished to wage war, he called upon his vassals according to the feudal custom of the ban. But his vassals were only obliged to serve him for forty days. If he wished to continue the war, the king had to recruit companies of mercenaries, a plague against which Machiavelli would later warn his readers. When the war ended, the mercenaries were dismissed. They then set about plundering the country. This is what happened at the start of the Hundred Years’ War, after the victories of Charles V and Du Guesclin.
Then, with the Ordinance of April 8, 1448, the Francs-Archers corps was created. The model for the royal « francs archiers » was probably taken from the militia of archers that the Dukes of Brittany had been raising, by parish, since 1425.
The Ordinance stipulated that each parish or group of fifty or eighty households had to arm, at its own expense, a man equipped with bow or crossbow, sword, dagger, jaque and salad, who had to train every Sunday in archery. In peacetime, he stays at home and receives no pay, but in wartime, he is mobilized and receives 4 francs a month. The Francs-Archers thus formed a military reserve unit with a truly national character.
As writes the Encyclopedia Brittanica:
« With the creation of the “free archers” (1448), a militia of foot soldiers, the new standing army was complete. Making use of a newly effective artillery, its companies firmly in the king’s control, supported by the people in money and spirit, France rid itself of brigands and Englishmen alike. »
At the same time, artillery grandmaster Gaspard Bureau and his brother Jean (Note N° 4) developed artillery, with bronze cannons capable of firing cast-iron cannonballs, lighter hand cannons, the ancestors of the rifle, and very long cannons or couleuvrines that could be dragged on wagons and taken to the battlefield.
As a result, when the time came to go on the offensive, the army went into battle. From all over the country, the Francs-Archers, made up of commoners trained in every region of France rather than nobles, began to converge on the north.
The war was on, and this time, « the gale changed sides ». The merciless French army, armed to the highest standards, pushed its opponents to the limit. This was particularly true at the Battle of Formigny near Bayeux, on April 15, 1450. It was a kind of Azincourt in reverse, with English losses amounting to 80% of the forces engaged, with 4,000 killed and 1,500 taken prisoner. At last, towns and strongholds returned to the Kingdom!
Helping a Humanist Pope
As mentioned above, the Council of Basel had ended in discord. On the one hand, with the support of Charles VII and Jacques Coeur, Eugene IV was elected Pope in Rome in 1431. On the other, in Basel, an assembly of prelates meeting in council sought to impose themselves as the sole legitimate authority to lead Christendom. In 1439, the Council declared Eugene IV deposed and appointed « his » own pope: the Duke of Savoy, Amédée VIII, who had abdicated and retired to a monastery. He became pope under the name of Felix V.
His election was based solely on the support of theologians and doctors of the universities, but without the support of a large number of prelates and cardinals.
In 1447, King Charles VII commissioned Jacques Coeur to intervene for Eugene IV’s return and Felix V’s renunciation. With a delegation, he went to Lausanne to meet Felix V. While the talks were going well, Eugene IV died. As Felix V saw no further obstacles to his pontificate, the Pontifical Council in Rome quickly proceeded to elect a new pope, the humanist scholar Nicholas V (Tommaso Parentucelli).
To make France’s case to him, Charles VII sent Jacques Coeur at the head of a large delegation. Before entering the Eternal City, the French formed a procession.
The parade was sumptuous: more than 300 horsemen, dressed in bright, shimmering colors, bearing weapons and glittering jewels, mounted on richly caparisoned horses, dazzled and impressed the whole of Rome, except for the English, who saw themselves doubled by the French to serve the Pope’s mission.
From the very first meeting, Nicholas V was charmed by Jacques Coeur. Slightly ill, Coeur was treated by the pope’s physician. Thanks to information obtained from the Pontiff, notably on the limits of concessions to be made, Coeur’s delegation subsequently obtained the withdrawal of Felix V, with whom Coeur remained on good terms.

Nicholas V, it should be remembered, was a happy exception. Nicknamed the « humanist pope », he knew Leonardo Bruni (Note N° 5), Niccolò Niccoli (Note N° 6) and Ambrogio Traversari (Note N° 7) in Florence, in the entourage of Cosimo de’ Medici.
With the latter and Eugenio IV, whose right-hand man he was, Nicholas V was one of the architects of the famous Council of Florence, which sealed a « doctrinal union » between the Western and Eastern Churches. (Note N° 8)
Elected pope, Nicholas V considerably increased the size of the Vatican Library. By the time of his death, the library contained over 16,000 volumes, more than any other princely library.
He welcomed the erudite humanist Lorenzo Valla to his court as apostolic notary. Under his patronage, the works of Herodotus, Thucydides, Polybius and Archimedes were reintroduced to Western Europe. One of his protégés, Enoch d’Ascoli, discovered a complete manuscript of Tacitus’ Opera minora in a German monastery.
In addition to these, he called to his court a whole series of scholars and humanists: the scholar and former chancellor of Florence Poggio Bracciolini, the Hellenist Gianozzo Manetti, the architect Leon Battista Alberti, the diplomat Pier Candido Decembrio, the Hellenist Giovanni Aurispa, the cardinal-philosopher Nicolas de Cues, founder of modern science, and Giovanni Aurispa, the first to translate Plato’s complete works from Greek into Latin.
Nicholas V also made gestures to his powerful neighbors: at the request of King Charles VII, Joan of Arc was rehabilitated.
Later, when he sought refuge in Rome, Jacques Coeur was received by Nicholas V as if he was a member of his family.
The Coup d’Etat against Jacques Coeur
Jacques Coeur’s adventurous life ended as if in a cloak-and-dagger novel. On July 31, 1451, Charles VII ordered his arrest and seized his possessions, from which he drew one hundred thousand ecus to wage war.
The result was one of the most scandalous trials in French history. The only reason for the trial was political. The hatred of the courtiers, especially the nobles, had built up. By making each of them a debtor, Coeur, believing he had made allies of them, made terrible enemies. By launching a number of national products, he undermined the financial empires of Genoa, Venice and Florence, which eternally sought to enrich themselves by exporting their products, notably silk, to France.
One of the most relentless, Otto Castellani, a Florentine merchant, treasurer of finances in Toulouse but based in Montpellier, and one of the accusers whom Charles VII appointed as commissioner to prosecute Jacques Coeur, practiced black magic and pierced a wax figure of the silversmith with needles!
Lastly, Charles VII undoubtedly feared collusion between Jacques Coeur and his own son, the Dauphin Louis, future Louis XI, who was stirring up intrigue after intrigue against him.
In 1447, following an altercation with Agnès Sorel, the Dauphin had been expelled from the Court by his father and would never see him again. Jacques Cœur lent money to the Dauphin, with whom he kept in touch through Charles Astars, who looked after the accounts of his mines.
« Trade with infidels », « Lèse majesté », « export of metals », and many other pretexts, the reasons put forward for Jacques Coeur’s trial and conviction are of little interest. They are no more than judicial window-dressing. The proceedings began with a denunciation that was almost immediately found to be slanderous.

A certain Jeanne de Mortagne accused Jacques Coeur of having poisoned Agnès Sorel, the king’s mistress and favorite, who died on February 9, 1450. This accusation was implausible and devoid of any serious foundation; for, having placed all her trust in Jacques Coeur, she had just appointed him as one of her three executors.
Coeur is imprisoned for a dozen equally questionable reasons. When he refused to admit what he was accused of, he was threatened with « the question » (torture). Confronted by the executioners, the accused, trembling with fear, claims that he « relies » on the words of the commissioners charged with breaking him.

His condemnation came on the same day as the fall of Constantinople, May 29, 1453. Only the intervention of Pope Nicholas V saved his life. With the help of his friends, he escaped from his prison in Poitiers, and took the route of the convents, including Beaucaire, to Marseille for Rome.
Pope Nicholas V welcomed him as a friend. The pontiff died and was succeeded by his successor. Jacques Cœur chartered a fleet in the name of his illustrious host, and set off to fight the infidels. Jacques Coeur, we are told, died on November 25, 1456 on the island of Chios, a Genoese possession, during a naval battle with the Turks.
The great King Louis XI, unloved son of Charles VII, as evidenced by his ordinances in favor of the productive economy, would continue the recovery of France begun by Jacques Coeur. Many of Coeur’s collaborators soon entered his service, including his son Geoffroy, who, as cupbearer, became Louis XI’s most trusted confidant.
Charles VII, by letters patent dated August 5, 1457, restored to Ravant and Geoffroy Coeur a small portion of their father’s property. It was only under Louis XI that Geoffroy obtained the rehabilitation of his father’s memory and more complete letters of restitution.
NOTES:
- During the five years between Joan of Arc’s first appearances and her departure for Chinon, several people attached to the Court stayed in Lorraine, including René d’Anjou, the youngest son of Yolande d’Aragon. While Charles VII remained undecided, his mother-in-law welcomed La Pucelle with maternal solicitude, opening doors for her and lobbying the king until he deigned to receive her. During the Poitiers trial, when Jeanne’s virginity had to be verified, she presided over the council of matrons in charge of the examination. She also provided financial support, helped her gather her equipment, provided safe stopping points on the road to Orléans, and gathered food and relief supplies for the besieged. To this end, she did not hesitate to open her purse wide, even going so far as to sell her jewelry and golden tableware. Yolande’s support was rewarded on April 30, 1429 with the liberation of Orléans, followed on July 17 by the King’s coronation in Reims. Although many of her contemporaries praised her simplicity, her closeness to her subjects and the warmth of her court, Yolande d’Aragon was a stateswoman. And whatever sympathy she may have felt for her protégée, she would not hesitate to abandon her to her sad fate when her warlike impulses no longer accorded with her own political objectives : to negociate a peaceful alliance with the Duchy of Burgundy. The Duchess knew how to be implacable, and like her comrades-in-arms, the Church and the King himself, she abandoned La Pucelle to the English, to Cauchon, to her trial and to the stake. For more: Gérard de Senneville, Yolande d’Aragon : La reine qui a gagné la guerre de Cent Ans, Editions Perrin)
- Georges Bordonove, Jacques Coeur, trésorier de Charles VII, p. 90, Editions Pygmalion, 1977).
- Description given by the great chronicler of the Dukes of Burgundy, Georges Chastellain (1405-1475), in Remontrances à la reine d’Angleterre.
- Jean Bureau was Charles VII’s grand master of artillery. On the occasion of his coronation in 1461, Louis XI knighted him and made him a member of the King’s Council. Louis XI stayed at Jean Bureau’s Porcherons house in northwest Paris after his solemn entry into the capital. Jean Bureau’s daughter Isabelle married Geoffroy Coeur, son of Jacques.
- Leonardo Bruni succeeded Coluccio Salutati as Chancellor of Florence, having joined his circle of scholars, which included Poggio Bracciolini and the erudite Niccolò Niccoli, to discuss the works of Petrarch and Boccaccio. Bruni was one of the first to study Greek literature, and contributed greatly to the study of Latin and ancient Greek, offering translations of Aristotle, Plutarch, Demosthenes, Plato and Aeschylus.
- Niccolò Niccoli built up one of the most famous libraries in Florence, and one of the most prestigious of the Italian Renaissance. He was assisted by Ambrogio Traversari in his work on Greek texts (a language he did not master). He bequeathed this library to the Florentine Republic on condition that it be made available to the public. Cosimo the Elder de’ Medici was entrusted with implementing this condition, and the library was entrusted to the Dominican convent of San Marco. Today, the library is part of the Laurentian Library.
- Prior General of the Camaldolese Order, Ambrogio Traversari was, along with Jean Bessarion, one of the authors of the decree of church union. According to the Urbino court historian Vespasiano de Bisticci, Traversari gathered in his convent at San Maria degli Angeli near Florence. There, Traversari brought together the heart of the humanist network: Nicolaus Cusanus; Niccolo Niccoli, who owned an immense library of Platonic manuscripts; Gianozzi Manetti, orator of the first Oration on the Dignity of Man; Aeneas Piccolomini, the future Pope Pius II; and Paolo dal Pozzo Toscanelli, the physician-cartographer and future friend of Leonardo da Vinci, whom Piero della Francesca also frequented.
- Philosophically speaking, reminding the whole of Christendom of the primordial importance of the concept of the filioque, literally « and of the son », meaning that the Holy Spirit (divine love) came not only from the Father (infinite potential) but also from the Son (its realization, through his son Jesus, in whose living image every human being had been created), was a revolution. Man, the life of every man and woman, is precious because it is animated by a divine spark that makes it sacred. This high conception of each individual was reflected in the relationship between human beings and their relationship with nature, i.e., the physical economy.
La splendeur des Royaumes d’Ifè et du Bénin


Les têtes en bronze d’Ifè (Nigeria) mettent à mal la théorie coloniale pour qui l’Afrique n’était qu’un terrain vierge, peuplé d’animaux et de quelques peuplades primitives n’ayant jamais fait leurs premiers pas dans « l’histoire ».
Aujourd’hui ville d’un demi-million d’habitants au sud-ouest du Nigeria, Ifè fut le centre religieux et l’ancienne capitale du peuple yoruba qui s’est développé pour l’essentiel grâce au commerce qu’il faisait sur le fleuve Niger, long de 4200 km, avec les peuples de l’Afrique de l’Ouest et au-delà.
Cet espace avant tout géoculturel de quelque 55 millions de personnes a prospéré dans une vaste ère géographique (Yoruba-land) d’environ 142 000 km², comprenant des régions entières de pays comme le Nigeria (76 %), le Bénin (18,9 %) et le Togo (6,5 %) actuels.
On trouve également des Yoruba au Ghana, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et, depuis la traite négrière, aux Etats-Unis. Ce n’est donc pas surprenant que le yuroba, une langue à tons, soit l’une des trois grandes langues du Nigeria, également parlée dans certaines régions du Bénin et du Togo, ainsi qu’aux Antilles et en Amérique latine, notamment à Cuba par les descendants d’esclaves africains. Espace géo-culturel des yoruba autour d’Ifè et, à droite, celui du peuple edo au Royaume autour de Bénin City.
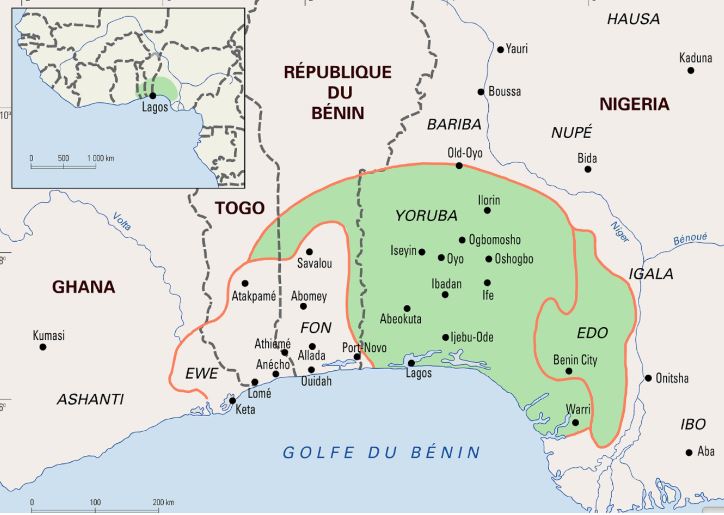
Un trésor hors du commun

C’est en janvier 1938, lors de travaux de terrassement pour la construction d’une maison, que des ouvriers découvrent à Ifè, dans le quartier de Wunmonije, un trésor peu ordinaire. A une centaine de mètres du site du Palais Royal, ils déterrent treize magnifiques têtes en bronze datant du XIIe siècle représentant un roi (un « Ooni ») et des courtisans. D’autres ont été déterrées depuis.
Leurs visages, hormis les lèvres, sont couverts de striures. La coiffure fait penser à une couronne complexe composée de plusieurs couches de billes tubulaires, surmontée d’une crête avec une rosette et une « aigrette ».
La surface de cette couronne porte des traces de peinture rouge et noire. Ces grandes têtes ont pu servir d’effigies de défunts lors de cérémonies funéraires, qui, chez les Yoruba, ont parfois lieu un an après l’enterrement rapide des morts qu’impose le climat tropical.
Le rendu très ressemblant et naturaliste des têtes est alors considéré comme anachronique dans l’art de l’Afrique subsaharienne, et encore plus troublant que celui des portraits de momie, très réalistes, du Fayoum égyptien (I-IIe siècle)..
Pourtant, une longue tradition de sculpture figurative présentant des caractéristiques semblables existait avant la création de ces sculptures de métal, en particulier chez les Nok, un peuple de cultivateurs maîtrisant le fer à partir de 800 ans avant notre ère.
Hystérie

Depuis 1938, les « têtes d’Ifè » ont provoqué des réactions proches de l’hystérie en Europe et en Occident.
D’un côté, les « modernistes » et les « abstraits » du début du XXe siècle, pour qui plus une sculpture est abstraite et s’éloigne de la réalité, plus elle est considérée comme typiquement africaine.
Pour ceux qui s’inspiraient de « l’abstrait » africain pour se libérer du naturalisme matérialiste, les têtes d’Ifè venaient donc brutalement bousculer leurs théories savamment construites.
De l’autre, surtout pour les partisans de l’impérialisme colonial, cet art ne pouvait tout simplement pas exister.
A Frank Willett, le responsable du Département nigérian des Antiquités et auteur d’Ifè, une civilisation africaine (Editions Tallandier, 1967), qui rapportait que « les Européens en visite à Ifè se demandent fréquemment comment des gens vivant dans des maisons de boue séchée, aux toits de paille, ont pu fabriquer d’aussi beaux objets que les bronzes et terres cuites au musée », l’éditeur Sir Mortimer Wheeler répondit :
Le préjugé a la vie dure, qui veut que la création et la sensibilité artistiques ne puissent exister sans les talents domestiques et le confort sanitaire !
Les interrogations des Européens étaient nombreuses. Comment, au XIIe siècle, des peuples primitifs, n’ayant jamais connu de forme d’État organisé, auraient-ils pu fabriquer des têtes en bronze d’un tel raffinement, faisant appel à des techniques que même l’Europe ne maîtrisait pas à cette époque ? Comment des tribus, vivant dans la superstition et la magie la plus irrationnelle, auraient-elles pu observer avec tant de minutie l’anatomie humaine ? Comment des sauvages auraient-ils pu exprimer des sentiments aussi nobles, aussi bien envers des hommes que des femmes ?

Devant un paradoxe aussi insoutenable, le déni fut la règle.
Ainsi, lorsque l’archéologue allemand Leo Frobenius présenta le premier ce type de tête, les experts refusèrent de croire à l’existence d’une civilisation africaine capable de laisser des artefacts d’une qualité qu’ils reconnaissaient comparable aux meilleures réalisations artistiques de la Rome ou de la Grèce antiques. Pour tenter d’expliquer ce qui passait pour une anomalie, Frobenius avança alors, sans le moindre début de preuve, la théorie que ces têtes auraient été moulées par une colonie grecque fondée au XIIIe siècle av. J.-C., et que cette dernière pouvait être à l’origine de la vieille légende de la civilisation perdue de l’Atlantide, un récit repris en chœur par la presse populaire…
Bronze

Ce qui choqua en premier lieu les experts occidentaux, c’est qu’il s’agissait de têtes en bronze, en réalité en laiton au plomb (environ 70 % de cuivre, 16,5 % de zinc et 11,3 % de plomb).
Etant donné la rareté de ce minerai au Nigeria, ces objets démontrent que la région entretenait des relations commerciales avec des pays lointains. On pense qu’il provenait de l’Europe centrale, du nord-ouest de la Mauritanie, de l’Empire byzantin ou, via le fleuve Niger, de Tombouctou, où le minerai arrivait, à dos de dromadaire, du sud du Maroc.
Si durant la période du Néolithique, des pépites de cuivre, d’or et d’argent sont martelés à froid ou à chaud, ce n’est qu’à partir de l’Age du bronze que l’homme découvre la métallurgie. A partir de minerais, il est alors capable d’extraire des métaux grâce à un traitement thermique précis, rendu possible par l’expérience des céramistes de l’époque, grands experts dans la maîtrise de la chaleur et des fours de cuisson.
Or, le cuivre ne fond qu’à 1083° Celsius, mais en y ajoutant de l’étain (qui fond à 232°) et du plomb (qui fond à 327°), on peut obtenir du bronze à 890° et du laiton à 900°. La terre cuite se fait, elle, à basse température, aux alentours de 600 à 800°.
Cependant, en Chine, dès la dynastie des Shang (1570 – 1045 av. JC), certaines porcelaines exigent des températures beaucoup plus élevées, entre 1000 et 1300°.
Les plus anciennes traces de céramique en Afrique subsaharienne semblent dater de plus de 9000 av. J.-C., voire plus encore, quelques tessons fragmentaires, datés de 12 000 av. J.-C. ayant été découverts en Afrique de l’Ouest, en l’occurrence au Mali.
La céramique se manifeste également plus au sud, notamment avec la culture Nok dans le nord du Nigeria au début du Premier millénaire av. JC.
Cire perdue
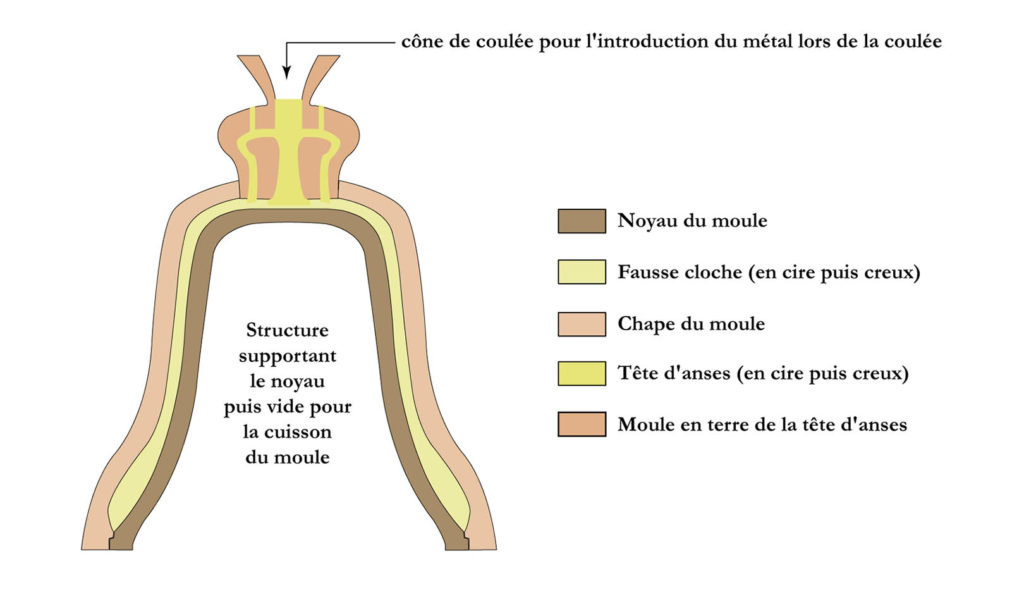
Ensuite, ce qui choqua tout autant les experts, c’est que la technique mise en œuvre pour leur réalisation était la technique dite « à cire perdue », un procédé de moulage de précision qu’on utilise encore de nos jours pour la fabrication des cloches d’églises. Le moule se compose de trois parties distinctes et superposées : le noyau, la cloche ou la statue (en cire) et la « carapace » ou chape. Par différentes astuces, le bronze en fusion qu’on laisse pénétrer va se substituer au modèle en cire. Lors de la coulée, différents conduits doivent permettre d’évacuer aussi bien la fumée qu’une partie de la cire lorsqu’elle fond.
En clair, il faut des artisans très qualifiés pour exercer le métier de fondeur de bronze professionnel.
Le savoir-faire exceptionnel des fondeurs d’Ifè fut précédé de peu par ceux d’Igbo-Ukwu au Nigeria oriental où l’on découvrit en 1939 un tombeau plein d’objets d’art datant du IXe siècle révélant l’existence d’un royaume puissant et raffiné maîtrisant la fameuse technique à la cire perdue, mais qui ne peut être rattachée à aucune autre culture de la région.

Historiquement, l’amulette de Mehrgarh au Pakistan, âgée de 6000 ans, est le premier objet connu façonné à la cire perdue. Si la Chine, la Grèce et Rome maîtrisent cette technique, il faut attendre la Renaissance pour qu’elle fasse son retour en Europe.
Ifè, un Etat organisé


Cartes des différents royaumes et empires africains avant la colonisation. Terre cuite en provenance du site d’Ita Yemoo, Ifè, Nigeria (XIIe au XIVe siècle).

En réalité, l’art d’Ifè mettait à mal la théorie coloniale pour qui l’Afrique n’était qu’un terrain vierge, peuplé d’animaux et de quelques peuplades primitives n’ayant jamais fait leurs premiers pas dans « l’histoire ».
En effet, toute preuve démontrant sur le continent africain l’existence d’empires, de royaumes ou de grands Etats ayant permis aux Africains de s’autogouverner de façon pacifique pendant des siècles, ne pouvait que délégitimer la « mission civilisatrice » du colonialisme.
Or, selon la tradition orale, Ifè fut fondée aux IXe-Xe siècles par Oduduwa, par le regroupement de 13 villages en une cité qui sera la ville centrale de la mythologie yoruba, pour qui elle est le berceau de l’humanité et le centre du monde.
Reconnu comme un dieu mineur, Oduduwa devint ainsi le premier Ooni (Roi) et se fit construire un Aafin (palais). Il gouverna à l’aide des isoro, anciens chefs de village ayant récupéré un titre religieux et assujettis à l’autorité politique royale.

Toujours selon les traditions orales, Oduduwa serait un prince exilé d’un peuple étranger, ayant quitté sa patrie avec une suite et voyagé en direction du sud, s’installant parmi les Yoruba vers le XIIe siècle. Sa foi, qu’il aura apportée, était si importante pour ses disciples et lui qu’elle aurait été la cause de leur exode en premier lieu.
La terre ou le pays d’origine d’Oduduwa sont sujet à débat. Pour les uns, il vient de La Mecque, pour les autres, d’Egypte, comme les savoir-faire qu’il apporta sont supposés le démontrer.
Il est vrai qu’on s’est avant tout intéressé aux routes conduisant vers la mer et les fleuves, il ne fait pas de doute que la savane, au cours des siècles précédents, a pu relier le delta du Niger au Nil, telle une sorte de grande route transcontinentale, passant notamment par le Tchad où des milliers de peintures pariétales témoignent d’un sens artistique créateur.
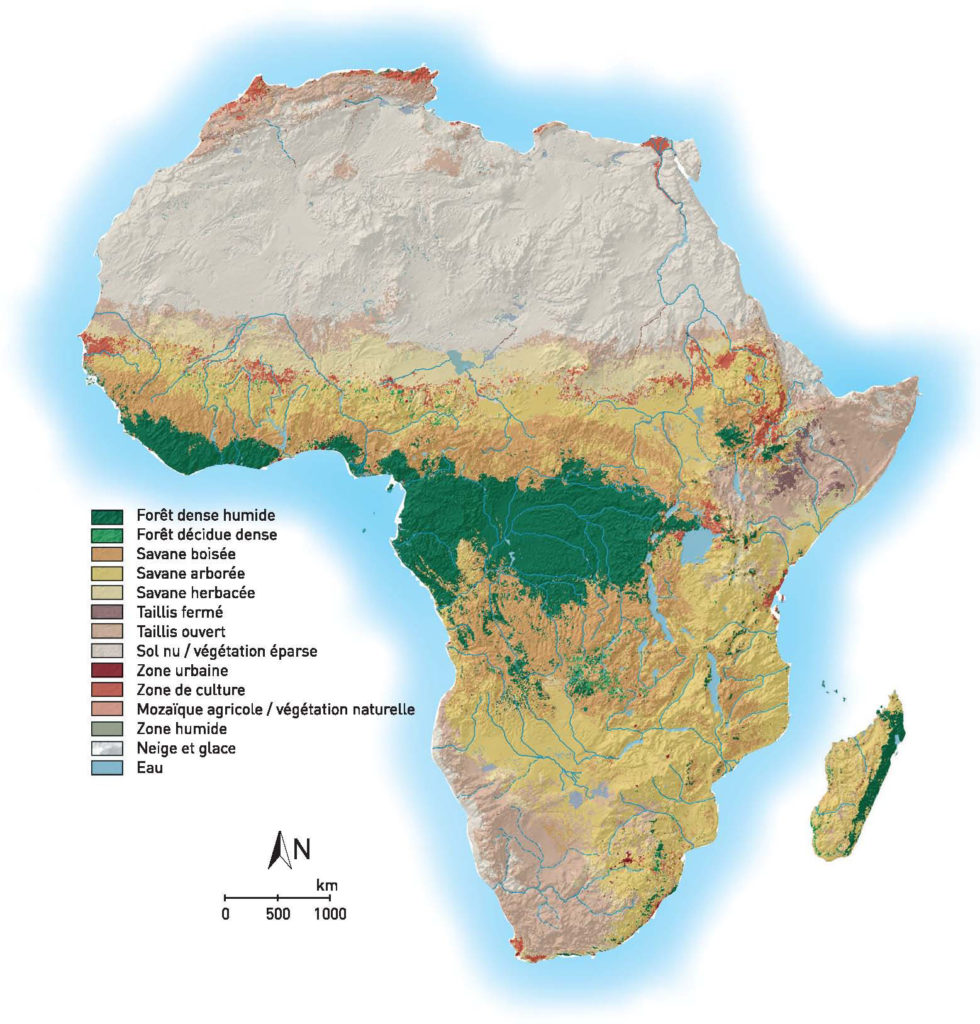
Le peuple Edo de Bénin City croit, quant à lui, qu’Oduduwa était en fait un prince de chez eux. Il aurait quitté le Bénin à cause d’une lutte pour la succession royale. C’est pourquoi l’un de ses descendants, le prince Oramiyan, fut par la suite autorisé à revenir, et fonda la dynastie qui régna sur le Royaume du Bénin. Le prince Oramiyan fut donc le premier oba du Benin, remplaçant ainsi avec succès le système monarchique Ogiso qui régnait jusque-là.
Métallurgie
Ce qui mérite l’attention, c’est que la métallurgie occupe une place centrale à Ifè. Oduduwa possédait une forge dans son palais (Ogun Laadin). Les rois des différents royaumes installaient leurs forges dans l’enceinte du palais royal, montrant ainsi le rapport symbolique fort entre pouvoir et métallurgie.
Les plus anciennes traces documentant la transformation du minerai de fer en Afrique remontent au IIIe millénaire av. JC. Il s’agit des sites archéologiques d’Egaro au Niger oriental et de Gizeh et Abydos en Egypte.

Tandis que le site de Buhen en Nubie égyptienne (- 1991), après avoir travaillé le fer, deviendra une « usine à cuivre », les sites d’Oliga au Cameroun (-1300) et de Nok au Nigeria (-925) témoignent d’une activité métallurgique dynamique.
Contrairement à ce qui s’est passé sur d’autres continents, l’Age de fer en Afrique aurait précédé dans certaines régions celui du cuivre. Comme nous l’avons vu, les techniques de production du laiton montrent un savoir-faire technologique très avancé. Ifè sera également un centre majeur de production verrière, en particulier de perles de verre. Les déchets de cette production ancestrale, constitués de parties de creusets recouverts de verre fondu, seront recherchés au XIXe siècle par les habitants de la région, bien que l’origine en soit à l’époque oubliée.
Des fouilles archéologiques récentes ont démontré que le peuplement de cette aire est très ancien. Mais comme nous l’avons vu, ce n’est qu’au début du IIe millénaire que des évolutions dans le domaine de la métallurgie auraient permis d’améliorer les outils agricoles et de générer des excédents de nourriture. On y cultive l’igname, le manioc, le maïs et le coton, qui est aussi à la source d’une importante industrie de tissage de vêtements.

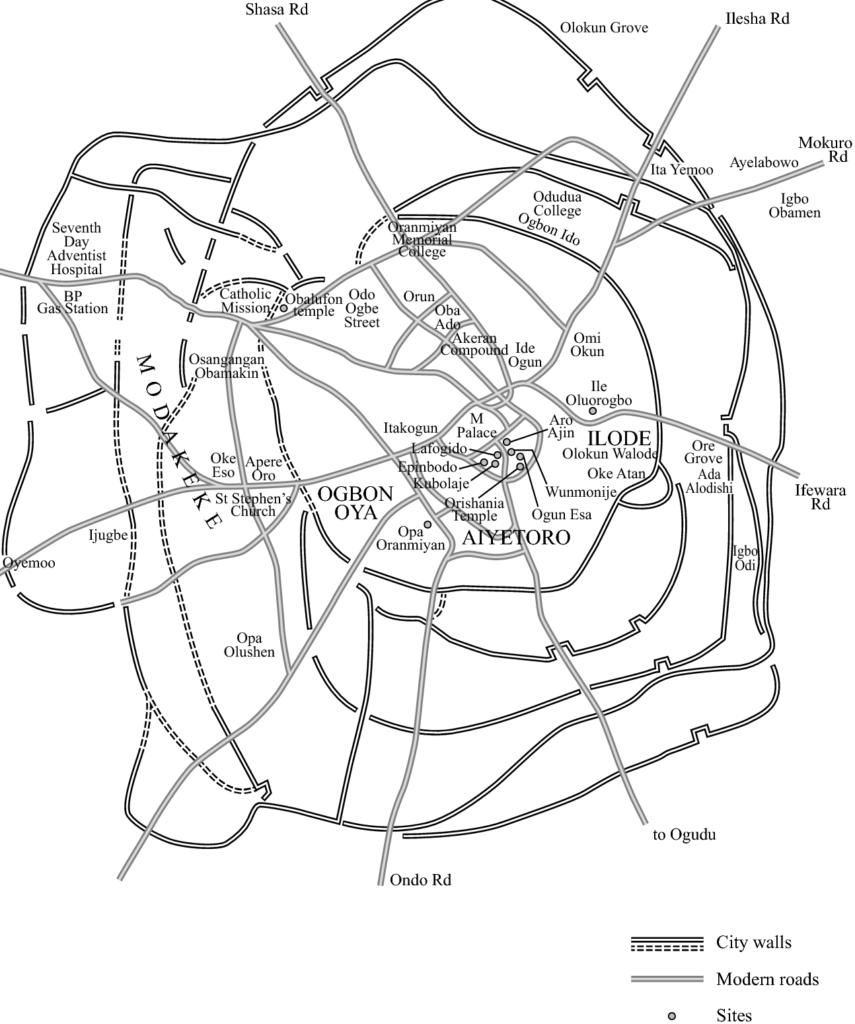
La ville connaîtra ainsi une expansion démographique rapide grâce à cet essor de la productivité agricole, dû à la maîtrise d’une densité énergétique accrue permettant de transformer des « pierres » en ressources utiles.
L’urbanisation médiévale d’Ifè est aujourd’hui largement attestée par l’existence de nombreuses enceintes faites de fossés et de talus, qui semblent indiquer les différents espaces ayant connu une concentration démographique et une entité politique suffisamment puissante pour mettre en œuvre de tels travaux.
Ainsi, en tant qu’Etat centralisé, Ifè s’érige très tôt en modèle pour d’autres Etats dans la région et au-delà. Plusieurs descendants et capitaines d’Oduduwa ont fondé d’autres royaumes sur le même modèle et s’appuyant sur la même légitimité. L’expérience monarchique d’Ifè s’exporte avec son cadre culturel. L’adé ilèkè, une couronne de perles de verre symbolisant le pouvoir royal, se retrouve dans la plupart des monarchies de la région.

En tout, de 7 à 20 royaumes selon les sources composent le monde yoruba dans la première moitié du deuxième millénaire de notre ère.
- L’État d’Oyo au Nigeria fut l’une des plus puissantes cités-États yoruba.
- Autre exemple, le Royaume de Kétou, actuellement au sud-est du Bénin, aurait été fondé vers le XIVe siècle par un prétendu descendant d’Oduduwa. Il aurait quitté Ifè avec sa famille et d’autres membres de son clan, pour se diriger vers l’ouest, avant de s’installer finalement dans la cité d’Aro, au nord-est de la ville de Kétou. Rapidement, Aro devint trop petit pour la population grandissante du clan, et la décision fut prise de s’installer à Kétou. Le roi Ede quitta donc Aro avec 120 familles et s’installa dans cette ville.
- Autre démonstration des bâtisseurs yoruba, près de la capitale nigeriane Lagos, l’enceinte de Sungbo Eredo, un système de murailles et de fossés construit au XIVe siècle e situé au sud-ouest de la ville d’Ijebu Ode, dans l’État d’Ogun, au sud-ouest du Nigeria. Sur plus de 160 km de long, ces fortifications, parfois hautes de 20 mètres, consistent en un fossé aux parois lisses, formant une douve intérieure par rapport aux murs qui le surplombent. Le fossé forme un anneau irrégulier autour des terres de l’ancien royaume d’Ijebu. Cet anneau fait environ 40 km dans le sens nord-sud et 35 km dans le sens est-ouest, c’est-à-dire l’équivalent du boulevard périphérique parisien ! Envahi par la végétation, l’édifice ressemble aujourd’hui à un tunnel verdoyant.
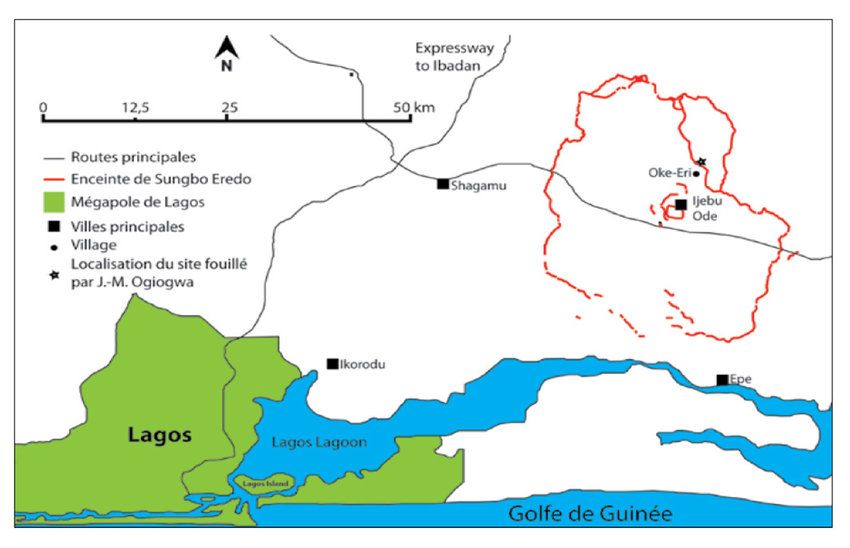
D’Ifè au Royaume du Bénin
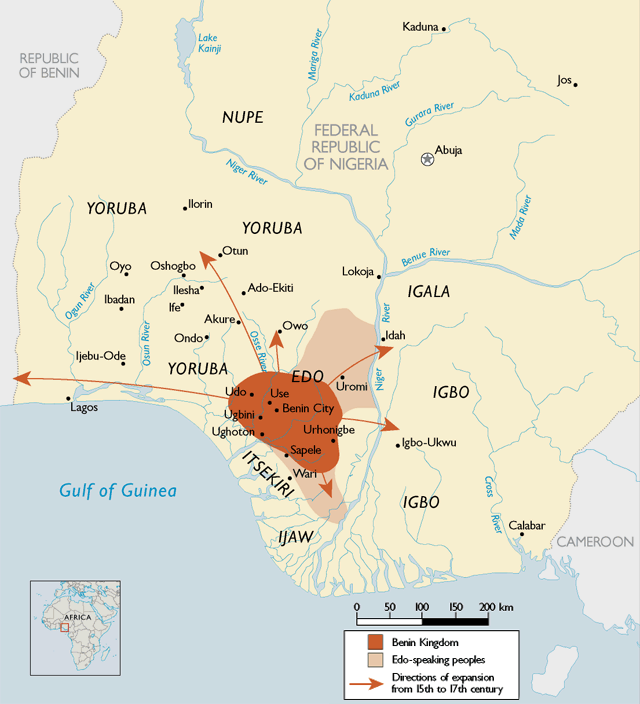
Au XIVe siècle, Ifè connaît un effondrement démographique, caractérisé par l’abandon de certaines enceintes et une forte avancée de la forêt dans des zones anciennement occupées. On constate également une rupture dans les savoir-faire et les techniques artisanales. Cet effondrement démographique pourrait s’expliquer par une épidémie de peste noire, selon certains auteurs, qui font un parallèle avec les grandes épidémies constatées en Europe sur des périodes proches.
Une partie des habitants a pu se réfugier et apporter son savoir-faire en métallurgie au Royaume du Bénin, qui dura du XIIe siècle jusqu’à son invasion par l’Empire britannique à la fin du XIXe siècle. Il s’agit d’un Etat d’Afrique de l’Ouest côtière dominé par les Edos, une ethnie dont la dynastie survit encore aujourd’hui. Son territoire correspond au Bénin actuel, plus une partie du Togo et le sud-ouest de l’actuel Nigeria, où se trouve d’ailleurs aujourd’hui « Bénin City », un port historique sur le fleuve Bénin. Au cœur de la cité, la résidence royale aux proportions monumentales traduit dans l’espace l’importance accordée au pouvoir politique, spirituel et traditionnel.
Bénin City, une merveille

L’organisation sociale de la ville impressionne les visiteurs européens à la fin du XVe siècle. Important pôle économique régional, on y trouve de l’ivoire, du poivre et des esclaves. Les Européens y échangent de l’huile de palme (le palmier à huile poussant abondamment dans la région) contre des fusils, permettant la modernisation de l’armement béninois.
Située dans une plaine, Bénin City est entourée de murs massifs au sud et de profonds fossés au nord. Au-delà des murs de la ville, de nombreuses autres murailles ont été érigées qui séparent les environs de la capitale en quelque 500 villages distincts.
En 2016, un article du Guardian retraçait la splendeur de la ville. Le journal rapporte que le livre des records Guinness de 1974 décrit les murs de Bénin City comme les plus grands travaux de terrassement au monde réalisés avant l’ère mécanique. Selon les estimations de Fred Pearce, du New Scientist, les murs de Bénin City étaient à un moment donné « quatre fois plus longs que la Grande Muraille de Chine et employaient cent fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Khéops ».
Pearce précise que ces murs « s’étendaient sur quelque 16 000 km en tout, dans une mosaïque de plus de 500 limites de colonies interconnectées. Ils couvraient 6500 km2 et ont tous été creusés par le peuple Edo… On estime qu’il a fallu 150 millions d’heures pour les construire et qu’ils constituent peut-être le plus grand phénomène archéologique de la planète ».

Bénin City fut également l’une des premières villes à s’équiper d’un semblant d’éclairage public. D’énormes lampes métalliques, hautes de plusieurs mètres, se dressaient autour de la ville, en particulier près du palais du roi. Alimentées par de l’huile de palme, leurs mèches brûlaient pendant la nuit pour éclairer la circulation à destination et en provenance du palais.
Lorsque les Portugais découvrirent la ville pour la première fois en 1485, ils furent stupéfaits de trouver ce vaste royaume, fait de centaines de villes et de villages imbriqués les uns dans les autres au milieu de la jungle africaine. Ils l’appelèrent la « Grande ville du Bénin », à une époque où il n’y avait aucun autre endroit en Afrique que les Européens reconnaissent comme une ville. Ils la classèrent comme l’une des villes les plus belles et les mieux aménagées du monde. Bénin City en 1686.

En 1691, le capitaine de navire portugais Lourenco Pinto constatait :
Le Grand Bénin, où réside le roi, est plus grand que Lisbonne ; toutes les rues sont droites et à perte de vue. Les maisons sont grandes, en particulier celle du roi, qui est richement décorée et possède de belles colonnes. La ville est riche et industrieuse. Elle est si bien gouvernée que le vol est inconnu et les gens vivent dans une telle sécurité qu’ils n’ont pas de portes pour leurs maisons.
En revanche, à la même époque, Londres est décrite par Bruce Holsinger, professeur d’anglais à l’université de Virginie, comme une ville
de vol, prostitution, meurtre, corruption et marché noir florissant, ce qui a rendu la ville médiévale mûre pour l’exploitation par ceux qui savent manier la lame rapide ou faire les poches.
Les fractales africaines
La planification et la conception de Bénin City ont été faites selon des règles précises de symétrie, de proportionnalité et de répétition, aujourd’hui connues sous le nom de « fractales ».
Le mathématicien Ron Eglash, auteur de African Fractals (qui traite des motifs sous-tendant l’architecture, l’art et le design dans de nombreuses régions d’Afrique), note que la ville et les villages environnants ont été délibérément aménagés pour former des fractales parfaites, avec des formes similaires répétées dans les pièces de chaque maison, la maison elle-même et les groupes de maisons du village selon des motifs mathématiquement prévisibles.
Lorsque les Européens arrivèrent en Afrique, précise-t-il, ils considéraient l’architecture comme très désorganisée et donc primitive. Il ne leur est jamais venu à l’esprit que les Africains pouvaient utiliser une forme de mathématiques qu’eux-mêmes n’avaient pas encore découverte.
Au centre de la ville se trouvait le Palais royal, entouré d’une trentaine de rues droites et larges chacune d’environ 120 pieds. Ces rues principales, perpendiculaires les unes par rapport aux autres, étaient dotées d’un drainage souterrain constitué d’un impluvium, avec une sortie pour évacuer les eaux d’orage. De nombreuses rues plus étroites et se croisant s’étendaient à l’extérieur. Au milieu des rues, il y avait du gazon que les animaux pouvaient paître.
Les maisons sont construites le long des rues en bon ordre, l’une à côté de l’autre, écrit Olfert Dapper, visiteur hollandais du XVIIe siècle. Elles sont généralement larges, avec de longues galeries à l’intérieur, surtout dans le cas des maisons de la noblesse, et divisées en de nombreuses pièces qui sont séparées par des murs en argile rouge, très bien érigés.
Dapper ajoute que les riches résidents ont gardé ces murs
aussi brillants et lisses en les lavant et en les frottant que n’importe quel mur en Hollande fait avec de la craie, et ils sont comme des miroirs. Les étages supérieurs sont faits de la même sorte d’argile. De plus, chaque maison est équipée d’un puits pour l’approvisionnement en eau douce.
Les maisons familiales sont divisées en trois parties : la partie centrale est le quartier du mari, qui donne sur la route ; à gauche le quartier des femmes (oderie), et à droite le quartier des jeunes hommes (yekogbe).
La vie quotidienne à Bénin City voyait peut-être se déplacer dans des rues encore plus grandes, des foules constituées de gens vêtus de couleurs vives, certains en blanc, d’autres en jaune, bleu ou vert, les capitaines de la ville jouant le rôle de juges dans les procès, modérant les débats dans les nombreuses galeries et arbitrant les petits conflits sur les marchés.
Les premiers explorateurs étrangers décrivent Benin City comme un lieu exempt de criminalité et de faim, avec de grandes rues et des maisons propres, une ville remplie de gens courtois et honnêtes, et gérée par une bureaucratie centralisée et très sophistiquée. Bénin : plaque en laiton (bronze) montrant l’entrée du Palais royal où d’autres plaques décorent les piliers.

La ville est divisée en 11 arrondissements, chacune étant une réplique en plus petit de la cour du roi, comprenant une série tentaculaire de complexes incluant des logements, des ateliers et des bâtiments publics – reliés entre eux par d’innombrables portes et passages, tous richement décorés avec l’art qui a rendu le Bénin célèbre. La ville en était littéralement recouverte.
Les murs extérieurs des cours et les faîtes des enceintes sont décorés de motifs horizontaux (agben) et de sculptures en argile représentant des animaux, des guerriers et d’autres symboles de pouvoir.
Les sculptures sont conçues pour créer des motifs contrastés sous le fort soleil. Des objets naturels (galets ou morceaux de silicium) sont également pressés dans l’argile humide, tandis que dans les palais, les piliers sont recouverts de plaques de bronze illustrant les victoires et les exploits des anciens rois et nobles.
À l’apogée de sa grandeur, au XIIe siècle (bien avant le début de la Renaissance européenne), les rois et les nobles de Bénin City ont accordé leur mécénat aux artisans et les ont comblés de cadeaux et de richesses, en échange de la représentation des grands exploits des rois et des dignitaires dans des sculptures en bronze complexes.
Ces œuvres du Bénin sont à la hauteur des plus beaux exemples de la technique de fonte européenne », écrit Felix von Luschan, ancien professeur au Musée d’ethnologie de Berlin. « [Le sculpteur et fondeur italien] Benvenuto Celini n’aurait pas pu mieux les couler, ni personne d’autre avant ou après lui. Techniquement, ces bronzes représentent la plus haute réalisation possible.
La rencontre avec « la civilisation »
Suite à la conférence de Berlin de 1885 où Britanniques, Français, Allemands et autres puissances européennes se partagent, au nom des lois immuables de la géopolitique germano-britannique, l’Afrique comme un gros gâteau qu’il entendent dévorer, les invasions européennes se multiplient et gagnent en brutalité.
Ainsi, suite au refus du roi de céder aux Britanniques son monopole sur la production de l’huile de palme et d’autres productions, lors d’une expédition punitive en 1897, Bénin City est pillée, incendiée et réduite en cendres par les Britanniques. Le roi (l’oba) est chassé et plusieurs milliers de « bronzes du Bénin », certes moins réalistes que ceux d’Ifè, sont dispersés et en partie perdus.
Ils finissent par se retrouver sur le marché de l’art et aboutissent dans des musées, notamment au British Museum (700 objets) et au Musée d’ethnologie de Berlin (500 pièces). Le gouvernement britannique lui-même en vend une partie « pour couvrir les frais de l’expédition ». Comme quoi les uns entrent dans l’histoire avec leur art, les autres avec leurs crimes. Expédition punitive de 1897. Une fois le palais royal brûlé, les pilleurs britanniques alignent les pièces en cuivre et en laiton qu’ils ramèneront en Europe.

Bibliographie sommaire :
- Ifè, une civilisation africaine, Frank Willett, Jardin des Arts/Tallandier, Paris 1971 ;
- Histoire générale de l’Afrique, Présence africaines/Edicef/Unesco, Paris 1987 ;
- Atlas historique de l’Afrique, Editions du Jaguar, Paris 1988 ;
- L’Afrique ancienne, de l’Acus au Zimbabwe, sous la direction de François-Xavier Fauvelle, Belin/Humensis, Paris 2018.

La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations


Il est de bon ton aujourd’hui de présenter les enjeux maritimes dans le cadre d’une l’idéologie géopolitique britannique moribonde dressant les pays et les peuples les uns contre les autres.
Cependant, comme le démontre cette brève histoire de la Route de la soie maritime, tirée pour l’essentiel d’un document de l’organisation internationale du tourisme, l’océan a été avant tout un lieu fantastique de rencontres fertiles, de brassages culturels et de coopérations mutuellement bénéfiques.
Les anciens Chinois ont inventé beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours, notamment le papier, les allumettes, les brouettes, la poudre à canon, la noria (élévateur), les écluses à sas, le cadran solaire, l’astronomie, la porcelaine, la peinture laque, la roue de potier, les feux d’artifice, la monnaie de papier, la boussole, le gouvernail d’étambot, le tangram, le sismographe, les dominos, la corde à sauter, les cerfs-volants, la cérémonie du thé, le parapluie pliable, l’encre, la calligraphie, le harnais pour animaux, les jeux de cartes, l’impression, le boulier, le papier peint, l’arbalète, la crème glacée, et surtout la soie dont nous aller parler ici.

Origine de la soie


Avant de parler des « routes » de la soie, deux mots sur les origines de la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage de vers à soie.
Comme le confirment des découvertes archéologiques récentes, la production de la soie représente un savoir-faire ancestral. La présence du mûrier pour l’élevage du ver à soie a été constatée en Chine autour du fleuve jaune chez la culture de Yangshao lors du néolithique moyen chinois de 4500 à 3000 av. JC.
En général, on préfère retenir la légende qui affirme que la soie a été découverte vers 2500 ans avant J.C., par la princesse chinoise Si Ling-chi, lorsqu’un cocon tomba accidentellement dans son bol de thé. En essayant de le retirer, elle s’aperçut que le cocon ramolli par l’eau chaude déployait un fil délicat, doux et solide pouvant être dévidé et assemblé. Ainsi serait née l’idée de confectionner des étoffes. La princesse décida alors de planter de nombreux mûriers blancs dans son jardin pour élever des vers à soie.
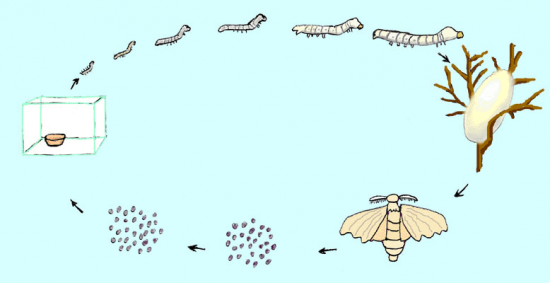
Les vers à soie (ou bombyx) et les mûriers furent divinement bien soignés par la princesse (les vers à soie se nourrissent uniquement de feuilles de mûriers blancs).
La production de soie est un processus long qui nécessite une grande surveillance. Les papillons de soie pondent environs 500 œufs au cours de leurs vies, qui est de 4 à 6 jours. Après éclosion des œufs, les bébés vers se nourrissent de feuilles de mûrier dans un environnement contrôlé. Ils ont un féroce appétit et leur poids peut considérablement augmenter. Après avoir emmagasiné suffisamment d’énergie, les vers sécrètent par leurs glandes de la soie une gelée blanche et s’en servent pour réaliser un cocon autour d’eux.
Après huit ou neuf jours, les vers sont tués et les cocons sont plongés dans de l’eau bouillante afin d’assouplir les filaments de protection qui sont enroulés sur une bobine. Ces filaments peuvent être de 600 à 900 mètres de long. Plusieurs filaments sont assemblés pour former un fil. Les fils de soie sont alors tissé pour former une toile ou utilisée pour de la broderie fine ou encore le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d’or et d’argent.
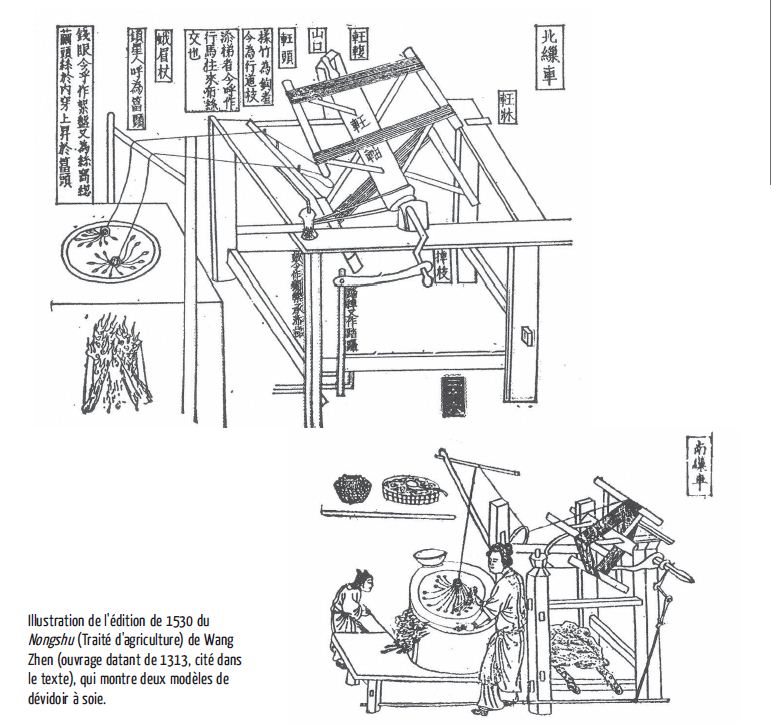
Le début du commerce de la soie
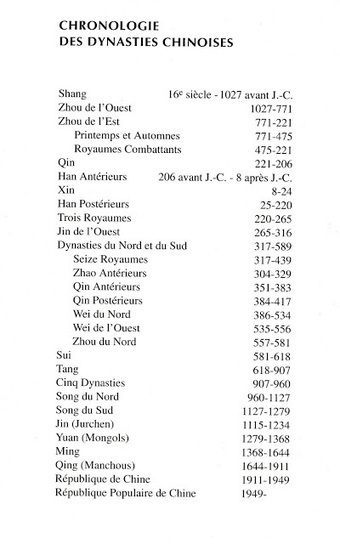
Sous la menace de la peine capitale, la sériciculture resta un secret bien gardé et la Chine conservera durant des millénaires son monopole sur la fabrication.
Ce n’est que sous la dynastie des Zhou (1112 av. JC.), qu’une Route de la soie maritime va desservir à partir de la Chine le Japon et la Corée car le gouvernement décide d’y envoyer, depuis le port situé dans la baie de Bohai (de la Péninsule de Shandong), des Chinois chargés de former les habitants à la sériciculture et l’agriculture. C’est ainsi que les techniques d’élevage du vers à soie, du bobinage et du tissage de la soie ont, peu à peu, été introduites en Corée via la mer Jaune.
Lorsque l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine (221 av. JC.), de nombreuses personnes des États de Qi, Yan et Zhao s’enfuient vers la Corée en emportant, avec eux, des vers à soie et leur technique d’élevage. Ceci va accélérer le développement de la filature de la soie dans ce pays.
Pour les relations internationales de la Chine, la Corée a joué un rôle central en particulier comme un pont intellectuel entre la Chine et le Japon. Son commerce avec la Chine a également permis la divulgation du bouddhisme et des méthodes de fabrication de la porcelaine.
Bien qu’initialement réservé à la Cour impériale, la soie s’est répandu à travers toute la culture asiatique, aussi bien géographiquement que socialement. La soie devient rapidement le tissu de luxe par excellence que la terre entière désire.
A l’époque des dynasties Han (206 av. JC à 220), un canevas dense de routes commerciales fait exploser les échanges culturels et commerciaux à travers l’Asie centrale et impacte profondément la dynamique civilisationnelle. La dynastie des Han continue la construction de la grande muraille et crée notamment la commanderie de Dunhuang (Gansu), poste clé de la Route de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles av. JC, jusqu’à la Grèce puis Rome où la soie est réservée aux élites.
Au IIIe siècle, l’Inde, le Japon et la Perse (Iran) réussissent à percer le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs.
La soie arrive en Europe
L’élevage du ver à soie, dit-on, aurait débuté en Europe au VIe siècle grâce à deux moines du Mont Athos, envoyés par l’empereur byzantin Justinien. Ils ont rapporté de Chine ou d’Inde, des œufs de vers à soie cachés dans leur bâton de pèlerin en bambou creux. Une autre version prétend que ce serait l’empereur Han Wu (IIe siècle) qui envoya des ambassadeurs, munis de présents tel que la soie, vers l’occident. L’élevage se répandit d’abord dans l’empire byzantin qui en conserva le secret.
Au VIIe siècle, la sériciculture se répand en Afrique et en Sicile où, sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l’ancien Péloponnèse.

Au Xe siècle, l’Andalousie devient l’épicentre de la fabrication de la soie avec Grenade, Tolède et Séville. Lors de la conquête arabe, la sériciculture passa en Espagne, en Italie (Venise, Florence et Milan) et en France.
Les plus anciennes traces françaises d’une activité séricicole remontent au XIIIe siècle, notamment dans le Gard (1234) et à Paris (1290).
Au XVe siècle, face à l’importation ruineuse de la soie (brute ou manufacturée) italiennes, Louis XI essaye de créer des manufactures de soieries, d’abord à Tours sur la Loire, en ensuite à Lyon, une ville au carrefour des routes nord-sud où les émigrants italiens pratiquaient déjà le commerce de soieries.
Au XIXe siècle, la production de la soie a été industrialisée au Japon mais au XXe siècle, la Chine reprend sa place comme le plus grand producteur mondial. Aujourd’hui, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Ouzbékistan et le Brésil ont des grosses capacités de production.
Brassage culturel
Autant que la soie elle-même, le transport de la soie par voie maritime remonte à des âges immémoriaux.
Pour les Chinois, il existe deux principales routes : la Route de la Soie de la Mer orientale de Chine (vers la Corée et le Japon) et la Route de la Soie de la Mer méridionale de Chine (via le détroit de Malacca vers l’Inde, le golfe Persique, l’Afrique et l’Europe). Royaume du Fou-Nan
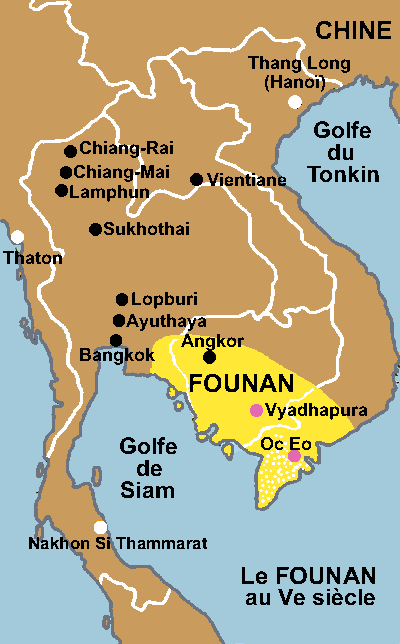
Au Vietnam, le musée de Hanoï possède une pièce de monnaie datant de l’an 152 arborant l’effigie de l’empereur romain Antonin le Pieux. Cette pièce a été découverte dans les vestiges d’Oc Eo, une ville vietnamienne située au sud du delta du Mékong, qu’on pense avoir été le port principal du Royaume du Fou-nan (Ier au IXe siècle).
Ce royaume, qui couvrait le territoire du Cambodge actuel et de la région administrative vietnamienne du delta du Mékong, a prospéré du Ier au IXe siècle. Or, la première mention du royaume du Fou-nan, apparait dans le compte rendu d’une mission chinoise qui s’y est rendue au IIIe siècle.
Les Founamiens furent à la gloire de leur puissance lorsque l’hindouisme et le bouddhisme furent introduits en Asie du Sud-Est.
Ensuite, à partir de l’Egypte, des marchands grecs ont atteint la baie de Bengale. Des quantités considérables de poivre atteignent alors Ostia, le port d’entrée de Rome. Toutes les preuves historiques démontrent que le commerce est-ouest fleurissait dès notre premier millénaire.
Perses et Arabes en Asie

Du coté occidental, à l’entrée de la baie de Koweït, à 20 kilomètres au large de la ville de Koweït City, non loin du débouché de l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate dans le golfe Persique, l’île de Failaka a été l’un des lieux de rendez-vous où la Grèce, Rome et la Chine échangeaient leurs marchandises.
Sous la dynastie des Sassanides (226-651), les Perses ont développé leurs routes commerciales jusqu’en Asie du Sud-est en passant par l’Inde et le Sri Lanka. Cette infrastructure commerciale fut reprise ensuite par les Arabes lorsqu’en 762 ils déplacèrent la capitale Omeyyade de Damas à Bagdad.


Ainsi, la ville de Quilon (Kollam), la capitale du Kerala en Inde, voit cohabiter dès le IXe siècle des colonies de marchands arabes, chrétiens, juifs et chinois.
Du coté occidental, les navigateurs perses et ensuite arabes ont joué un rôle central dans la naissance de la route de la soie maritime. A la suite des routes sassanides, les Arabes poussaient leurs dhows, c’est-à-dire les boutres ou voiliers arabes traditionnels, de la mer Rouge aux côtes chinoises et jusqu’aux confins de la Malaisie et de l’Indonésie.
Ces marins apportèrent avec eux une nouvelle religion, l’islam qui s’étendra en Asie du Sud-Est. Si initialement le pèlerinage traditionnel (le hajj) vers la Mecque ne fut qu’une aspiration pour de nombreux musulmans, il leur deviendra de plus en plus possible de l’effectuer.
Lors de la mousson, la saison où les vents sont favorables à la navigation vers l’Inde dans l’océan Indien, les missions commerciales semestrielles se transformaient en véritables foires internationales offrant du même coup une occasion pour transporter par la mer une grande quantité de marchandises dans des conditions (abstraction faite des pirates et de l’imprévisibilité du temps) relativement moins exposées aux dangers du transport par voie terrestre.
Chine : la Route de la soie maritime
sous les dynasties Sui, Tang et Song

C’est sous la dynastie Sui (581-618), qu’en partance de Quanzhou, ville côtière dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, la Route de la soie maritime trace ses premiers itinéraires commerciaux.
Riche de sa panoplie d’endroits pittoresques et de sites historiques, Quanzhou a été proclamée « point de départ de la Route de la Soie maritime » par l’UNESCO.
C’est à cette époque que les premières méthodes d’imprimerie font leur apparition en Chine. Il s’agit de blocs de bois permettant d’imprimer sur du textile. En 593, l’Empereur Sui, Wen-ti, ordonna l’impression des images et des écrits bouddhiques. Un des plus anciens textes imprimés est un écrit bouddhiste datant de 868 retrouvé dans une grotte près de Dunhuang, une ville étape de la Route de la soie.
Sous la dynastie Tang (618-907), l’expansion militaire du Royaume apporta de la sécurité, du commerce et des idées nouvelles. Le fait que la stabilité de la Chine des Tang coïncide avec celle de la Perse des Sassanides, permet alors aux routes de la soie terrestres et maritimes de prospérer. La grande transformation de la route de la soie maritime aura lieu à partir du VIIe siècle lorsque la Chine s’ouvre de plus en plus aux échanges internationaux.
Le premier ambassadeur arabe y prend ses fonctions en 651.

La Dynastie Tang choisit comme capitale la ville de Chang’an (appelé aujourd’hui Xi’an). Elle adopte une attitude ouverte vis-à-vis des différentes croyances. Des temples bouddhistes, taoïstes et confucéens y coexistent pacifiquement avec des mosquées, des synagogues et des églises nestoriennes chrétiennes.
Chang’an étant le terminus de la Route de la Soie, le marché ouest de Chang’an devient le centre du commerce mondial. Selon le registre de l’Autorité Six des Tang, plus de 300 nations et régions avaient des relations commerciales avec Chang’an.
Presque 10 000 familles de pays étrangers de l’ouest vivaient dans la ville, spécialement dans la zone autour du marché ouest. Il y avait beaucoup d’auberges étrangères dont le personnel était des servantes étrangères choisies pour leur beauté. Le poète le plus célèbre dans l’histoire Chinoise, Li Bai, flânait souvent parmi elles. La nourriture étrangère, les costumes, la musique étaient la mode de Chang’an.
Après la chute de la dynastie Tang, les Cinq dynasties et la période des dix royaumes (907-960), l’arrivée de la dynastie Song (960-1279) va inaugurer une nouvelle période faste caractérisée par une centralisation accrue et un renouveau économique et culturel. La route maritime de la soie retrouve alors de son allant. En 1168 une synagogue est érigée à Kaifeng, capitale de la dynastie Song du Sud, pour servir aux marchands de la route de la soie.
Durant la même période, de pair avec l’expansion de l’islam, des comptoirs commerciaux vont apparaître tout autour de l’océan Indien et dans le reste de l’Asie du Sud-est.
La Chine incite alors ses marchands à saisir les occasions qu’offre le trafic maritime, notamment la vente du camphre, une plante médicinale très recherchée. Un véritable réseau commercial se développe alors dans les Indes orientales sous les auspices du Royaume de Sriwijaya, une cité-Etat du sud de Sumatra en Indonésie (voir ci-dessous) qui fera pendant près de six siècles la jonction entre d’un coté les marchands chinois et de l’autre les Indiens et les Malais. Une route commerciale émerge alors réellement méritant le nom de « route de la soie » maritime.
Des quantités de plus en plus importantes d’épices passent alors par l’Inde, la mer Rouge et Alexandrie en Egypte avant d’atteindre les marchands de Gênes, Venise et les autres ports occidentaux. De là, ils repartiront vers les marchés du nord de l’Europe de Lübeck (Allemagne), Riga (Lituanie) ou encore Tallinn (Estonie), qui deviendront, à partir du XIIe siècle, des villes importantes de la Ligue hanséatique.

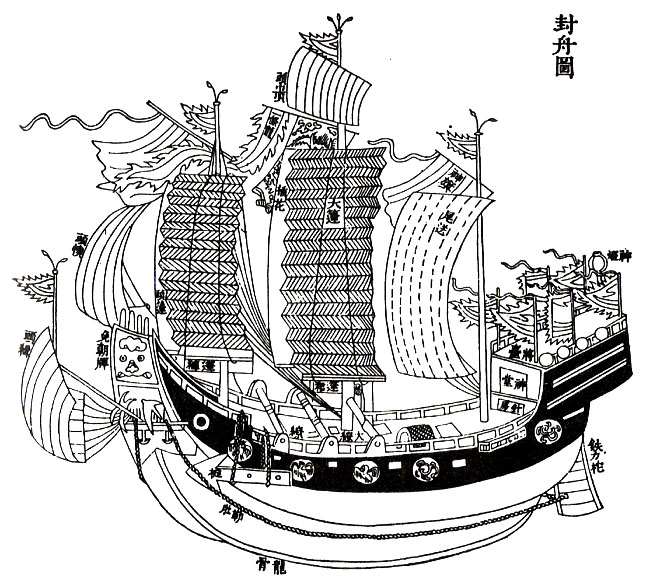
En Chine, sous le règne de l’empereur Song, Renzong (1022-1063), beaucoup d’argent et d’énergie furent dépensés pour réunir les savoirs et les savoir-faire. L’économie fut la première à en bénéficier.
En s’appuyant sur le savoir-faire des marins arabes et indiens, les navires chinois deviennent alors les plus avancés du monde.
Les Chinois, qui avaient inventé la boussole (au moins depuis l’an 1119), dépassèrent rapidement leurs concurrents au niveau de la cartographie et l’art de naviguer alors que la jonque chinoise devient le vraquier par excellence.
Dans son traité géographique, Zhou Qufei, en 1178, rapporte :
« Les gros navires qui croisent la Mer du sud sont comme des maisons. Lorsqu’ils déplient leurs voiles, on dirait d’énormes nuages. Leur gouvernail est long de plusieurs dizaines de pieds. Un seul navire peut abriter plusieurs centaines d’hommes. A bord, il y a de quoi manger pour un an ».
Des fouilles archéologiques confirment cette réalité comme par exemple l’épave d’une jonque datant du XIVe siècle, retrouvée aux larges de la Corée, dans laquelle on a découvert plus de 10 000 pièces de céramique.
Lors de cette période, le commerce côtier passe graduellement des mains des marchands arabes aux mains des marchands chinois. Le commerce s’étend, notamment grâce à l’inclusion de la Corée ainsi que l’intégration du Japon, de la côte indienne de Malabar, du golfe Persique et de la mer Rouge dans les réseaux commerciaux existants.
La Chine exporte du thé, de la soie, du coton, de la porcelaine, des laques, du cuivre, des colorants, des livres et du papier. En retour, elle importe des produits de luxe et des matières premières, notamment des bois rares, des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des épices et de l’ivoire.
Des pièces de monnaie en cuivre de la période Song ont été découvertes au Sri Lanka, et la présence de la porcelaine de cette époque a été constatée en Afrique de l’Est, en Egypte, en Turquie, dans certains Etats du Golfe et en Iran, tout comme en Inde et en Asie du Sud-est.
L’importance de la Corée et du Royaume de Silla

Pendant le premier millénaire, la culture et la philosophie ont fleuri dans la péninsule Coréenne. Un réseau marchand bien organisé et bien protégé avec la Chine et le Japon y opérait.
Sur l’île japonaise d’Okino-shima on trouve de nombreuses traces historiques témoignant des échanges intenses entre l’archipel japonais, la Corée et le continent asiatique.
Des fouilles effectuées dans des tombeaux anciens à Gyeongju, aujourd’hui une ville sud-coréenne de 264 000 habitants et capitale de l’ancien Royaume de Silla (de 57 av. JC à 935) qui contrôlait la plus grande partie de la péninsule du VIIe au IXe siècle, démontrent l’intensité des échanges de ce royaume avec le reste du monde, via la route de la soie.
L’Indonésie, une grande puissance maritime au coeur de la Route de la soie maritime
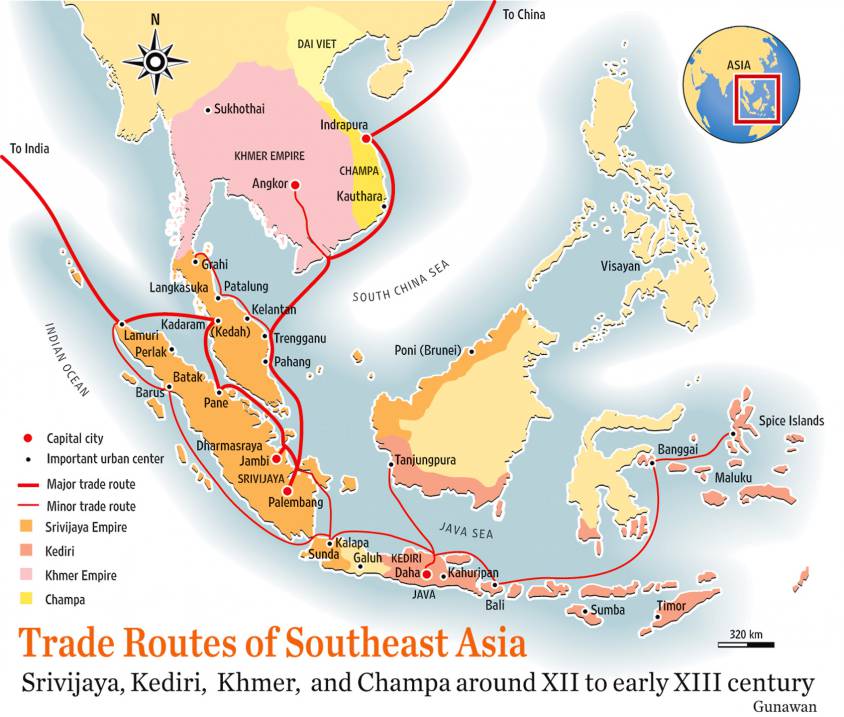
En Indonésie, en Malaisie et dans le sud de la Thaïlande, le Royaume de Sriwijaya (VIIe au XIIIe) a joué le rôle majeur de comptoir maritime où furent entreposées des marchandises de forte valeur de la région et au-delà en vue de leur commercialisation ultérieure par voie maritime. Sriwijaya contrôlait notamment le détroit de Malacca, le passage maritime incontournable entre l’Inde et la Chine.
A l’apogée de sa puissance au XIe siècle, le réseau des ports et des comptoirs sous domination Sriwijaya échangèrent une vaste palette de produits et de productions : du riz, du coton, de l’indigo et de l’argent de Java, de l’aloès (une plante succulente d’origine africaine), des résines végétales, du camphre, de l’ivoire et des cornes de rhinocéros, de l’étain et de l’or de Sumatra, du rotin, des bois rouges et d’autres bois rares, des pierres précieuses de Bornéo, des oiseaux rares et des animaux exotiques, du fer, du santal et des épices d’Indonésie orientale, d’Inde et d’Asie du Sud-est, et enfin, de Chine, des porcelaines, des laques, du brocart, des tissues et de la soie.
Avec comme capitale la ville de Palembang (à ce jour 1,7 million d’habitants) sur la rivière Musi dans ce qui est aujourd’hui la province méridionale de Sumatra, ce royaume d’inspiration hindouiste et bouddhiste, qui a prospéré du VIIIe au XIIIe siècle, a été le premier royaume indonésien d’importance et la première puissance maritime indonésienne.
Dès le VIIe siècle, il règne sur une grande partie de Sumatra, la partie occidentale de l’île de Java et une partie importante de la péninsule malaise. Avec une étendue au Nord jusqu’en Thaïlande, où des vestiges archéologiques de cités Sriwijaya existent encore.
Le musée de Palembang — une ville où communautés chinoises, indiennes, arabes et yéménites, chacun avec ses institutions particulières, co-prospèrent depuis plusieurs générations — raconte à merveille comment la Route de la soie maritime a engendré un enrichissement culturel mutuel exemplaire.
Madagascar, le sanskrit et la Route de la cannelle
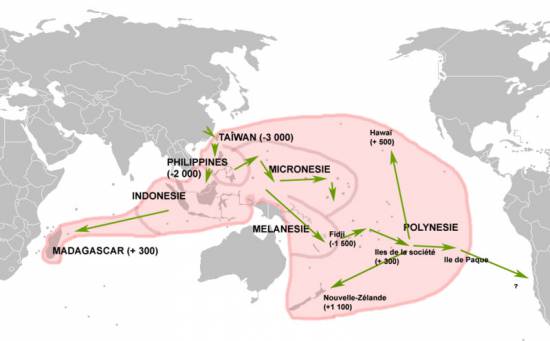
Aujourd’hui, Madagascar est habitée par des noirs et des asiatiques. Des tests ADN ont confirmé ce que l’on savait depuis longtemps : de nombreux habitants de l’île descendent de marins malais et indonésiens qui ont mis pied sur l’ile vers l’année 830 lorsque l’Empire Sriwijaya étend son influence maritime vers l’Afrique.
Autre élément de preuve de cette présence, le fait que la langue parlée sur l’île emprunte des mots sanskrits et indonésiens.
Sans surprise, la carte de l’expansion des langues austronésiennes est quasiment superposable à celle de la Route de la cannelle (ci-dessus).

Pour démontrer la faisabilité de ces voyages maritimes, une équipe de chercheurs a navigué en 2003 d’Indonésie jusqu’au Ghana en passant par Madagascar à bord du Borobudur, la reconstruction d’un des voiliers figurant dans plusieurs des 1300 bas-reliefs décorant le temple bouddhiste de Borobudur sur l’île de Java en Indonésie, datant du VIIIe siècle.
Beaucoup pensent que ce navire est une représentation de ceux que les marchands indonésiens utilisaient autrefois pour traverser l’océan jusqu’en Afrique. Les navigateurs indonésiens utilisaient habituellement des bateaux relativement petits. Pour en assurer l’équilibre, ils les équipaient de balanciers, aussi bien doubles (ngalawa) que simples.
Leurs bateaux, dont la coque était taillée dans un seul tronc d’arbre, étaient appelés sanggara. Dans leurs traversées vers l’est, les marchands de l’archipel indonésien pouvaient jadis se rendre jusqu’à Hawaii et la Nouvelle-Zélande, à une distance de plus de 7 000 km.
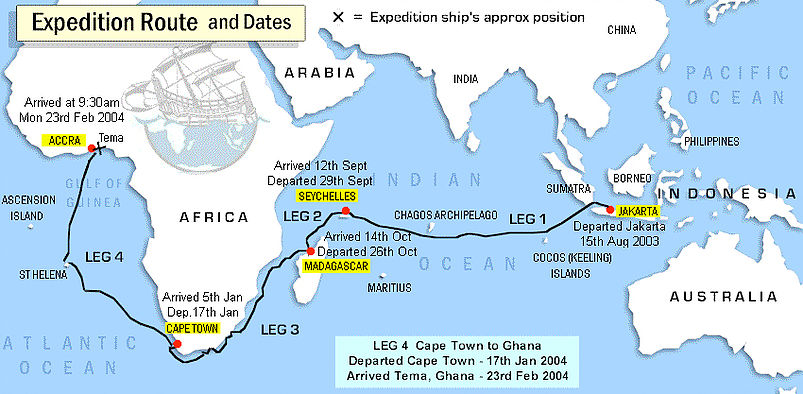

En tout cas, le bateau des chercheurs, équipé d’un mât de 18 mètres de haut, a réussi à parcourir la route Jakarta – Maldives – cap de Bonne-Espérance – Ghana, une distance de 27 750 kilomètres, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre !
L’expédition visait à refaire une route bien précise : celle de la cannelle, qui a conduit les marchands indonésiens jusqu’en Afrique pour vendre des épices, dont la cannelle, une denrée très recherchée à l’époque. Elle était déjà très prisée dans les régions du bassin méditerranéen bien avant l’ère chrétienne.
Sur les murs du temple égyptien de Deir el-Bahari (Louksor), une peinture représente une expédition navale importante dont il est dit qu’elle aurait été ordonnée par la reine Hatshepsout, qui régna de 1503 à 1482 avant JC.
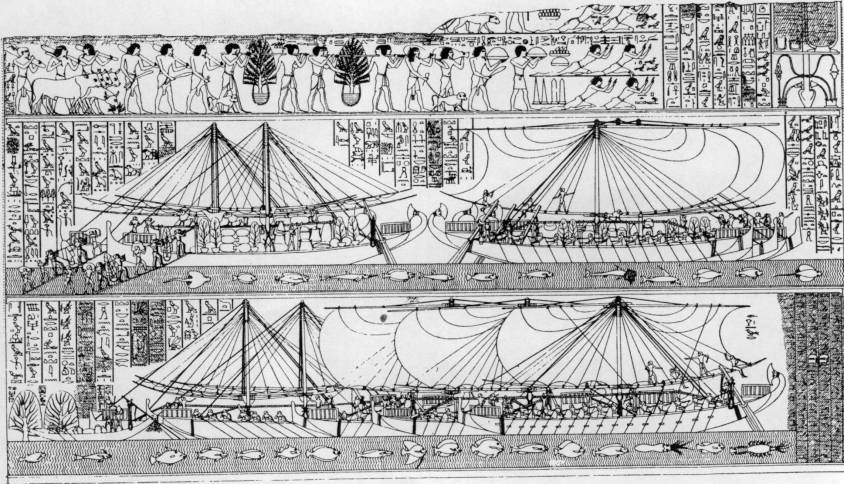
Autour de cette peinture des hiéroglyphes expliquent que ces navires transportaient diverses espèces de plantes et d’essences odorantes destinées au culte. Une de ces denrées est la cannelle. Riche en arôme, elle était une composante importante des cérémonies rituelles dans les royaumes d’Egypte.
Or, la cannelle poussait à l’origine en Asie centrale, dans l’est de l’Himalaya et dans le nord du Vietnam. Les Chinois méridionaux l’ont transplantée de ces régions dans leur propre pays et l’ont cultivée sous le nom de gui zhi.
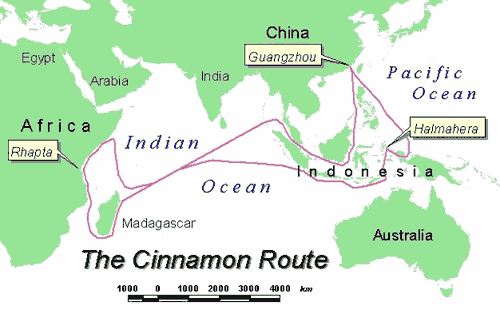
De la Chine, le gui zhi s’est répandu dans tout l’archipel indonésien, trouvant là une terre d’accueil très fertile, en particulier dans les îles Moluques. De fait, le commerce international de la cannelle était alors un monopole tenu par les marchands indonésiens. La cannelle d’Indonésie était appréciée pour son excellente qualité et son prix très compétitif.
Les Indonésiens parcouraient donc à la voile de grandes distances, jusqu’à plus de 8 000 km, traversant l’océan Indien jusqu’à Madagascar et le nord-est de l’Afrique. De Madagascar, les produits étaient transportés à Rhapta, dans une région côtière qui prit par la suite le nom de Somalie. Au-delà, les marchands arabes les expédiaient vers le nord jusqu’à la mer Rouge.
Le détroit de Malacca
Pour la Chine, le détroit de Malacca a toujours représenté un intérêt stratégique majeur. À l’époque où le grand amiral chinois Zheng He mène la première de ses expéditions vers l’Inde, le Proche-Orient et l’Afrique de l’Est entre 1405 et 1433, un pirate chinois du nom de Chen Zuyi a pris le contrôle de Palembang. Zheng He défait la flotte de Chen et capture les survivants. Du coup, le détroit est redevenu une route maritime sûre.
Selon la tradition, un prince de Sriwijaya, Parameswara, se réfugie sur l’île de Temasek (l’actuelle Singapour) mais s’établit finalement sur la côte ouest de la péninsule malaise vers 1400 et fonde la ville de Malacca, qui deviendra le plus grand port d’Asie du Sud-est, à la fois successeur de Sriwijaya et précurseur de Singapour.
Suite au déclin de Sriwijaya, c’est le Royaume de Majapahit (1292-1527), fondé à la fin du XIIIe siècle sur l’île de Java, qui dominera la plus grande partie de l’Indonésie actuelle.

C’est l’époque où les marins arabes commencent à s’installer dans la région.
Le royaume de Majapahit noua des relations avec celui le Royaume de Champa (192-1145 ; 1147-1190 ; 1220-1832) (Sud Vietnam), du Cambodge, du Siam (la Thaïlande) et du Myanmar méridional.
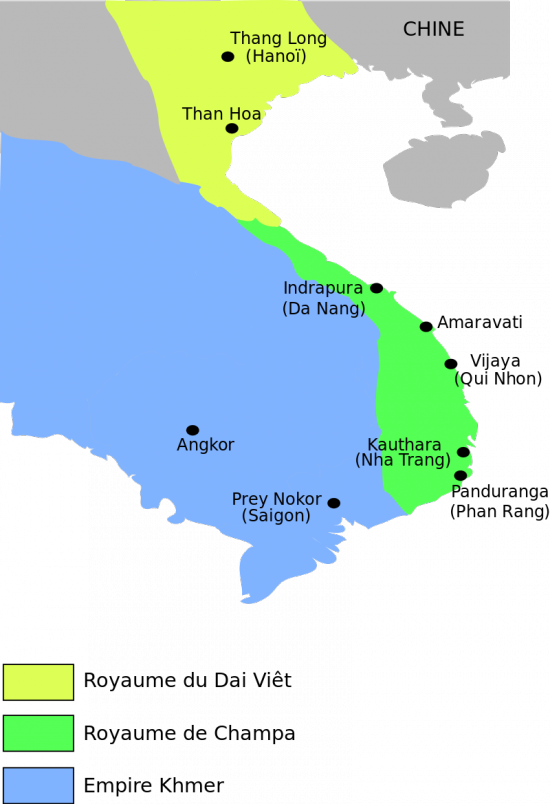
Le royaume de Majapahit envoyait également des missions en Chine. Alors que ses dirigeants étendirent leur pouvoir sur d’autres îles et mirent à sac les royaumes voisins, il chercha avant tout à augmenter sa part et son contrôle sur le commerce des marchandises transitant par l’archipel.
L’île de Singapour et la partie la plus au sud de la péninsule malaise fut un carrefour clé de l’ancienne Route de la soie maritime. Des fouilles archéologiques entrepris dans l’estuaire du Kallang et le long du fleuve Singapour, ont permis de découvrir des milliers d’éclats de verre, des perles naturelles ou en or, des céramiques et des pièces de monnaie chinoises de la période des Song du nord (960-1127).
La montée de l’Empire mongol au milieu du XIIIe siècle va provoquer l’accroissement du commerce par la mer et contribuer à la vitalité de la Route de la soie maritime. Marco Polo, après un voyage terrestre qui dura 17 ans, vers la Chine reviendra par bateau. Après avoir été témoin d’un naufrage, il passa de la Chine à Sumatra en Indonésie avant de remettre pied à terre à Ormuz en Perse (Iran).
Sous les dynasties Yuan et Ming
Sous la dynastie des Song, on exporte, vers le Japon, une quantité importante d’articles de soie. Sous celle des Yuan (1271-1368), le gouvernement instaure le Shi Bo Si, bureau en charge des échanges commerciaux, dans de nombreux ports comme, notamment, Ningbo, Canton, Shanghai, Ganpu, Wenzhou et Hangzhou, permettant, ainsi, l’exportation des soieries vers le Japon.
Durant les dynasties des Tang, Song et Yuan, et au début de celle des Ming, on assiste, dans chaque port, à la création d’un département océanique de négoce pour gérer l’ensemble des échanges commerciales extérieures maritimes.
Le commerce avec les sud de l’Inde et du golfe Persique fleurit. Le commerce avec l’Afrique de l’Est se développe également en fonction de la mousson et apporte de l’ivoire, de l’or et des esclaves. En Inde, des guildes commencent à contrôler le commerce chinois sur la côte du Malabar et au Sri Lanka. Les relations commerciales se formalisent tout en restant soumises à une forte concurrence. Cochin et Kozhikode (Calicut), deux grandes villes de l’Etat indien du Kerala, rivalisent alors pour dominer ce commerce.
Les explorations maritimes de l’amiral Zheng He
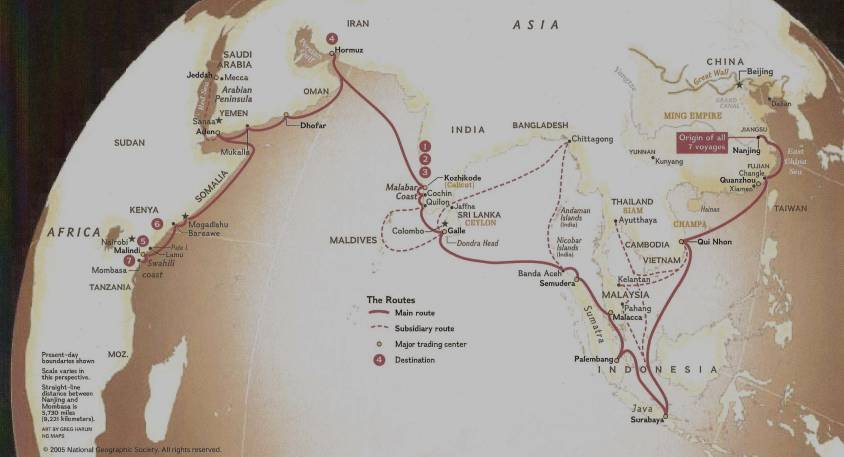
Les explorations maritimes chinoises connaitront leur apogée au début du XVe siècle sous la dynastie Ming (1368-1644) qui, pour diriger sept expéditions diplomatiques navales, choisira un eunuque musulman de la cour, l’amiral Zheng He.
Financées par l’Empereur Ming Yongle, ces missions pacifiques en Asie du Sud-est, en Afrique de l’Est, dans l’Océan indien, dans le golfe Persique et en Mer Rouge, viseront avant tout à démontrer le prestige et la grandeur de la Chine et de son Empereur. Il s’agit également de reconnaître une trentaine d’Etats et de nouer des relations politiques et commerciales avec eux.
En 1409, avant une des expéditions, l’amiral chinois Zheng He demanda à des artisans de fabriquer une stèle en pierre taillée à Nanjing, actuelle capitale de la province du Jiangsu (est de la Chine). La stèle voyagea avec la flottille et fut laissée au Sri Lanka comme cadeau à un temple bouddhiste local. Des prières aux divinités en trois langues -chinois, persan et tamoul- furent gravés sur la stèle. Elle fut retrouvé en 1911 dans la ville de Galle, dans le sud-ouest du Sri Lanka et une réplique se trouve aujourd’hui en Chine.
L’armada de Zheng était composée de vraquiers armés, le plus modeste étant plus grand que les caravelles de Christophe Colomb. Les plus vastes atteignaient une longueur de 100 et une largeur de 50 mètres. D’après les chroniques Ming de l’époque, une expédition pouvait comprendre 62 navires avec 500 personnes à bord chacun. Certains d’entre eux transportaient la cavalerie militaire et d’autres des réservoirs d’eau potable. La construction navale chinoise était en avance. La technique de cloisons hermétiques, imitant la structure interne du bambou, offrait une sécurité incomparable. Elle fut la norme pour la flotte chinoise avant d’être copiée par les Européens 250 ans plus tard. A cela s’ajoutait l’emploi de la boussole et celui de cartes célestes peintes sur soie.
La synergie qui a pu exister entre marins arabes, indiens et chinois, tous des hommes de mer qui fraternisent face à l’adversité de l’océan, a de quoi nous impressionner. Par exemple, certains historiens estiment qu’il n’est pas exclu que le nom « Sindbad le marin », qui apparaît dans la fable d’origine perse qui conte les aventures d’un marin du temps de la dynastie des Abbassides (VIIIe siècle) et fut intégrée dans les Contes des Mille et Une Nuits, dérive du mot Sanbao, le surnom honorifique donné par l’Empereur chinois à l’amiral Zheng He, signifiant littéralement « Les trois joyaux », c’est-à-dire les trois vertus capitales indissociables communes aux principales philosophies que sont l’Eveil (qui permet d’apprendre), l’Altruisme (qui permet la compréhension de l’autre) et l’Equité (qui invite à partager avec lui).

Aussi bien en Chine (à Hong-Kong, à Macao, à Fuzhou, à Tianjin et à Nanjing) qu’à Singapour, en Malaisie et en Indonésie, des musées maritimes mettent les expéditions de l’amiral Zheng en valeur.
Soulignons cependant qu’au moins douze autres amiraux ont effectué des expéditions similaires en Asie du Sud-est et dans l’océan Indien. En 1403, l’amiral Ma Pi a conduit une expédition jusqu’en Indonésie et en Inde. Wu Bin, Zhang Koqing et Hou Xian en ont fait d’autres. Après que la foudre avait provoqué un incendie de la Cité interdite, une dispute éclata entre la classe des eunuques, partisans des expéditions, et des mandarins lettrés, qui obtiendront l’arrêt d’expéditions jugées trop onéreuses. Le dernier voyage a eu lieu entre 1430 et 1433, c’est-à-dire 64 ans avant que l’explorateur portugais Vasco da Gama ne se rende sur les mêmes lieux en 1497.
Le Japon, de son coté, de façon similaire, a restreint ses contacts avec le monde extérieure lors de la période Tokugawa (1600-1868) bien que son commerce avec la Chine ne fut jamais suspendu. Ce n’est qu’après la restauration Meiji en 1868 qu’un Japon ouvert au monde a ré-émergé.
Dans un repli sur eux-mêmes, le commerce aussi bien la Chine que du Japon tomba aux mains de comptoirs maritimes comme Malacca en Malaisie ou Hi An au Vietnam, deux villes aujourd’hui reconnues par l’Unesco comme patrimoine de l’humanité. H ?i An était un port étape majeur sur la route maritime reliant l’Europe et le Japon en passant par l’Inde et la Chine. Dans les épaves de navires retrouvées à Hi An, les chercheurs ont retrouvé des céramiques qui attendaient leur départ pour le Sinaï en Egypte.
Histoire des ports chinois
Au fil des années, on assiste à une évolution en ce qui concerne les principaux ports de la Route maritime de la Soie. A partir des années 330, Canton et Hepu étaient les deux ports les plus importants.
Cependant, Quanzhou se substitue à Canton, de la fin de la dynastie des Song à celle des Yuan.
A cette époque, Quanzhou, dans la province du Fujian et Alexandrie en Egypte étaient considérés comme les plus vastes ports du monde. A cause de la politique de fermeture sur le monde extérieur imposée à partir de 1435 et de l’influence des guerres, Quanzhou a été, progressivement, remplacé par les ports de Yuegang, Zhangzhou et Fujian.
Dès le début du IVe siècle, Canton est un important port de la Route maritime de la Soie. Peu à peu, il devient le plus vaste mais, également, le port d’Orient le plus renommé à travers le monde sous les dynasties des Tang et des Song. Durant cette période, la route maritime reliant Canton au golfe persique en passant par la Mer de Chine méridionale et l’océan Indien est la plus longue du monde.
Bien que plus tard supplanté par Quanzhou sous la dynastie des Yuan, le port de Canton demeurera le second plus grand port commercial de Chine. Par comparaison avec les autres, on le considère comme étant un port durablement prospère au cours des 2000 ans d’histoire de la Route maritime de la Soie.
Le système tributaire de 1368
La dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, a régné de 1644 à 1912. Depuis l’arrivée de la dynastie Ming, les échanges commerciaux maritimes avec la Chine s’organisaient de deux façons :
- le « système tributaire » chinois ;
- le système dit « de Canton » (1757–1842).
Né sous les Ming en 1368, et le « système tributaire » atteindra son apogée sous les Qing. Il prend alors la forme raffinée d’une hiérarchie inclusive mutuellement bénéfique. Les Etats qui y adhèrent faisaient preuve de respect et de reconnaissance en présentant régulièrement à l’Empereur un tribut composé de produits locaux et en exécutant certaines cérémonies rituelles, notamment le « kowtow » (trois génuflexions et neuf prosternations). Ils demandaient également l’investiture de leurs dirigeants par l’Empereur et adoptaient le calendrier chinois. Outre la Chine, on y retrouvait le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, les îles Ryükyü, le Laos, le Myanmar et la Malaisie.
Paradoxalement tout en occupant un statut culturel central, le système tributaire offrait à ses vassaux un statut d’entité souveraine et leur permettait d’exercer leur autorité sur une aire géographique donnée. L’Empereur gagnait leur soumission en se préoccupant vertueusement de leur bien-être et en promouvant une doctrine de non-intervention et de non-exploitation. En effet, d’après les historiens, en termes financiers, la Chine ne s’est jamais enrichie d’une façon directe avec le système tributaire. En général, tous les frais de voyage et de séjour des missions tributaires étaient couverts par le gouvernement chinois. En plus des coûts de fonctionnement du système, les cadeaux offerts par l’Empereur avaient en général beaucoup plus de valeur que les tributs qu’il recevait. Chaque mission tributaire avait en effet le droit d’être accompagnée par un grand nombre de commerçants et une fois le tribut présenté à l’Empereur, le commerce pouvait commencer.
Il est à noter que, lorsqu’un pays perdait son statut d’Etat tributaire suite à un désaccord, ce dernier essayait à tout prix et parfois de façon violente d’être à nouveau autorisé à payer le tribut.
Le système de Canton de 1757

Le deuxième système concernait les puissances étrangères, principalement européennes, désireuses de faire du commerce avec la Chine. Il passait par le port de Guangzhou (à l’époque appelé Canton), le seul port accessibles aux Occidentaux.
Ainsi, les marchands, notamment ceux de la Compagnie britanniques des Indes orientales, pouvaient accoster, non pas dans le port mais devant la côte de Canton, d’octobre à mars, lors de la saison commerciale. C’est à Macao, à l’époque une possession Portugaise, que les Chinois leur fournissait le cas échéant une permission à cet effet. Les représentants de l’Empereur autorisaient alors des marchands chinois (les hongs) de commercer avec des navires étrangers tout en les chargeant de collecter les droits de douane avant qu’ils ne repartent.
Cette façon de commercer s’est amplifiée à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la forte demande anglaise de thé. C’est d’ailleurs du thé chinois de Fujian que les « insurgés » américains ont jeté à la mer lors de la fameuse « Boston Tea Party » de décembre 1773, un des premiers événements contre l’Empire britannique qui déclenchera la Révolution américaine. Des produits en provenance de l’Inde, en particulier le coton et l’opium furent échangés par la Compagnie des Indes orientales contre du thé, de la porcelaine et de la soie.
Les droits de douane collectés par le système de Canton étaient une source majeure de revenus pour la dynastie des Qing bien qu’elle bannira l’achat d’opium en provenance de l’Inde. Cette restriction imposée par l’Empereur chinois en 1796 conduira au déclenchement des guerres de l’Opium, la première dès 1839. En même temps, des rebellions éclatèrent dans les années 1850-60 contre le règne affaibli des Qing, doublées de guerres supplémentaires contre des puissances européennes hostiles.

En 1860, l’ancien Palais d’été (parc Yuanming), avec un ensemble de pavillons, de temples, de pagodes et de librairies, c’est-à-dire la résidence des empereurs de la dynastie Qing à 15 kilomètres au nord-ouest de la Cité interdite de Pékin, fut ravagée par les troupes britanniques et françaises lors de la Seconde guerre de l’opium. Cette agression reste dans l’histoire comme l’un des pires actes de vandalisme culturel du XIXe siècle. Le Palais fut mis à sac une deuxième fois en 1900 par une alliance de huit pays contre la Chine.
Aujourd’hui, on peut y admirer une statue de Victor Hugo et un texte qu’il avait écrit pour s’élever contre Napoléon III et les destructions de l’impérialisme français, pour rappeler que cela était non pas le fait d’une nation, mais celui d’un gouvernement.
A la fin de la première guerre mondiale, la Chine disposait de 48 ports ouverts où les étrangers pouvaient commercer en suivant leurs propres juridictions. Le XXe siècle fut une ère de révolutions et de changements sociaux. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 engendra un repli sur soi.
Ce n’est qu’en 1978 que Deng Xiaoping annonça une politique d’ouverture sur le monde extérieur en vue de la modernisation du pays.
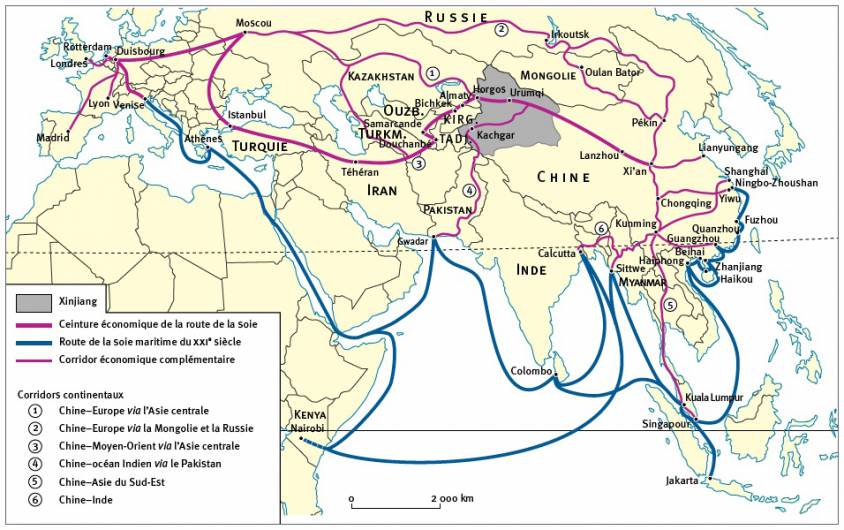
Au XXIe siècle, grâce à l’Initiative une ceinture (économique) une route (maritime) lancée par le Président Xi Jingping, la Chine ré-émerge comme une grande puissance mondiale offrant des coopérations mutuellement bénéfiques au service d’un meilleur avenir partagé pour l’humanité.
« l’Homme de Vitruve » de Léonard de Vinci

Alors que nous commémorons cette année, avec une belle exposition au Louvre, Léonard de Vinci (1452-1519), mort en France il y a cinq cents ans, bien des bêtises circulent à propos de ce personnage si inspirant.
Ayant eu la chance de pouvoir assimiler, dès mon adolescence, les rudiments de l’anatomie lors de ma formation à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles comme peintre-graveur, je m’efforcerais ici de vous livrer quelques clés permettant au grand public de pleinement apprécier un dessin très connu de Léonard, présent à Paris, « l’Homme de Vitruve ».
Or, comme Léonard l’indique lui-même dans ses carnets en reprenant l’expression de Nicolas de Cues, ce n’est qu’avec « les yeux de l’esprit » que l’art nous devient « visible », car les « yeux de la chair » y sont aveugles.
Canons de proportions

La civilisation grecque, et avec elle celle de l’Europe, comme chacun le sait, n’a pu atteindre toute sa splendeur que grâce à l’assimilation patiente des apports d’autres grandes civilisations.
L’Asie, connue chez nous grâce au monde arabo-musulman, et l’Afrique, en particulier l’Égypte, jouèrent un rôle majeur. Les cultes funéraires de l’Égypte ancienne, dont la momification des défunts, permirent aux médecins locaux, grecs et levantins travaillant en Égypte, d’explorer les secrets du corps humain.
Comme le montrent les sculptures de l’Égypte ancienne, la taille exacte du corps humain avoisine l’équivalent de 7 ¼ à 7 ½ la taille de la tête d’un individu.
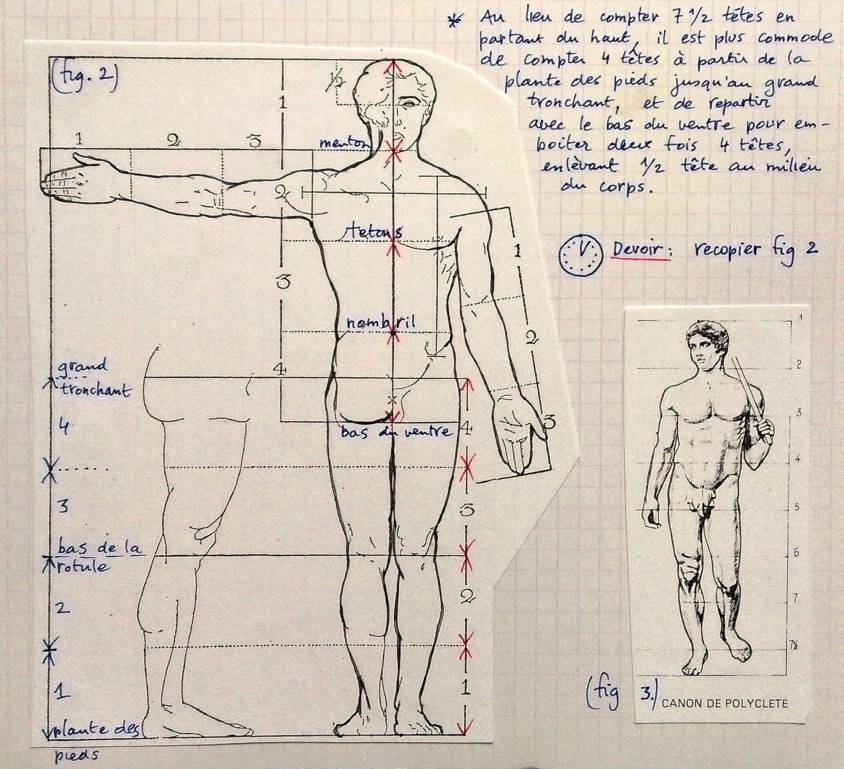
La taille d’un nouveau-né dépasse à peine 4 têtes, celle d’un enfant de sept ans est de 6 têtes, et celle d’un adolescent de dix-sept ans atteint les 7 têtes.
En sous-divisant la partie supérieure du corps humain, du sommet du crâne jusqu’au bas du torse, l’on mesure 4 têtes : la première jusqu’au menton ; la deuxième jusqu’aux mamelons ; la troisième jusqu’au nombril et la quatrième jusqu’au pubis. En partant de l’autre bout du corps humain, en remontant à partir de la plante des pieds, l’on mesure également 4 têtes : 2 jusqu’au haut du genou et 2 têtes supplémentaires jusqu’au « grand trochanter », c’est-à-dire l’articulation entre le fémur et l’os iliaque du bassin.
Ces deux fois quatre têtes s’emboîtent au milieu de notre corps d’une demie tête, ce qui donne, non pas huit, mais 7 ½ têtes au total. Ces tailles varient proportionnellement avec la taille du corps et toute disproportion provoque assez vite un sentiment de monstruosité.
Polyclète contre Lysippe
Dès le Ve siècle, le sculpteur grec Polyclète capta, dans son fameux « doryphore » (porteur de lance) du Musée national d’archéologie de Naples, ce magnifique canon anatomique, connu depuis comme le « canon de Polyclète ».
Il faut souligner qu’à l’époque de la Renaissance, certains nostalgiques de l’Empire romain préféraient un autre canon grec, celui de Lysippe (IVe siècle av. J.C.), codifié par la suite par l’architecte, auteur et ingénieur civil romain Vitruve (Ier siècle av. J.C.).
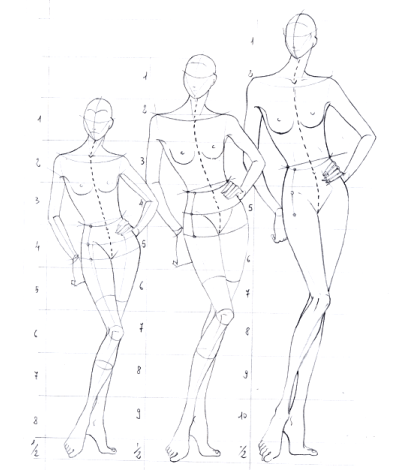
Vitruve n’a fait qu’exprimer le goût dominant de son époque. Les sculpteurs grecs, afin de donner une apparence athlétique et héroïque aux Empereurs dont ils dressaient les portraits, en adoptant le « canon de Lysippe », réduisaient souvent la tête de leur modèle à seulement 1/8e de la longueur totale du corps.
Ainsi, avec la réduction de la taille de la tête, celle du corps se retrouva proportionnellement augmentée permettant à la figure de gagner en proéminence musculaire, chose que les empereurs, pas forcément doté dès la naissance d’un physique à la hauteur de leur ambition, ne pouvaient qu’apprécier et favorisaient grandement leur popularité.
L’engouement pour cette astuce a même conduit certains artistes à imaginer des figures 12 à 15 fois la taille de leur tête. En bref, les relations publiques trônaient au détriment de la science et de la vérité.
Aujourd’hui les illustrateurs de bandes dessinées choisissent les proportions selon le rôle qu’ils veulent donner à leur sujet :
— pour une personne ordinaire : 7,5 ou « canon normal »
— pour une star de cinéma : 8 têtes ou « canon idéalisé »
— pour un modèle de mode : 8,5 têtes
— pour un héro du type superman : 9 têtes ou « canon héroïque »
L’Homme de Vitruve
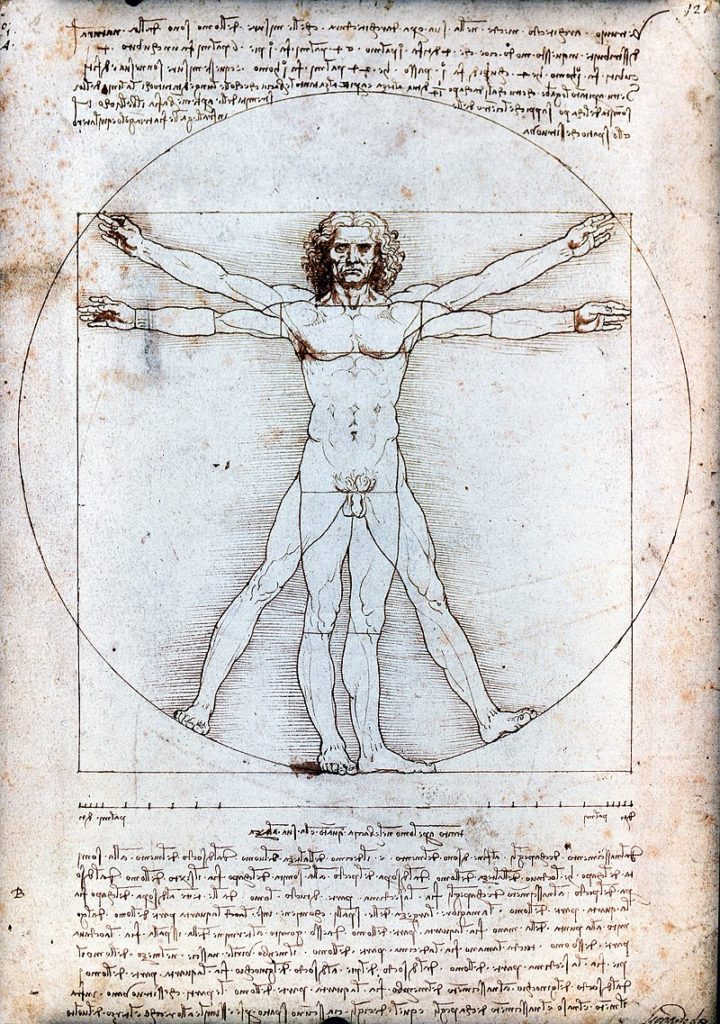
Autour du dessin, le texte suivant, en image miroir, traduction de Léonard d’un extrait du Livre III sur l’Architecture de Vitruve :
« Vitruve dit, dans son ouvrage sur l’architecture : la Nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci :
Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un coude : quatre coudes font la hauteur d’un homme. Et quatre coudes font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures dans ses constructions.
Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral.
La longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur.
Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un septième.
Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart. Depuis le coude jusqu’à l’aisselle, un huitième.
La main complète est un dixième de l’homme. La naissance du membre viril est au milieu. Le pied est un septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme.
La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage. »
Évidemment, le fait que Léonard, en le dessinant, ait étudié « l’Homme de Vitruve », ne signifie nullement qu’il s’agisse là des « proportions idéales ». Sans doute, en disséquant plusieurs cadavres de façon clandestine comme il fut obligé de le faire à l’époque, le maître s’est-il forgé sa propre idée sur la question.
Musclé
Il faut savoir qu’en Italie, le pur goût romain est redevenu tendance suite à la découverte en 1506 de la statue du Laocoon sur l’emplacement de la villa de Néron à Rome. On y redoublera le volume des masses musculaires prétendant travailler « à l’Antique ».
Bien qu’il n’ait jamais critiqué ouvertement ce courant, on a du mal à ne pas penser aux fresques de Michelange dans la Chapelle Sixtine, lorsque Léonard, cherchant à élever l’esprit à des hauteurs philosophiques inégalées, conseille aux peintres : « ne donne pas à tous les muscles des figures un volume exagéré » et « si tu agis différemment c’est davantage à la représentation d’un sac de noix que tu seras parvenu qu’à celle d’une figure humaine » (Codex Madrid II, 128r).
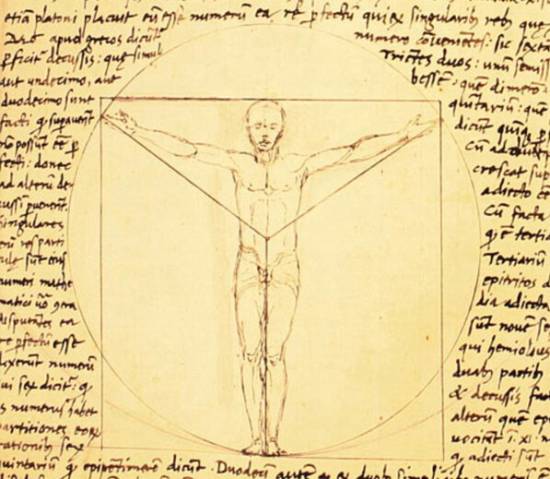
Sans doute inspiré par son ami, l’architecte Giacomo Andréa, dans « l’Homme de Vitruve », Léonard s’intéresse avant tout à d’autres harmonies : si une personne étend ses bras en direction parallèle au sol, l’on obtient la même longueur que toute sa taille.
Egalité que Léonard inscrit dans un carré (symbole du domaine terrestre). Si l’on étire ses bras et ses jambes en étoile, ils s’inscrivent dans un cercle dont le centre est le nombril. Or, l’emplacement de ce dernier divise le corps selon le nombre d’or (dans cet exemple 5 têtes sur un total de 8 têtes, 5+3 faisant partie de la série de Fibonnacci : 1+2 = 3 ; 3+2 = 5 ; 5+3 = 8 ; 8+5 = 13 ; 13+8 = 21, etc.).
Proportion d’or
Léonard avait compris ce que signifie réellement la proportion d’or : non pas un « nombre magique » en lui-même, ni une fantaisie numérologique, mais l’expression et le reflet, dans le visible, d’une dynamique de moindre action qui caractérise aussi bien le principe du vivant que celui du travail humain, c’est-à-dire le principe même qui unit l’homme (le carré) au Créateur et à l’univers (le cercle).
Alors, si vous y jetez un œil, faites attention ! Car, il y a ce que vous voyez, et ce que vous vous interdisez de voir !
Index, Études Renaissance

INDEX, Etudes Renaissance
- Mohenjo-Daro, Harappa: Le défi que nous lance la modernité de la Civilisation de l’Indus (FR en ligne);
- Mohenjo-Daro, Harappa : The challenging modernity of the Indus Valley Civilization (EN online);
- La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations (FR en ligne)
- The Maritime Silk Road, a History of 1001 cooperations (EN online);
- Afghanistan, le pays des 1000 cités d’or et l’histoire d’Aï Khanoum (FR en ligne);
- Afghanistan: the Land of a 1000 Golden Cities and Aï-Khanoun (EN online);
- Le miracle du Gandhara, quand Bouddha s’est fait homme (FR en ligne);
- The miracle of Gandhara: when Buddha turned himself into man (EN online);
- Derrière les chevaux célestes chinois, la science terrestre (FR en ligne);
- The Earthly Science behind China’s Heavenly Horses (EN online);
- Et l’Homme créa l’acier… (FR en ligne);
- Portraits du Fayoum: un regard de l’au-delà (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio);
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: The Greek tradition behind the Fayum Mummy Portraits (EN audio);
- La pratique ancestrale d’annulation des dettes (FR en ligne);
- The Ancient Practice of Debt Cancelation (EN online);
- Bagdad, Damas, Cordoue, creuset d’une civilisation universelle (FR online);
- Mutazilisme et astronomie arabe, deux étoiles brillantes au firmament de la civilisation (FR en ligne). (EN online version);
- Qanâts perses et Civilisation des eaux cachées (FR en ligne). (EN online version).
- Renaissance africaine: la splendeurs des royaumes d’Ifè et du Bénin (FR en ligne) + (EN online);
- Sur la peinture chinoise et son influence en Occident (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).
- L’invention de la perspective FR pdf (Fusion) + EN pdf (Fidelio);
- La révolution du grec ancien, Platon et la Renaissance (FR en ligne)
- The Greek language project, Plato and the Renaissance (EN online).
- Les Frères de la vie commune et la Renaissance du nord (FR en ligne)
- Moderne Devotie en Broeders van het Gemene Leven, bakermat van het humanisme (NL online)
- Devotio Moderna, Brothers of the Common Life, the cradle of humanism in the North (EN online)
- 1405: l’amiral Zheng et les expéditions maritimes chinoises (FR en ligne)
- Jan van Eyck, la beauté comme prégustation de la sagesse divine (FR en ligne) + EN on line.
- Jan Van Eyck, un peintre flamand dans l’optique arabe (FR en ligne)
- Jan Van Eyck, a Flemish Painter using Arab Optics (EN online)
- Rogier Van der Weyden, maître de la compassion (FR pdf)
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Van der Weyden and Cusanus (EN online audio);
- Comment Jacques Cœur a mis fin à la Guerre de Cent Ans (FR en ligne);
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Who whispered in the Ear of Joan of Arc? (EN online audio);
- Hugo van der Goes et la Dévotion moderne (FR en ligne)
- A la découverte d’un tableau (FR en ligne)
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Ghirlandaio’s immortality (EN online audio);
- Avicenne, Ghiberti, leur rôle dans l’invention de la perspective à la Renaissance (FR en ligne) et EN online.
- ENTRETIEN Omar Merzoug: Avicenne ou l’islam des lumières (FR en ligne). + EN pdf.
- Les secrets du dôme de Florence (FR en ligne) + EN pdf (Schiller Institute archive website) + DE pdf (Neue Solidarität).
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Cimabue, Giotto, Fra Angelico; Wonders of the Italian Trecento (EN online audio);
- L’œuf sans ombre de Piero della Francesca (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Antonello de Messina in the Image of Christ (EN audio online)
- Uccello, Donatello, Verrocchio et l’art du commandement militaire (FR en ligne) et EN online.
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Leonardo and Verrochio’s workshop (EN audio online)
- La Cène de Léonard, une leçon de métaphysique (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).
- Léonard de Vinci : peintre de mouvement (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Mona Lisa made in China? (EN online audio);
- La Vierge aux rochers, l’erreur fantastique de Léonard (FR en ligne).
- Romorantin et Léonard ou l’invention de la ville moderne (FR en ligne) + EN pdf (Executive Intelligence Review) + DE pdf (Neue Solidarität) + IT pdf (Movisol website).
- L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci (FR en ligne) + EN online.
- Léonard en résonance avec la peinture traditionnelle chinoise — entretien avec Le Quotidien du Peuple. (en ligne: texte chinois suivi des traductions FR + EN).
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Leonardo didn’t like painting (EN online audio)
- Raphaël, entre mythe et réalité (FR pdf + EN pdf)
- Raphaël 1520-2020 : ce que nous apprend « L’Ecole d’Athènes » (FR en ligne).
- Raphael 1520-2020: What Humanity can learn from the « School of Athens » (EN online)
- Comment la folie d’Erasme sauva notre civilisation (FR en ligne) + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website) + DE pdf (Neue Solidarität).
- Le rêve d’Erasme: le Collège des Trois Langues de Louvain (FR en ligne)
- Erasmus‘ dream: the Leuven Three Language College (EN online);
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Erasmus had no time to pause for portraits (EN online audio);
- ENTRETIEN: Jan Papy: Erasme, le grec et la Renaissance des sciences (FR en ligne)
- Dirk Martens, l’imprimeur d’Erasme qui diffusa le livre de poche (FR en ligne).
- 1512-2012 : Mercator et Frisius, des cosmographes aux cosmonautes + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website).
- La nef des fous de Sébastian Brant (FR en ligne), un livre d’une grande actualité !
- Avec Jérôme Bosch sur la trace du Sublime (FR en ligne) + EN pdf.
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: How Bosch’s Ship of Fools drove the Jester out of business (EN online audio);
- Joachim Patinir et l’invention du paysage en peinture (FR en ligne).
- Joachim Patinir and the invention of landscape painting (EN online)
- Exposition de Lille : ce que nous apprennent les fabuleux paysages flamands (FR en ligne).
- Portement de croix: redécouvrir Bruegel grâce au livre de Michael Gibson (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).
- ENTRETIEN Michael Gibson: Pour Bruegel, le monde est vaste (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio)
- Pierre Bruegel l’ancien, Pétrarque et le Triomphe de la Mort (FR en ligne) + EN online.
- A propos du film « Bruegel, le moulin et la croix » (FR en ligne).
- L’ange Bruegel et la chute du cardinal Granvelle (FR en ligne).
- Albrecht Dürer contre la mélancolie néo-platonicienne + EN pdf.
- How neo-Platonism gave Plato a bad name (EN pdf).
- Le combat inspirant d’Henri IV et de Sully + EN pdf (Schiller Institute Archives Website).
- La paix de Westphalie, une réorganisation financière mondiale (FR en ligne + EN online)
- Rembrandt, un bâtisseur de nations FR pdf (Nouvelle Solidarité).
- Rembrandt et la lumière d’Agapè (FR en ligne)
- Rembrandt and the Light of Agapè (EN online)
- Rembrandt : 400 ans et toujours jeune ! (FR en ligne).
- Rembrandt: 400 years old and still young ! (EN online).
- Rembrandt et la figure du Christ (FR en ligne) + EN pdf + DE pdf.
- Metsu, Ter Borch, Hals, l’éloge du quotidien. FR pdf (Nouvelle Solidarité);
- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Vermeer was hiding his convictions (EN online audio);
- Entre l’Europe et la Chine: le rôle du jésuite flamand Ferdinand Verbiest. (FR en ligne).
- Francisco Goya et la révolution américaine (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio) + ES pdf.
- BOOK: Karel Vereycken et Karl Lestar : El Degüello de Goya (livre ES)
- Beethoven et le Meeresstille: initiation à une culture de la découverte (FR en ligne) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website) + DE pdf (Neue Solidarität).
- Mutual Tuition: historical curiosity or promise for a better future? (EN online)
- Enseignement mutuel: curiosité historique ou piste d’avenir? (FR en ligne)
- Le combat républicain de David d’Angers, la statue de Gutenberg à Strasbourg (FR en ligne)
- The republican struggle of David d’Angers and the Gutenberg statue in Strasbourg (EN online)
- Hippolyte Carnot, père de l’éducation républicaine moderne (FR en ligne)
- Hippolyte Carnot, father of modern republican education (EN online)
- Victor Hugo et le colosse (FR en ligne);
- Victor Hugo and the awakening of the colossus (EN online);
- Enquête sur les origines de l’art contemporain (FR en ligne) + EN pdf.
- On the Origins of Modern Art, the Question of Symbolism (EN online)
- Les racines symbolistes des killer games (FR en ligne).
- Neo-Platonism and Huxley’s Doors of Perception (EN online)
- L’art moderne de la CIA pour combattre le communisme (FR en ligne).
- The Congress for Cultural Freedom (CCF) – How the CIA « weaponized » Moder Art (EN online).
- M. Hockney, le génie artistique n’est pas une illusion optique ! FR pdf (Fusion) + DE pdf + EN pdf (21st Science & Technology).
- Gérard Garouste et La Source (FR en ligne).
- Rembrandt’s oil painting is back… in China ! (EN online)
- Ce que nous apprend l’expérience Trou-dans-le-Mur de Sugata Mitra (FR en ligne)
- The hidden lesson behing Sugata Mitra‘s Hole-in-the-Wall experience (EN online)
Portraits du Fayoum : un regard de l’au-delà

par Karel Vereycken
A la fin des années 1880, des pilleurs de tombes mettent à jour de remarquables portraits dans le Fayoum, une région d’Egypte située à l’ouest du Nil.
Dès 1887, l’antiquaire viennois Theodor Ritter von Graf acquiert un grand nombre de ces portraits et les fait connaître à travers le monde grâce à des expositions qu’il organise à Berlin, Munich, Paris, Bruxelles, Londres et New York.
Très rapidement, la polémique enfle : certains se disputent pour dater ces peintures, d’autres vont même jusqu’à crier à la fraude.
C’est l’archéologue britannique Flinders Petrie, auteur d’importantes recherches dans la nécropole d’Hawara, qui déterminera qu’ils remontent à l’époque de l’occupation romaine de l’Egypte, c’est-à-dire aux premiers siècles de notre ère.
A ce jour, on a découvert environ un millier de « portraits du Fayoum », appelés ainsi car c’est la région qui en compte le plus même même si d’autres ont été trouvés à Saqqarah, Memphis, Antinooupolis, Akhmim et Thèbes. Le climat sec des lieux où elles ont été placées (en bordure de cette luxuriante dépression du Fayoum) explique leur bonne conservation.
Mais les sables chauds égyptiens ont également protégé des milliers de papyrus très précieux. Ces documents en grec, démotique, latin, hébreu, etc., nous indiquent que la population de l’époque avait un haut niveau d’alphabétisation. Plus encore, ils nous révèlent la rencontre exceptionnelle entre la tradition de Platon, d’Homère et des auteurs dramatiques grecs, grâce à l’importante population grecque établie en Egypte depuis Alexandre le Grand, (voir l’annexe : Alexandre le Grand en Egypte) la pensée juive de l’Ancien Testament et des écrits contemporains de Philon d’Alexandrie, le christianisme naissant et, enfin, la culture égyptienne classique. Ce n’est qu’en ayant à l’esprit cette richesse culturelle que l’on peut pénétrer les secrets des portraits du Fayoum.
Le prochain lointain
La première chose qui nous frappe lorsque l’on regarde ces portraits, c’est leur familiarité : le réalisme des traits conjugué avec la profondeur de l’expression effacent les nombreuses années qui nous séparent. A l’opposé des automatismes que dictent une peinture de cour ou un esthétisme maniériste, les portraits du Fayoum soulignent le caractère unique de chaque être humain. Il n’y aucune volonté de la part de l’artiste d’idéaliser les formes, d’aplanir les défauts physiques comme on peut le voir avec certaines statues grecques ou romaines. Il serait en effet vain de chercher la beauté de cette manière, dans un corps parfait mais sans âme ni vie. Ce que l’artiste veut faire transparaître, c’est la beauté intérieure de l’individu, celle qui ne peut jamais être altérée par des imperfections corporelles.
Toutefois, le souci du peintre n’est pas non plus de réaliser une réplique parfaite, hyperréaliste. Si tel avait été le cas, il se serait contenté de confectionner un masque moulé qui, malgré sa grande fidélité aux traits du visage, reste figé, « mort » et, paradoxalement, peu ressemblant.
C’est au contraire cet intérêt pour le particulier des individus qui les rend universels. Dans ce sens, ces portraits appartiennent parfaitement à la « peinture classique » telle qu’on la retrouvera, entre autres, chez Bruegel ou Rembrandt.
Le terme « classique » ne fait ici référence ni à un code esthétique formel ni à une période historique particulière. L’art classique est en fait la science qui, à travers une expérience sensuelle (principalement la vue et l’ouïe), permet d’éveiller des idées, des sentiments, des principes qui sont à la fois universels et immatériels. Alors que le folklore privilégie l’appartenance à une communauté ou à une ethnie, l’art classique exprime ce qui est commun à tous les hommes mais spécifique à l’humanité, c’est-à-dire sa créativité.
Ainsi, nous devons considérer toutes les avancées techniques de ces peintures non pas comme une fin en soi (une prouesse) mais comme la volonté du peintre de refléter plus fidèlement la beauté du vivant et le caractère divin de l’homme. La peinture ne se réduit donc pas à décrire l’objet que l’on voit mais l’idée qu’il représente. Et puis, ne désignait-on pas souvent ces peintres sous le terme de zographoï, c’est-à-dire littéralement « peintres de la vie » ?
Cependant, ce qui renforce davantage ce sentiment de familiarité, c’est le regard qu’ils posent sur nous. Nous ne sommes pas en train d’observer, de manière distante, une scène appartenant à une autre époque mais nous échangeons un regard avec un autre être humain. On peut véritablement dire que, conformément à son rôle, l’artiste a immortalisé celui qu’il a peint.
Et c’est de cela dont il s’agit ici. Nous n’avons pas affaire avec des individus représentés pour la société des hommes, comme on les trouve dans certaines fresques de Pompéi, mais avec des âmes qui portent leur regard à partir du monde des morts (de l’Hadès) sur le monde des vivants.
En effet, les portraits du Fayoum étaient destinés à être fixés sur les sarcophages des défunts. Ils étaient peints soit directement sur les linceuls entourant le sarcophage ou sur de minces tablettes de bois insérées ensuite grâce à des bandelettes de lin.
Certes, cette tradition n’était pas nouvelle. Nous en avons un témoignage intéressant avec le commentaire de Pline l’Ancien (23-79 après J.-C.), même si celui-ci, ignorant ce qui se faisait en Egypte à son époque, était convaincu que cet art avait disparu :
« En tout cas la peinture de portraits, qui permettait de transmettre à travers les âges des représentations parfaitement ressemblantes, est complètement tombée en désuétude.(…) Oui, c’est bien vrai : la mollesse a causé la perte des arts et, puisqu’on ne peut faire le portrait des âmes, on néglige aussi le portrait physique. Il en allait autrement chez nos ancêtres : dans les atriums, on exposait un genre d’effigies destinées à être contemplées ; non pas des statues dues à des artistes étrangers ni des bronzes ou des marbres, mais des masques moulés en cire, qui étaient rangés chacun dans une niche : on avait ainsi des portraits pour faire cortège aux convois de famille et, quand il mourait quelqu’un, toujours était présente la foule entière de ses parents disparus ; et les branches de l’arbre généalogique couraient en tous sens, avec leurs ramifications linéaires, jusqu’à ces portraits, qui étaient peints. » (Vers 6, Histoire naturelle, Livre XXXV – La peinture).
Petrie a découvert des cadres et même certaines peintures encadrées destinées à être accrochées à un mur. On peut d’ailleurs constater que la plupart des portraits ont été coupés afin de pouvoir être fixés correctement au sarcophage. Cela indiquerait que la plupart des portraits ont été réalisés d’après nature, excepté quand il s’agissait de la mort d’un enfant.
Les portraits du Fayoum représentent en général des hommes ou des femmes âgés entre 25 et 30 ans, au zénith de leur vie. D’autre part, les recherches ont révélé que certains sarcophages décorés de portraits d’adultes contiennent des momies de vieillards, confirmant que certains portraits avaient été réalisés bien avant le décès de la personne.
Selon Petrie, les sarcophages n’étaient pas enterrés tout de suite mais gardés dressés contre un mur dans une pièce de la maison familiale, conformément à la tradition égyptienne rapportée par Diodore de Sicile au Ier siècle avant J-C : « (…) beaucoup d’Egyptiens gardent le corps de leurs ancêtres dans des chambres magnifiques et ont ainsi sous les yeux ceux qui sont morts bien des générations avant leur naissance, si bien qu’[ils] (…) en éprouvent une satisfaction singulière, comme si ces morts avaient vécus avec eux. »
Les sarcophages, recouverts de représentations symboliques égyptiennes qui dénotent avec le réalisme des portraits, comportent quelques fois des inscriptions, souvent en grec, ou des étiquettes sur lesquelles on peut lire le nom du défunt et d’autres commentaires comme, par exemple, « Hermione l’institutrice » ou encore « Sabinus, peintre, âgé de 26 ans. Bon courage ! » Petrie a aussi découvert sous la tête de la momie d’une jeune femme le deuxième livre de l’Iliade sous forme d’un rouleau de papyrus, montrant leur attachement à cette grande culture classique.
Ce qui est étonnant, c’est que cette pratique ne semble pas liée à une catégorie particulière de la population. En effet, leurs origines ethniques, sociales et même religieuses sont très diverses : on trouve des prêtres du culte de Sérapis, des juifs et des chrétiens (malgré les protestations, les chrétiens d’Egypte embaumaient leurs défunts jusqu’au IVème siècle après J.-C.) ; des hauts fonctionnaires romains et des esclaves affranchis, des athlètes et des héros militaires ; des Ethiopiens et des Somaliens, etc. Toutefois, il serait faux de croire à une sorte de « conversion » à la religion égyptienne de la part de ces personnes. En fait, on peut véritablement parler d’un oecuménisme autour de certaines idées qui transcendent les rites funéraires égyptiens.
Le rapport à la mort
Il apparaît clairement que ces peintures réunissent tous ces hommes et femmes d’origines si différentes autour d’une idée fondamentale : l’âme est immortelle. La rencontre avec le peintre, lui-même mortel, se concentre alors autour d’une réflexion sur l’éternel, et le modèle réfléchit sur le caractère éphémère de son existence.

Portrait funéraire (sur toile !) de la momie d’Aline; 24 après J.-C.; tempera sur toile, 42 cm; Hawara (site archéologique en bordure du Fayoum)
Tous ces portraits ont cette caractéristique d’avoir les yeux grands ouverts exprimant un étonnement tranquille, une angoisse maîtrisée devant une mort sereine. L’acceptation du caractère incontournable de la mort se transcende ici en amour pour la vie, en affirmation tranquille que chaque être humain est porteur d’une part singulière d’éternité.
Le fait est que nous sommes sur terre à peine pour quelques décennies et ce temps ne doit pas être gaspillé si l’on veut laisser quelque chose après sa mort. Ce que Diodore de Sicile décrit ainsi : « C’est ce que les gens du pays tiennent pour tout à fait négligeable le temps passé à vivre et qu’ils font le plus grand cas du temps qui, par la vertu, restera dans la mémoire après la mort ; ils nomment les habitations des vivants des auberges, puisque nous n’y passons qu’un bref moment, et donnent le nom d’habitations éternelles aux tombeaux, puisque les morts mènent en Hadès une existence illimitée. »
Mais quel était le contenu de ces rituels funéraires égyptiens ? D’abord, il faut bien comprendre que les croyances égyptiennes ont beaucoup évolué, et que derrière les noms d’Osiris et d’Isis se trouvent des cultes dont la nature est totalement différente selon les époques et les traditions. De plus, il est fort probable que l’influence des premiers chrétiens et des juifs ont privilégié les aspects des croyances égyptiennes les plus compatibles avec leur religion. Enfin, il faut noter que, comme le souligne justement Jean Vercoutter, la religion égyptienne, polythéiste de forme, tend en fait à un monothéisme de fond (Aménophis IV-Akhénaton a même tenté de le formaliser). A tel point que les premiers chrétiens en Egypte n’ont eu aucun problème à traduire le terme « Dieu » par le terme égyptien « neter » désignant la divinité non représentable.
Pour les Egyptiens, face à la mort, il convient d’agir conformément à Maât, symbole de la vérité et de la justice mais surtout de l’ordre universel tel qu’il a été établi au moment de la création du monde. Et le souci de tout homme doit être de « placer Maât en son coeur ». Le défunt est amené par Anubis, divinité bienveillante à tête de chien et muni d’une clef, devant le Tribunal divin. C’est là que l’on va peser son coeur, siège de la conscience. Sur l’un des plateaux de la balance, on trouve une image de la déesse Maât et sur l’autre, le coeur. Si les deux plateaux sont au même niveau, le défunt est déclaré « juste » et, accédant lui-même à l’état d’« Osiris », Horus l’accompagnera auprès d’Osiris. Rappelons que les Egyptiens pratiquent la momification pour préserver l’unité de l’individu, corps et âme confondus. C’est cette unité perdue qui a fait tomber le roi Osiris (lorsqu’il a été assassiné et découpé en plusieurs morceaux) et c’est cette unité retrouvée (quand Isis a recomposé son corps) qui a permis sa résurrection. Comme l’exprimera un théologien chrétien du XIIème siècle : « (…) l’unité est la forme de l’être de toute chose, on répond en vérité que tout ce qui est, est parce qu’il est un. (…) En fait, l’unité est entretien et forme de l’être alors que la division est la cause de l’anéantissement. »
Il est vrai, cependant, que nous n’avons aucun écrit de cette époque concernant ces portraits et leur signification exacte, mais les indications qui précèdent nous éclairent sur l’esprit général de leur démarche.
Beaucoup plus tard, cet esprit sera porté à un niveau supérieur, débarrassé de ses formes païennes. Le regard en peinture deviendra, de manière explicite, le miroir de l’âme humaine. Au XVème siècle, le cardinal Nicolas de Cues ira encore plus loin dans son ouvrage Le tableau ou la vision de Dieu, dans lequel il utilise comme base de réflexion un autoportrait de Rogier van der Weyden ayant comme particularité de fixer du regard l’observateur peu importe où celui-ci se trouve. Nicolas de Cues va comparer ce regard à la vision de Dieu et rapproche le terme « Dieu » (theos) à celui de « voir » (theôrein). Le Cusain pose d’abord un paradoxe : « Cependant, ton regard me porte à considérer pourquoi l’image de ta face est peinte de manière sensible : c’est qu’on ne peut peindre une face sans couleur et que la couleur n’existe pas sans quantité. Mais ce n’est pas avec les yeux de chair qui regardent ce tableau, c’est avec les yeux de la pensée et de l’intelligence que je vois la vérité invisible de ta face qui se signifie ici dans une ombre réduite. » Ensuite, il insiste sur le fait que ce n’est pas seulement le regard du tableau qui est important mais aussi celui de l’observateur : « (…) ta face portera ce que le regard de qui te regarde y apporte », en soulignant que « là où est l’oeil, là est l’amour ». Ainsi, le regard porté sur l’autre devient acte d’amour :
« (…) Je vois maintenant en un miroir, en un tableau, en une énigme, la vie éternelle qui n’est autre que la vision bienheureuse, et c’est en cette vision que tu ne cesses jamais de me voir avec le plus grand amour jusqu’au plus profond de mon âme. Et pour toi, voir n’est autre que donner vie, m’inspirer toujours l’amour le plus doux, (…) me donner la fontaine de vie, par ce don augmenter et faire durer mon être, me communiquer ton immortalité(…). » [Souligné par nous]
Maintenant, regardez à nouveau les portraits du Fayoum. Ne sommes-nous pas en présence d’une « vie éternelle qui n’est autre que la vision bienheureuse » ?
La tradition d’Apelle
Ces peintures ne nous remémorent pas seulement le souvenir d’individus que l’on n’a jamais connus, elles immortalisent également le peintre anonyme qui, grâce à son art, continue aujourd’hui à nous émouvoir.
Contrairement à ce qui est souvent avancé, nous ne sommes pas en présence de « peintures romaines ». Euphrosyne Doxiadis, se basant sur les recherches passionnées du peintre moderne grec Yannis Tsarouchis, affirme qu’« elles étaient une contribution des Grecs au combat des Egyptiens contre la mort ». On peut faire remonter cette tradition picturale au moins jusqu’à l’époque du portraitiste exclusif d’Alexandre, le peintre réaliste Apelle (360-300 av. J.-C.).
Deux indices révèlent une influence éventuelle de cette tradition sur les portraits de Fayoum. Pline l’Ancien nous apporte le premier indice lorsqu’il décrit les peintures d’Apelle :
« Le point sur lequel cet art manifestait sa supériorité était la grâce, bien qu’il y eût à la même époque de très grands peintres ; mais, tout en admirant leurs oeuvres et en les comblant toutes d’éloges, il [Apelle] disait qu’il leur manquait ce fameux charme qui lui était propre et que les Grecs appellent Charis ; qu’ils avaient atteint à toutes les autres perfections mais que, sur ce seul point, il n’avait pas d’égal. Il revendiqua aussi un autre titre de gloire : alors qu’il admirait une oeuvre de Protogène, d’un travail immense et d’un fini méticuleux à l’excès, il dit en effet que sur tous les autres points ils étaient égaux ou même que Protogène était supérieur, mais qu’il avait, lui, ce seul avantage de savoir ôter la main d’un tableau (précepte digne d’être noté), selon lequel un trop grand souci de la précision est souvent nuisible. » (vers 80, Livre XXXV)
N’est-ce pas là précisément l’un des éléments stylistiques caractéristiques des portraits du Fayoum ?
Aucun tableau ni traité d’Apelle, ou de son maître Pamphile (qui avait eu comme maître Eupompe, natif de Sicyone), n’a survécu jusqu’à nos jours. Selon le témoignage de Pline, Eupompe aurait été l’initiateur d’une révolution picturale, ajoutant aux genres attique et ionien qui composent le genre hellénique celui de l’école de Sicyone. On peut se faire une petite idée de cet art grâce à certaines mosaïques, comme celle de Pompéi représentant Alexandre à la bataille d’Issos (IIème siècle av. J.-C.), qui serait la copie d’une oeuvre d’un peintre de l’école de Sycione. On retrouve cette même tradition à Alexandrie dans de monumentales mosaïques, des portraits de femmes réalisés aussi au IIème siècle av. J.-C. et reflétant l’attachement au réalisme dans la représentation. Rajoutons à cela le fait important que les Grecs en Egypte ont introduit les pauses de trois quarts et de face dans un pays où, il semblerait, toutes les figures avaient été jusque-là peintes de profil.
Le deuxième indice, c’est la tétrachromie, c’est-à-dire l’utilisation de quatre couleurs. Cela peut sembler incroyable mais jusqu’à l’invention dans les années 70 des peintures acryliques (polymères de plastique), les ingrédients de base de la peinture n’ont quasiment pas changé de l’école sycionienne qui forma Apelle jusqu’à Rembrandt et Goya, en passant par les peintres du Fayoum ! Ses ingrédients qui composent les médiums sont, dans des proportions diverses, l’albumine du jaune et le blanc d’oeuf (le sang pour les peintres de la préhistoire), la colle (produit, par exemple, à partir des peaux), les résines aqueuses, les essences, les huiles et la cire d’abeille.
La fameuse palette à quatre couleurs d’Apelle, la tétrachromie se retrouve entièrement dans les portraits de Fayoum : le melinum, un blanc constitué d’une craie argileuse venant de l’île de Mélos (éventuellement remplacé par le blanc de plomb) ; le sil attique ou ochra : un jaune tiré du limon recueilli dans les mines d’argent ; la sinopis du Pont : une terre d’ocre rouge venant de Sinopis ; l’astramentum : un noir fabriqué de diverses manières, en toute probabilité du noir de vigne permettant des reflets bleus. D’autres pigmentsapparaissent seulement pour remplacer ces derniers selon des circonstances de disponibilité ou pour le détail d’un bijou (terre verte naturelle ou malachite) ou d’un vêtement (rose garance naturel, rose cyclamen ou la coûteuse pourpre extraite des coquillages).
Pour les portraits du Fayoum, soit on appliquait une peinture à la cire (encaustique) sur des supports en bois soit on travaillait à la détrempe sur des toilesdelin (déjà !).Il s’agissait principalement de minces planchettes en figuier de sycomore, facile à trouver à cette époque en Egypte, ou en cyprès (le chêne typique des peintres du nord étant très rare en méditerranée). La cire d’abeille (blanchie) était chauffée et mélangée avec d’autres substances, comme des résines du type Mastic de Chios, aux pigments. On pouvait aussi la préparer pour être appliquée à froid (cire punique) après l’avoir émulsionnée ou saponifiée, permettant des mélanges astucieux avec l’oeuf ou l’huile. Pour travailler la matière, on utilisait trois types d’instruments : le pinceau, le cautère (un fer chaud) et le cestre (un petit poinçon).
Sur la toile de lin, on travaillait plutôt à la détrempe, après avoir posé une couche de colle mélangée à une fine couche de plâtre (équivalent du gesso). Sur le bois, où l’on appliquait d’abord une couche de colle à la détrempe, on posait les carnations parfois directement sur le brun miellé du bois nu ou sur un fond teinté kaki, le proplasmos, équivalent de l’impression ou de l’impregnatura des grands maîtres classiques européens.
Comme l’affirmait correctement le peintre grec moderne Tsarouchis, « le bon coloriste voit une harmonie de couleurs où d’autres voient des objets ». Ainsi, sur ce fond kaki et travaillant du foncé vers le clair, on construisait la profondeur en opposant teintes froides et chaudes pour faire avancer ou reculer l’espace, plutôt que par le clair-obscur.
On retrouve ce démarrage sur fonds sombre dans le Titus, oeuvre de l’entourage de Rembrandt au Louvre, et chez la Jeune fille au turban de Vermeer au Mauritshuis de La Haye. La peinture se libère de sa prison de lignes captives pour devenir une sculpture de lumière.
Conclusion
Le peintre et historien florentin Giorgio Vasari (1511-1574) rapporte avec stupeur dans Les Vies des excellents peintres, sculpteurs et architectes que la peinture, à partir du milieu du XIIIème siècle, n’avait pas seulement été négligée mais avait « quasiment disparu » en Occident.
Pour la faire revivre, une équipe de peintres grecs fut de tout urgence invitée par les autorités de Florence, convaincues que ceux-ci détenaient les secrets perdus de cet art. Un jeune homme issu de la noblesse, Cenni di Pepe (1240-1302 ?), plus connu sous le nom de Cimabue, délaissa ses études pour suivre leurs travaux. Une fois initié à leurs secrets d’artisans, il deviendra le maître de Giotto, figure fondatrice de la Renaissance qui, sous l’impulsion de quelques franciscains éclairés, fera renaître la peinture classique. Et l’on peut véritablement parler d’une re-naissance puisque cet art fut pratiquement inexistant pendant les quelque mille deux cents années qui séparent le XVème siècle des portraits du Fayoum.
En effet, le fil de cette tradition picturale a été coupé. Cette région du Nil extrêmement riche a d’abord été pillée par l’empire romain : près de 30% de sa production de grain était destiné à Rome et toute l’infrastructure liée à l’eau a été progressivement négligée. Ensuite, en 395, l’Egypte deviendra une partie intégrante de l’empire byzantin. C’est alors que la peinture entrera dans un monde à deux dimensions et cela pour des siècles. L’avènement de l’empire byzantin avec ses icônes a institué une stylisation plate et un symbolisme qui a aboutit à la superstition du « dédoublement magique » : le tableau devenu objet est supposé posséder « magiquement » les qualités divines de ce qu’il représente. Il prétend capturer pour toujours un segment d’éternité et ne représente qu’un moment de vide. De ce point de vue, les portraits du Fayoum, malgré des ressemblances techniques, sont à l’opposé de la tradition des icônes. On pourrait dire qu’en perdant cette quatrième dimension de la transcendance, la troisième dimension, celle de l’espace créé par l’unité entre perspective et couleurs, s’est dissipée avec elle.
Mais ce fil qui a été renoué au moment de la Renaissance, qu’est-il devenu aujourd’hui ?
Alexandre le Grand en Egypte
Conquises par Alexandre le Grand en 332 avant J.-C., les riches terres agricoles du Nil et du Fayoum furent attribuées aux anciens combattants gréco-macédoniens en récompense de leurs services. L’Egypte avait construit un impressionnant système d’irrigation lui permettant de capter plusieurs millions de litres d’eau pour faire prospérer ses cultures. Propriétaires héréditaires, les immigrants gréco-macédoniens, mais aussi juifs, asiatiques, syriens, libyens, éthiopiens, etc., y produisaient du blé, du vin, des olives, du lin, et du papyrus.
Comme le note Plutarque, Alexandre « ne fit pas comme Aristote, son précepteur, lui conseilla, qu’il se portât envers les Grecs comme père, et envers les barbares comme seigneur ». Le précepte d’Aristote était de traiter « les premiers en amis et familiers, et d’user des seconds comme on use des animaux ou des plantes », les considérant barbares et esclaves « par nature ». Euripide, comme de nombreux autres grecs chauvins, affirmait avec éloquence que « le barbare est né pour l’esclavage et le Grec pour la liberté ». Cependant, Alexandre ne se conforma pas aux préjugés de son temps. Il pensait que la naissance ou le sang n’y faisaient rien et que l’on devenait esclave ou libre « par culture ».
On a donc pu voir, en Egypte, les immigrants se marier entre eux ainsi que se mélanger avec la population autochtone pour fonder les grandes cités : Alexandrie, Naucratis, Ptolémaïs et Antinooupolis. Bâties sur un modèle géométrique, ces villes abritaient des temples, des gymnases, des thermes, des portiques et des théâtres où l’on jouait parfois plusieurs jours de suite les grands auteurs grecs. On y lisait Homère et Platon. C’est à Alexandrie que l’on traduisit l’Ancien Testament en grec et que l’astronome et poète Ératosthène y dirigea la plus grande bibliothèque de l’Antiquité, Philon d’Alexandrie y fréquenta l’apôtre Paul de Tarse et le philosophe néoplatonicien Plotin y naîtra.
Quant à la religion, Alexandre le Grand ainsi que son général et successeur Ptolémée Ier Sôter (304-284 avant J.-C.) ne s’intéressaient pas aux formes rituelles en tant que telles mais plutôt à insuffler de nouvelles conceptions plus conformes avec l’image universaliste qu’ils avaient de l’homme. Il ne s’agit donc pas de syncrétisme religieux où l’on mélangerait les cultes grecs, égyptiens et autres. En fait, Alexandre voulait simplement éviter d’entrer dans un débat stérile sur les rites.
Inspiré par L’Odyssée d’Homère, Alexandre considérait Zeus comme « le père des hommes et des dieux ». Il est le père commun de tous les hommes et encourage ainsi une fraternité humaine qui puisse vivre « dans la concorde » et participer activement à l’administration de l’empire.
Bibliographie :
- Jean-Christophe Bailly, L’apostrophe muette, essai sur les portraits du Fayoum, Hazan,1997.
- Catherine Bridonneau, « Le Livre des Morts et les coutumes funéraires », in Le monde de la Bible, n°78, sept.-oct. 1992.
- Euphrosyne Doxiadis, Portraits du Fayoum, Gallimard 1995.
- Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXV, La Peinture, Les Belles Lettres, 1997.
- Nicolas de Cues, Le Tableau ou la vision de Dieu, Editions du Cerf, 1986.
- André Bonnard, Civilisation Grecque, d’Euripide à Alexandre, Editions Complexe, 1991.
- Jean Vercoutter, « L’Egypte antique », in Encyclopedia Universalis.