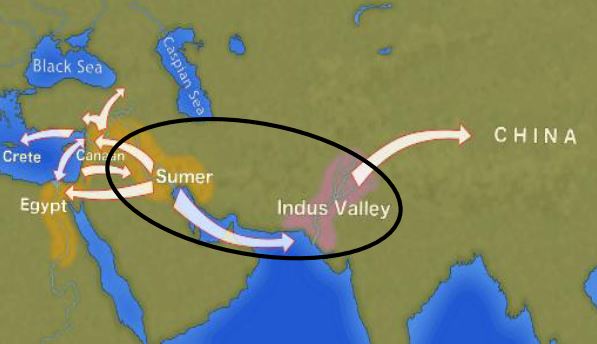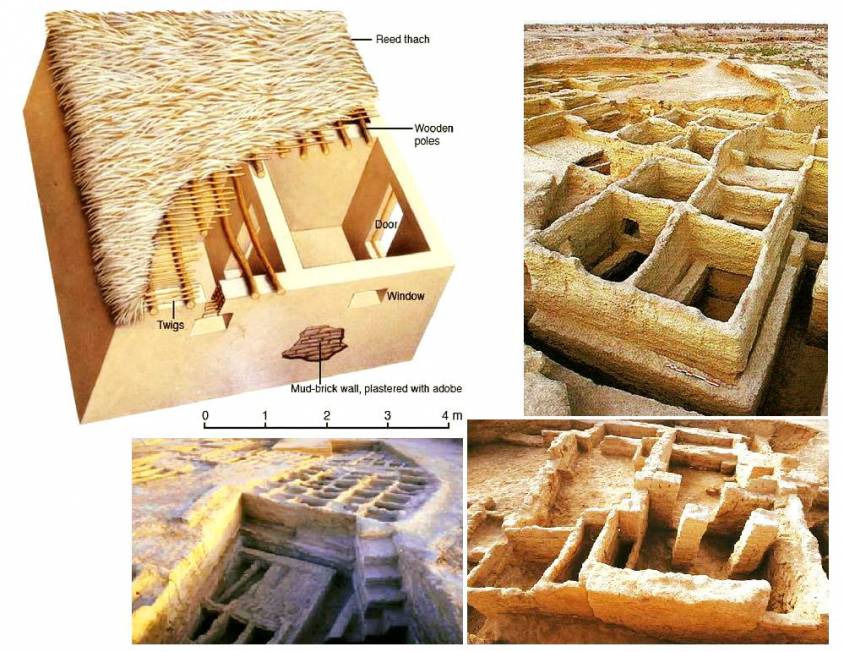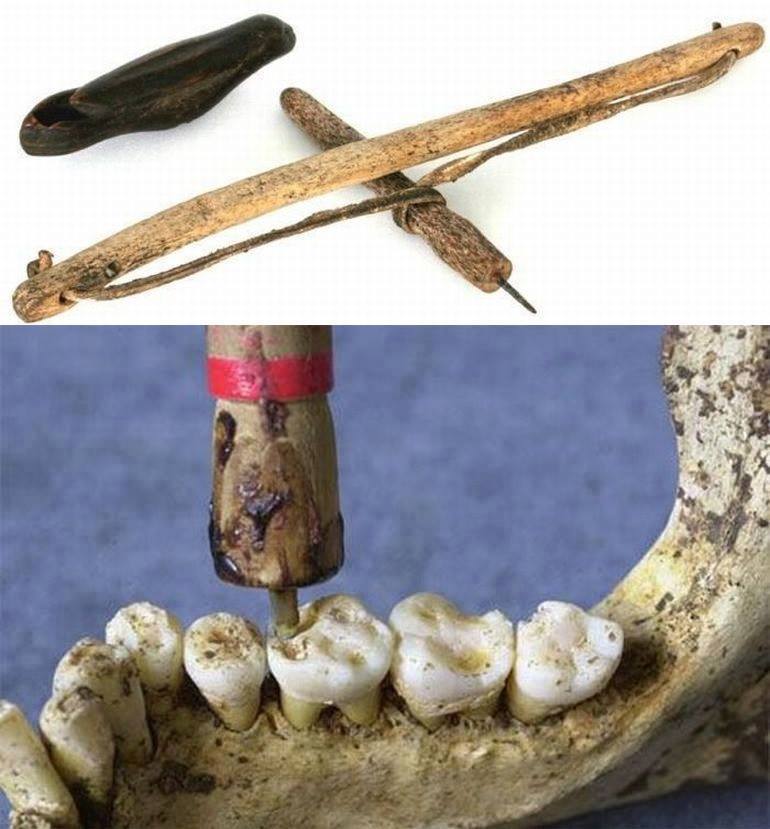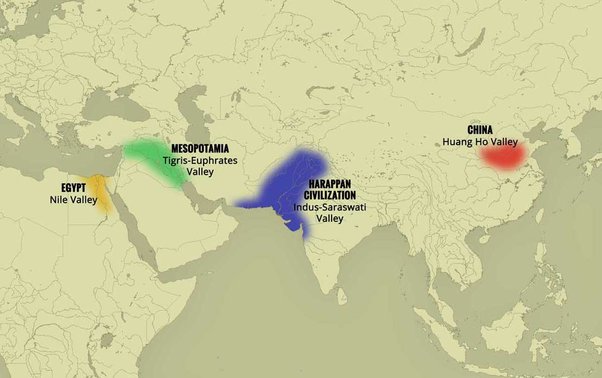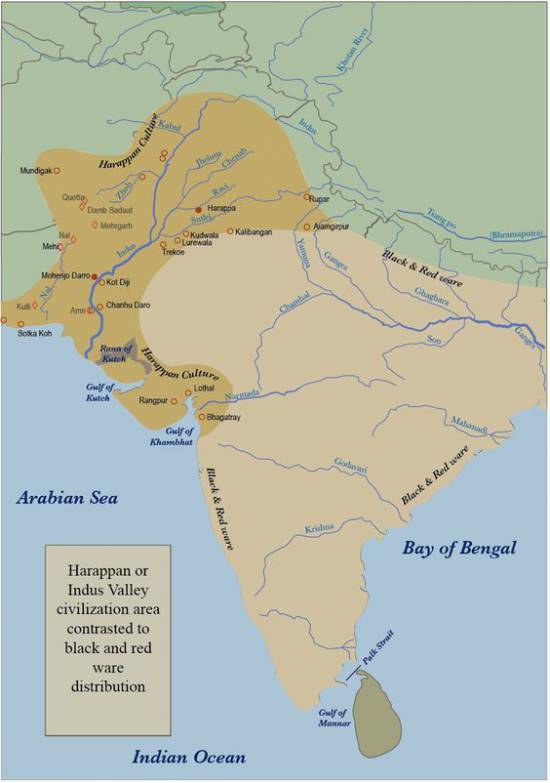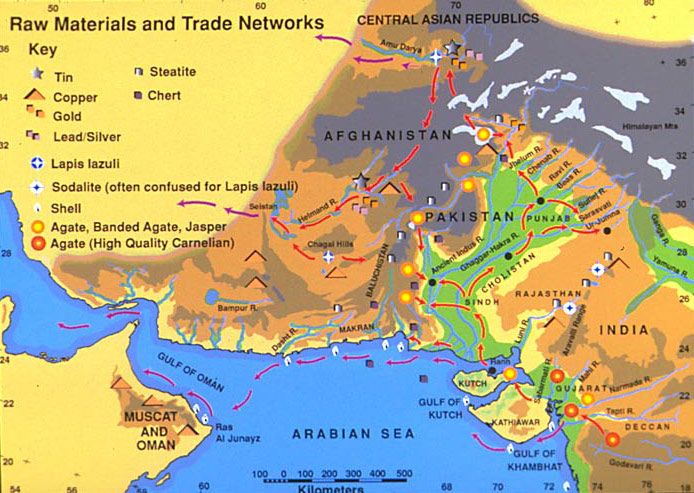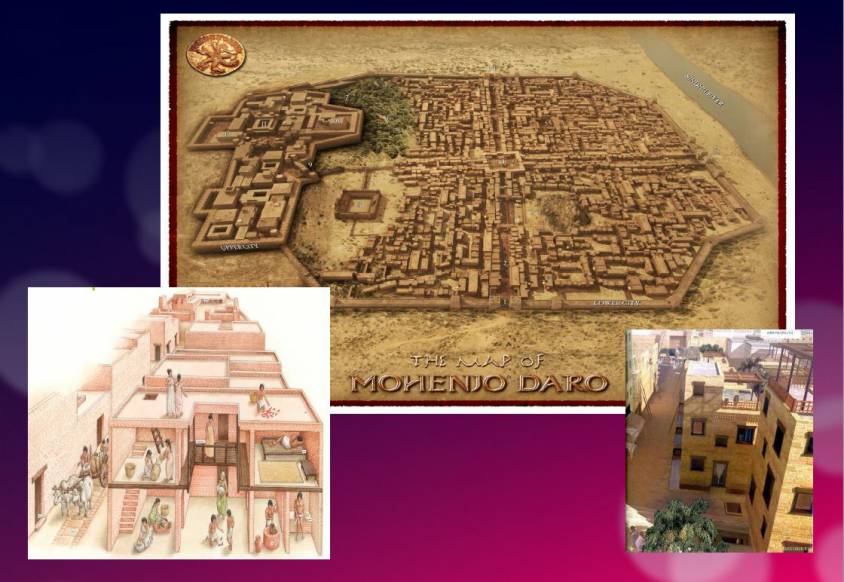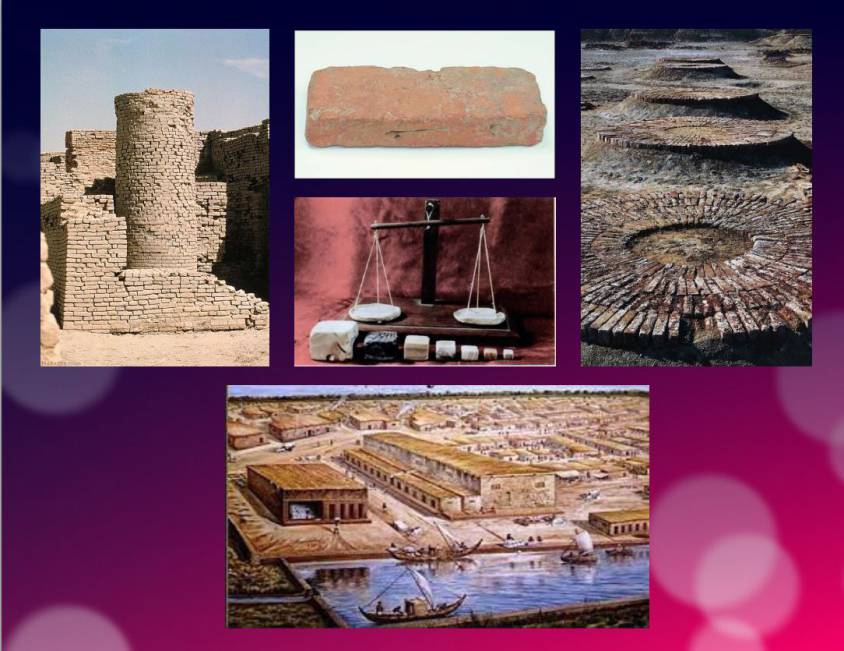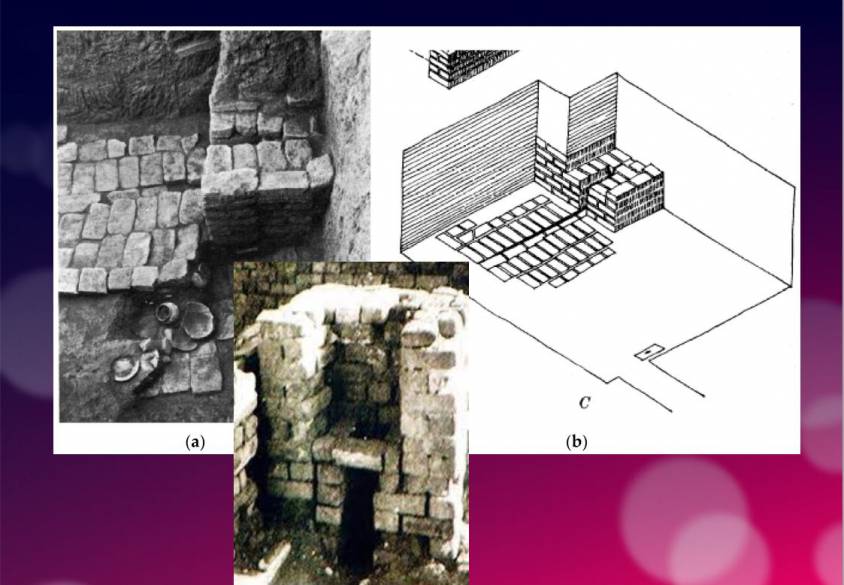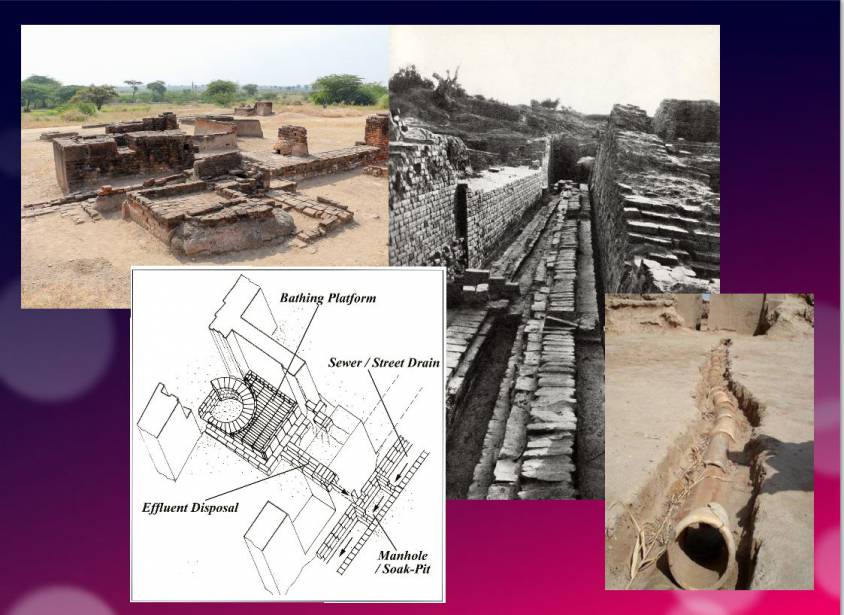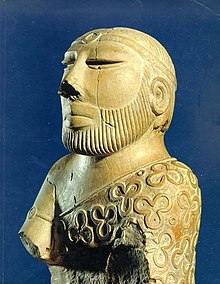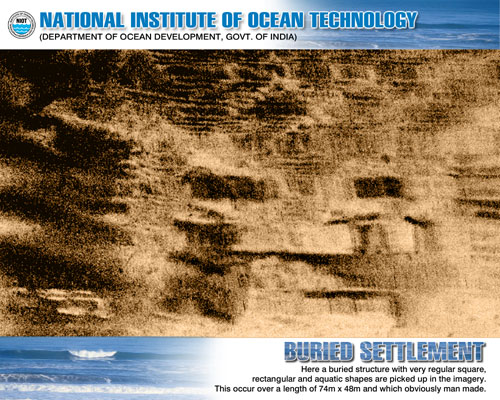Étiquette : Inde
Le « miracle » du Gandhara : quand Bouddha s’est fait homme


C’est lors de mon voyage en Afghanistan, en novembre 2023, que j’ai réalisé à quel point j’ignorais tout de cette partie du monde. Si aujourd’hui l’islam prévaut en Afghanistan et au Pakistan, on oublie souvent qu’une région commune à ces deux pays, historiquement connue sous le nom de Gandhara, a joué, du Ier au IIIe siècle de notre ère, un rôle majeur dans l’épopée du bouddhisme, une spiritualité qui, en refusant toute idée de caste, va bousculer l’ordre du monde.
Carrefour obligé sur les Routes de la soie reliant l’Europe à l’Inde et à la Chine, c’est au Gandhara, qu’a eu lieu un véritable dialogue entre les cultures eurasiatiques, perses, turques, grecques, chinoises et indiennes.
Bouddha. C’est par le volontarisme de deux grands rois d’Asie centrale (Ashoka et Kanishka) que le bouddhisme, né au Népal, trouvera l’énergie et la détermination pour gagner les esprits et les cœurs du monde.
Enfin, c’est au Gandhara que l’art bouddhique, en rupture avec les consignes du maître, va s’approprier les plus belles formes de diverses cultures artistiques grecques, indiennes, perses et autres, pour présenter bouddha sous une forme humaine aux fidèles, un homme éclairé, plein de sagesse et animé de compassion.
En offrant fraîcheur, poésie et un sens du mouvement spectaculairement moderne, les premiers artistes bouddhistes du Gandhara nous invitent à identifier en nous-mêmes, un saut vers l’auto-perfectionnement. A ce titre, ils sont les précurseurs de l’humanisme classique et de bien des Renaissances.
N’est-il pas temps de reconnaître la juste place que mérite leur contribution à la civilisation universelle ?
Enfin, vu la situation actuelle du monde, je tiens à citer le Premier Ministre indien Nehru, qui, le 3 octobre 1960 s’adressait à l’Assemblée générale des Nations unies avec des paroles qui n’ont cessé de gagner en pertinence : « Dans un passé lointain, un grand fils de l’Inde, le Bouddha, a dit que la seule vraie victoire était celle où tous étaient également victorieux et où personne n’était vaincu. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est la seule victoire concrète ; toute autre voie mène au désastre. »
- Introduction
- Bouddha, bio-express
- Les quatre vérités et l’octuple sentier
- Réincarnation
- Les Aryens et le védisme
- Les Brahmanes et le système des castes
- L’Inde avant le Bouddhisme
- Les grands conciles bouddhistes
- L’arrivée des Grecs
- L’Empire Maurya
- Le règne d’Ashoka le Grand
- Edits d’Ashoka
- Contenu des édits
- L’Empire Kouchan
- Le miracle de Gandhara
a) La poésie
b) La littérature
c) L’urbanisme
d) L’architecture, l’invention des stupa
e) Sculpture
–Aniconisme
–Fin de l’aniconisme
–Différence de forme, différence de contenu
1) Ecole greco-bouddhique de Gandhara
2) Ecole de Mathura
3) Ecole d’Andrah Pradesh
4) Ecole de la période Gupta. - Lorsque l’Asie rencontre la Grèce
a) Pièces de monnaies kouchanes
b) Reliquaire bimaran
c) Triade de Harra
d) Prendre la terre à témoin
e) Tous Bodhisattva - Le Bouddhisme aujourd’hui, l’exemple de Nehru
- Science et religion, Albert Einstein et Buddha.
Introduction
Les Ve et IVe siècles avant J.-C. furent une période d’effervescence intellectuelle mondiale. C’est l’époque des grands penseurs, tels que Socrate, Platon et Confucius, mais aussi Panini et Bouddha.
Dans le nord de l’Inde, c’est l’âge du Bouddha, après la mort duquel émerge une foi non théiste (Bouddha n’est qu’un homme…), qui se répand bien au-delà de sa région d’origine. Avec entre 500 millions et un milliard de croyants, le bouddhisme constitue aujourd’hui l’une des principales croyances religieuses et philosophiques du monde et sans doute une force potentielle redoutable pour la paix.
Bouddha, bio-express

« Le bouddha » (l’éveillé) est le nom donné à un homme appelé Siddhartha Gautama Shakyamuni (le muni ou sage du clan des Shakya). Il aurait atteint l’âge d’environ quatre-vingts an. Craignant l’idolâtrie, il refuse toute représentation de sa personne sous forme d’image.
Les traditions divergent sur les dates exactes de sa vie que la recherche moderne tend à situer de plus en plus tard : vers 623-543 av. J.-C. selon la tradition theravâda, vers 563-483 av. J.-C. selon la majorité des spécialistes du début du XXe siècle, tandis que d’autres le situent aujourd’hui entre 420 et 380 av. J.-C. (sa vie n’aurait pas dépassé les 40 ans).
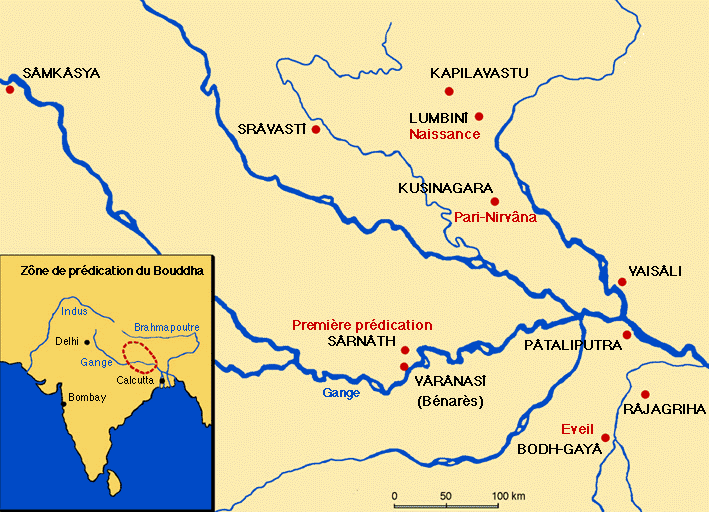

Selon la tradition, Siddhartha Gautama est né à Lumbini (dans l’actuel Népal) en tant que prince de la famille royale de la ville de Kapilavastu, un petit royaume situé dans les contreforts de l’Himalaya, dans l’actuel Népal.
Un astrologue aurait mis en garde le père du garçon, le roi Suddhodana : lorsque l’enfant grandirait, il deviendrait soit un brillant souverain, soit un moine influent, en fonction de sa lecture du monde. Farouchement déterminé à en faire son successeur, le père de Siddhartha ne le laissa donc jamais voir le monde en dehors des murs du palais. Tout en lui offrant tous les plaisirs et distractions possibles, il en fait un prisonnier virtuel jusqu’à l’âge de 29 ans.
Lorsque le jeune homme s’échappe de sa cage dorée, il découvre l’existence de personnes affectées par leur grand âge, la maladie et la mort. Bouleversé par la souffrance des gens ordinaires qu’il rencontre, Siddhartha abandonne les plaisirs éphémères du palais pour rechercher un but plus élevé dans la vie. Il se soumet d’abord à un ascétisme draconien, qu’il abandonne six ans plus tard, estimant qu’il s’agissait d’un exercice futile.
Il s’assoit alors sous un grand figuier pour méditer et y fait l’expérience du nirvana (la bodhi : libération ou, en sanskrit, extinction). On le désigne désormais sous le nom de « Bouddha » (l’éveillé ou l’éclairé).
Les « quatre vérités » et « l’octuple sentier »
Avant d’en esquisser le développement politique, quelques mots sur la philosophie sous-jacente au bouddhisme.
A ses jeunes disciples, Bouddha enseigne la « Voie du milieu », entre les deux extrêmes de la mortification et de la satisfaction des désirs.
Et il énonce les Quatre nobles vérités :
- La noble vérité de la souffrance.
- La noble vérité de l’origine de la souffrance.
- La noble vérité de la cessation de la souffrance.
- La noble vérité de la voie menant à la cessation de la souffrance, celle du Noble Chemin octuple.
Ainsi que le feront Augustin et plus encore les Frères de la Vie commune dans le monde chrétien, le bouddhisme insiste sur le fait que notre attachement à l’existence terrestre implique la souffrance.
Chez les chrétiens, c’est ce qui conduirait au « péché », notion inexistante dans le bouddhisme, pour qui l’errance vient de l’ignorance du bon chemin.
Pour Bouddha, il faut combattre, voire éteindre tout sens démesuré du moi (on dirait ego aujourd’hui). Il est possible de mettre fin à notre souffrance en transcendant ce fort sentiment de « moi », afin d’entrer dans une plus grande harmonie avec les choses en général. Les moyens d’y parvenir sont résumés dans le Noble Chemin octuple, parfois représenté par les huit rayons d’une Roue de la Loi (dharmachakra) que Bouddha mettra en marche, la Loi signifiant ici le dharma, un ensemble de préceptes moraux et philosophiques.
Ces huit points du Noble Chemin octuple sont :
- la vue juste
- la pensée juste
- la parole juste
- l’action juste
- les moyens d’existence justes
- l’effort juste
- la pleine conscience
- la concentration juste
– La vision juste est importante dès le départ, car sans cela, on ne peut pas voir la vérité des quatre nobles vérités.
– La pensée juste en découle naturellement. Le terme « juste » signifie ici « en accord avec les faits », c’est-à-dire avec la façon dont les choses sont (qui peut être différente de la façon dont je voudrais qu’elles soient).
– La pensée juste, la parole juste, l’action juste et les moyens d’existence justes impliquent une retenue morale – s’abstenir de mentir, de voler, de commettre des actes violents et gagner sa vie d’une manière qui ne soit pas préjudiciable aux autres. La retenue morale ne contribue pas seulement à l’harmonie sociale générale, elle nous aide aussi à contrôler et à diminuer le sentiment démesuré du « moi ». Comme un enfant gâté, le « moi » grandit et devient indiscipliné à mesure que nous le laissons agir à sa guise.
– Ensuite, l’effort juste est important parce que le « moi » prospère dans l’oisiveté et le mauvais effort ; certains des plus grands criminels sont les personnes les plus énergiques, donc l’effort doit être approprié à la diminution du « moi » (son ego, dirait-on aujourd’hui). Dans tous les cas, si nous ne sommes pas prêts à faire des efforts, nous ne pouvons pas espérer obtenir quoi que ce soit, ni dans le sens spirituel ni dans la vie. Les deux dernières étapes de la voie, la pleine conscience et la concentration ou absorption, représentent la première étape permettant de nous libérer de la souffrance.
Les ascètes qui avaient écouté le premier discours du Bouddha devinrent le noyau d’un sangha (communauté, mouvement) d’hommes (les femmes devaient entrer plus tard) qui suivaient la voie décrite par le Bouddha dans sa Quatrième noble vérité, celle précisant le Noble Chemin octuple.
Pour rendre le nirvana bouddhiste accessible au citoyen ordinaire, l’imagination bouddhiste a inventé le concept très intéressant de bodhisattva, mot dont le sens varie selon le contexte. Il peut aussi bien désigner l’état dans lequel se trouvait Bouddha lui-même avant son « éveil », qu’un homme ordinaire ayant pris la résolution de devenir un bouddha et ayant reçu d’un bouddha vivant la confirmation ou la prédiction qu’il en serait ainsi.
Dans le bouddhisme theravâda (l’école ancienne), seules quelques personnes choisies peuvent devenir des bodhisattvas, comme Maitreya, présenté comme le « Bouddha à venir ».
Mais dans le bouddhisme mahâyâna (Grand Véhicule), un bodhisattva désigne toute personne qui a généré la bodhicitta, un souhait spontané et un esprit compatissant visant à atteindre l’état de bouddha pour le bien de « tous les êtres sensibles », hommes aussi bien qu’animaux. Etant donné qu’une personne peut, dans une vie future, se réincarner dans un animal, le respect des animaux s’impose.
Réincarnation
Tout en voulant construire sa propre vision sur certains fondements de l’hindouisme, l’une des plus anciennes religions du monde, Siddhartha introduisit néanmoins des changements révolutionnaires aux implications politiques importantes.
Dans la plupart des croyances impliquant la réincarnation (hindouisme, jaïnisme, sikhisme), l’âme humaine est immortelle et ne se disperse pas après la disparition du corps physique. Après la mort, l’âme transmigre simplement (métempsychose) dans un nouveau-né ou un animal pour poursuivre son immortalité. La croyance en la renaissance de l’âme a été exprimée par les penseurs grecs anciens, à commencer par Pythagore, Socrate et Platon.
Le but du bouddhisme est d’apporter un bonheur durable et inconditionnel. Celui de l’hindouisme est de se libérer du cycle de naissance et de renaissance (samsara) pour atteindre, finalement, le moksha, qui en est la libération.
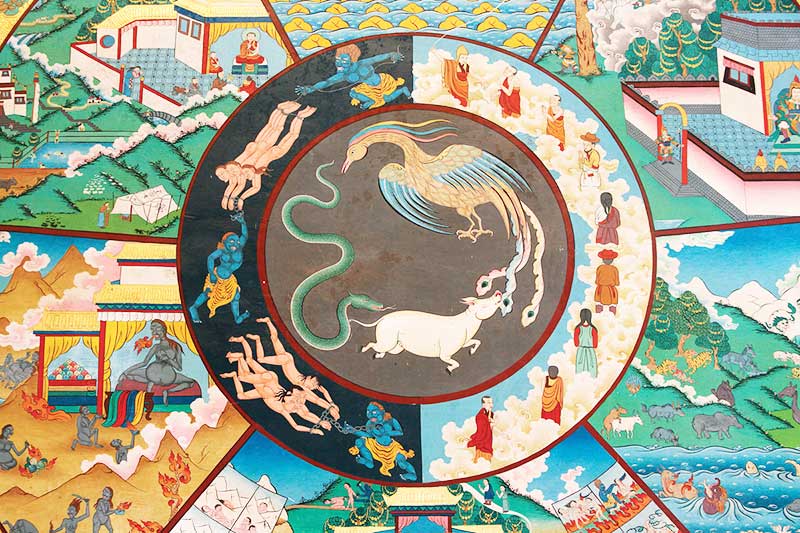
Le bouddhisme et l’hindouisme s’accordent sur le karma, le dharma, le moksha et la réincarnation. Mais ils diffèrent politiquement dans la mesure où le bouddhisme se concentre sur l’effort personnel de chacun et accorde par conséquent une moindre importance aux prêtres et aux rituels formels que l’hindouisme. Enfin, le bouddhisme ne reconnaît pas la notion de caste et prône donc une société plus égalitaire.
Alors que l’hindouisme soutient que l’on ne peut atteindre le nirvana que dans une vie ultérieure, le bouddhisme, plus volontariste et optimiste, soutient qu’une fois qu’on a réalisé que la vie est souffrance, on peut mettre un terme à cette souffrance dans sa vie présente.
Les bouddhistes décrivent leur renaissance comme une bougie vacillante qui vient en allumer une autre, plutôt que comme une âme immortelle ou un « moi » passant d’un corps à un autre, ainsi que le croient les hindous. Pour les bouddhistes, il s’agit d’une renaissance sans « soi », et ils considèrent la réalisation du non-soi ou du vide comme le nirvana (extinction), alors que pour les hindous, l’âme, une fois libérée du cycle des renaissances, ne s’éteint pas, mais s’unit à l’Être suprême et entre dans un éternel état de félicité divine.
Les Aryens et le védisme
L’une des grandes traditions ayant façonné l’hindouisme est la religion védique (védisme), qui s’est épanouie chez les peuples indo-aryens du nord-ouest du sous-continent indien (Pendjab et plaine occidentale du Gange) au cours de la période védique (1500-500 av. J.-C.).
Au cours de cette période, des peuples nomades venus du Caucase et se désignant eux-mêmes comme « Aryens » (« noble », « civilisé » et « honorable ») pénétrèrent en Inde par la frontière nord-ouest.

Le terme « aryen » a une très mauvaise connotation historique, en particulier depuis le XIXe siècle, lorsque plusieurs antisémites virulents, tels qu’Arthur de Gobineau, Richard Wagner et Houston Chamberlain, ont commencé à promouvoir le mythe d’une « race aryenne », soutenant l’idéologie suprémaciste blanche de l’aryanisme qui dépeint la race aryenne comme une « race des seigneurs », les non-aryens étant considérés non seulement comme génétiquement inférieurs (Untermensch, ou sous-homme) mais surtout comme une menace existentielle à exterminer.
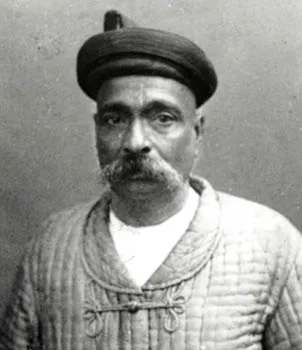
D’un point de vue purement scientifique, dans son livre The Arctic Home (1903), le patriote indien Bal Gangadhar Tilak (1856-1920), s’appuyant sur son analyse des observations astronomiques contenues dans les hymnes védiques, émet l’hypothèse selon laquelle le pôle Nord aurait été le lieu de vie originel des Aryens pendant la période préglaciaire, région qu’ils auraient quittée vers 8000 avant J.-C. à cause de changements climatiques, migrant vers les parties septentrionales de l’Europe et de l’Asie. Gandhi disait de Tilak, l’un des pères du mouvement de l’indépendance du pays, qu’il était « l’artisan de l’Inde moderne ».
Les Aryens arrivant du Nord étaient probablement moins barbares qu’on ne l’a suggéré jusqu’à présent. Grâce à leur supériorité militaire et culturelle, ils conquirent toute la plaine du Gange, avant d’étendre leur domination sur les plateaux du Deccan.
Cette conquête a laissé des traces jusqu’à nos jours, puisque les régions occupées par ces envahisseurs parlent des langues indo-européennes issues du sanskrit. (*1)

En réalité, la culture védique est profondément enracinée dans la culture eurasienne des steppes Sintashta (2200-1800 avant notre ère) du sud de l’Oural, dans la culture Andronovo d’Asie centrale (2000-900 avant notre ère), qui s’étend du sud de l’Oural au cours supérieur de l’Ienisseï en Sibérie centrale, et enfin dans la Civilisation de la vallée de l’Indus (Harappa) (4000-1500 avant notre ère).
Cette culture védique se fonde sur les fameux Védas (savoirs), quatre textes religieux consignant la liturgie des rituels et des sacrifices et les plus anciennes écritures de l’hindouisme. La partie la plus ancienne du Rig-Veda a été composée oralement dans le nord-ouest de l’Inde (Pendjab) entre 1500 et 1200 av. JC., c’est-à-dire peu après l’effondrement de la Civilisation de la vallée de l’Indus.
Le philologue, grammairien et érudit sanskrit Panini, qu’on croit être un contemporain de Bouddha, est connu pour son traité de grammaire sanskrite en forme de sutra, qui a suscité de nombreux commentaires de la part d’érudits d’autres religions indiennes, notamment bouddhistes.
Les Brahmanes et le système des castes

Cependant, avec l’émergence de cette culture aryenne apparut ce que l’on appelle le « brahmanisme », c’est-à-dire la naissance d’une caste toute puissante de grands prêtres.
« De nombreuses études linguistiques et historiques font état de troubles socioculturels résultant de cette migration et de la pénétration de la culture brahmanique dans diverses régions, de l’ouest de l’Asie du Sud vers l’Inde du Nord, l’Inde du Sud et l’Asie du Sud-Est », constate aujourd’hui Gajendran Ayyathurai, un anthropologue indien de l’Université de Göttingen en Allemagne.
Le brahman, littéralement « supérieur », est un membre de la caste sacerdotale la plus élevée (à ne pas confondre avec les adorateurs du dieu hindou Brahma). Bien que le terme apparaisse dans les Védas, les chercheurs modernes tempèrent ce fait et soulignent qu’il « n’existe aucune preuve dans le Rig-Veda d’un système de castes élaboré, très subdivisé et très important ».
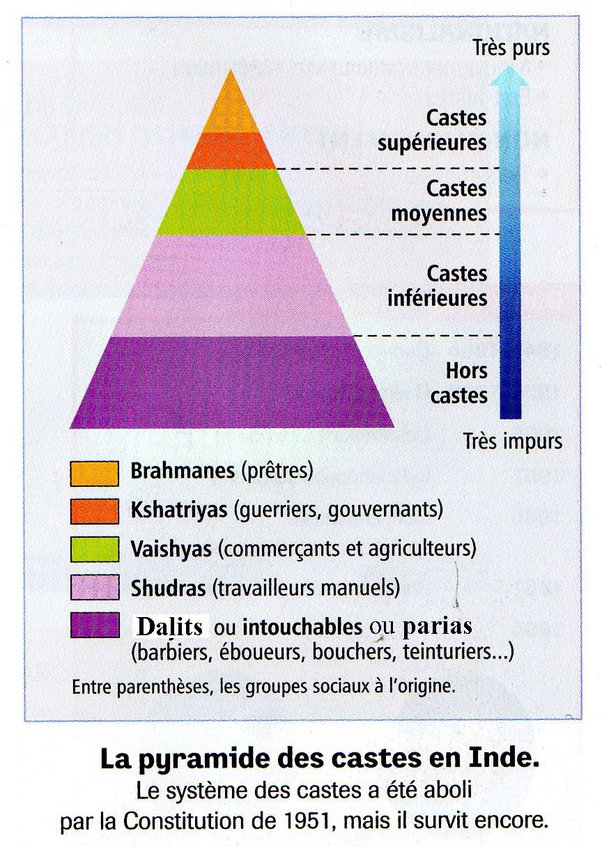
Mais avec l’émergence d’une classe dirigeante de brahmanes, devenus banquiers et propriétaires terriens, notamment sous la période Gupta (de 319 à 515 après J.-C.), un redoutable système de castes se met graduellement en place. La classe dirigeante féodale, ainsi que les prêtres, vivant des recettes des sacrifices, mettront l’accent sur des dieux locaux qu’ils intégreront progressivement au brahmanisme afin de séduire les masses. Même parmi les souverains, le choix des divinités indiquait des positions divergentes : une partie de la dynastie Gupta soutenait traditionnellement le dieu Vishnou, tandis qu’une autre soutenait le dieu Shiva.
Ce système déshumanisant des castes fut ensuite amplifié et utilisé à outrance par la Compagnie britannique des Indes orientales, une entreprise et une armée privée à la tête de l’Empire britannique, pour imposer son pouvoir aristocratique et colonial sur les Indes, une politique qui perdure encore aujourd’hui, surtout dans les esprits.
Le système hindou des castes s’articule autour de deux concepts clés permettant de catégoriser les membres de la société : le varṇa et la jati. Le varna (littéralement « couleur ») divise la société en une hiérarchie de quatre grandes classes sociales :
- Brahmanes (la classe sacerdotale)
- Kshatriyas (guerriers et dirigeants)
- Vaishyas (marchands)
- Shudras (travailleurs manuels)
En outre, la jati fait référence à plus de 3000 classifications hiérarchiques, à l’intérieur des quatre varnas, entre les groupes sociaux en fonction de la profession, du statut social, de l’ascendance commune et de la localité…
La justification de cette stratification sociale est intimement liée à la vision hindouiste du karma. Car la naissance de chacun est directement liée au karma, véritable bilan de sa vie précédente. Ainsi, la naissance dans le varna brahmanique est le résultat d’un bon karma…
« Ceux qui ont eu une bonne conduite ici auront rapidement une bonne naissance – naissance en tant que brahmane, kshatriya ou vaishya. Mais ceux dont la conduite ici a été mauvaise obtiendront rapidement une mauvaise naissance – naissance en tant que chien, porc ou chandala (bandit). »
(Chandogya Upanishad 5.10.7)
Selon cette théorie, le karma détermine la naissance de l’individu dans une classe, ce qui définit son statut social et religieux, qui fixe à son tour ses devoirs et obligations au regard de ce statut spécifique.
En 2021, une enquête a révélé que trois Indiens sur dix (30 %) s’identifient comme membres des quatre varnas et seulement 4,3 % des Indiens (60,5 millions) comme des brahmanes.
Certains d’entre eux sont prêtres, d’autres exercent des professions telles qu’éducateurs, législateurs, érudits, médecins, écrivains, poètes, propriétaires terriens et politiciens. Au fur et à mesure de l’évolution de ce système de castes, les brahmanes ont acquis une forte influence en Inde et ont exercé une discrimination à l’encontre des autres castes « inférieures ».
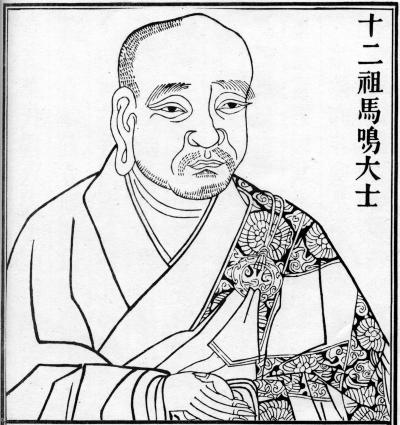
L’immense partie restante des Indiens (70 %), y compris parmi les hindous, déclare faire partie des dalits, encore appelés intouchables, des individus considérés, du point de vue du système des castes, comme hors castes et affectés à des fonctions ou métiers jugés impurs. Présents en Inde, mais également dans toute l’Asie du Sud, les dalits sont victimes de fortes discriminations. En Inde, une écrasante majorité de bouddhistes se déclarent dalits.
Dès le Ier siècle, le philosophe bouddhiste, dramaturge, poète, musicien et orateur indien Asvaghosa (v. 80 – v. 150 ap. J.-C.) a élevé la voix pour condamner ce système des castes, avec des arguments empruntés pour certains aux textes les plus vénérés des brahmanes eux-mêmes, et pour d’autres, fondés sur le principe de l’égalité naturelle entre tous les hommes.
Selon Asvaghosa,
« la qualité de brahmane n’est inhérente ni au principe qui vit en nous, ni au corps dans lequel réside ce principe, et elle ne résulte ni de la naissance, ni de la science, ni des pratiques religieuses, ni de l’observation des devoirs moraux, ni de la connaissance des Védas. Puisque cette qualité n’est ni inhérente ni acquise, elle n’existe pas, ou plutôt tous les hommes peuvent la posséder. »
Une allégorie bouddhiste rejette clairement et se moque de l’idée même du système de castes:
« De même que le sable ne devient pas de la nourriture simplement parce qu’un enfant le dit, lorsque de jeunes enfants jouant sur une route principale construisent des pâtés de sable et leur donnent des noms, en disant ‘Celui-ci est du lait, celui-ci de la viande et celui-ci du lait caillé’, il en va de même pour les quatre varnas, tels que vous, les brahmanes, les décrivez. »
L’Inde avant le bouddhisme
L’époque du Bouddha est celle de la deuxième urbanisation de l’Inde et d’une grande contestation sociale.
L’essor des shramaṇas, des philosophes ou moines errants ayant rejeté l’autorité des Védas et des brahmanes, était nouveau. Bouddha n’était pas le seul à explorer les moyens d’obtenir la libération (moksha) du cycle éternel des renaissances (saṃsara).
Le constat que les rituels védiques ne menaient pas à une libération éternelle conduisit à la recherche d’autres moyens. Le bouddhisme primitif, le yoga et des courants similaires de l’hindouisme, jaïnisme, ajivika, ajnana et chârvaka, étaient les shramanas les plus importants.
Malgré le succès obtenu en diffusant des idées et des concepts qui allaient bientôt être acceptés par toutes les religions de l’Inde, les écoles orthodoxes de philosophie hindoue (astika) s’opposaient aux écoles de pensée shramaṇiques et réfutèrent leurs doctrines en les qualifiant d’hétérodoxes (nastika), parce qu’elles refusaient d’accepter l’autorité épistémique des Védas.
Pendant plus de quarante ans, le Bouddha sillonna l’Inde à pied pour diffuser son dharma, un ensemble de préceptes et de lois sur le comportement de ses disciples. À sa mort, son corps fut incinéré, comme c’était la coutume en Inde, et ses cendres furent réparties dans plusieurs reliquaires, enterrés dans de grands monticules hémisphériques connus sous le nom de stupas. Alors déjà, sa religion était répandue dans tout le centre de l’Inde et dans de grandes villes indiennes comme Vaishali, Shravasti et Rajagriha.
Les grands conciles bouddhistes

Quatre grands conciles bouddhistes furent organisés, à l’instigation de différents rois qui cherchaient en réalité à briser l’omnipuissante caste des brahmanes.
Le premier eut lieu en 483 avant J.-C., juste après la mort du Bouddha, sous le patronage du roi Ajatasatru (492-460 av. J.-C.) du Royaume du Magadha, le plus grand des seize royaumes de l’Inde ancienne, afin de préserver les enseignements du Bouddha et de parvenir à un consensus sur la manière de les diffuser.
Le deuxième intervint en 383 avant J.-C., soit cent ans après la mort du Bouddha, sous le règne du roi Kalashoka. Des divergences d’interprétation s’installant sur des points de discipline au fur et à mesure que les adeptes s’éloignaient les uns des autres, un schisme menaçait de diviser ceux qui voulaient préserver l’esprit originel et ceux qui défendaient une interprétation plus large.
Le premier groupe, appelé Thera (signifiant « ancien » en pâli), est à l’origine du bouddhisme theravâda, engagé à préserver les enseignements du Bouddha dans l’esprit originel.
L’autre groupe était appelé Mahasanghika (Grande Communauté). Ils interprétaient les enseignements du Bouddha de manière plus libérale et nous ont donné le bouddhisme Mahâyâna.
Les participants au concile tentèrent d’aplanir leurs divergences, sans grande unité mais sans animosité non plus. L’une des principales difficultés venait du fait qu’avant d’être consignés dans des textes, les enseignements du Bouddha n’avaient été transmis qu’oralement pendant trois à quatre siècles. (*2)
L’arrivée des Grecs
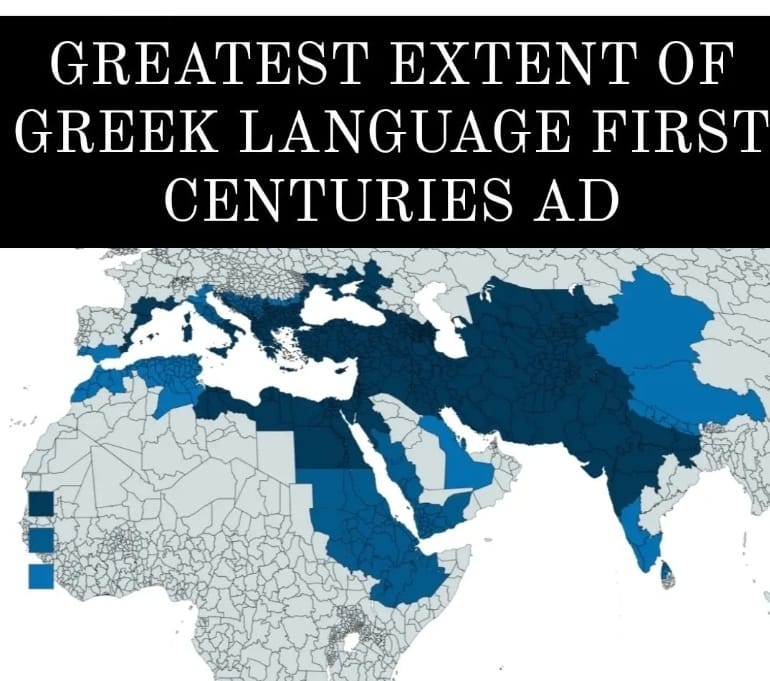
Ainsi que nous l’avons documenté par ailleurs, l’Asie centrale, et l’Afghanistan en particulier, furent le lieu de rencontre entre les civilisations perses, chinoises, grecques et indiennes.
C’est au Gandhara, région à cheval entre le Pakistan et l’Afghanistan, au cœur des Routes de la soie, que le bouddhisme prendra à deux reprises un envol majeur, donnant naissance à un art dit « gréco-bouddhiste », qui parviendra à faire la synthèse entre plusieurs cultures à travers des œuvres d’une beauté incomparable.

Les premiers Grecs commencèrent à s’installer dans la partie nord-ouest du sous-continent indien à l’époque de l’Empire perse achéménide. Après avoir conquis la région, le roi perse Darius le Grand (521 – 486 av. J.-C.) colonisa également une grande partie du monde grec, qui comprenait à l’époque toute la péninsule anatolienne occidentale.
Lorsque des villages grecs se rebellaient sous le joug perse, ils faisaient parfois l’objet d’un nettoyage ethnique et leurs populations étaient déportées à l’autre bout de l’empire.
C’est ainsi que de nombreuses communautés grecques virent le jour dans les régions indiennes les plus reculées de l’empire perse.
Au IVe siècle avant J.-C., Alexandre le Grand (356 – 323 av. J.-C.) vainquit et conquit l’empire perse. En 326 avant J.-C., cet empire comprenait la partie nord-ouest du sous-continent indien jusqu’à la rivière Beas (que les Grecs nommaient l’Hyphase). Alexandre établit des satrapies et fonde plusieurs colonies. Il se tourne vers le sud lorsque ses troupes, conscientes de l’immensité de l’Inde, refusent de pousser plus loin encore vers l’est.
Après sa mort, son empire se délite. De 180 av. J.-C. à environ l’an 10 de notre ère, plus de trente rois hellénistiques se succèdent, souvent en conflit entre eux. Cette époque est connue dans l’histoire sous le nom des « Royaumes indo-grecs ».
L’un d’eux a été fondé lorsque le roi gréco-bactrien Démétrius envahit l’Inde en 180 avant notre ère, créant ainsi une entité faisant sécession avec le puissant royaume gréco-bactrien, la Bactriane (comprenant notamment le nord de l’Afghanistan, une partie de l’Ouzbékistan, etc.).
Pendant les deux siècles de leur règne, ces rois indo-grecs intégrèrent dans une seule culture des langues et des symboles grecs et indiens, comme en témoignent leurs pièces de monnaie, et mêlèrent les anciennes pratiques religieuses grecques, hindoues et bouddhistes, comme le montrent les vestiges archéologiques de leurs villes et les signes de leur soutien au bouddhisme.
L’Empire Maurya
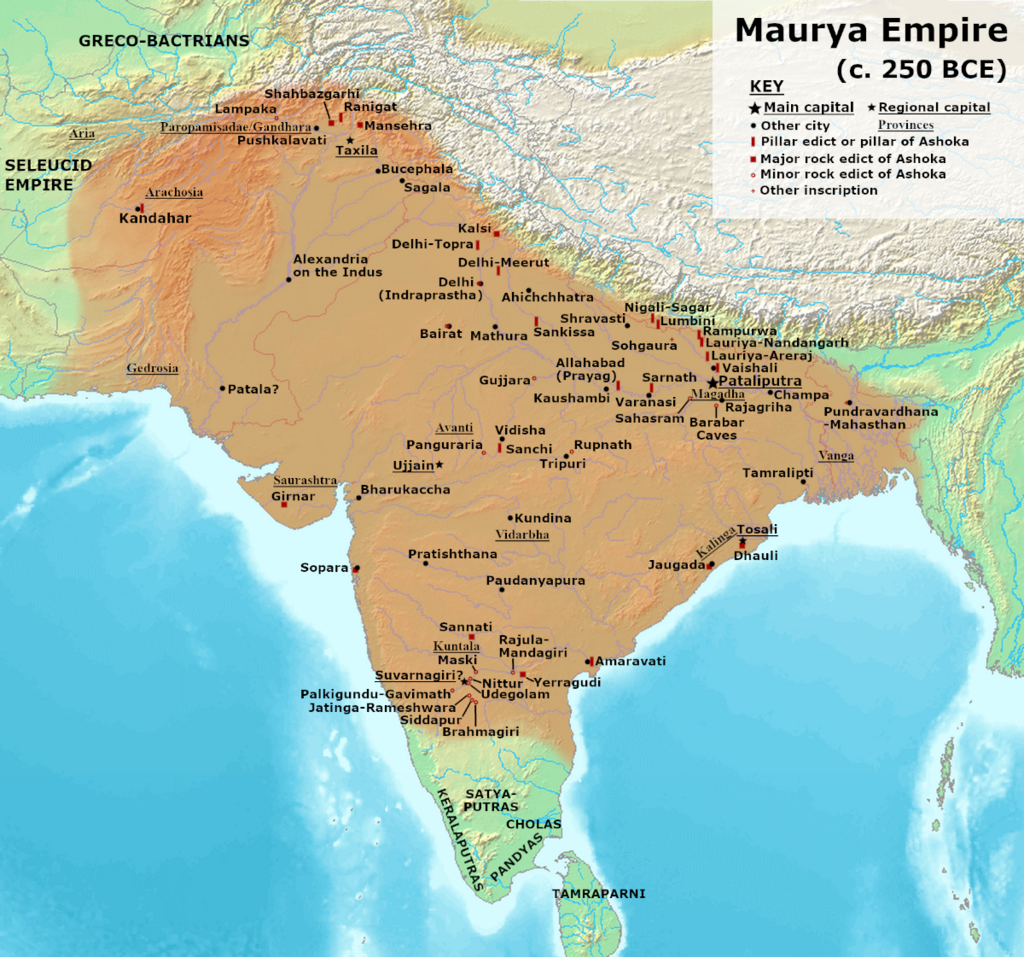
Vers 322 avant J.-C., les Grecs appelés Yona (Ioniens) ou Yavana dans les sources indiennes, participent, avec d’autres populations, au soulèvement de Chandragupta Maurya (né v. -340 et mort v. – 297), le fondateur de l’Empire maurya.
Le règne de Chandragupta ouvre une ère de prospérité économique, de réformes, d’expansion des infrastructures et de tolérance. De nombreuses religions ont ainsi prospéré dans son royaume et dans l’empire de ses descendants. Bouddhisme, jaïnisme et ajivika prennent de l’importance aux côtés des traditions védiques et brahmaniques, tout en respectant les religions minoritaires telles que le zoroastrisme et le panthéon grec.
Le règne d’Ashoka le Grand
(de 268 à 231 av. JC)

L’Empire Maurya atteint son apogée sous le règne du petit-fils de Chandragupta, Ashoka le Grand, de 268 à 231 av. J.-C. (parfois écrit Asoka).
Huit ans après sa prise de pouvoir, Ashoka mène une campagne militaire pour conquérir le Kalinga, un vaste royaume côtier du centre-est de l’Inde. Sa victoire lui permet de conquérir un territoire plus vaste que celui de tous ses prédécesseurs. Grâce aux conquêtes d’Ashoka, l’Empire Maurya devient une puissance centralisée couvrant une grande partie du sous-continent indien, s’étendant de l’actuel Afghanistan à l’ouest à l’actuel Bangladesh à l’est, avec sa capitale à Pataliputra (proche de l’actuelle Patna en Inde).
Alors que l’Empire Maurya avait existé dans un certain désordre jusqu’en 185 av. J.-C., Ashoka va transformer le royaume en recourant à une violence extrême qui caractérise le début de son règne. On parle de 100 000 à 300 000 morts, rien que lors de la conquête du Kalinga !
Mais le poids d’un tel carnage plonge le roi dans une grave crise personnelle. Ashoka est gravement choqué par la multitude de vies arrachées par ses armées. L’édit N° 13 d’Ashoka reflète le profond remords ressenti par le roi après avoir observé la destruction de Kalinga :
« Sa Majesté a éprouvé des remords à cause de la conquête de Kalinga car, lors de l’assujettissement d’un pays non conquis auparavant, il y a nécessairement des massacres, des morts et des captifs, et Sa Majesté en éprouve une profonde tristesse et un grand regret. »
Ashoka renonce alors aux démonstrations de force militaires et autres formes de violence, y compris la cruauté envers les animaux. Conquis par le bouddhisme, il se consacre alors à répandre sa vision du dharma, une conduite juste et morale. Il va encourager la diffusion du bouddhisme dans toute l’Inde. Selon l’archéologue et érudit français François Foucher, même si les cas de mauvais traitements envers les animaux ne disparurent pas du jour au lendemain, la croyance en la fraternité de tous les êtres vivants est plus florissante en Inde que partout ailleurs.
En 250 avant J.-C., Ashoka convoque le troisième concile bouddhique. Les sources theravâda mentionnent qu’en plus de régler les différends intérieurs, la principale fonction du concile était de planifier l’envoi de missionnaires bouddhistes dans différents pays afin d’y répandre la doctrine.
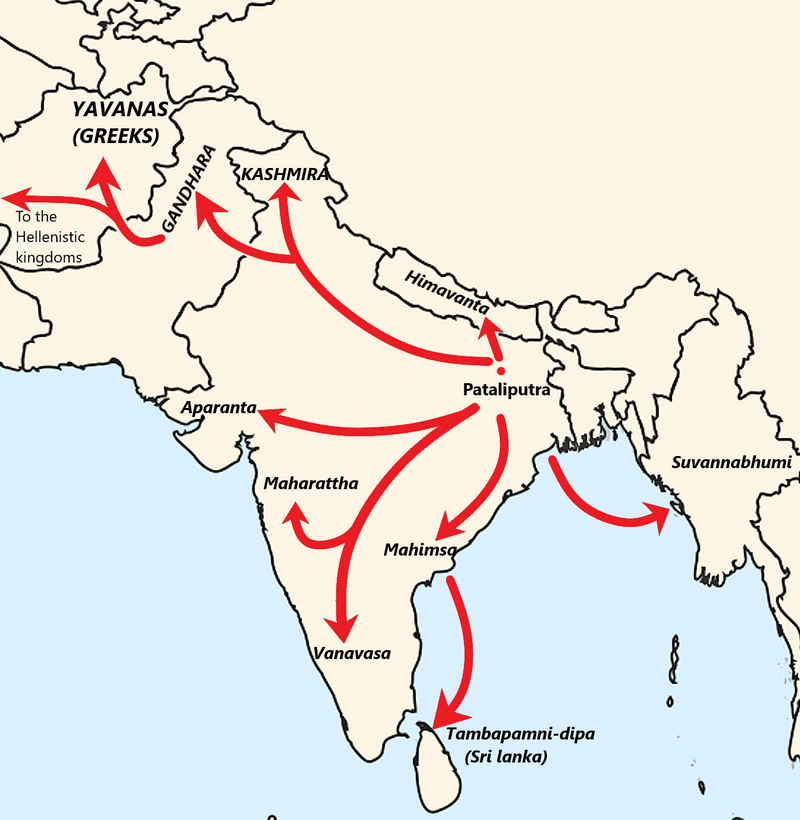
Ces missionnaires allèrent jusqu’aux royaumes hellénistiques de l’ouest, en commençant par la Bactriane voisine. Des missionnaires furent également envoyés en Inde du sud, au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est (peut-être en Birmanie).
La forte implication de ces missions dans l’éclosion du bouddhisme en Asie à l’époque d’Ashoka est solidement étayée par des preuves archéologiques. Le bouddhisme ne s’est pas répandu par pur hasard, mais dans le cadre d’une opération politique créative, stimulante et bien planifiée, tout au long des Routes de la soie.
Le Mahavamsa ou Grande chronique (XII, 1er paragraphe), relatant l’histoire des rois cinghalais et tamouls de Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka), donne la liste des missionnaires bouddhistes envoyés par le Concile et Ashoka :
- Le vieux Majjhantika prit la tête de la mission au Cachemire et au Gandhara (aujourd’hui le nord-ouest du Pakistan et l’Afghanistan) ;
- L’aîné Mahadeva dirigea la mission dans le sud-ouest de l’Inde (Mysore, Karnataka) ;
- Rakkhita, celle du sud-est de l’Inde (Tamil Nadu) ;
- Le vieux Yona (Ionien, Grec) Dharmaraksita partit vers Aparantaka (« frontière occidentale », comprenant le nord du Gujarat, le Kathiawar, le Kachch et le Sindh, toutes des parties de l’Inde à l’époque) ;
- L’aîné Mahadharmaraksita dirigea la mission de Maharattha (région péninsulaire occidentale de l’Inde) ;
- Maharakkhita (Maharaksita Thera) fut envoyé au pays des Yona (Ioniens), probablement la Bactriane et peut-être le royaume séleucide ;
- Majjhima Thera conduisit la mission dans la région d’Himavant (nord du Népal, contreforts de l’Himalaya) ;
- Sona Thera et Uttara Thera, celles de Suvannabhumi (quelque part en Asie du Sud-Est, peut-être au Myanmar ou en Thaïlande) ;
- Enfin, Mahinda, fils aîné d’Ashoka et donc le Prince de son royaume, accompagné de ses disciples Utthiya, Ittiya, Sambala et Bhaddasala, se rendit à Lankadipa (Sri Lanka).
Certaines de ces missions furent couronnées de succès, permettant d’implanter le bouddhisme en Afghanistan, au Gandhara et au Sri Lanka, par exemple.
Le bouddhisme gandharien, le gréco-bouddhisme et le bouddhisme cinghalais ont puissamment inspiré le développement du bouddhisme dans le reste de l’Asie, notamment en Chine, et ceci pendant des générations.
Si les missions dans les royaumes hellénistiques méditerranéens semblent avoir été moins fructueuses, il est possible que des communautés bouddhistes se soient établies pendant une période limitée dans l’Alexandrie égyptienne, ce qui pourrait être à l’origine de la secte dite des Therapeutae, mentionnée dans certaines sources anciennes comme Philon d’Alexandrie (v. 20 av. J.-C. – 50 apr. J.-C.).
Le courant juif des Esséniens et les Thérapeutes d’Alexandrie seraient des communautés fondées sur le modèle du monachisme bouddhique. « C’est l’Inde qui serait, selon nous, au départ de ce vaste courant monastique qui brilla d’un vif éclat durant environ trois siècles dans le judaïsme même », affirme l’historien français André Dupont-Sommer, et cette influence aurait même contribué, selon lui, à l’émergence du christianisme.
Edits d’Ashoka

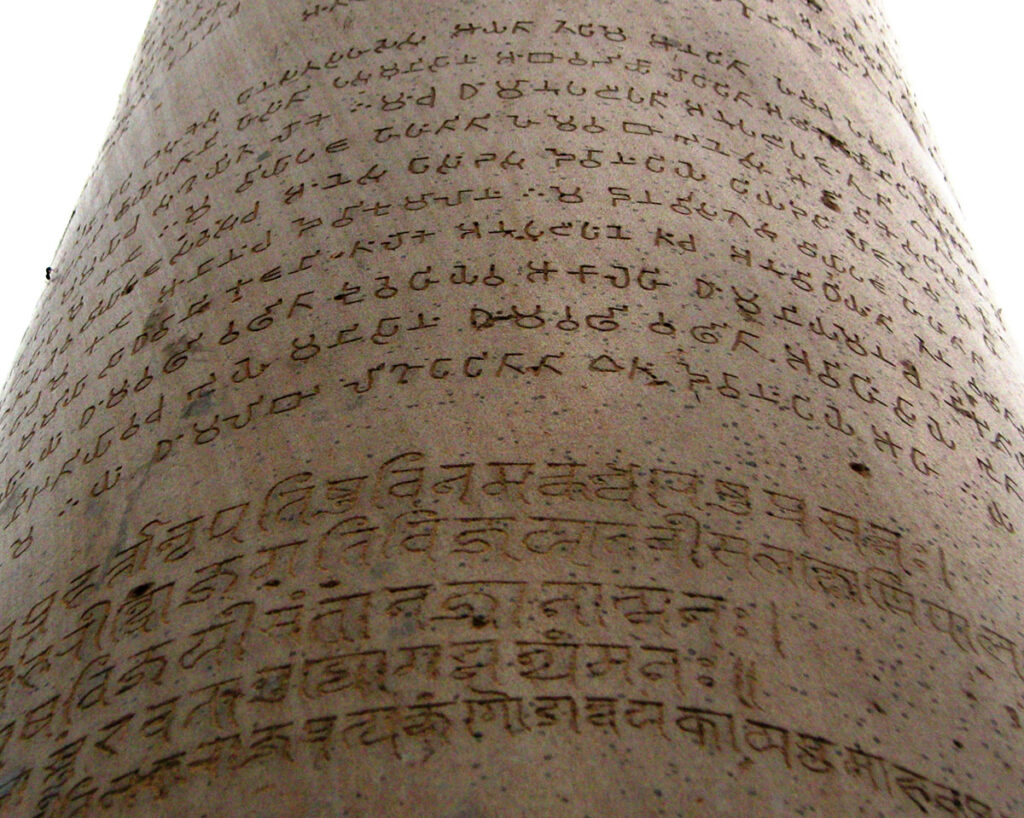
Ashoka transmettait ses messages par le biais d’édits gravés sur des piliers et des rochers en divers lieux du royaume, proches des stupas, sur des lieux de pèlerinage et le long de routes commerciales très fréquentées.
Une trentaine d’entre eux ont été conservés. Ils sont souvent rédigés non pas en sanskrit, mais en grec (la langue du royaume gréco-bactrien voisin et des communautés grecques du royaume d’Ashoka), en araméen (langue officielle de l’ancien empire achéménide) ou en divers dialectes du prâkrit (une langue indo-aryenne moyenne), y compris le gândhârî ancien, langue parlée au Gandhara. (*3)
Ces édits utilisaient la langue pertinente pour la région. Par exemple, en Bactriane, ou les Grecs dominaient, on trouve près de l’actuelle Kandahar un édit rédigé uniquement en grec et en araméen.
Contenu des édits

Certains d’entre eux reflètent l’adhésion profonde d’Ashoka aux préceptes du bouddhisme et ses relations étroites avec le Sangha, l’ordre monastique bouddhiste. Il utilise également le terme spécifiquement bouddhiste de dharma pour désigner les qualités du cœur qui sous-tendent l’action morale.
Dans son édit mineur sur rocher N° 1, le roi se déclare « adepte laïc de l’enseignement du Bouddha depuis plus de deux ans et demi », mais avoue que jusqu’ici, il n’a « pas fait grand progrès ». « Depuis un peu plus d’un an, je me suis rapproché de l’Ordre », ajoute-t-il.
Dans l’édit mineur sur rocher N° 3 de Calcutta-Bairat, il affirme : « Tout ce qui a été dit par le Bouddha a été bien dit », décrivant les enseignements du Bouddha comme le véritable dharma.
Ashoka a reconnu les liens étroits entre l’individu, la société, le roi et l’État. Son dharma peut être compris comme la moralité, la bonté ou la vertu, et l’impératif de le poursuivre lui a donné le sens du devoir. Les inscriptions expliquent que le dharma intègre la maîtrise de soi, la pureté de la pensée, la libéralité, la gratitude, la dévotion ferme, la véracité, la protection de la parole et la modération dans les dépenses et les possessions.
Le dharma a également un aspect social. Il comprend l’obéissance aux parents, le respect des aînés, la courtoisie et la libéralité envers les adorateurs de Brahma, la courtoisie envers les esclaves et les serviteurs, et la libéralité envers les amis, les connaissances et les parents.
La non-violence, qui consiste à s’abstenir de blesser ou de tuer tout être vivant, était un aspect important du dharma d’Ashoka. Ne tuer aucun être vivant est décrit comme faisant partie du bien (Édit mineur sur rocher N° 11), de même que la douceur à leur égard (Édit mineur sur rocher N° 9). L’accent mis sur la non-violence s’accompagne de l’incitation à une attitude positive d’attention, de douceur et de compassion.
Ashoka adopte et préconise une politique fondée sur le respect et la tolérance des autres religions. L’un de ses édits préconise :
« Tous les hommes sont mes enfants. A mes enfants, je souhaite prospérité et bonheur dans ce monde et dans l’autre ; mes vœux sont les mêmes pour tous les hommes. »
Loin d’être sectaire, Ashoka, s’appuyant sur la conviction que toutes les religions partagent une essence commune et positive, encourage la tolérance et la compréhension des autres religions :
« Le bien-aimé des dieux, le roi Piyadassi (c’est-à-dire Ashoka), souhaite que toutes les sectes puissent habiter en tous lieux, car toutes recherchent la maîtrise de soi et la pureté de l’esprit. » (Édit majeur sur rocher N° 7)
Et il précise :
« Car quiconque loue sa propre secte ou blâme les autres sectes, –par pure dévotion à sa propre secte, dans le simple but de la glorifier, – en agissant ainsi, il porte au contraire gravement préjudice à sa propre secte. Mais la concorde est méritoire, (c’est-à-dire) que tous doivent écouter et obéir à la morale de l’autre. » (Édit majeur sur rocher N° 12)
Ashoka avait l’idée d’un empire politique et d’un empire moral, le second englobant le premier. Sa conception de sa circonscription s’étendait au-delà de ses sujets politiques pour inclure tous les êtres vivants, humains et animaux, vivant à l’intérieur comme à l’extérieur de son domaine politique. Ses inscriptions expriment sa conception paternelle de la royauté et décrivent ses mesures d’aide sociale, notamment la fourniture de traitements médicaux, la plantation d’herbes, d’arbres et de racines pour les hommes et les animaux, et le creusement de puits le long des routes (Edit majeur sur rocher N°2). Les efforts du roi pour propager son dharma ne se limitaient pas à son propre domaine politique, mais s’étendaient aux royaumes des autres souverains.
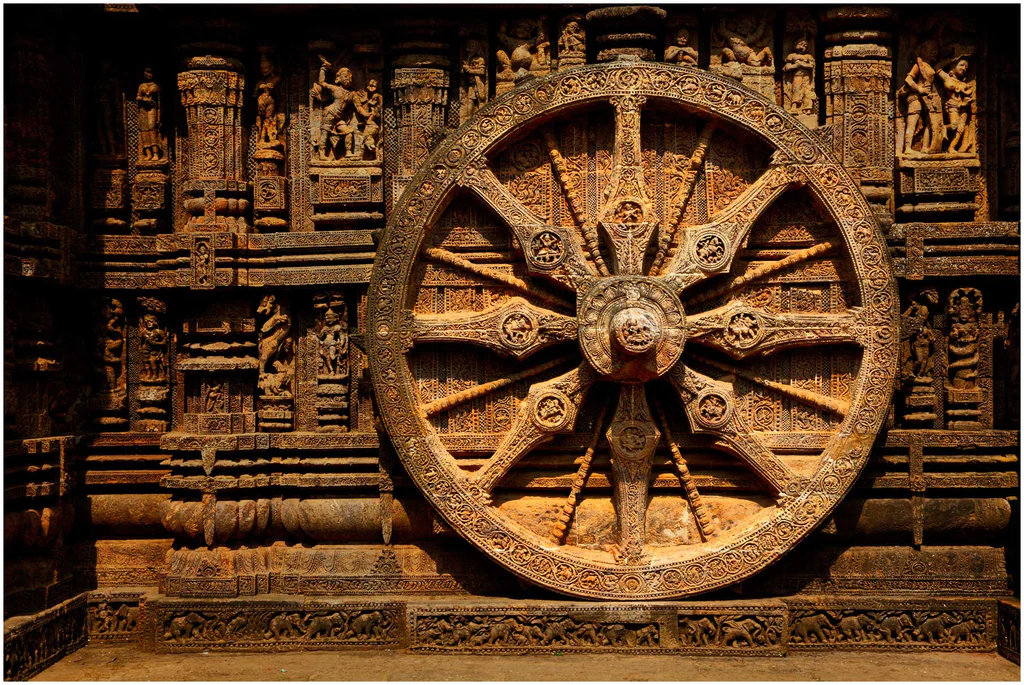
L’empereur est devenu un sage. Il dirige un gouvernement centralisé depuis Pataliputra, capitale de l’Empire Maurya. Son administration perçoit des impôts et il demande à ses inspecteurs de lui rendre des comptes. L’agriculture se développe grâce à des canaux d’irrigation. Il fait construire des routes de qualité pour relier les points stratégiques et les centres politiques, exigeant, des siècles avant notre grand Sully en France, qu’elles soient bordées d’arbres d’ombrage, de puits et d’auberges.
Si l’existence même d’Ashoka en tant que personnage historique a été quasiment oubliée, depuis le déchiffrement de sources écrites en brahmi au XIXe siècle, il est désormais considéré comme l’un des plus grands empereurs indiens. La roue bouddhiste d’Ashoka figure d’ailleurs sur le drapeau indien.
Comme nous l’avons déjà dit, Ashoka et ses descendants ont utilisé leur pouvoir pour construire des monastères et répandre l’influence bouddhiste en Afghanistan, dans de vastes régions de l’Asie centrale, au Sri Lanka et, au-delà, en Thaïlande, Birmanie, Indonésie, puis en Chine, en Corée et au Japon.
Des statues en bronze de son époque ont été déterrées dans les jungles d’Annam, de Bornéo et des Célèbes. La culture bouddhiste s’est implantée dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, même si chaque région a su conserver une partie de sa personnalité et de son caractère propres.
L’Empire Kouchan
(du Ier siècle av. JC au IIIe siècle)

L’Empire Maurya, qui régnait sur la Bactriane et d’autres anciennes satrapies grecques, s’effondra en 185 avant J.-C., à peine cinq décennies après la mort d’Ashoka, accusé d’avoir trop dépensé pour les temples et les missions bouddhistes. Les mafias brahmaniques, qui avaient abhorré son règne, revinrent immédiatement au pouvoir.
Mais la période est turbulente. Au premier siècle avant J.C., les Kouchans, l’une des cinq branches de la confédération nomade chinoise Yuezhi, émigrent du nord-ouest de la Chine (Xinjiang et Gansu) et s’emparent, après les nomades iraniens Saka, de l’ancienne Bactriane.
Ils forment l’Empire kouchan dans les territoires de la Bactriane. Cet empire s’étend assez vite à une grande partie de ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, le Pakistan et le nord de l’Inde, au moins jusqu’à Saketa et Sarnath, près de la ville de Varanasi (Bénarès).

Le fondateur de la dynastie kouchane, Kujula Kadphisès, qui suit les idées culturelles et l’iconographie grecques après la tradition gréco-bactrienne, est un adepte de la secte shivaïte de l’hindouisme. Deux rois kouchans ultérieurs, Vima Kadphisès et Vasudeva II, furent également des mécènes de l’hindouisme et du bouddhisme. La patrie de leur empire se trouvait en Bactriane, où le grec était initialement la langue administrative, avant d’être remplacé par le bactrien écrit en caractères grecs jusqu’au VIIIe siècle, lorsque l’islam le remplace par l’arabe.

Les Kouchans devinrent également de grands mécènes du bouddhisme, en particulier l’empereur Kanishka le Grand (78-144 après J.-C.), qui joua un rôle important dans sa diffusion, via les Routes de la soie, vers l’Asie centrale et la Chine, inaugurant une période de paix relative de 200 ans, parfois décrite comme la « Pax Kouchana ».
Il semble également que dès ses débuts, le bouddhisme ait prospéré dans la classe des marchands, à qui la naissance interdisait l’accès aux ordres religieux de l’Inde et de l’Himalaya. La pensée et l’art bouddhistes se développèrent grâce aux routes commerciales entre l’Inde, l’Himalaya, l’Asie centrale, la Chine, la Perse, l’Asie du Sud-Est et l’Occident. Les voyageurs recherchaient la protection des images bouddhistes et faisaient des offrandes aux sanctuaires le long de la route, ramassant des objets et des sanctuaires portables pour leur usage personnel.
Le terme quatrième concile bouddhiste désigne deux évènements différents selon les écoles theravâda et mahâyâna.
1) La tradition theravâda : afin d’éviter que ne se perde l’enseignement du Bouddha, qui se serait jusqu’alors transmis oralement, cinq cents moines menés par le Vénérable Maharakkhita se réunirent à Tambapanni (Sri Lanka), sous le patronage du roi Vattagamani (r. 103 – 77 av. J.-C.) afin de coucher par écrit sur des feuilles de palme le Canon pâli. (*4)
Le travail, qui aurait duré trois ans, se serait déroulé dans la grotte Aloka lena, près de l’actuel Matale.
2) Selon la tradition mahâyâna, c’est 400 ans après l’extinction du Bouddha que cinq cents moines sarvastivadin se réunirent en 72 après J.-C. au Cachemire pour compiler et clarifier leurs doctrines sous la direction de Vasumitra et sous le patronage personnel de l’empereur Kanishka. Ils auraient ainsi produit le Mahavibhasa (Grande exégèse) en sanskrit.
Selon plusieurs sources, le moine bouddhiste indien Asvaghosa, considéré comme le premier dramaturge classique sanskrit et dont nous avons évoqué plus haut les attaques contre le système des castes, était le conseiller spirituel du roi Kanishka dans les dernières années de sa vie.

A noter que les plus anciens manuscrits bouddhiques découverts à ce jour, tels que les vingt-sept rouleaux d’écorce de bouleau acquis par la British Library en 1994 et datant du Ier siècle, ont été trouvés, non pas en Inde, mais enterrés dans les anciens monastères du Gandhara, la région centrale de l’empire maurya et kouchan, qui comprend les vallées de Peshawar et de Swat (Pakistan) et s’étend vers l’ouest jusqu’à la vallée de Kaboul en Afghanistan et vers le nord jusqu’à la chaîne du Karakoram
Ainsi, après le grand élan donné par le roi Ashoka le Grand, la culture du Gandhara connaîtra un second souffle sous le règne du roi kouchan Kanishka Ier.
Les villes de Begram, Taxila, Purushapura (aujourd’hui Peshawar) et Surkh Kotal atteignent alors des sommets de développement et de prospérité.
Le miracle de Gandhara

C’est peu dire que le Gandhara, surtout à l’époque kouchane, fut au cœur d’une véritable renaissance de la civilisation, avec une incroyable concentration de productions artistiques et une inventivité sans pareil. Si l’art bouddhiste était principalement centré sur les temples et les monastères, les objets de dévotion personnelle étaient très courants.
Grâce à l’art du Gandhara, le bouddhisme se mua en une grande force de beauté, d’harmonie et de paix, conquérant le monde.
Il favorisa alors une création artistique qui élève la pensée et la moralité en faisant appel à des paradoxes métaphoriques.
Les médiums et supports qui prévalent sont la peinture sur soie, les fresques, les livres illustrés et gravures, la broderie et autres arts du tissu, la sculpture (bois, métal, ivoire, pierre, jade) et l’architecture. Quelques exemples :
A. La poésie
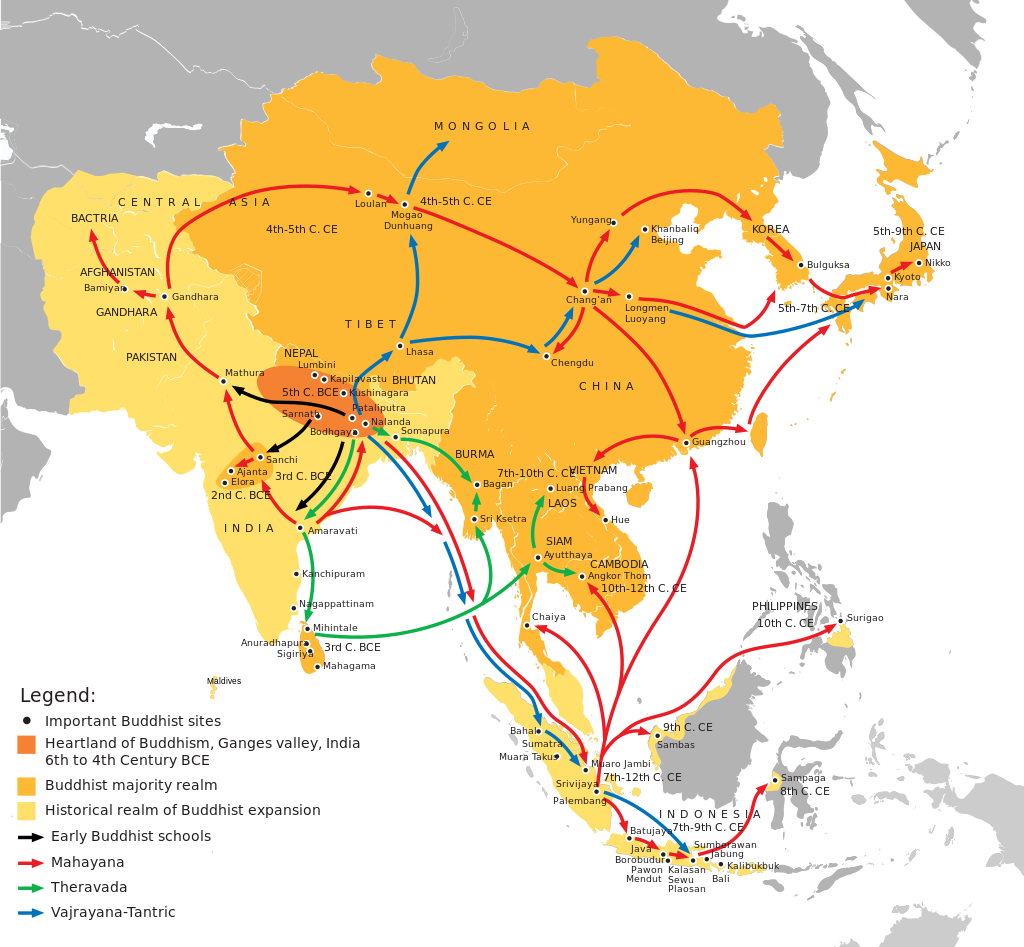
Pour la plupart des Occidentaux, le bouddhisme est une émanation typique de la culture asiatique, généralement associée à l’Inde, au Tibet, au Népal, mais aussi à la Chine et à l’Indonésie.
Peu de gens savent que les plus anciens manuscrits bouddhistes connus à ce jour (Ier siècle de notre ère) ont été découverts, non pas en Asie, mais en Asie centrale, dans d’anciens monastères bouddhistes du Gandhara.
A l’origine, avant leur transcription en sanskrit (pendant longtemps la langue des élites), ils étaient écrits en gândhârî, une langue indo-aryenne du groupe prâkrit, transcrit avec l’alphabet kharosthi (une ancienne écriture indo-iranienne). Le gândhârî était la lingua franca de la pensée bouddhiste à ses débuts. Preuve en est, les manuscrits bouddhistes écrits en gândhârî qui ont voyagé jusqu’en Chine orientale pour se retrouver dans les inscriptions de Luoyang et d’Anyang.

Afin de préserver leurs écrits, les bouddhistes étaient à l’avant-garde de l’adoption des technologies chinoises liées à la fabrication de livres, notamment le papier et la xylographie. Cette technique d’impression consiste à reproduire le texte à imprimer sur une feuille de papier transparente qui est retournée et gravée sur une planche de bois tendre. L’encrage des parties saillantes permet ensuite des tirages multiples. C’est ce qui explique que le premier livre entièrement imprimé est le Sutra du diamant bouddhique (vers 868) réalisé par ce procédé
Le Khaggavisana Sutta, littéralement « la corne du rhinocéros », est une expression authentique de la poésie religieuse bouddhiste originale. Connu sous le nom de Sutra du rhinocéros, cette œuvre poétique fait partie du recueil pâli de textes courts Kuddhhaka Nikava, la cinquième partie du Sutta Pitaka, écrit au Ier siècle de notre ère.
Parce que la tradition accorde au rhinocéros asiatique une vie solitaire dans la forêt, l’animal n’aime pas les troupeaux, ce sutra (enseignement) porte le titre approprié d’essai « sur la valeur de la vie solitaire et errante ». L’allégorie du rhinocéros permet de communiquer aux dévots un sens aigu de la souveraineté individuelle que requièrent les engagements moraux prescrits par le Bouddha pour mettre fin à la souffrance en se déconnectant des plaisirs et des douleurs terrestres.

Extrait :
Refuser la violence à l’égard de tous les êtres,
ne jamais faire de mal à un seul d’entre eux,
aider avec compassion et un cœur aimant ;
erre seul comme un rhinocéros.
Celui qui tient compagnie nourrit l’affection
et de l’affection naît la souffrance.
Réalisant le danger qui découle de l’affection,
erre seul comme un rhinocéros.
En sympathisant avec les amis et les compagnons,
l’esprit se fixe sur eux et perd son chemin.
Percevoir ce danger, c’est la familiarité,
erre seul comme un rhinocéros.
Les préoccupations que l’on a pour ses fils et ses femmes
sont comme une pensée et un bambou enchevêtré.
Reste démêlé comme un jeune bambou,
erre seul comme un rhinocéros.
Comme un cerf qui erre librement dans la forêt,
va où il veut en broutant,
un homme sage, qui chérit sa liberté,
erre seul comme le rhinocéros.
Laissez derrière vous vos fils, vos femmes et votre argent,
tous vos biens, vos parents et vos amis.
Abandonnez tous vos désirs, quels qu’ils soient,
erre seul comme le rhinocéros. (…)
B. La littérature
Deux autres chefs-d’œuvre tirés du même recueil sont d’une part les célèbres Jataka (Récits des vies antérieures du Bouddha), et d’autre part, le Milindapanha (Les questions du roi Milinda).
Les Jataka, qui mettent en scène de nombreux animaux, montrent comment, avant la dernière incarnation humaine au cours de laquelle il atteignit le nirvana, le Bouddha lui-même s’était réincarné d’innombrables fois en animal (en diverses sortes de poissons, en crabe, coq, pivert, perdrix, francolin, caille, oie, pigeon, corbeau, zèbre, buffle, plusieurs fois en singe ou en éléphant, en antilope, cerf et cheval).
Et puisque c’est Bouddha qui est incarné dans cet animal, celui-ci a soudainement des propos d’une grande sagesse.
Mais en d’autres occasions, ce sont des personnages qui sont des animaux alors que notre Bodhisattva apparaît sous forme humaine. Ces contes sont souvent pimentés d’un humour piquant. On sait d’ailleurs qu’elles ont inspiré La Fontaine, qui a dû les entendre du docteur François Bernier, qui les avait lui-même apprises alors qu’il était médecin en Inde pendant huit ans.
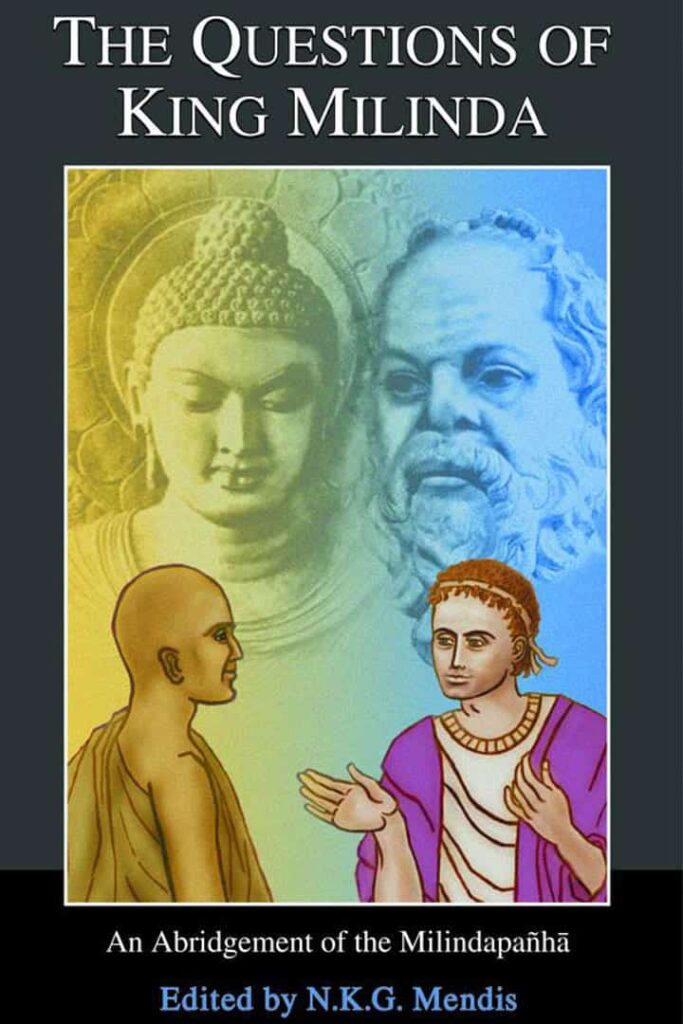
Les questions du roi Milinda est un compte-rendu imagé, véritable dialogue platonicien entre le roi grec de Bactriane, Milinda (le Grec, Ménandre), qui régnait au Pendjab, et le sage bouddhiste Bhante Nagasena. Leur dialogue animé, dramatique et spirituel, éloquent et inspiré, explore les divers problèmes de la pensée et de la pratique bouddhistes du point de vue d’un intellectuel grec perspicace, à la fois perplexe et fasciné par la religion étrangement rationnelle qu’il découvre sur le sous-continent indien.
Par le biais de paradoxes, Nagasena amène le « rationaliste » grec à s’élever jusqu’à la dimension spirituelle, au-delà de la logique et de la simple rationalité. Car le nirvana, tout comme l’espace, n’a « pas de cause » formelle et, bien qu’il peut se produire, « ne peut pas être causé ». Mince, comment faire alors pour y aboutir ?
Et à l’un de ses disciples qui un jour lui posa la question de savoir si l’univers était fini ou infini, éternel ou non, si l’âme était distincte du corps, ce que devenait l’homme après la mort, le Bouddha répondit par une parabole :
« Supposons qu’un homme soit gravement atteint d’une flèche, que l’on l’amène chez un médecin, et que l’homme dise : “Je ne laisserai pas retirer cette flèche, avant de savoir qui m’a blessé, de quel caste il est, de quel village il est né, de quel arc il s’est servi, de quelle matière a été faite la flèche, de quelle direction elle a été tirée…” Alors cet homme mourrait certainement avant d’avoir les réponses. »
C. Urbanisme
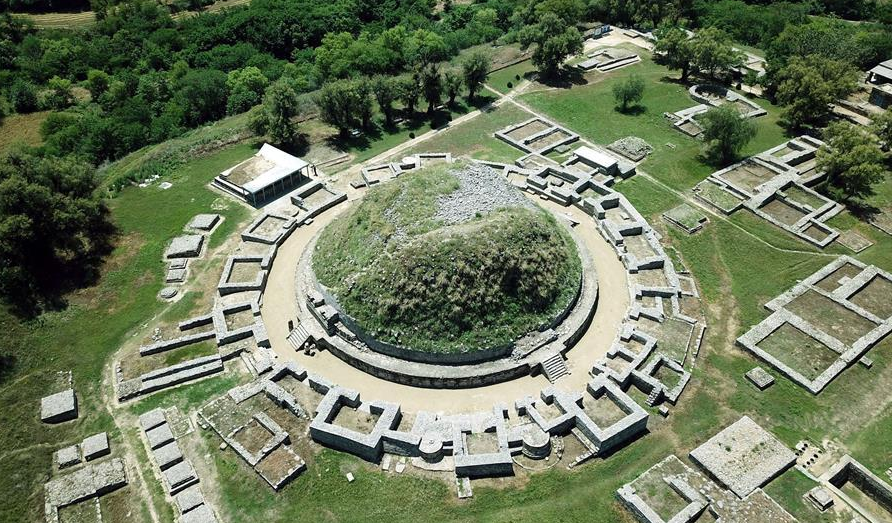
Taxila ou Takshashila (aujourd’hui au Pendjab), l’un des grands centres urbains et, pendant un certain temps, la capitale du Gandhara, fut fondée vers 1000 avant J.-C. sur les ruines d’une cité datant de la période Harappa et située sur la rive orientale de l’Indus, point de jonction entre le sous-continent indien et l’Asie centrale.
Certaines ruines de Taxila datent de l’époque de l’empire perse achéménide, suivi successivement par l’Empire Maurya, le royaume indo-grec, les Indo-Scythes et l’empire kouchan.
D’après certains témoignages, l’université de l’ancienne Taxila (des siècles avant l’université bouddhiste résidentielle de Nalanda fondée en 427 après J.-C.) peut être considérée comme l’un des premiers centres d’enseignement d’Asie du Sud. Dès 800 av. J.-C., la ville fonctionnait en grande partie comme une université, offrant des études supérieures. Avant d’y être admis, les étudiants devaient avoir terminé ailleurs leurs études primaires et secondaires. L’âge minimum requis était de seize ans. Non seulement les Indiens, mais aussi les étudiants de contrées voisines comme la Chine, la Grèce et l’Arabie affluaient dans cette ville d’apprentissage.
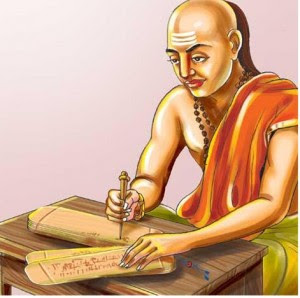
Vers 321 avant J.-C., c’est le grand philosophe, enseignant et économiste du Gandhara, Chanakya (375 à 283 av. J.-C.) qui aida le premier empereur maurya, Chandragupta, à accéder au pouvoir.
Sous la tutelle de Chanakya, Chandragupta avait reçu une éducation complète à Taxila, englobant les différents arts de l’époque, y compris l’art de la guerre, pendant sept à huit ans.
En 303 avant J.-C., Taxila tomba entre leurs mains et sous Ashoka le Grand, le petit-fils de Chandragupta, la ville devint un grand centre de l’enseignement et de l’art bouddhiste.
Chanakya, dont les écrits n’ont été redécouverts qu’au début du XXe siècle et qui fut le principal conseiller des deux empereurs Chandragupta et de son fils Bindusara, est considéré comme ayant joué un rôle majeur dans l’établissement de l’Empire Maurya.
Également connu sous les noms de Kauṭilya et Vishnugupta, Chanakya est l’auteur de l’Arthashastra, un traité politique sanskrit sur l’art de gouverner, la science politique, la politique économique et la stratégie militaire. L’Arthashastra aborde également la question d’une éthique collective assurant la cohésion de la société.
Il conseille au roi de lancer de grands projets de travaux publics dans les régions dévastées par la famine, les épidémies et autres catastrophes naturelles, ou par la guerre, tels que la création de voies d’irrigation et la construction de forts autour des principaux centres de production et villes stratégiques, et d’exonérer d’impôts les personnes touchées par ces catastrophes.
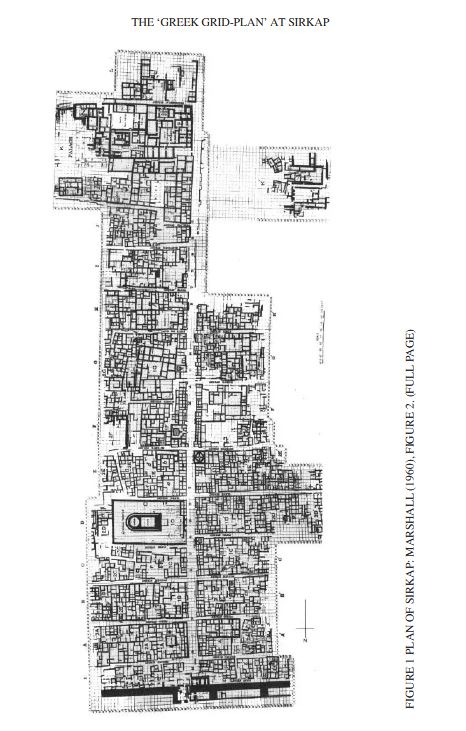
Au IIe siècle avant notre ère, Taxila fut annexée par le royaume indo-grec de Bactriane qui y érigea une nouvelle capitale nommée Sirkap, où des temples bouddhistes côtoyaient des temples hindous et grecs, signe de tolérance religieuse et de syncrétisme. Sirkap fut construite selon le plan quadrillé hippodamien (*5) caractéristique des villes grecques
Elle s’organise autour d’une avenue principale et de quinze rues perpendiculaires, couvrant une surface d’environ 1200 mètres sur 400, avec un mur d’enceinte de 5 à 7 mètres de large et de 4,8 kilomètres de long.
Après sa construction par les Grecs, la ville fut reconstruite lors des incursions des Indo-Scythes, puis par les Indo-Parthiens, après un tremblement de terre en l’an 30 de notre ère.
Certaines parties de la ville, notamment le stupa (reliquaire) bouddhiste de l’aigle bicéphale et le temple du dieu Soleil, furent construites par Gondophares, le premier roi du royaume indo-parthien. Enfin, des inscriptions datant de l’an 76 de notre ère démontrent que la ville était déjà passée sous la domination des Kouchans. Le souverain kouchan Kanishka érigera Sirsukh, à environ 1,5 km au nord-est de l’ancienne Taxila.
Des sutras bouddhistes de la région du Gandhara sont étudiés en Chine dès 147 de notre ère, lorsque le moine kouchan Lokakṣema (né en 147) commença à traduire en chinois certains des premiers sutras bouddhistes. Les plus anciennes de ces traductions montrent qu’elles ont été faites à partir de la langue
D. Architecture, l’invention des stupas
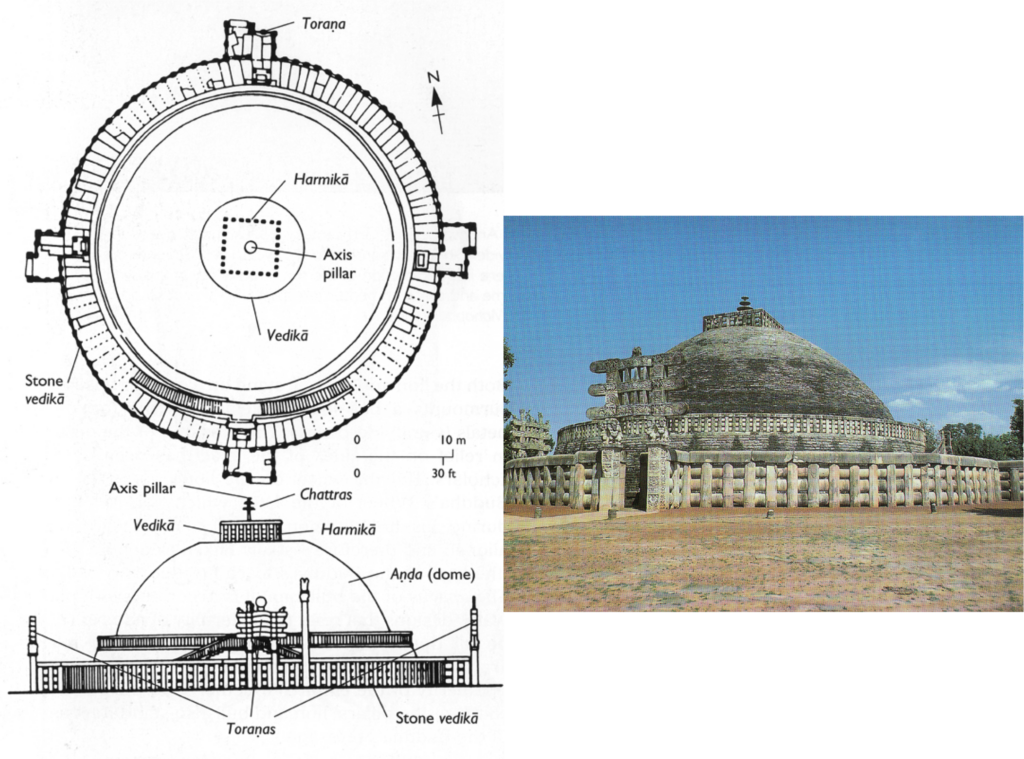
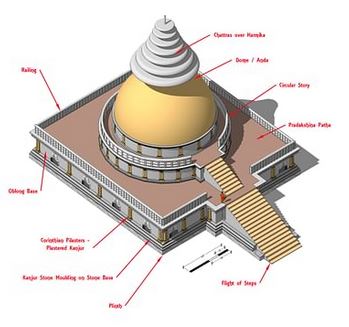
A l’origine, les édifices religieux sous forme de stupa (reliquaire) ont été érigés en Inde comme monuments commémoratifs associés à la conservation des reliques sacrées du Bouddha.
Construits en forme de dôme, ils sont entourés d’une balustrade qui sert de rampe pour la circumambulation rituelle. On accède à la zone sacrée par des portes situées aux quatre points cardinaux. Les stupas se situent souvent à proximité de sites funéraires préhistoriques beaucoup plus anciens, associés notamment à la Civilisation de la vallée de l’Indus.

Des grilles et des portails en pierre, recouverts de sculptures, leur ont été ajoutés. Les thèmes favoris sont les événements de la vie historique du Bouddha, ainsi que de ses vies antérieures, au nombre de 550, décrites avec beaucoup d’ironie dans les Jatakas. (Voir B)
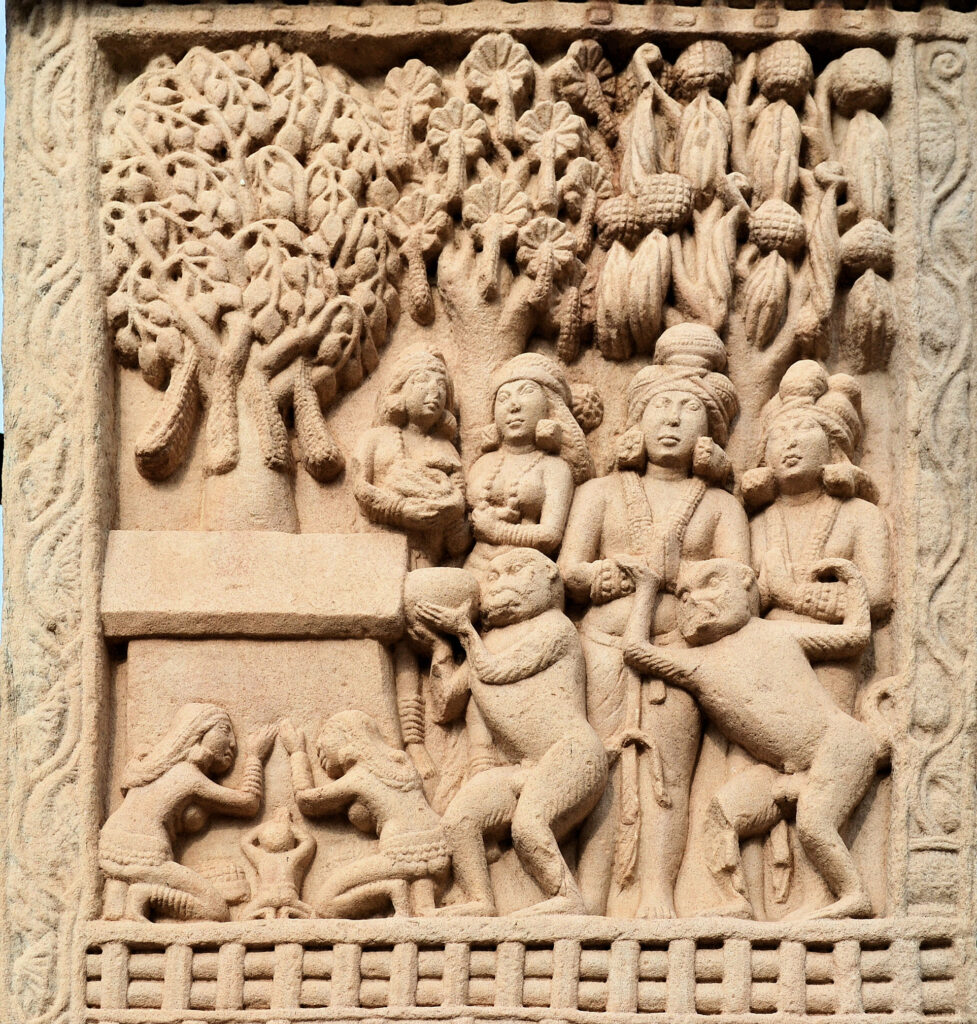
Les bas-reliefs des stupas sont comme des bandes dessinées qui nous racontent la vie quotidienne et religieuse du Gandhara : amphores, coupes à vin (kantaros), bacchanales, instruments de musique, vêtements grecs ou indiens, ornements, coiffures arrangées à la grecque, artisans, leurs outils, etc.
Sur un vase trouvé à l’intérieur d’un stupa, on trouve l’inscription d’un Grec, Théodore, gouverneur civil d’une province au Ier siècle avant J.-C., expliquant en alphabet kharosthi comment les reliques ont été déposées dans le stupa.
On pense que de nombreux stupas datent de l’époque d’Ashoka, comme celui de Sanchi (Inde centrale) ou de Kesariya (Inde de l’Est), où il a également érigé des piliers avec ses édits, et peut-être ceux de Bharhut (Inde centrale), Amaravati (sud-est de l’Inde) ou Dharmarajika (Taxila) dans le Gandhara (Pakistan).
Selon la tradition bouddhiste, l’empereur Ashoka aurait récupéré les reliques du Bouddha dans des stupas plus anciens et en aurait fait ériger 84 000 pour répartir l’ensemble de ces reliques sur tout le territoire indien.
Marchant dans les pas d’Ashoka, Kanishka ordonna la construction à Purushapura (Peshawar) du grand stupa de 400 pieds qui figure parmi les plus hauts édifices du monde antique.
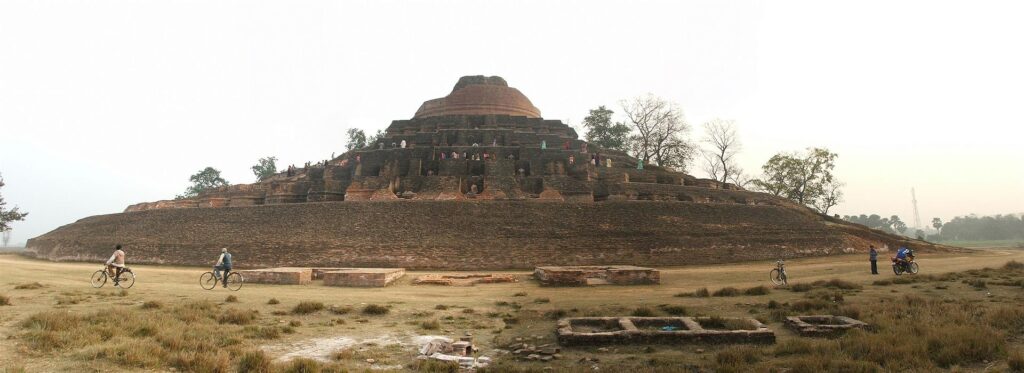
Les archéologues qui en ont redécouvert la base en 1908-1909 ont estimé que ce stupa avait un diamètre de 87 mètres. Selon les rapports de pèlerins chinois tels que Xuanzang, il faisait environ 200 mètres de haut et était recouvert de pierres précieuses. Sous les Kouchans également, d’immenses statues du Bouddha furent érigées dans les monastères ou sculptées à flanc de colline.
E. Sculpture
—PERIODE ANICONIQUE
Il est important de rappeler que dans les premiers temps, Bouddha n’était jamais représenté sous forme humaine.
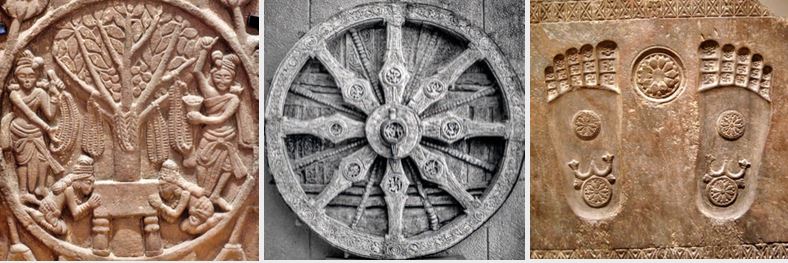
Pendant plus de quatre siècles, sa présence est simplement suggérée par des éléments symboliques tel qu’une empreinte de pieds, une fleur de lotus (indiquant la pureté de sa naissance), une roue à huit rayons (symbolisant la dharma), un trône vide, un espace inoccupé sous un parasol, un cheval sans cavalier ou encore le figuier sous lequel il a atteint le nirvana.
–FIN DE L’ANICONISME
Ce qui a conduit les bouddhistes à renoncer aux représentations aniconiques reste un vaste mystère. Un tel développement est assez unique dans l’histoire des religions. Imaginons soudainement les musulmans promouvant des statues du prophète Mohammed !
Les explications avancées jusqu’ici nous laissent sur la faim.
Pour les uns, les bouddhistes auraient voulu séduire une clientèle grecque, mais aussi bien les populations grecques que le bouddhisme était au Gandhara bien avant la révolution iconographique en question.
Pour les autres, les pratiquants, en l’absence de Bouddha lui-même, auraient cherché désespérément un centre d’intérêt visuel, soit une statue, une peinture ou mêmes quelques cheveux… Ces représentations symboliques, on l’a vu, répondaient à cette demande.
« Le Jataka de Kalingabodhi (écrit majeur sur les vies multiples de Bouddha) relate la frustration des habitants de Sravasti, en découvrant un jour qu’ils n’ont personne à vénérer lorsqu’ils se rendent au Jetavana et trouvent le Bouddha ‘absent’, parti en voyage. Pour remédier à cette situation, à son retour, le Bouddha permet à [son disciple] Ananda de planter un figuier Bodhi devant le [monastère de] Jetavana (…) qui sert de centre de substitution pour les dévotions des gens, chaque fois que le Bouddha n’est pas en résidence », écrit John Strong, dans Reliques du Bouddha.
Bouddha, rapporte-t-on, aurait refusé qu’il soit représenté d’aucune façon, craignant de voir prospérer l’idolâtrie.
Avec le temps, le bouddhisme va évoluer. Au Gandhara, c’est le bouddhisme mahâyâna (Grand Véhicule) qui s’épanouit. Pour ce courant, l’objectif ne se limite plus à atteindre le nirvana à titre personnel mais de libérer toute l’humanité de la souffrance.
Si pour le bouddhisme theravâda, Siddhartha Gautama n’était qu’un homme éclairé donnant l’exemple, pour le bouddhisme mahâyâna, il s’agit indubitablement, avec Bouddha, d’une tentative (réussie) de personnifier le dharma (la force spirituelle omniprésente, le principe ultime et suprême de la vie) dans la conception du premier de tous les bouddhas. Une sorte de Jésus, un dieu devenu homme pour ainsi dire…
Comme plus tard Jésus dans le christianisme à partir du Ve siècle, Bouddha pouvait dès lors être représenté sous une forme humaine.
Certains bouddhas du Gandhara représentent également des états d’âme spécifiques, tels que la sagesse, la tendresse et la compassion.
Contrairement à de nombreux artistes chrétiens chez nous, qui, conformément à la doxa, ont représenté le Christ souffrant sur la Croix (événement fondamental de la foi chrétienne), les artistes du Gandhara présentent Bouddha comme un être totalement détaché de la douleur humaine, regardant avec compassion l’humanité tout entière.
Le but étant d’éliminer la souffrance chez tous les hommes, la compassion n’est pas une notion passive chez les bouddhistes. Ce n’est pas seulement de l’empathie, mais plutôt un altruisme empathique qui s’efforce activement de libérer les autres de la souffrance, un acte de bienveillance empreinte à la fois de sagesse et d’amour.
DIFFERENCES DE FORME, DIFFERENCE DE CONTENU
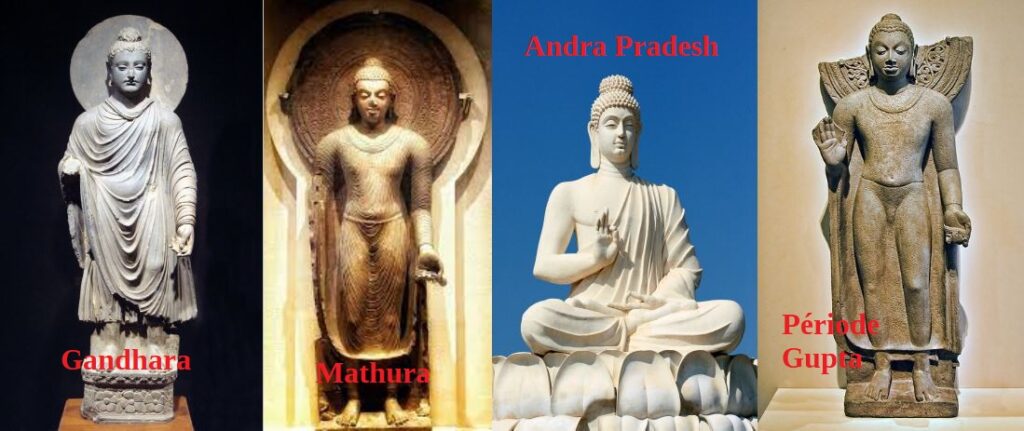
Avant de discuter de leurs différences, pour faire simple, distinguons ici, parmi tant d’autres, quatre types de représentations de bouddha:
- L’école dite « greco-bouddhique » de Gandhara produite dans la région qui va de Hadda (Afghanistan) à Taxila (Pundjab) en passant par Peshawar (Pakistan);
- L’école dite « indo-bouddhique » de Mathura;
- L’école d’Andra Pradesh, au sud de l’Inde;
- L’école de la période Gupta (3e au 5e siècle).
1. Greco-Bouddhique au Gandhara

Le terme « greco-bouddhique », renvoie à la thèse de l’archéologue Alfred Foucher (1865-1952) soutenue à la Sorbonne en 1905 sur l’art du Gandhara.
Comme l’écrivait André Malraux (1901-1976) dans les « Voix du silence », en 1951, l’art gréco-bouddhique est cette rencontre entre hellénisme et bouddhisme. Au lieu de dire que l’art venu de Grèce s’était métamorphosé en art bouddhique comme le disait Malraux, je pense plutot qu’au Gandhara, c’est l’art bouddhique qui s’est approprié le meilleur de l’esthétique indienne, grecque et des steppes.
Cependant, Foucher avait raison d’insister, contre ses amis anglais, qu’il s’agit bien d’une influence hellénique et non pas romaine. De leur coté, avec l’Inde s’émancipant de l’Empire britannique, les savants indiens ont tenté de valider la thèse d’une création autochtone de l’image de Buddha, opposant au style du Gandhara, que Foucher voulait gréco-bouddhique, le style de Mathura, dans la région de Delhi, lui aussi englobé dans l’empire des Kouchans, et vu par certains comme contemporain, même s’il est beaucoup moins prolixe que l’art du Gandhara.

L’art du Gandhara prit véritablement son essor à l’époque kouchane, et plus particulièrement sous le règne du roi Kanishka.
Des milliers d’images furent produites et répandues dans tous les coins de la région, depuis les bouddhas portatifs jusqu’aux statues monumentales des lieux de culte sacrés.
Au Gandhara, pour figurer Bouddha, on représente d’une façon très réaliste une belle personne, souvent un jeune homme, voire une femme. La charge spirituelle est telle que le genre n’est plus essentiel. On ne sait pas s’il s’agit de beaux portraits pris sur le vif, ou de purs fruits de l’imagination des artistes.

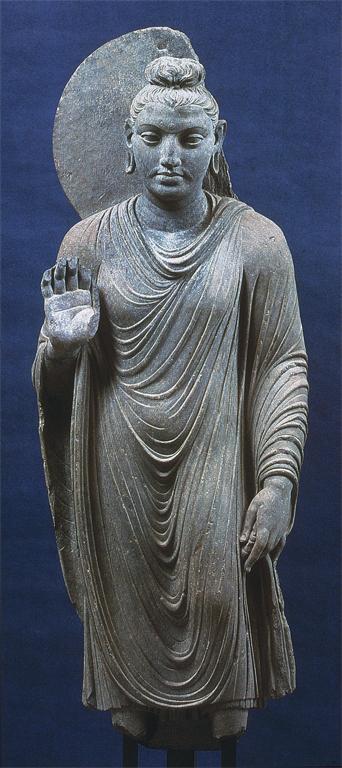
Bouddha y est souvent montré en posture méditative afin d’évoquer le moment où il atteint le nirvana.
Couronné d’une auréole, le visage grave ou souriant, les yeux mi-clos, il irradie la lumière. Plein de sérénité, il incarne le détachement, la concentration, la sagesse et la bienveillance.
Ses cheveux en chignon (l’ushnisha) au sommet du crâne indiquent qu’il est doué d’une connaissance supramondaine. Le point noire entre les deux yeux symbolise le troisième œil, celui de l’éveil.
Dans certaines sculptures, cette cavité contient une perle de cristal, symbole de lumière irradiante. Les lobes d’oreilles sont allongés et servent à accueillir les lourds bijoux que portait autrefois le jeune prince Siddhartha, durant sa jeunesse princière.
Le positionnement des mains, comme dans le reste de l’art indien, répond à des codes. Il peut s’agir de « l’abhayamudra », le geste qui rassure, la paume de la main tournée vers l’extérieur ; de la « varamudra », qui symbolise le don, la main pendante et ouverte avec le bras à demi plié, ou encore de la « vitarkamudra », qui symbolise l’argumentation, la main levée à hauteur de la poitrine, à demi fermée, paume en avant, l’index recourbé vers le pouce.
Au Gandhara, Bouddha est vêtu d’un manteau monastique qui lui couvre les deux épaules. L’étoffe n’est ni taillée, ni cousue, mais simplement drapée à la grecque autour du corps. Les plis à peine stylisés suivent les volumes naturels.
Le roi Kanitscha encouragea à la fois l’école d’art gréco-bouddhique du Gandhara (à Taxila, Peshawar et Hadda) et l’école indo-bouddhique (à Mathura, plus proche de l’Inde).
2. Ecole de Mathura


A Mathura, les artistes ont produit un Bouddha très différent. Son corps est dilaté par le souffle sacré (prana) et sa robe monastique est drapée à l’indienne de manière à laisser l’épaule droite dénudée.
On pense que les artistes, pour plaire à un public local, se sont inspirés des statues de yaksha, des esprits de la nature.
Dans les mythologies hindoue, jaïne et bouddhiste, le yakṣha a une double personnalité.
D’un côté, ce peut être une fée de nature inoffensive, associée aux forêts et aux montagnes ; mais il existe une version beaucoup plus sombre du yakṣa, qui est une sorte d’ogre, de fantôme ou de démon anthropophage qui harcèle et dévore les voyageurs.
3. Ecole d’Andrah Pradesh

Un troisième type de bouddha influent s’est développé dans l’Andhra Pradesh, au sud de l’Inde, où des représentations aux proportions imposantes, au visage grave, sans sourire, sont vêtues de robes qui laissent également apparaître l’épaule droite.
Ces sites méridionaux ont servi d’inspiration artistique à la terre bouddhiste du Sri Lanka, à la pointe sud de l’Inde, et les moines sri-lankais s’y rendaient régulièrement. Un certain nombre de statues de ce style se sont également répandues dans toute l’Asie du Sud-Est.
4. Ecole Gupta

La période Gupta, du IVe au VIe siècle de notre ère, dans le nord de l’Inde, souvent qualifiée d’âge d’or, est supposée avoir synthétisé les deux courants. En réalité, en cherchant une image idéale, elle a sombré dans le maniérisme. Les bouddhas gupta ont les cheveux disposés en petites boucles individuelles et leur tunique arbore un réseau de cordelettes suggérant les plis des draperies (comme à Mathura).
Avec leurs yeux baissés et leur aura spirituelle, les bouddhas gupta deviendront le modèle des futures générations d’artistes, que ce soit dans l’Inde post-Gupta et Pala ou au Népal, en Thaïlande et en Indonésie.
Des statues métalliques gupta du Bouddha, emportées par les pèlerins, ont également été disséminées le long de la Route de la soie jusqu’en Chine.
Mais les Bouddhas du Gandhara sont uniques et vraiment à part. Ce sont de véritables individualités échappant à toute codification et aux normes. Ils ont été fabriqués par des artistes habités d’une spiritualité élevée, explorant de nouvelles frontières de la beauté, du mouvement et de la liberté, et non produisant des objets pour satisfaire un marché émergent.
Aujourd’hui, Pakistanais, Indiens, Afghans et Européens aiment à se quereller. Tous prétendent avoir été les principaux parrains et auteurs du « miracle de Gandhara », mais peu se demandent comment il s’est produit.
Dès le Ier siècle avant J.-C., les artistes locaux délaissent les matériaux périssables avec lesquels ils travaillaient, comme la brique, le bois, le chaume et le bambou, pour adopter la pierre. Le nouveau matériau utilisé était principalement une pierre de schiste allant du gris clair au gris foncé (dans la vallée de la rivière Kaboul et la région de Peshawar). Les périodes ultérieures se caractérisent par l’utilisation du stuc et de l’argile (spécialité de Hadda).
Les techniques utilisées pour les sculptures et les pièces de monnaie du Gandhara sont très proches de celles de la Grèce. Ont-elles été créées par des sculpteurs grecs itinérants ou par des artistes locaux qu’ils ont formés ? Rien n’a été prouvé, mais est-ce vraiment important ?
Lorsque l’Asie rencontre la Grèce
Examinons maintenant des expressions artistiques attestant la belle rencontre entre la culture hellénique et les cultures indiennes et locales.
A. Pièces de monnaie kouchanes

Tout en soutenant toutes les religions qu’il jugeait dignes, Kanishka ne cachait pas sa préférence pour le bouddhisme.
Une pièce d’or datant de 120 après J.-C. montre le roi vêtu d’un lourd manteau kouchan et de longues bottes, des flammes sortant de ses épaules, un étendard dans la main gauche et faisant un sacrifice sur un autel, avec cette légende en caractères grecs : « Roi des rois, Kanishka le Kouchan. » Le revers de la même pièce représente un bouddha debout, en costume grec, faisant de la main droite le geste « ne craignez rien » (abhaya mudra) et tenant un pli de sa robe dans la main gauche. La légende en caractères grecs se lit désormais ΒΟΔΔΟ (Boddo), pour Bouddha.
B. Reliquaire bimaran

Un véritable thème classique du répertoire de tout artiste de l’époque consiste à montrer Bouddha entouré, accueilli et protégé des divinités d’autres croyances et de religions plus anciennes. La plus ancienne représentation de ce type connue à ce jour figure sur un reliquaire trouvé dans le stupa de Bimaran, au nord-ouest du Gandhara.
Sur cette petite urne en or, généralement datée de 50-60 après J.-C., figure, à l’intérieur de niches voûtées d’architecture gréco-romaine, une représentation hellénistique du Bouddha (coiffure, contrapposto, himation d’élite, etc.), entourée des divinités indiennes Brahma et Sakra.
Tout comme Ashoka, Kanishka, presque laïque, entendait régner, non pas contre mais avec, et surtout au-dessus de toutes les religions. Ainsi, à l’occasion, les divinités grecques, représentées sur les pièces de monnaie (Zeus, Apollon, Héraclès, Athéna, etc.), côtoient les divinités du védisme, du zoroastrisme et du bouddhisme.
Autre exemple, à Ellora, au centre de l’Inde, la grotte et le temple taillés dans le roc où se côtoient les représentants des trois religions (bouddhisme, hindouisme et jaïnisme).
C. Triade de Hadda


Un autre exemple exquis de cet art gandharien est un groupe sculptural connu sous le nom de Triade de Hadda, excavé à Tapa Shotor, un grand monastère sarvastivadin près de Hadda en Afghanistan, datant du IIe siècle après J.-C.
Pour donner une idée de son activité, ce sont quelque 23 000 sculptures gréco-bouddhiques, en argile et en plâtre, qui ont été mises au jour rien qu’à Hadda, entre les années 1930 et 1970.
Le site, fortement endommagé lors des dernières guerres, possédait de belles statues, notamment un bouddha assis, vêtu d’une chlamyde grecque (manteau blanc), les cheveux bouclés, accompagné d’Héraclès et de Tyché (déesse grecque de la fortune et de la prospérité), vêtue d’un chiton (robe à la grecque) et tenant une corne d’abondance.

Seule adaptation aux traditions locales de l’iconographie grecque, Héraclès tient en main, non plus son habituelle massue, mais la foudre de Vajrapani (du sanskrit vajra, signifiant « foudre », et pani « en main »), l’une des trois premières divinités protectrices entourant le Bouddha.
C’est un bodhisattva. Il apparaît dès le IIe siècle dans l’iconographie mahāyāna comme doué d’une grande force et comme protecteur du Bouddha. Dans l’art gréco-bouddhique il ressemble à Héraclès ou Zeus, tenant en main une courte massue en forme de vajra, un foudre stylisé. On l’identifie au protecteur, « puissant comme un éléphant », qui aurait veillé sur Bouddha à sa naissance.
Une autre statue rappelle le portrait d’Alexandre le Grand.

De cet ensemble sculptural, il ne reste malheureusement que des photographies.
Selon l’archéologue afghan Zemaryalai Tarzi, le monastère de Tapa Shotor, avec ses sculptures en argile datées du IIe siècle de notre ère, représente le « chaînon manquant » entre l’art hellénistique de Bactriane et les sculptures en stuc plus tardives trouvées à Hadda, généralement datées du IIIe-IVe siècle de notre ère.
Traditionnellement, l’afflux d’artistes, maître de l’art hellénistique, a été attribué à la migration des populations grecques des villes gréco-bactriennes d’Aî-Khanoum et de Takht-I-Sangin (Nord de l’Afghanistan).

Tarzi suggère que les populations grecques se sont établies dans les plaines de Jalalabad, qui comprennent Hadda, autour de la ville hellénistique de Dionysopolis, et qu’elles sont à l’origine des créations bouddhistes de Tapa Shotor, au IIe siècle de notre ère.
Les colons grecs restés au Gandhara (les Yavanas) après le départ d’Alexandre, soit par choix, soit en tant que populations condamnées à l’exil par Athènes, ont grandement embelli les expressions artistiques de leur nouvelle spiritualité.
Offrant fraîcheur, poésie et un sens du mouvement spectaculairement moderne, les premiers artistes bouddhistes du Gandhara, saisissant des instants de « mouvement-changement » permettant à l’esprit humain d’appréhender un saut vers la perfection, sont une contribution inestimable à la culture de l’humanité tout entière. N’est-il pas temps de reconnaître ce magnifique travail ?
D. Prendre la terre à témoin

Parmi les autres types productions artistiques de Gandhara, ce magnifique bas-relief, aujourd’hui conservée au musée de Cleveland, illustre la lutte du Bouddha pour atteindre le nirvana.

Au centre de la composition se trouve l’arbre de la Bodhi, sous lequel le Bouddha atteignit l’illumination. Ce figuier sacré est vénéré depuis des temps ancestraux par les villageois locaux, car il passe pour être la résidence d’une divinité de la nature. L’autel lui-même est recouvert de kusha, herbe utilisée pour des offrandes sacrificielles.
Il y a environ 2500 ans, après être resté en méditation pendant 49 jours, assis sous cet arbre, le Bouddha est défié par des démons cauchemardesques qui remettent en cause l’authenticité de son illumination.
Leur chef Mara (littéralement, la mort), qui se tient à droite dans une posture arrogante, entouré de ses filles, fait tout pour empêcher Bouddha d’atteindre le nirvana (l’éveil).
Il le menace et encourage ses propres filles à le séduire. Innocemment, il lui demande s’il est sûr de pouvoir trouver quelqu’un pour témoigner qu’il a véritablement atteint le nirvana. En réponse à ce défi, le Bouddha touche alors la terre et la prend à témoin.
Selon la mythologie, la jeune déesse de la Terre surgit alors du sol et commença à essorer les eaux déferlant de ses cheveux pour noyer Mara. Sur la sculpture, on peut la voir, toute petite, au pied de l’autel, agenouillée devant Bouddha en signe de révérence. Elle a également pris forme humaine en sortant de terre. Les anciennes religions interviennent ici pour défendre et protéger la nouvelle, celle de Bouddha.
Semblant, eux aussi, regretter les anciens dieux et déesses de leur panthéon, les Indiens convertis au bouddhisme les ajoutent au-dessus de la tête de Bouddha ou à côté, comme, par exemple, le dieu védique Indra.
E. Tous bodhisattva ?

Enfin, pour conlure cette section sur la sculpture, deux mots sur le bodhisattva, figure très intéressante sortie de l’imaginaire bouddhiste pour rendre la spiritualité bouddhiste accessible au citoyen ordinaire.

Il peut s’agir soit d’une représentation de Bouddha en personnage princier orné de bijoux, avant son renoncement à la vie de palais, soit d’un humain ordinaire, déjà conscient qu’il est sur la voie de l’illumination et qu’il est devenu un outil au service du bien.
Animé d’altruisme et obéissant les disciplines destinées aux bodhisattvas, il doit aider par compassion d’abord les autres êtres sensibles à s’éveiller, y compris en retardant sa propre libération !
Les bodhisattvas se distinguent par de grandes qualités spirituelles telles que les « quatre demeures divines » que sont:

- l’amour bienveillant (maitri),
- la compassion (karuna),
- la joie empathique (mudita) et
- l’équanimité (upekṣa),
ainsi que les diverses perfections (paramitas), qui comprennent la prajnaparamita (« connaissance transcendante » ou « perfection de la sagesse ») et les moyens habiles (upaya).
Des bodhisattvas spirituellement avancés tels qu’Avalokiteshvara (ci-dessus), Maitreya et Manjushri, largement vénérés dans le monde bouddhiste mahâyâna, sont censés posséder un grand pouvoir, qu’ils utilisent pour aider tous les êtres vivants.
Pour certains courants bouddhistes, seul Maitreya mérite le titre de « Bouddha du futur ». Dans l’art on le représente à la fois comme un bouddha vêtu d’une robe monastique et comme un bodhisattva princier avant l’illumination.
Un magnifique bodhisattva de Gandhara peut être admiré au Dallas Museum of Art (ci-dessous).
Cette sculpture en terre cuite représente un « Bodhisattva pensant » de la région de Hadda en Afghanistan, une production typique du Gandhara.

Avec très peu d’éléments visuels, l’artiste réussit un travail gigantesque. Les piliers de sa large chaise sont des lions au regard un peu fou, représentation allégorique de ces passions qui nous font souffrir et qui sont maintenues sous un sage contrôle par l’effort hautement réflexif du Bodhisattva héroïque au centre de l’œuvre.
Le bouddhisme aujourd’hui, l’exemple de Nehru

Paradoxalement, le bouddhisme, en tant que religion, a presque cessé d’exister dans son propre berceau, l’Inde, depuis le XIIe siècle de notre ère.
Bel exemple de la lutte incessante des meilleurs esprits indiens pour l’émancipation, en 1956, près d’un demi-million « d’intouchables » se sont convertis au bouddhisme sous l’impulsion du dirigeant politique à la tête du comité chargé de rédiger la Constitution de l’Inde, le réformateur social B. R. Ambedkar (1891-1956), et du Premier ministre indien et chef du Parti du Congrès Jawaharlal Nehru (1889-1964), lui-même issu d’une famille de brahmanes.
En juin de la même année, le Courrier de l’UNESCO consacrait son édition à « 25 siècles d’art et de culture bouddhistes ».
En Inde, les deux hommes d’État ont orchestré une année de célébration en l’honneur de « 2500 ans de bouddhisme », non pas pour ressusciter une ancienne religion en soi, mais pour s’approprier le statut de berceau de cette vieille religion et renvoyer au monde une image de champion de la non-violence et du pacifisme.

Quelques années plus tard, lors de sa visite d’État à la Maison Blanche, le 9 novembre 1961, le Premier ministre indien Nehru offrit une sculpture bouddhiste au président John F. Kennedy
Comme beaucoup d’hindous, Mahatma Gandhi vénérait Bouddha. Pour lui, le bouddhisme n’était qu’une « autre forme d’hindouisme » et sa critique venait donc « de l’intérieur de l’hindouisme ».
Un point de vue que ne partageait pas le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru. Profondément troublé par certaines caractéristiques intrinsèques à l’hindouisme, telles que le ritualisme et les castes, Nehru ne pouvait pas placer le bouddhisme, qui abhorrait ces institutions, dans la même rubrique…
Nehru fut fortement influencé par le bouddhisme. C’est ainsi qu’il appela sa fille (la future Première ministre Indira Gandhi) Indira Priyadarshini, du nom de « Priyadarshi » adopté par le grand empereur Ashoka, après être devenu un prince bouddhiste de la paix !

Par ailleurs, Nehru contribua à faire de l’Ashoka Chakra (la Roue bouddhiste intégrée au drapeau national) le symbole de l’Inde. Chaque fois qu’il se rendait au Sri Lanka, il visitait la statue du Bouddha à Anuradhapura.
Le dirigeant indien, qui ne cessait d’exhorter les Indiens superstitieux et ritualistes à cultiver un « tempérament scientifique » et à faire entrer l’Inde dans l’ère de l’âge atomique, était naturellement attiré par le rationalisme prôné par le Bouddha.
« Bouddha ne demandait à personne de croire en quoi que ce soit d’autre que ce qui pouvait être prouvé par l’expérience et l’essai. Tout ce qu’il voulait, c’était que les hommes recherchent la vérité et n’acceptent rien sur la foi d’un autre homme, même s’il s’agissait du Bouddha lui-même. Il me semble que c’est là l’essence de son message », alléguait Nehru.
Et d’ajouter :
« Lui-même a eu le courage d’accepter la vérité et de ne rien accepter sur la foi d’un autre (…) Bouddha a eu le courage de s’attaquer à la religion populaire, à la superstition, au cérémonial et à la prêtrise, ainsi qu’à tous les intérêts qui s’y rattachent. Il a également condamné les perspectives métaphysiques et théologiques, les miracles, les révélations et les relations avec le surnaturel. Il fait appel à la logique, à la raison et à l’expérience ; il met l’accent sur l’éthique (…) Toute son approche est comme le souffle du vent frais des montagnes après l’air vicié de la spéculation métaphysique (…) Bouddha n’a pas attaqué directement les castes, mais dans son propre ordre, il ne les a pas reconnues, et il ne fait aucun doute que toute son attitude et son activité ont affaibli le système des castes. »
L’influence du Bouddha s’est manifestée dans la politique étrangère de Nehru. Cette politique était motivée par un désir de paix, d’harmonie internationale et de respect mutuel. Elle visait à résoudre les conflits par des méthodes pacifiques. Le 28 novembre 1956, Nehru déclare :
« C’est essentiellement grâce au message du Bouddha que nous pouvons envisager nos problèmes dans la bonne perspective et nous éloigner des conflits et de la concurrence dans le domaine des conflits, de la violence et de la haine. »
Visiblement inspirés par les préceptes bouddhistes, les concepts de non-alignement et le Traité de Panchsheel de Nehru, communément appelé « Traité des cinq principes de coexistence pacifique », ont été formellement énoncés pour la première fois dans l’Accord sur le commerce et les relations entre le Tibet chinois et l’Inde, signé le 29 avril 1954.
Cet accord stipulait, dans son préambule, que les deux gouvernements,
« ont décidé de conclure le présent accord sur la base des principes suivants :
1) respect mutuel de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’autre,
2) non-agression mutuelle,
3) non-ingérence mutuelle,
4) égalité et avantage mutuel,
5) coexistence pacifique. »
Le 29 novembre 1952, lors de la Conférence culturelle bouddhiste internationale à Sanchi, où Kanitscha avait entamé la construction du plus haut stupa de l’Antiquité, Nehru précisait :
« Le message que Bouddha a transmis il y a 2500 ans a éclairé non seulement l’Inde et l’Asie, mais le monde entier. La question qui se pose inévitablement est la suivante : le grand message du Bouddha peut-il s’appliquer au monde d’aujourd’hui ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je sais que si nous suivons les principes énoncés par le Bouddha, nous gagnerons la paix et la tranquillité pour le monde. »
Le 3 octobre 1960, Nehru s’adressait à l’Assemblée générale des Nations unies :
« Dans un passé lointain, un grand fils de l’Inde, le Bouddha, a dit que la seule vraie victoire était celle où tous étaient également victorieux et où personne n’était vaincu. Dans le monde d’aujourd’hui, c’est la seule victoire concrète ; toute autre voie mène au désastre. »
Nehru a fait de son mieux pour appliquer les enseignements du Bouddha dans la gestion des affaires intérieures de l’Inde. Sa conviction que le changement social ne peut être obtenu que par le consensus social le plus large découle de l’influence du Bouddha, d’Ashoka et de Gandhi.
Dans son discours du 15 août 1956 à l’occasion de la fête de l’indépendance, Nehru fixe les défis à relever :
« Nous sommes fiers que le sol sur lequel nous sommes nés ait produit de grandes âmes comme le Bouddha Gautama et Gandhi. Rafraîchissons-nous la mémoire une fois de plus et rendons hommage à Gautama Bouddha et à Gandhi, ainsi qu’aux grandes âmes qui, comme eux, ont façonné ce pays. Suivons la voie qu’ils nous ont montrée avec force, détermination et coopération. »
Science et religion, Albert Einstein et Bouddha
Pour conclure, je vous invite à méditer quelques citations d’Albert Einstein discutant les rapports entre la science et la religion où il évoque l’importance de Bouddha :
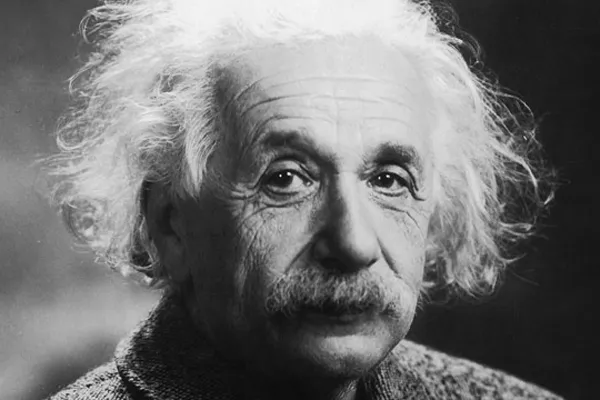
Le sentiment religieux cosmique
« Il existe un troisième état d’expérience religieuse… que j’appellerai le sentiment religieux cosmique. Il est très difficile d’expliquer ce sentiment à quelqu’un qui en est totalement dépourvu, d’autant plus qu’il n’y a pas de conception anthropomorphique de Dieu qui lui corresponde. L’individu ressent le néant des désirs et des objectifs humains, ainsi que la sublimité et l’ordre merveilleux qui se révèlent tant dans la nature que dans le monde de la pensée. Il considère l’existence individuelle comme une sorte de prison et veut faire l’expérience de l’univers comme un tout unique et significatif. Les prémices d’un sentiment religieux cosmique apparaissent déjà à un stade précoce du développement, par exemple dans de nombreux Psaumes de David et dans certains Prophètes.
Le bouddhisme, comme nous l’ont appris les merveilleux écrits de Schopenhauer en particulier, en contient un élément beaucoup plus fort. Les génies religieux de tous les temps se sont distingués par ce type de sentiment religieux, qui ne connaît ni dogme, ni Dieu conçu à l’image de l’homme, de sorte qu’il ne peut y avoir d’Église dont l’enseignement central se fonde sur lui.
C’est donc précisément parmi les hérétiques de toutes les époques que l’on trouve des hommes animés du sentiment religieux le plus élevé et qui, dans bien des cas, étaient considérés par leurs contemporains comme des athées, parfois même comme des saints. Vu sous cet angle, des hommes comme Démocrite, François d’Assise et Spinoza sont très proches les uns des autres. Comment le sentiment religieux cosmique peut-il se transmettre d’une personne à l’autre, s’il ne peut donner lieu à aucune notion précise de Dieu et à aucune théologie ? À mon avis, c’est la fonction la plus importante de l’art et de la science que d’éveiller ce sentiment et de le maintenir en vie chez ceux qui en sont capables ».
—Einstein, Albert. Le monde tel que je le vois. (Secaucus, NJ : Carol Publishing Group, 1999). p. 26.
Libéré des entraves et de ses désirs égoïstes
« Une personne religieusement éclairée me semble être celle qui, au mieux de ses capacités, s’est libérée des entraves de ses désirs égoïstes et se préoccupe de pensées, de sentiments et d’aspirations auxquels elle s’accroche en raison de leur valeur supra-personnelle. Il me semble que ce qui est important, c’est la force de ce contenu supra-personnel et la profondeur de la conviction concernant son sens impérieux, indépendamment de toute tentative d’unir ce contenu à un Être divin, car sinon il ne serait pas possible de considérer Bouddha et Spinoza comme des personnalités religieuses.
Par conséquent, une personne religieuse est pieuse dans le sens où elle ne doute pas de la signification et de la hauteur de ces objets et objectifs supra-personnels qui ne nécessitent ni ne peuvent être fondés rationnellement. Ils existent avec la même nécessité et la même évidence que lui. En ce sens, la religion est l’effort séculaire de l’humanité pour devenir clairement et complètement consciente de ces valeurs et de ces objectifs et pour renforcer et étendre constamment leur effet.«
—Einstein, Albert. Einstein, Science, Philosophy and Religion, A Symposium, publié par la Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc, New York, 1941.
Bouddha, Moïse et Jésus
« Ce que l’humanité doit à des personnalités comme Bouddha, Moïse et Jésus est pour moi plus important que toutes les réalisations de l’esprit curieux et constructif. Ce que ces hommes bénis nous ont donné, nous devons le garder et essayer de le maintenir en vie de toutes nos forces si l’humanité ne veut pas perdre sa dignité, la sécurité de son existence et sa joie de vivre ».
—Einstein, Albert. Déclaration écrite (septembre 1937), p. 70
Commencer par le coeur de l’homme
« Si nous voulons améliorer le monde, nous ne pouvons pas le faire avec des connaissances scientifiques, mais avec des idéaux. Confucius, Bouddha, Jésus et Gandhi ont fait plus pour l’humanité que la science. Nous devons commencer par le cœur de l’homme, par sa conscience, et les valeurs de la conscience ne peuvent se manifester que par un service désintéressé à l’humanité ».
—Einstein, Albert. Einstein et le poète (1983), p. 92
L’illusion optique de la conscience
L’un des échanges les plus poignants de son rôle de philosophe a eu lieu alors qu’il avait 70 ans et vivait à Princeton. Un rabbin ordonné lui avait écrit pour lui dire qu’il avait cherché en vain à réconforter sa fille de 19 ans après la mort de sa sœur, « une belle enfant de 16 ans, sans péché ».
L’être humain », écrit Einstein en réponse, « est une partie du tout, que nous appelons « Univers », une partie limitée dans le temps et l’espace. Il fait l’expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste – une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l’affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion à toutes les créatures vivantes et à toute la nature dans sa beauté. Personne n’est en mesure d’y parvenir complètement, mais le fait de s’efforcer d’y parvenir est en soi une partie de la libération et un fondement de la sécurité intérieure ».
— Walter Sullivan, “The Einstein Papers: A Man of Many Parts,” New York Times, 29 mars 1972.
NOTES :
*1. Les langues indo-aryennes. Il existe plus de 200 langues indo-aryennes connues, parlées par environ 1 milliard de personnes. Leurs formes modernes descendent des langues indo-aryennes anciennes, telles que le sanskrit védique primitif, en passant par les langues indo-aryennes moyennes (ou prakrits). Les langues indo-aryennes les plus importantes en termes de premiers locuteurs sont l’hindi-ourdou (c. 330 millions), le bengali (242 millions), le pendjabi (environ 120 millions), le marathi (112 millions), le gujarati (60 millions), le rajasthani (58 millions), le bhojpuri (51 millions), l’odia (35 millions), le maithili (environ 34 millions), le sindhi (25 millions), le népali (16 millions), l’assamais (15 millions), le chhattisgarhi (18 millions), le cinghalais (17 millions) et le romani (environ 3,5 millions). Le sud de l’Inde compte des langues dravidiennes (telugu, tamil, kannada et malayalam). En Europe, les principales langues indo-européennes sont l’anglais, le français, le portugais, le russe, le néerlandais et l’espagnol.
*2. Discords. Dès le IIIe siècle avant J.-C., pas moins de dix-huit écoles bouddhistes distinctes sont à l’œuvre en Inde, mais toutes se reconnaissent mutuellement comme des adeptes de la philosophie du Bouddha. Enfin, le bouddhisme du Véhicule du Diamant, dit Vajrayâna, dont les textes et les rituels complexes ont été élaborés dans les universités du nord-est de l’Inde vers le VIIe et VIIIe siècles.
*3. Le prâkrit est un terme qui désigne une langue indo-aryenne dérivée du sanskrit classique. Le mot lui-même a une définition assez souple, car il a parfois le sens de « originel, naturel, sans artifices, normal, ordinaire, usuel, ou encore, local », contrastant ainsi avec la forme littéraire et religieuse du sanskrit ; mais parfois, on peut aussi comprendre prâkrit comme signifiant « dérivé d’une langue originelle », c’est-à-dire dérivé du sanskrit. On peut donc dire que le prâkrit, comme toute langue vulgaire et vernaculaire de l’Inde, est issu du sanskrit. En fait, on peut comparer les prâkrits au latin vulgaire, tandis que le sanskrit serait le latin classique. L’usage le plus ancien que l’on connaisse du prâkrit est formé par l’ensemble d’inscriptions de l’empereur indien Ashoka (IIIe siècle av. J.-C.). L’un des prâkrits les plus célèbres est le pâli, qui a accédé au statut de langue littéraire et intellectuelle en devenant celle des textes du bouddhisme theravâda.
*4. Le pâli est une langue indo-européenne de la famille indo-aryenne. C’est un prâkrit moyen indien proche du sanskrit et remontant vraisemblablement au IIIe siècle av. J.-C. Le pâḷi est utilisé comme langue liturgique bouddhiste au Sri Lanka, en Birmanie, au Laos, en Thaïlande et au Cambodge. Son statut de langue liturgique l’a rendu, à l’instar du sanskrit, figé et normalisé.
*5. Hippodamos de Milet (né en 498 av. J.-C. et mort en 408 av. J.-C.) est un géomètre et ingénieur du Ve siècle av. J.-C., qui fut aussi architecte urbaniste, physicien, mathématicien, météorologiste et philosophe pythagoricien. La tradition a retenu de lui ses grands travaux de planification urbaine. Bien que ces travaux se caractérisent par l’utilisation systématique du plan en damier, il n’en est pas l’inventeur, de très anciennes colonies grecques nous fournissant déjà des exemples de cette structure urbaine.
Commentaires:
8 mars 2024, Bernard C.
Je continue la lecture du long texte illustré sur le « miracle du Gandhara ». Décidemment, tu as toujours l’art –et ce n’est pas un vain mot chez toi ! – de nous surprendre ! Quel bonheur ce doit être ! Merci Karel. Belle soirée à vous.
8 mars 2024, Bernard C., suite
J’espère qu’on reconnaitra un jour (ou l’autre) la beauté de ce travail (artkarel) dans son envergure, car tu ne cesses de nous renvoyer au moyen d’hyperliens (mots en bleu), à travers les âges, d’un bout à l’autre des continents, d’Ashoka à Sully – de véritables efforts intercontinentaux échafaudent, à grands traits pour ne pas dire à grandes enjambées, devant nos yeux surpris (encore une fois, c’est le mot!), une œuvre d’art illustrant qu’il n’est de richesse que d’hommes, et où se meuvent, d’un bord à l’autre de l’histoire de la civilisation, correspondances d’idées majeures qu’on aurait pu croire isolément réservées à leurs temps. Chapeau !
Ce que nous apprend l’expérience du « trou-dans-le-mur » de Sugata Mitra


On dénombre plus d’un milliard d’Indiens. Environ la moitié d’entre eux est malheureusement illettrée. Seulement un sur quatre a accès à des sanitaires dignes de ce nom. Quelque 350 millions d’Indiens vivent avec moins d’un euro par jour. Et pourtant, comme un étrange paradoxe, l’Inde est aussi l’un des terreaux qui voit fleurir des entreprises de haute technologie parmi les plus avancées au monde. New Delhi, c’est un peu la Silicon Valley à l’indienne. Et depuis peu, le génie indien a su poser un astromobile sur la Lune.

Scandalisé par le manque d’accès à l’éducation dont souffrent les enfants de son pays vivant loin des centres urbains, le Dr Sugata Mitra, un physicien indien devenu chercheur en technologie éducationnelle, a conduit, à partir de 1999, une série d’expériences baptisée « The Hole in the Wall » (le trou dans le mur), dont les résultats étonnants bousculent les fondements de la pédagogie conventionnelle.
Mitra, dont le bureau est accolé à un mur séparant un quartier résidentiel de New Delhi du bidonville de Kalkaji, décide alors de faire un trou dans ce mur. Il y installe son ordinateur et rend accessible son écran et la souris aux enfants vivant « de l’autre côté du mur ».
En principe, les enfants de ce quartier ne savent ni lire ni écrire et parlent un dialecte tamoul. La possibilité qu’ils puissent se débrouiller avec l’ordinateur est donc objectivement presque nulle.

Or, dans le monde réel, les choses se passent différemment. A peine huit minutes après l’installation de l’ordinateur, un gosse qui n’a jamais vu une télévision de sa vie vient renifler l’objet.
Lorsqu’il demande s’il peut toucher l’écran, Mitra lui répond : « C’est de votre côté du mur. » La règle veut, en effet, qu’ils aient le droit de toucher tout ce qui est de leur côté du mur.
Rapidement l’enfant se rend compte qu’en bougeant la souris dans un certain sens, quelque chose se déplace sur l’écran de façon similaire. Excité par ce qu’il a découvert, il appelle sans tarder ses copains et leur montre ce qu’il est capable de faire. En règle générale, dans l’expérimentation « Le trou dans le mur », un seul enfant manipule l’ordinateur. Il est entouré d’un premier groupe de trois autres qui lui donnent des conseils. Un second groupe d’environ seize enfants complète l’équipe, qui interagissent aussi avec l’enfant qui manipule le matériel. Leurs conseils sont souvent moins avisés, voire faux, mais ils apprennent aussi.
En quelques mois, les enfants sont capables d’apprendre jusqu’à deux cents mots d’anglais. S’ils ne les prononcent pas toujours correctement, ils en comprennent le sens et parviennent à interagir avec l’ordinateur. « Vous nous avez laissé ces machines qui ne parlent que l’anglais, alors nous avons dû l’apprendre ! » lui disent-ils. La plupart savent naviguer, jouer à des jeux ou faire des dessins avec Paint. Mieux encore, ils s’échangent sans problème des courriels, et bien d’autres choses encore.
En répétant l’expérience dans plusieurs villes pauvres d’Inde, avec des garçons aussi bien qu’avec des filles, Mitra, soupçonné de charlatanisme, parvient à dissiper les doutes initiaux insinuant qu’il y avait forcément « quelqu’un » qui avait formé les enfants à l’avance.
Les leçons à en tirer

Si les résultats étonnent, ils sont souvent mal interprétés, chacun, y compris Mitra, cherchant à démontrer sa propre théorie établie d’avance. Je vous laisse juge.
Pour les Européens, l’expérience elle-même est considérée comme à la limite de l’acceptable. Faire des enfants des cobayes sans l’autorisation de leurs parents n’est pas très éthique d’après les normes européennes. Et apporter de la technologie chez les pauvres et penser que tout s’arrangera tout seul, n’est-ce pas une de ces pratiques teintées de néo-colonialisme que la Banque mondiale classe parmi les pires approches en matière de technologie éducationnelle ?
De leur côté, les gourous de la Silicon Valley et du GAFAM jubilent ! Ils nous le disent depuis des années : il suffit de donner un ordinateur (qu’ils fabriquent et contrôlent) à chaque enfant et il s’éduque tout seul ! Vraiment ?
Rappelons-nous le projet « One Laptop per Child » lancé il y a une décennie, consistant à fournir des ordinateurs portables et des tablettes à énergie solaire, peu chères, aux enfants du tiers-monde. Sans vouloir critiquer la bonne volonté de ses promoteurs, disons que le fait de mettre simplement des ordinateurs à disposition ne s’est pas avéré une approche prometteuse. Une récente évaluation du projet faite au Pérou le confirme.
Pour sa part, Mitra, dont la bonne volonté est incontestable, conclut que l’expérience montre que l’éducation primaire peut se faire, du moins en partie, à peu près toute seule, une démarche qu’il a baptisée « éducation non invasive ».
A notre avis, le Dr Mitra semble malheureusement rater l’essentiel de ce que son expérience met brillamment en lumière.
En France, après en avoir été partisan, l’enseignant Vincent Faillet en est venu à penser, lui aussi, qu’offrir une tablette à chaque enfant n’est pas la bonne approche. Avec raison, il souligne que ce n’est pas l’ordinateur, la tablette ou l’écran qui enseigne aux enfants, mais bien l’interaction entre élèves :
« L’apprentissage entre pairs tel qu’il est défini par Sugata Mitra et qui a émerveillé nombre de pédagogues est, en réalité, ni plus ni moins qu’une forme moderne et spontanée d’enseignement mutuel. Il est frappant de constater qu’en dépit des siècles qui séparent ces observations, on retrouve un schéma constant : des enfants en situation d’apprentissage, regroupés autour d’une surface d’interaction commune, qu’il s’agisse de sable, d’un tableau ou d’un écran d’ordinateur. L’idée d’interaction est essentielle. Sugata Mitra le dit lui-même, les élèves n’obtiennent pas les mêmes résultats s’il devait y avoir un ordinateur par enfant. Il faut toujours plusieurs enfants pour un ordinateur, de la même façon que plusieurs enfants des écoles mutuelles se regroupent autour d’un même tableau. »
(La métamorphose de l’école, Vincent Faillet, 2017)

L’expérience est évidemment prometteuse pour les régions éloignées et pauvres, à condition que l’on comprenne bien ce qui vient d’être dit.
Ce qui est certain, c’est que l’expérience rappelle aux habitants du Nord l’inefficacité de leurs pratiques pédagogiques, avec la forte passivité qu’engendrent nos systèmes éducationnels. Après l’éradication des méthodes d’« enseignement mutuel » chères à Lazare Carnot en 1815, c’est la méthode « simultanée » de Jean-Baptiste de La Salle qui triomphe. Le maître enseigne. Son autorité est incontestable. Comme à la messe, les élèves ne bougent pas, se taisent et obéissent.
(Voir sur ce site notre article sur l’enseignement mutuel)
En 2004 est créée Hole-in-the-Wall Education Ltd., une entreprise qui exporte l’idée de Mitra au Cambodge et en Afrique. Ce dernier a également mis sa méthode en application en Angleterre.
Là aussi, ses résultats spectaculaires ont fait grand bruit : les élèves qui enseignent les uns aux autres, assure-t-il, ont sept ans d’avance sur leur niveau académique. Pourvu qu’ils s’inscrivent dans un processus d’enseignement mutuel, internet, tablettes et smartphones retrouvent effectivement toute leur place, celle d’outils au service de celui qui enseigne, et non pas voués à le remplacer.
Des élèves de seulement 8 ou 9 ans auxquels on permet de chercher sur internet pour se préparer au General Certificate of Secondary Education (GCSE), non seulement réussissent l’épreuve, mais se souviennent encore de ce qu’ils ont appris lorsqu’on les teste à nouveau trois mois plus tard. On voit même des enfants de 14 ans passer avec succès des épreuves du niveau du baccalauréat à l’Université de Newcastle. Trouveront-ils des emplois à la hauteur de leurs compétences ?
Le Dr Mitra décrit ses résultats:
Extrait :
« Certaines observations communes ont émergé de nos expériences, suggérant que le processus d’apprentissage suivant se produit lorsque les enfants s’auto-instruisent dans l’utilisation de l’ordinateur :
« 1. Les découvertes ont tendance à se produire de deux manières : lorsqu’un enfant d’un groupe a déjà des connaissances en informatique, il montre ses compétences aux autres. Ou bien, pendant que les autres observent, un enfant explore au hasard l’environnement graphique jusqu’à ce qu’il fasse une découverte accidentelle. Par exemple, l’enfant peut découvrir que le curseur prend la forme d’une main à certains endroits de l’écran.
« 2. Plusieurs enfants répètent la découverte en demandant au premier enfant de les laisser essayer.
« 3. Au cours de l’étape 2, un ou plusieurs enfants font d’autres découvertes accidentelles ou fortuites.
« 4. Tous les enfants répètent toutes les découvertes faites et, ce faisant, en font d’autres. Ils commencent bientôt à créer un vocabulaire pour décrire leurs expériences.
« 5. Ce vocabulaire les encourage à percevoir des généralisations, telles que « lorsque vous cliquez sur un curseur en forme de main, il prend la forme d’un sablier pendant un certain temps et une nouvelle page s’affiche ».
« 6. Ils mémorisent des procédures entières pour faire quelque chose, par exemple pour ouvrir un programme de peinture et récupérer une image sauvegardée. Chaque fois qu’un enfant trouve une procédure plus courte, il l’enseigne aux autres. Ils discutent, organisent de petites conférences, établissent leurs propres calendriers et plans de recherche. Il est important de ne pas les sous-estimer.
« 7. Le groupe se divise entre « ceux qui savent » et « ceux qui ne savent pas », de la même manière qu’il se divise entre « ceux qui ont » et « ceux qui n’ont pas » en ce qui concerne leurs possessions. Cependant, un enfant qui sait partagera ses connaissances en échange d’une amitié et d’une réciprocité de l’information, contrairement à ce qui se passe avec la propriété des choses physiques, où ils peuvent utiliser la force pour obtenir ce qu’ils n’ont pas. Lorsque vous lui « prenez » une information, le donneur ne la « perd » pas !
« 8. Un stade est atteint lorsque les enfants ne font plus de découvertes et qu’ils s’emploient à mettre en pratique ce qu’ils ont déjà appris. À ce stade, il est nécessaire d’intervenir pour planter une nouvelle graine de découverte (…). Généralement, une spirale de découvertes s’ensuit et un autre cycle d’auto-apprentissage commence. »
Source : Sugata Mitra, 2012
Enseignement mutuel : curiosité historique ou piste d’avenir ?
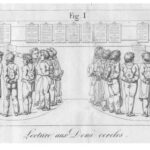

Par Karel Vereycken, Paris, France
- Introduction
- Apprendre et enseigner, une même joie
- Précédents
A. En Inde
B. En France - Les brigades de Gaspard Monge
- Andrew Bell
- Joseph Lancaster
- Enseignement mutuel, comment ça marche ?
A. Le local
B. Maîtres et moniteurs
C. Fonctionnement
D. Progresser selon sa connaissance
E. Les outils
F. Commandement - Bellistes contre lancastériens
- Lorsque ça intéresse les Français
- Lazare Carnot à la manœuvre
- Enseignement mutuel et chant choral
- Le projet pilote de la rue Saint-Jean-de-Beauvais
- Jomard, Choron, Francœur et savoirs élémentaires
- Rayonnement national
- Critiques
- Dérive mécaniste ?
- Mort de l’enseignement mutuel en France
- Conclusion
- Quelques ouvrages et textes consultés, en accès libre
« Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D’avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d’un jour, demain vaincus par d’autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n’êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu’ils vous ont appris ;
J’écoute mal un sot qui veut que je le craigne,
Et je sais beaucoup mieux ce qu’un ami m’enseigne. »
Victor Hugo, Discours sur les avantages de l’Enseignement mutuel, 1817.
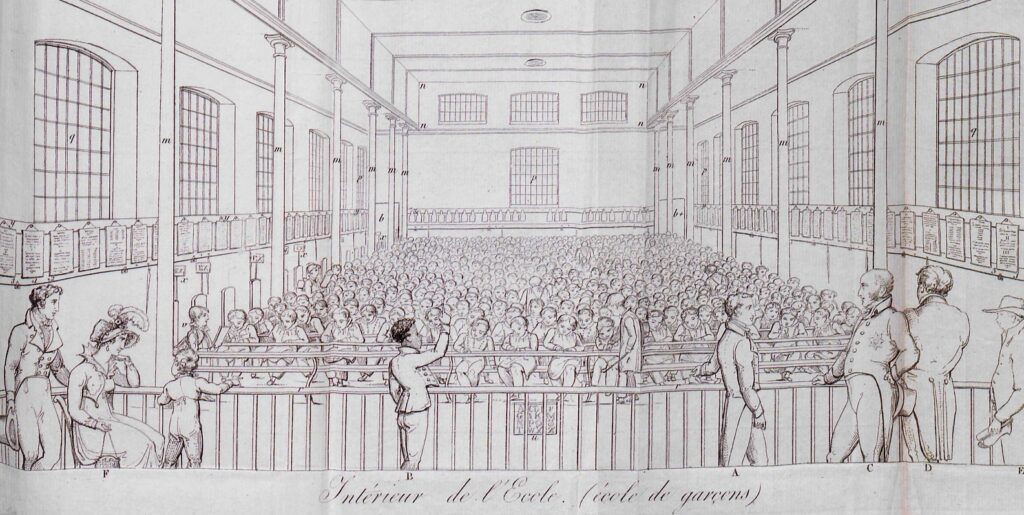
1. Introduction
Enseigner la lecture et l’écriture à 1000 enfants présents dans une même salle, sans instituteur, sans livres scolaires, sans papier et sans encre, c’est clairement impossible. Et pourtant, cela a été imaginé et mis en pratique avec grand succès ! Chut ! Il ne faut pas en parler, car cela pourrait donner des idées à certains, et pas seulement dans les pays émergents !
Qu’un tel défi puisse être relevé ne pouvait qu’inquiéter l’oligarchie et ses serviteurs. Depuis la nuit des temps ils formatent une « élite » (les grands prêtres de la connaissance, les « experts » et autres sachants) se reproduisant en vase clos au sommet, tout en veillant à ce que la grande masse du peuple d’en bas s’instruise juste assez pour pouvoir livrer des colis, payer ses impôts, se plier aux règles définies par le sommet, et surtout, ne fasse pas (trop) désordre.
Pourtant, comme l’avait compris bien avant nous Hippolyte Carnot, ministre de l’Instruction publique de la IIe République, sans éducation républicaine, c’est-à-dire sans une véritable formation de citoyen dès la maternelle, le suffrage universel devient, assez souvent, une farce tragique capable d’engendrer des monstres.
Au début du XIXe siècle, « l’enseignement mutuel » (parfois appelé système « monitorial » anglais, « système de Madras » ou « système de Lancaster »), se répand comme un feu de brousse en Europe puis à travers le monde.
Si le maître s’adresse à un seul élève, c’est le mode individuel (cas du précepteur) ; s’il s’adresse à toute une classe, c’est le mode simultané ; s’il charge des enfants d’instruire les autres, c’est le mode mutuel. L’alliance des procédés simultané et mutuel est appelée mode mixte.
L’enseignement mutuel est rapidement victime de querelles de personnes et d’enjeux idéologiques, politiques et religieux. Il est vécu comme une agression par les congrégations religieuses qui pratiquent, elles, « l’enseignement simultané », édicté dès 1684 par Jean-Baptiste de la Salle pour les « Frères des écoles chrétiennes » : classes par âge, division par niveau, place fixe et individuelle, discipline stricte, travail répétitif et simultané surveillé par un maître inflexible.
Avec la constitution de petits groupes où les élèves enseignent les uns aux autres, se déplacent dans la salle de classe, l’enseignement mutuel a immédiatement fait naître, assez bêtement, la crainte d’un monde cul par-dessus tête, sortant d’un tableau de Jérôme Bosch. Dans quel monde sommes-nous si l’élève enseigne au maître, l’enfant au parent, le fidèle au prêtre, le citoyen au gouvernement ! Sans chef, que faire, chef ?
Estimant qu’un tel enseignement « affaiblit l’autorité » aussi bien des maîtres que des autorités politiques et religieuses, en 1824, le pape Léon XII (à ne pas confondre avec le bienveillant Léon XIII), le « pape de la Sainte-Alliance », farouche partisan de l’ordre et soupçonnant un vaste complot protestant contre le Vatican, l’interdit.
En France, où dans les années qui suivent la Révolution de 1830, près de 2 000 écoles mutuelles existent, principalement dans les villes, en concurrence avec les écoles confessionnelles, François Guizot, ministre de Louis-Philippe, les fera disparaître.
2. Apprendre et enseigner, une même joie

Le tutorat connaît aujourd’hui un regain d’intérêt dans le cadre des apprentissages scolaires et formations professionnelles. Il s’agit d’un processus « d’assistance de sujets plus expérimentés à l’égard de sujets moins expérimentés, susceptible d’enrichir les acquisitions de ces derniers ». C’est ainsi que le tutorat entre enfants, en particulier entre enfants d‘âges différents, est encouragé dès l’école maternelle, jusqu’à l’université avec l’institutionnalisation au niveau du premier cycle du tutorat méthodologique, en passant par l’école élémentaire et le secondaire qui ont vu se développer depuis les années 1980, tant en France qu’à l’étranger, de nombreuses expériences tutorales.
Or, le tutorat n’est que le pâle héritier de l’enseignement mutuel développé en Angleterre puis en France au XIXe siècle.
Il existe une vérité immuable : l’avenir de l’humanité dépend d’une faculté exclusivement humaine : la découverte de principes physiques universels nouveaux, parfois dépassant de loin les bornes de notre appareil sensoriel, permettant à l’Homme d’accroître sa capacité de transformation de l’univers afin d’améliorer de façon qualitative son sort et celui de son environnement. Or, une découverte n’est jamais le fruit d’une somme ou d’une moyenne d’opinions multiples mais bien celui d’un acte unique parfaitement souverain.

Cependant, sans la socialisation de cette découverte, elle ne servira à rien. L’histoire de l’humanité est donc, par sa propre nature, pourrait-on dire, l’histoire d’un « enseignement mutuel ».
Le plus grand plaisir de celui qui vient d’effectuer une découverte, et cela est naturel chez les enfants, n’est-il pas de partager, non seulement ce qu’il ou elle vient de découvrir, mais la joie et la beauté que représente toute percée scientifique ? Et lorsque ceux qui découvrent, enseignent, le plaisir est au rendez-vous. Laissons-donc à nos enseignants professionnels le temps de faire des découvertes, leur enseignement y gagnera en qualité !
3. Précédents
A. En Inde
En 1623, l’explorateur italien Pietro Della Valle (1586-1652), après un voyage en « Indoustan » (Inde), dans une lettre expédiée d’Ikkeri (ville du sud-ouest de l’Inde), rapporte avoir vu :

« certains jeunes enfants qui y apprenaient à lire d’une façon extraordinaire (…) Ils étaient quatre et avaient pris du maître une même leçon ; afin de l’inculquer parfaitement dans leur mémoire, de répéter les précédentes qui leur avaient été prescrites, de peur de les oublier, l’un d’eux chantait d’un certain ton musical une ligne de la leçon, comme par exemple deux et deux font quatre. En effet, on apprend facilement une chanson. Pendant qu’il chantait cette partie de leçon pour l’apprendre mieux, il l’écrivait en même temps, non pas avec une plume, ni sur du papier. Mais pour l’épargner et n’en pas gâter inutilement, ils en marquaient les caractères avec le doigt sur le même plancher où ils étaient assis en rond, qu’ils avaient couvert pour ce sujet d’un sable très délié. Après que le premier de ces enfants avait écrit de la sorte en chantant, les autres chantaient et écrivaient la même chose tous ensemble (…) Sur ce que je leur demandais qui (…) les corrigeait lorsqu’ils manquaient, vu qu’ils étaient tous écoliers, ils me répondirent fort raisonnablement, qu’il était impossible qu’une seule difficulté les arrêtât tous quatre en même temps, sans pouvoir la surmonter et que pour le sujet ils s’exerçaient toujours ensemble afin que si l’un manquait les autres fussent ses maîtres. »
Dans ce texte apparaissent déjà les grands principes de l’enseignement mutuel, notamment l’apprentissage simultané de la lecture et de l’écriture, l’utilisation du sable pour les exercices d’écriture afin de ne pas gaspiller le papier qui est rare et fort cher, un cours en collectif donné par un maître, puis un travail en sous-groupes dans lequel les élèves apprennent à s’autoréguler, et enfin, une intégration du savoir qui, grâce à l’utilisation du chant, va faciliter la mémorisation.
B. En France
A Lyon, le prêtre lyonnais Charles Démia figure comme l’un des précurseurs de l’enseignement mutuel qu’il a théorisé dès 1688, et qu’il mettait en pratique dans les « petites écoles » pour enfants pauvres qu’il a fondées. D’après le Nouveau dictionnaire de pédagogie et de l’instruction primaire,

« Démia introduisit dans les classes ce qu’on appela plus tard l’enseignement mutuel : il recommande de choisir, parmi les écoliers les plus capables et les plus studieux, un certain nombre d’officiers, dont les uns, sous le nom d’intendants et de décurions, seront chargés de la surveillance, tandis que les autres devront faire répéter les leçons du maître, reprendre les écoliers quand ils se trompent, guider la main hésitante des ‘jeunes écrivains’, etc. Pour rendre possible la simultanéité de l’enseignement, l’auteur des règlements divise l’école en huit classes, dont le maître devra s’occuper tour à tour ; chacune de ces classes peut se subdiviser en bandes. »
A Paris, dès 1747, l’enseignement mutuel est pratiqué avec un grand succès dans une école de plus de 300 élèves, établie par M. Herbault à l’hospice de la Pitié, en faveur des enfants des pauvres. L’expérience, hélas, ne survécut pas à son fondateur.
En 1772, la charité ingénieuse du chevalier Paulet conçut et exécuta le projet d’appliquer une semblable méthode à l’éducation d’un grand nombre d’enfants, que la mort de leurs parents laissaient sans appui dans la société.
4. Les brigades de Gaspard Monge
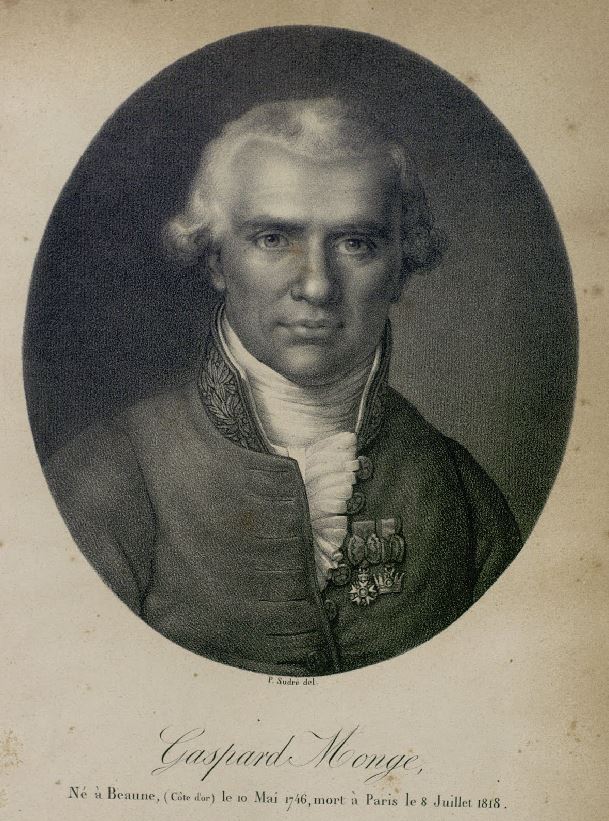
Enfin, comme le raconte, dans sa biographie de Gaspard Monge, son élève le plus brillant, l’astronome François Arago (1786-1853), lui-même un ami proche d’Alexandre de Humboldt, c’est à l’École polytechnique que Monge va peaufiner son propre système d’enseignement mutuel et de tutorat.
Jugeant qu’il était inacceptable de devoir attendre trois ans pour voir sortir les premiers ingénieurs de l’École polytechnique, Monge décida, afin d’accélérer la formation des élèves, d’organiser des « cours révolutionnaires », une formation accélérée pendant trois mois. Pour cela, il perfectionna le concept de « chefs de brigades », une technique qu’il avait déjà pu tester avec succès à l’école du Génie de Mézières.


François Arago :
« Les chefs de brigade, toujours réunis à de petits groupes d’élèves dans des salles séparées, devaient avoir des fonctions d’une importance extrême, celles d’aplanir les difficultés à l’instant même où elles surgiraient. Jamais combinaison plus habile n’avait été imaginée pour ôter toute excuse à la médiocrité ou à la paresse.
« Cette création appartenait à Monge. A Mézières, où les élèves du génie étaient partagés en deux groupes de dix, à Mézières, où, en réalité, notre confrère fit quelque temps, pour les deux divisions, les fonctions de chef de brigade permanent, la présence, dans les salles, d’une personne toujours en mesure de lever les objections avait donné de trop heureux résultats pour qu’en rédigeant les développements joints au rapport de Fourcroy, cet ancien répétiteur n’essayât pas de doter la nouvelle école des mêmes avantages.
« Monge fit plus ; il voulut qu’à la suite des leçons révolutionnaires, qu’à l’ouverture des cours des trois degrés, les 23 sections de 16 élèves chacune, dont l’ensemble des trois divisions devait être composé, eussent leur chef de brigade, comme dans les temps ordinaires ; il voulut, en un mot que l’École, à son début, marchât comme si elle avait déjà trois ans d’existence.
« Voici comment notre confrère atteignit ce but en apparence inaccessible. Il fut décidé que 25 élèves, choisis par voie de concours parmi les 50 candidats que les examinateurs d’admission avaient le mieux notés, deviendraient les chefs de brigade de trois divisions de l’école, après avoir reçu à part une instruction spéciale. Le matin, les 50 jeunes suivaient, comme tous leurs camarades, les cours révolutionnaires ; le soir, on les réunissait à l’hôtel Pommeuse, près du Palais-Bourbon, et divers professeurs les préparaient aux fonctions qui leur étaient destinées. Monge présidait à cette initiation scientifique avec une bonté, une ardeur, un zèle infinis. Le souvenir de ses leçons est resté en traits ineffaçables dans la mémoire de tous ceux qui en profitèrent. »
Arago cite alors le témoignage d’Edme Augustin Sylvain Brissot (1786-1819), fils du célèbre girondin et abolitionniste, un des 50 élèves :
« C’est là, que nous commençâmes à connaître Monge, cet homme si bon attaché à la jeunesse, si dévoué à la propagation des sciences. Presque toujours au milieu de nous, il faisait succéder aux leçons de géométrie, d’analyse, de physique, des entretiens particuliers où nous trouvions plus à gagner encore. Il devint l’ami de chacun des élèves de l’Ecole provisoire ; il s’associait aux efforts qu’il provoquait sans cesse, et applaudissait, avec toute la vivacité de son caractère, aux succès de nos jeunes intelligences ».
Si une forme d’enseignement mutuel y est pleinement pratiquée, le dévouement total d’un maître aussi fervent que Monge, vient compléter ce qui ne serait autrement qu’un « système ».
5. Andrew Bell
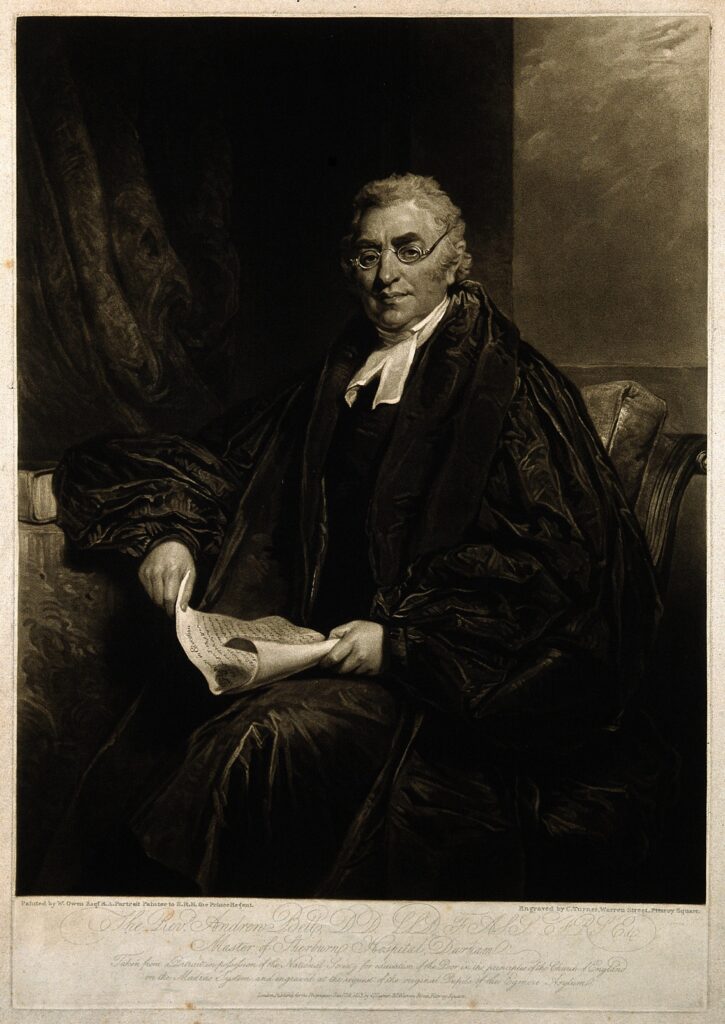
C’est un Écossais, le pasteur anglican Andrew Bell (1753-1832), qui revendique la paternité de l’enseignement mutuel qu’il a pratiqué et théorisé en Inde, à la tête de l’Asile militaire pour orphelins d’Egmore (Inde orientale). Cette institution, créée en 1789, est chargée d’éduquer et d’instruire les orphelins et les fils indigents des officiers et des soldats européens de l’armée de Madras.
Après sept ans sur place, Bell rentre à Londres et en 1797, il rédige un rapport destiné à la Compagnie des Indes (son employeur à Madras) sur les incroyables avantages de son invention.
Le médecin, naturaliste et inventeur russe Iosif Kristianovich (Joseph Christian) Hamel (1788-1862), membre de l’Académie des Sciences, est chargé par le Tsar de Russie Alexandre Ier, de faire un rapport complet sur ce nouveau type d’enseignement dont toute l’Europe discutait alors.
Il relate, dans Der Gegenseitige Unterricht (1818), ce qu’écrivait Bell dans un de ses écrits :

« Il arriva dans ce temps, qu’en faisant un matin ma promenade ordinaire, je passai devant une école de jeunes enfants Malabares, et je les vis occupés à écrire sur la terre. L’idée me vint aussitôt qu’il y aurait peut-être moyen d’apprendre aux enfants de mon école, à connaître les lettres de l’alphabet, en leur faisant tracer sur le sable. Je rentrai sur-le-champ chez moi, et je donnai ordre au maître de la dernière classe, de faire exécuter ce que je venais d’arranger dans mon chemin. Heureusement, l’ordre fût très mal accueilli ; car si le maître s’y fut conformé à ma satisfaction, il est possible que tout développement ultérieur eût été arrêté, et par là, le principe même de l’enseignement mutuel… »
Accueilli avec froideur en Angleterre, l’enseignement mutuel finit par séduire Samuel Nichols, un des dirigeants de l’école de St-Botolph’s Aldgate, la plus vieille paroisse protestante anglicane de Londres. La mise en œuvre des préceptes de Bell est réalisée avec grand succès et sa méthode est reprise par le docteur Briggs lorsqu’il ouvre une école industrielle à Liverpool.
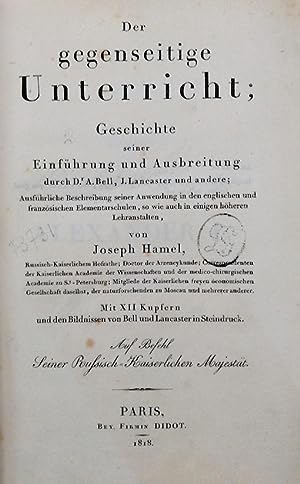
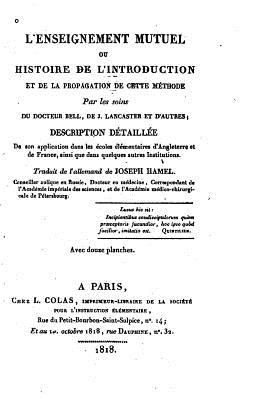

6. Joseph Lancaster

En Angleterre, c’est Joseph Lancaster (1778-1838), un instituteur londonien âgé de vingt ans, qui s’empare de la nouvelle manière d’enseigner, la perfectionne et la généralise à grande échelle.
En 1798, il ouvre une école élémentaire pour les enfants pauvres à Borough Road, un des faubourgs les plus miséreux de Londres. L’enseignement n’y est pas encore totalement gratuit mais 40 % moins cher que dans les autres écoles de la capitale.
Faute d’argent, Lancaster fait tout pour faire baisser encore les coûts de ce qui devient un véritable « système » : emploi de sable et d’ardoises plutôt que d’encre et de papier (Erasme de Rotterdam rapporte en 1528 qu’en son temps il y avait des gens qui écrivaient avec une sorte de poinçon sur des tables recouvertes d’une fine poussière) ; tableaux reproduisant les pages d’ouvrages scolaires suspendus aux murs pour éviter l’achat de livres ; maîtres auxiliaires remplacés par des élèves pour éviter de payer des salaires ; augmentation du nombre d’élèves par classe.

En 1804, son école compte 700 élèves, et douze mois plus tard, un millier. Lancaster, en s’endettant de plus en plus, ouvre une école pour 200 filles. Pour échapper à ses créanciers, il quitte Londres en 1806 et lors de son retour il est enprisonné pour dette. Deux de ses amis, le dentiste Joseph Foxe et le fabricant de chapeaux de paille William Corston, remboursent sa dette et fondent avec lui « La société pour la promotion du système lancastérien pour l’éducation des pauvres ». D’autres quakers viendront alors les soutenir, notamment l’abolitionniste William Wilberforce (1759-1833) que David d’Angers, sur le socle de son célèbre monument commémorant Gutenberg à Strasbourg, fait figurer aux côtés de Condorcet et de l’abbé Grégoire.
A partir de là, comme le relate Joseph Hamel dans son rapport de 1818, la nouvelle approche s’est répandue aux quatre coins du monde : Angleterre, Écosse, Irlande, France, Prusse, Russie, Italie, Espagne, Danemark, Suède, Pologne et Suisse, sans oublier le Sénégal et plusieurs pays d’Amérique du Sud comme le Brésil et l’Argentine et, bien sûr, les États-Unis d’Amérique. L’enseignement mutuel a été adopté comme pédagogie officielle à New York (1805), Albany (1810), Georgetown (1811), Washington D.C. (1812), Philadelphie (1817), Boston (1824) et Baltimore (1829), et la législature de Pennsylvanie a envisagé de l’adopter à l’échelle de l’État.
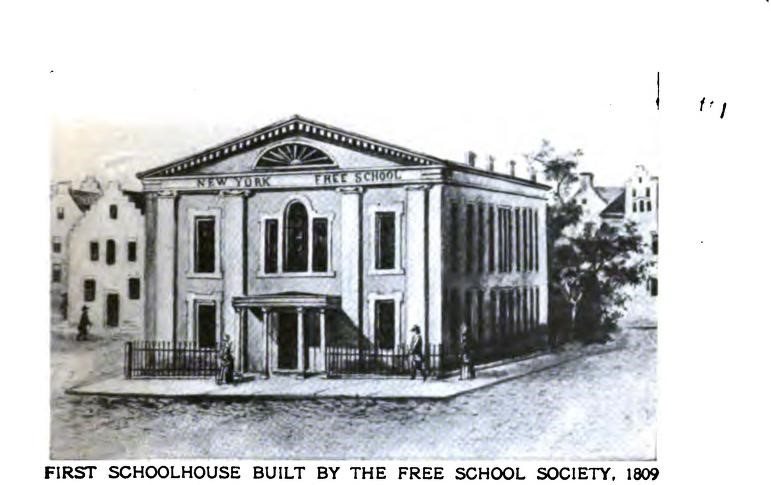
7. Enseignement mutuel, comment ça marche ?
Le principe fondamental de « l’enseignement mutuel », particulièrement pertinent pour l’école primaire, consiste dans la réciprocité de l’instruction entre les écoliers, le plus capable servant de maître à celui qui l’est moins. Dès le début, tous avancent graduellement, quel que soit le nombre d’élèves. Bell et Lancaster, et leurs disciples français, posent en postulat la diversité des facultés, l’inégalité des progrès, des rythmes de compréhension et d’acquisition. Ils sont donc conduits à repartir les élèves en classes différentes suivant les disciplines et suivant le niveau de connaissances des enfants, l’âge n’intervenant aucunement dans cette classification. Les écoliers ainsi réunis prennent part aux mêmes exercices. Leur programme d’étude est identique dans son contenu et dans ses méthodes.
Si l’effectif d’une division est trop élevé dans une discipline, la lecture ou l’arithmétique, par exemple, on constitue des sous-groupes qui évoluent parallèlement, les méthodes et supports de l’enseignement restant identiques.
Comment se présente alors une école du nouveau système ?
A. La salle de classe
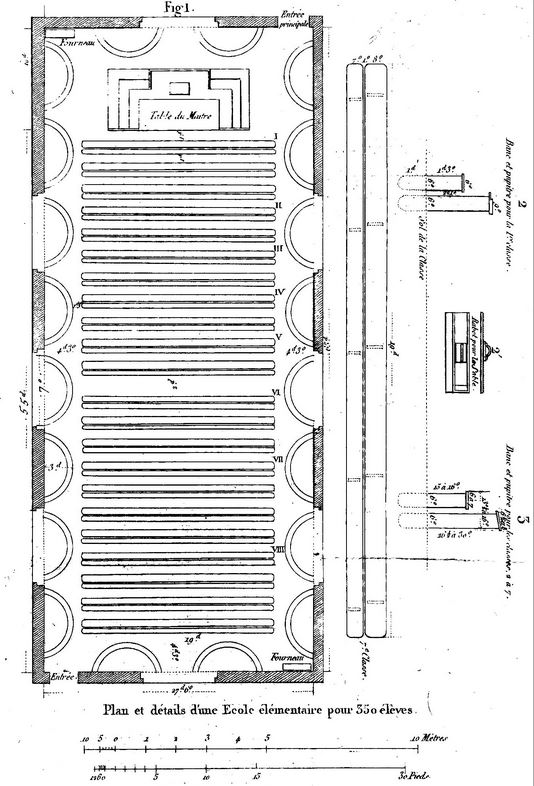
Quel que soit le nombre d’élèves — une centaine dans les bourgades françaises, mille dans l’école de Lancaster à Londres, deux cents dans les écoles parisiennes – ceux-ci sont groupés dans une salle unique, rectangulaire, sans cloisons. Jomard qui déploya dans les premières années de l’installation du mode d’enseignement mutuel une extraordinaire et féconde activité, a fixé les normes souhaitables pour des effectifs variant de 70 à 1 000 élèves. Il indique, par exemple, pour 350 élèves la nécessité d’une salle de 18 m de long sur 9 m de large. En Angleterre et dans les campagnes françaises, on utilise souvent une grange pour la nouvelle école. En France, les édifices religieux désaffectés depuis la période révolutionnaire sont nombreux et répondent parfaitement aux normes souhaitées. Ils accueilleront beaucoup d’écoles mutuelles.
B. Maîtres et « moniteurs »
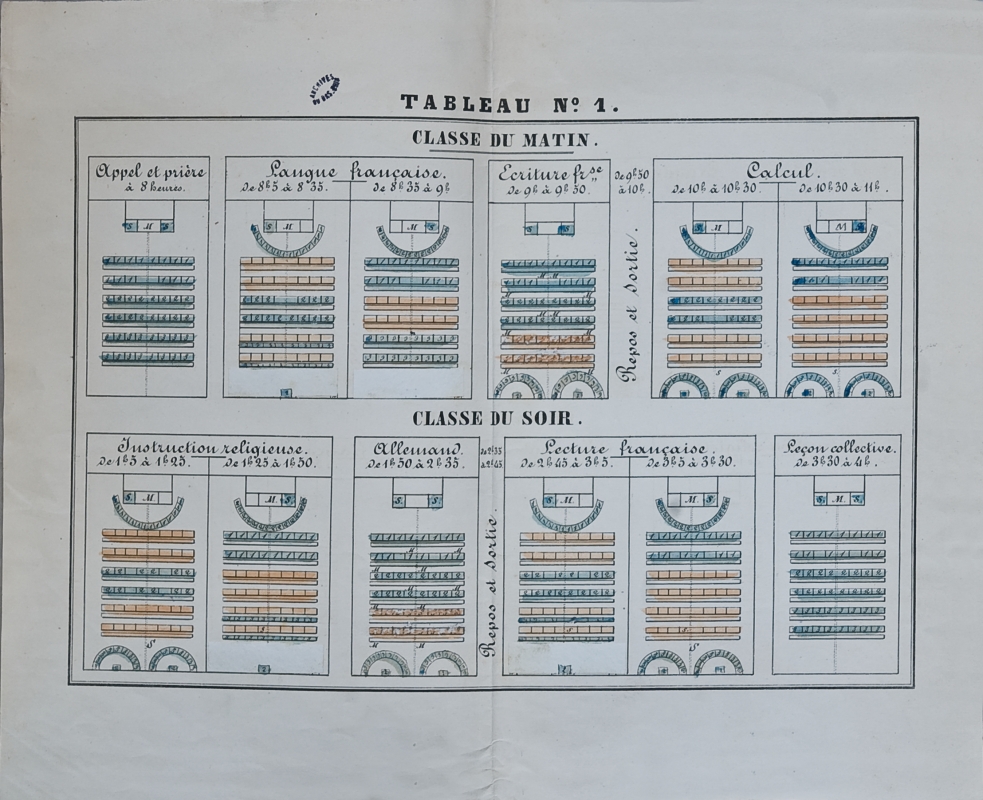
Le mode mutuel répartit la responsabilité de l’enseignement entre le « maître » et des élèves désignés comme « moniteurs » et considérés comme « la cheville ouvrière de la méthode ». Le moniteur (ou admoniteur) est un élève un peu plus grand et plus avancé dans la discipline. Il de doit point enseigner mais s’assurer que les élèves s’enseignent entre eux. Comme le rappelle Bally, dès 1819 :
« La base de l’enseignement mutuel repose sur l’instruction communiquée par les élèves les plus forts à ceux qui sont les plus faibles. Ce principe qui fait le mérite de cette méthode, a nécessité une organisation toute particulière pour créer une hiérarchie raisonnable, qui pût concourir de la manière la plus efficace, au succès de tous. »
Chaque jour, dans une « classe » réservée aux moniteurs, le maître transmet des connaissances et dispense à ses adjoints les conseils techniques pour la bonne application de la méthode. Au cours de la journée, il reste responsable de la 8e classe (celle de l’achèvement du cursus scolaire), et, à ce titre, se charge de la conduite de leurs exercices. Il procède aux examens périodiques, mensuels ou occasionnels, dans les classes et décide, éventuellement, des changements de classe. C’est lui, enfin, qui, au stade ultime, distribue punitions et récompenses.
C. Fonctionnement
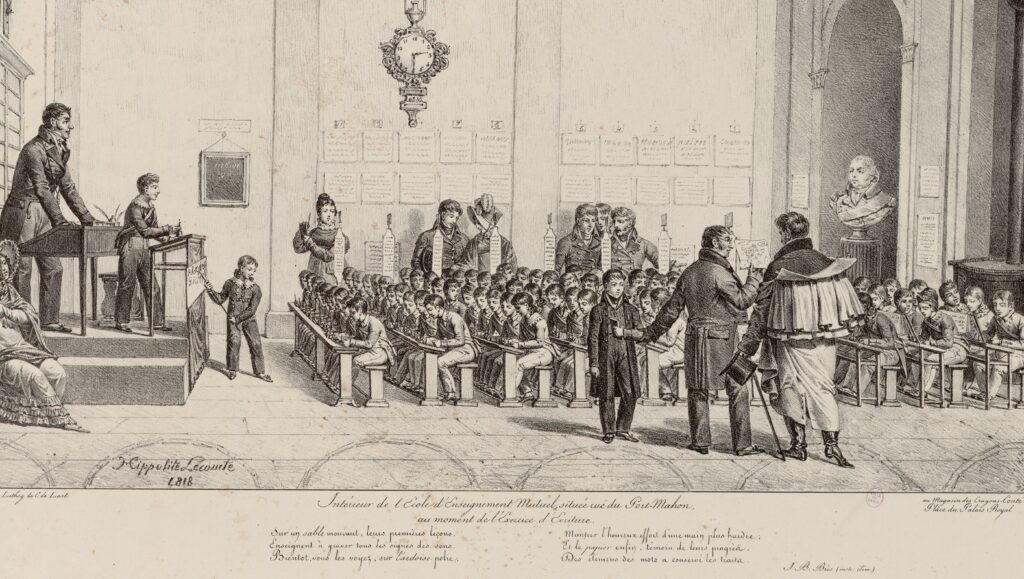
Ainsi, sur une estrade, le bureau du maître avec un large tiroir où sont rangés argent, billets de récompense, registres, modèles d’écriture, sifflets, cahiers des enfants.
Derrière le maître, à côté de l’horloge – instrument essentiel pour organiser la vie de l’enseignement – un tableau noir sur lequel sont écrits sentences et modèles d’écriture.
Au pied de l’estrade, des bancs sont fixés transversalement aux pupitres, de tailles différentes, au milieu de la pièce. Les premières tables, non inclinées, comportent du sable sur lesquelles les petits enfants tracent des signes, les autres tables reçoivent des ardoises ; on trouve également, sur les dernières d’entre elles, des encriers de plomb et du papier, des baguettes pour indiquer les mots ou les lettres à lire.
À l’extrémité de chaque table sont fixés les « tableaux de dictées » ainsi que des signaux télégraphiques indiquant les moments de la leçon, tel par exemple « COR » pour « correction » ou « EX » pour « examen du travail ». Des modèles de table demi-circulaire ont été ensuite proposés afin de faciliter le travail des moniteurs.
D. Progresser en fonction de sa connaissance
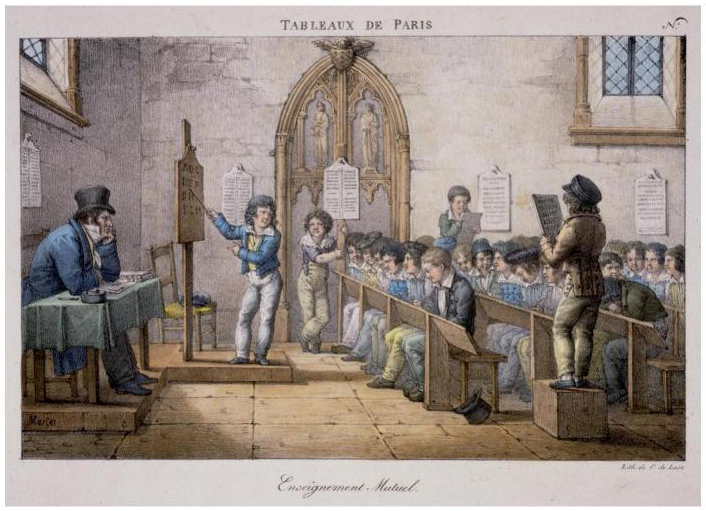
A l’origine, le programme de l’école mutuelle est limité aux trois disciplines fondamentales : lecture, écriture, arithmétique, et à l’enseignement de la religion. S’y ajouteront rapidement, la géographie, la grammaire, la rédaction, le chant et le dessin. Les groupements d’élèves, souples, mobiles, différenciés, sont fonction de la nature des matières d’étude et des activités pratiquées dans la discipline.
Chaque matière enseignée dans les écoles mutuelles repose sur un programme précis et codifié. Ce programme est découpé en 8 degrés hiérarchisés, qui doivent être parcourus successivement. Chaque degré s’appelle « classe » et c’est ainsi que l’on parle de 8 classes d’écriture ou d’arithmétique. Ce terme de « classe » est totalement exclusif de la notion d’architecture ou de local. Il ne s’entend que par rapport aux acquisitions et aux connaissances, la 1ere classe étant celle des débutants et la 8e celle de l’achèvement du cursus scolaire. Les rythmes d’apprentissages et les acquisitions varient suivant les élèves et suivant la discipline.
Ainsi, au bout de six mois de présence, tel élève pourra se trouver en 4e classe de lecture, en 5e classe d’écriture et en deuxième classe d’arithmétique. Comme nous l’avons dit, l’affectation dans la classe se décide en fonction du niveau de connaissance et non pas en fonction de l’âge.
Mais cette première répartition s’assortit, au sein de chaque classe et dans chaque discipline, de la constitution de groupes restreints établis selon les activités qui doivent y être pratiquées. En arithmétique, par exemple, des travaux écrits se font sur l’ardoise. Ils ont lieu, assis, sur les bancs réservés à cet usage, avec 16 à 18 élèves au maximum par banc, selon les normes établies par Jomard.
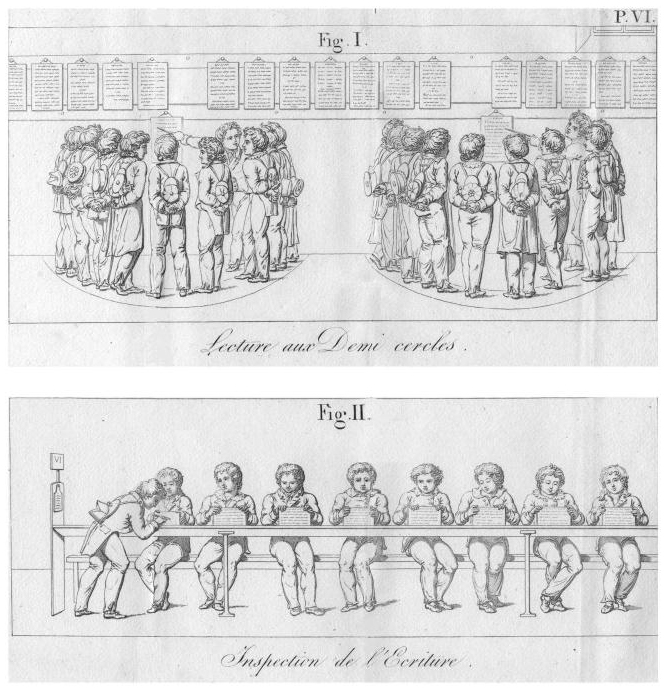
Les exercices oraux, en lecture, en arithmétique ou en dessin linéaire, à l’aide d’un tableau noir, se font debout, par groupes de 9 au maximum, les élèves se tenant côte à côte et formant un demi-cercle. De là, d’ailleurs, l’appellation donnée à ce genre d’activité : « travail au cercle ».
Ainsi, dans une école mutuelle ayant 36 élèves en 3e classe d’arithmétique, le travail aux bancs se fera en deux groupes avec deux moniteurs et les exercices au tableau noir avec 4 groupes et 4 moniteurs. Les effectifs des classes pourront donc varier suivant les écoles et tout au cours de l’année, la seule limitation étant imposée par l’étendue du local.
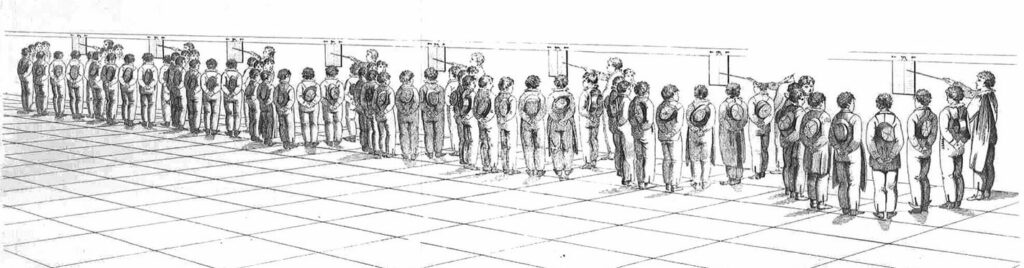
D. Les outils
Le souci d’économie est l’une des caractéristiques fondamentales du nouvel enseignement. Le mobilier reste donc très sommaire.
- Les bancs et pupitres sont faits de planches très ordinaires, fixées avec de gros clous. Les bancs n’ont pas de dossier : c’est un luxe superflu !
- L’estrade est nettement surélevée : 0,65 m environ. On accède par plusieurs marches au bureau du maître. Celui-ci règne sur la collectivité enfantine autant par sa position matérielle que par son ascendant personnel.
- La pendule est notée comme « indispensable », l’enseignement et les manœuvres étant strictement minutés.
- Les demi-cercles, encore appelés cercles de lecture, donnent aux écoles mutuelles un aspect typique et original. Ce sont, généralement, des cintres de fer, demi-circulaires, qui peuvent se lever ou s’abaisser à volonté. Parfois, la matérialisation est simplement portée sur le plancher : rainures, gros clous ou bandes tracées en forme d’arc.
- Les tableaux noirs ont été systématiquement utilisés pour le dessin linéaire et l’arithmétique. Ils mesurent 1 m de long sur 0,70 m de large et portent à leur partie supérieure un mètre mobile. On les place à l’intérieur de chaque demi-cercle.
- Les télégraphes. Lorsque le travail a lieu aux tables, l’écriture par exemple, on se sert de signaux permettant la liaison et la communication entre le moniteur général et les moniteurs particuliers : ce sont les télégraphes. Une planchette, fixée à l’extrémité supérieure d’un bâton rond de 1,70 m de haut, est installée à la première table de chaque classe, grâce à deux trous percés en haut et en bas du pupitre. Sur l’une des faces est inscrit le numéro de la classe (de 1 à 8) ; sur l’autre, la mention EX (examen) remplacée vers 1830 par COR (correction). Ces télégraphes sont transportables. On les déplace en cas d’augmentation ou de diminution du nombre d’élèves. Le maître et le moniteur général ont ainsi la composition exacte de chaque classe et le nombre de tables occupées par chacune d’elles. Dès qu’un exercice est terminé, le moniteur de classe fait tourner le télégraphe et présente vers le bureau la face EX. Tous les moniteurs font de même. Le moniteur général donne l’ordre de procéder à l’inspection et de faire des corrections éventuelles. Celles-ci achevées, on présente de nouveau le numéro de la classe. Et les exercices reprennent. Près des télégraphes se trouvent aussi, à l’occasion, les porte-tableaux.
- Les baguettes des moniteurs. Elles servent à indiquer sur les tables les lettres ou mots à lire, le détail des opérations à effectuer, les tracés à reproduire. Elles n’existent généralement dans les écoles rurales que grâce à la bonne volonté et à l’ingéniosité des moniteurs qui se les procurent dans les bois avoisinants.
- Le sable (pour l’écriture) puis les ardoises sont constamment utilisés dans toutes les disciplines. C’est là une innovation essentielle du mode mutuel, les autres écoles n’en faisant pas usage.
- Tableaux à la place de livres. La première raison est d’ordre pécuniaire, un seul tableau suffisant jusqu’à neuf élèves. Mais les motifs pédagogiques ne sont pas moindres. Le format permet une lecture aisée et un rangement facile. Le souci de présentation et de valorisation de certains caractères s’accompagne d’un souci de mise en page différent de ceux des manuels.
- Les livres sont réservés à la huitième classe, de même que les plumes, l’encre et le papier.
- Des registres, couramment en service, garantissent une saine gestion des établissements. L’un d’eux mérite une mention particulière : c’est « Le grand livre de l’école », avant tout un cahier- matricule. On y inscrit le nom, le prénom et l’âge de l’enfant, la profession et l’adresse des parents. Le maître y porte la date précise de l’entrée et de la sortie de chaque enfant, dans chaque classe, y compris pour les cours de musique et le dessin linéaire.
E. Le commandement
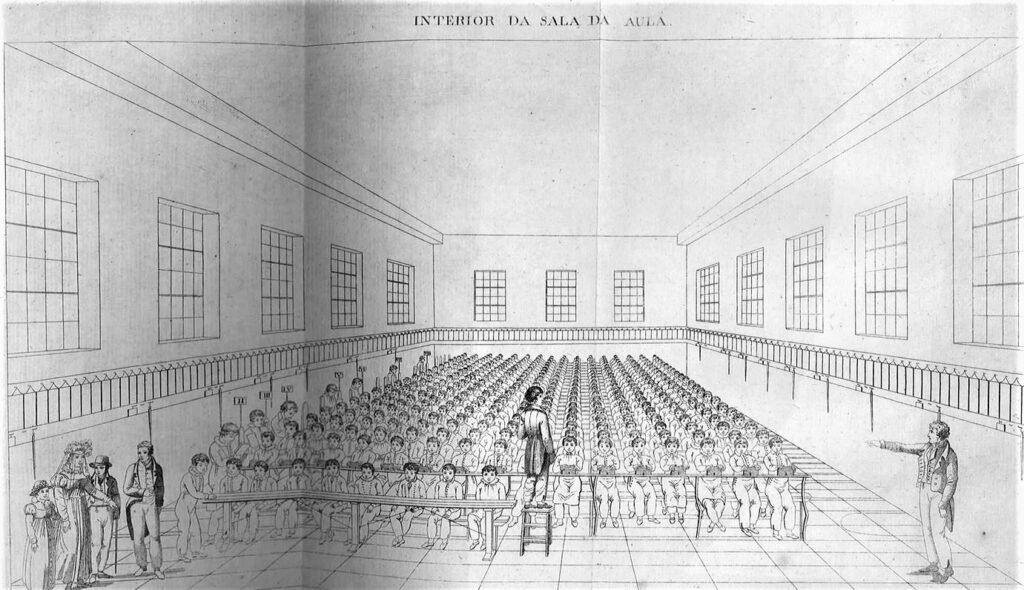
Pour conduire et faire évoluer correctement des dizaines ou centaines d’élèves et éviter toute perte de temps, les responsables de l’enseignement mutuel ont prévu des ordres précis, rapides, immédiatement compréhensibles :
- La voix intervient peu. Les injonctions transmises de cette manière s’adressent généralement aux moniteurs, parfois à une classe tout spécialement.
- La sonnette attire l’attention. Elle précède une information ou un mouvement à exécuter.
- Le sifflet est à double usage. Il permet des interventions dans l’ordre général de l’école, « imposer le silence », par exemple, et il commande le début ou la fin de certains exercices au cours de la leçon, «faire dire par cœur, épeler, cesser la lecture ». Le maître est seul habilité à s’en servir.
- Quant aux signaux manuels, ils ont été beaucoup utilisés. Destinés à évoquer l’acte ou le mouvement à accomplir, ils attirent le regard et doivent apporter le calme dans la collectivité.
Bellistes contre lancastériens
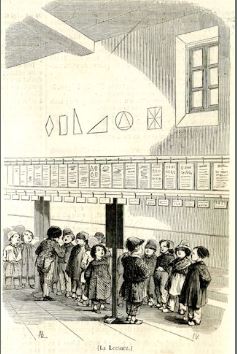
Alors que les deux écoles, celle de Bell et celle de Lancaster sont très proches l’une de l’autre, tant sur le plan des contenus d’enseignement que des méthodes et de l’organisation, elles s’opposeront violemment sur le rôle et la place de l’enseignement religieux. Toutes les autres divergences liées au programme sont affaires de goût, d’habitude ou de circonstances locales.
Comme le précisent Sylvian Tinembert et Edward Pahud dans Une innovation pédagogique, le cas de l’enseignement mutuel au XIXe siècle (Editions Livreo-Alphil, 2019), Lancaster, en tant qu’adepte du mouvement dissident quaker,
« reconnaît le christianisme mais professe que la croyance appartient à la sphère personnelle et que chacun est libre de ses convictions. Il prône également l’égalitarisme, la tolérance et défend l’idée que, dans le pays, il y a une telle variété de religions et de sectes qu’il est impossible d’enseigner toutes les doctrines. Par conséquent, il faut rester neutre, limiter cet enseignement à la lecture de la Bible, en évitant toute interprétation, et laisser l’instruction religieuse fondamentale aux diverses Églises en s’assurant que les élèves suivent les offices et les enseignements de la confession à laquelle ils appartiennent ».
N’empêche que Bellistes et Lancastériens vont s’écharper. Pour les Lancastériens, Bell n’a rien inventé et ne fait que décrire ce qu’il a vu en Inde. Pour les Bellistes, furieux que Lancaster trouve un répondant positif de la part de certains membres de la famille royale, il est dépeint comme le diable, un « ennemi » de la religion anglicane officielle, lui qui admet dans ses écoles des enfants de toutes les confessions !
9. Lorsque la méthode intéresse les Français
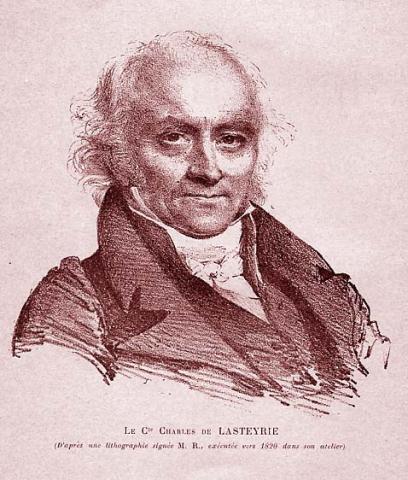

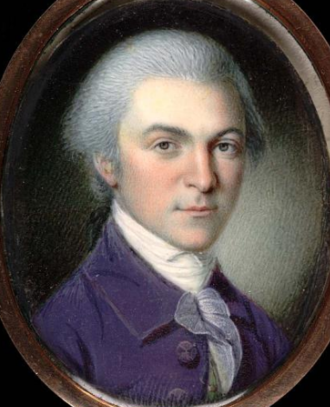
A Londres, l’association de Lancaster sera rejointe par de nombreuses personnalités de haut rang, aussi bien anglaises qu’étrangères. On y retrouve notamment le physicien genevois Marc Auguste Pictet de Rochemont (1752-1825), l’anatomiste et paléontologue français Georges Cuvier (1769-1832) et ses compatriotes, l’agronome Charles Philibert de Lasteyrie et le futur traducteur de Lancaster, l’archéologue Alexandre de Laborde (1773-1842).
Après la paix de 1814, de nombreux pays, notamment l’Angleterre, la Prusse, la France tout comme la Russie, rendus exsangues par les guerres napoléoniennes qui provoquèrent la perte de milliers de jeunes enseignants et cadres qualifiés sur les champs de bataille, font de l’éducation leur priorité notamment pour être à la hauteur de la révolution industrielle qui vient les bousculer.
A cela il faut ajouter que le nombre d’orphelins en Europe est devenu un problème majeur pour tous les États, d’autant plus que les coffres sont vides. Pour occuper les enfants de la rue, il faut des écoles, beaucoup d’écoles à construire avec très peu d’argent et beaucoup de professeurs… inexistants. Apprenant le succès retentissant de l’enseignement mutuel, plusieurs Français se rendent alors outre-Manche pour y découvrir la nouvelle méthode.
De Laborde en rapporte un « Plan d’éducation pour les enfants pauvres, d’après les deux méthodes (du docteur Bell et de M. Lancaster) », et Lasteyrie son « Nouveau système d’éducation pour les écoles primaires ». En 1815, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827), publie son livre sur le « Système anglais d’instruction de Joseph Lancaster ».
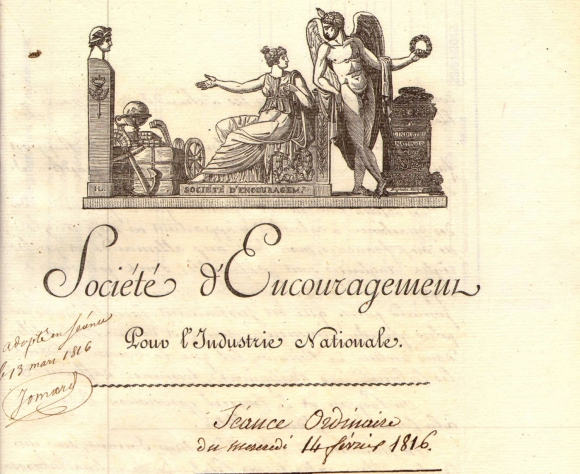
Depuis 1802, il existait à Paris la « Société d’encouragement pour l’industrie nationale », dont le secrétaire général était le linguiste Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) et dont Laborde était un des fondateurs. Sans surprise, Gérando avait été élevé par les Oratoriens et se destinait initialement à l’Église.
Le 1er mars 1815, Lasteyrie, Laborde et Gérando proposent à la Société d’encouragement la création d’une association qui aurait pour objet
« de rassembler et de répandre les lumières propres à procurer à la classe inférieure du peuple le genre d’éducation intellectuelle et morale le plus approprié à ses besoins ».

Dans son rapport présenté le 20 mars 1815 devant la Société d’encouragement, Gérando propose de solliciter le tout nouveau ministre de l’Intérieur Lazare Carnot (du 20 mars au 22 juin 1815) pour qu’il favorise « l’adoption des procédés propres à régénérer l’instruction primaire en France », c’est-à-dire le système d’enseignement mutuel.
L’intérêt politique et social ne sont pas seuls en jeu. L’économie française aussi doit tirer profit du développement de l’instruction. Qu’espérer, dit Carnot en 1815,
« si l’homme qui conduit la charrue est aussi stupide que les chevaux qui la tirent ? »
Gérando propose également la création d’une société dédiée spécifiquement à sa propagation en soulignant les avantages de la nouvelle approche : avantage économique d’abord, puisqu’il s’agit d’« employer les enfants eux-mêmes, les uns vis-à-vis des autres, comme auxiliaires de l’enseignement » et qu’un seul maître suffit pour 1000 élèves ; avantage éducatif ensuite, puisqu’il est possible « d’enseigner, en deux ans, tout ce que les enfants des conditions inférieures ont besoin de savoir et beaucoup plus qu’ils n’apprennent aujourd’hui par des procédés bien plus longs » ; avantage moral et social enfin, dans la mesure où les enfants « se pénètrent de bonne heure du sentiment du devoir, sentiment qui garantira un jour leur obéissance aux lois et leur respect pour l’ordre social ».
L’ingénieur-géographe et polytechnicien Edme-François Jomard (1777-1862), pour qui l’instruction du peuple est une obligation de la société vis-à-vis d’elle-même, ne disait rien d’autre: « Comment exiger d’infortunés, dénués de toutes lumières, qu’ils connaissent le pacte social et s’y soumettent ? ou comment pourrait-on, sans être insensé, compter sur leur invariable et aveugle soumission ? »
La Société d’encouragement valida alors les conclusions de son rapport en souscrivant pour une somme de 500 francs en faveur de l’association nouvelle et en décidant qu’elle mettrait à la disposition de celle-ci, outre son influence morale, les divers moyens d’exécution qui pouvaient lui appartenir.
10. Lazare Carnot à la manœuvre

Suite au Concordat entre Napoléon et le Vatican, l’Empereur, par son décret du 15 août 1808 sur l’éducation, décide que les écoles doivent désormais suivre les « principes de l’Église catholique ».
Les « Frères des écoles chrétiennes » (ou Lasalliens), partisans inconditionnels de « l’enseignement simultané », théorisé par leur fondateur Jean-Baptiste de La Salle, s’occuperont désormais de l’enseignement primaire et formeront les instituteurs.
Dispersés lors de la Révolution, ils reprennent leurs fonctions en 1810. Encouragés à se développer pour contrer l’influence des jésuites, autorisés en 1816 à revenir en France, ils se développent rapidement dans toute la France.
Mais la situation de l’éducation est pitoyable. C’est ce que constatent des hauts fonctionnaires français lorsqu’ils se rendent dans les territoires annexés par l’Empire, notamment l’Allemagne du Nord et la Hollande. La comparaison avec la France les fait rougir de honte.
« Nous aurions peine, écrit en 1810 le naturaliste Georges Cuvier dans son rapport, à rendre l’effet qu’a produit sur nous la première école primaire où nous sommes entrés en Hollande. »
Enfants, maîtres, local, méthodes, enseignement, tout est d’une tenue parfaite : « Plusieurs préfets ont assuré qu’on ne trouverait pas aujourd’hui dans leur département un seul jeune garçon qui ne sût lire et écrire. » Devant un tel contraste, qui ne tournait pas à l’avantage du conquérant, l’Université impériale, comme la Rome antique, se mit à l’école du pays conquis. Dans son décret du 15 novembre 1811 l’Empereur décide : « Le conseil de notre Université Impériale nous présentera un rapport sur la partie du système établi en Hollande pour l’instruction primaire qui serait applicable aux autres départements de notre Empire. »
L’Empereur abdique le 4 avril 1814 avant qu’une décision ait été prise pour régénérer les « petites écoles » françaises. Du moins l’Université Impériale avait-elle, par ses rapports, étalé au grand jour leur misère, attirant sur elles l’attention de l’opinion.
Nommé ministre de l’Intérieur, et donc en charge de l’Education lors des Cent-Jours, Lazare Carnot est persuadé du potentiel d’excellence de « l’enseignement mutuel ».
Il crée, le 10 avril 1815, un Conseil d’industrie et de bienfaisance, à la première séance duquel il donne lui-même communication du rapport de Gérando ;

Le 27 avril 1815, Lazare Carnot fait un rapport à l’Empereur où il dit :
« Il y a en France, 2 millions d’enfants qui réclament l’éducation primaire, et, sur ces 2 millions, les uns en reçoivent une très imparfaite, tandis que les autres en sont complètement privés. »
Il recommande alors l’enseignement mutuel :
« Elle a pour objet de donner à l’éducation primaire le plus grand degré de simplicité, de rapidité et d’économie, en lui donnant également le degré de perfectionnement convenable pour les classes inférieures de la société et aussi en y portant tout ce qui peut faire naître et entretenir dans le cœur des enfants le sentiment du devoir, de la justice, de l’honneur et le respect pour l’ordre établi ».
Il fait signer le même jour à l’empereur le décret suivant :
« Article 1er. – Notre ministre de l’Intérieur appellera près de lui les personnes qui méritent d’être consultées sur les meilleures méthodes d’éducation primaire. Il examinera ces méthodes, décidera et dirigera l’essai de celles qu’il jugera devoir être préférées.
« Art. 2. – Il sera ouvert, à Paris, une École d’essai d’éducation primaire, organisée de manière à pouvoir servir de modèle et à devenir école normale, pour former des instituteurs primaires.
« Art. 3. – Après qu’il aura été obtenu des résultats satisfaisants de l’École d’essai, notre ministre de l’Intérieur nous proposera les mesures propres à faire promptement jouir tous les départements des nouvelles méthodes qui auront été adoptées ».
Pour Carnot, en rupture avec ceux qui ne pensaient qu’en termes de philanthropie, il n’y avait plus d’enfants riches ou pauvres. En tant que citoyens, tous devraient désormais pouvoir disposer de la meilleure éducation possible.
Le conseil consultatif constitué par Carnot comprend ses amis Laborde, Jomard, l’abbé Gaultier, puis Lasteyrie et Gérando, c’est-à-dire les promoteurs mêmes ou les premiers fondateurs de la Société en formation.
Ainsi naîtra, le 17 juin 1815 (c’est-à-dire la veille de la défaite de Waterloo) la Société pour l’instruction élémentaire (SIE), toujours sous l’impulsion de Carnot bien décidé à gagner la guerre pour l’instruction. La première assemblée générale de la SIE se tient dans les locaux de la Société d’encouragement. À sa tête, on retrouve plusieurs protagonistes de la commission ministérielle : Jomard devient l’un des secrétaires de la nouvelle société, aux côtés de Gérando (président), Lasteyrie (vice-président) et Laborde (secrétaire général).

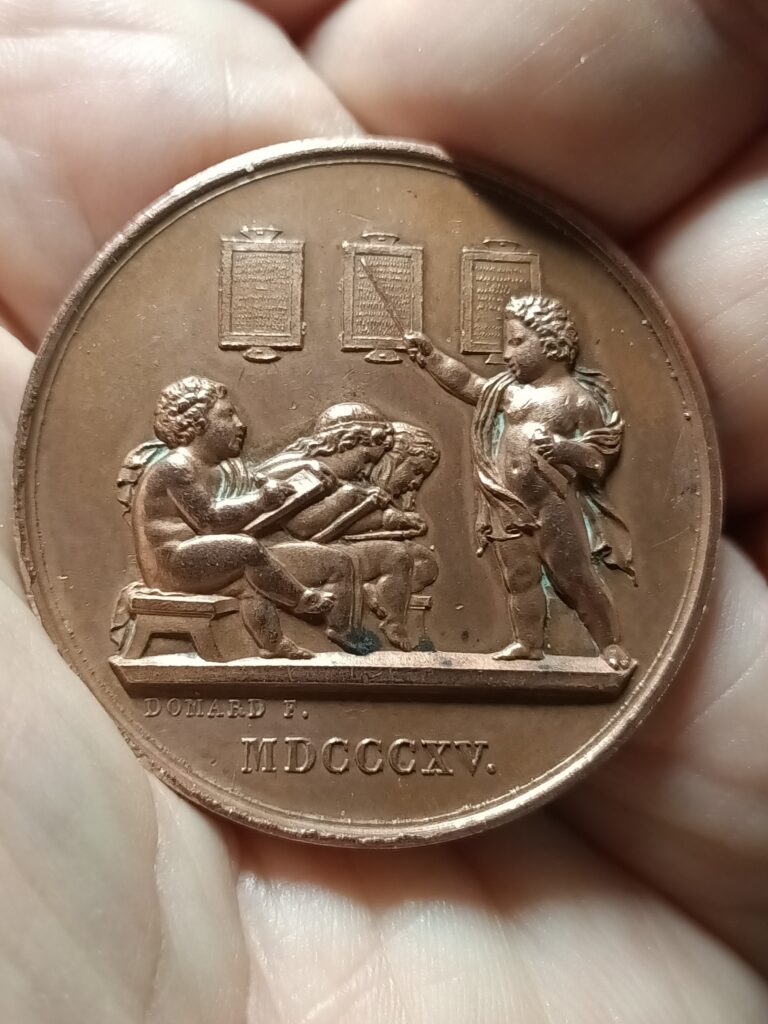
Avant l’ordonnance de 1816, le nombre d’enfants qui suivaient les petites écoles était de 165 000 dans toute la France, et il se trouve porté à 1 123 000 à la fin de 1820.
Lazare Carnot a clairement voulu pérenniser son offensive lancée durant les Cent-Jours en faveur de la propagation de l’enseignement mutuel à travers le pays et, ce faisant, en participant au développement rapide de l’instruction de tous les enfants de la Patrie.
Après sa création, les souscriptions pour la SIE affluent, et en peu de temps 150 noms s’ajoutent à ceux des fondateurs pour promouvoir et organiser l’enseignement mutuel en France. L’un de ces souscripteurs est forcément Lazare Carnot.
Au cours de sa première année d’existence, la SIE recueille l’adhésion de près de 700 membres, dans un premier temps des enseignants de l’École polytechnique (Ampère, Berthollet, Chaptal, Guyton de Morveau, Hachette, Mérimée, Thénard), et ensuite une trentaine d’anciens élèves, dont environ la moitié est issue de la première promotion (1794) de l’École polytechnique. Parmi ces derniers, un camarade de Jomard à l’Ecole des géographes, Louis-Benjamin Francœur, professeur d’algèbre supérieure à la Faculté des sciences de Paris, des camarades de la campagne d’Egypte ou encore Chabrol de Volvic, préfet de la Seine depuis 1812.
Tous n’ont qu’un seul espoir : que les méthodes géniales de Monge, brigades et enseignement mutuel, diminuées et interdites depuis que Napoléon a transformé Polytechnique en une simple école militaire sous la direction du mathématicien Pierre-Simon Laplace (1749-1827), puissent profiter au plus grand nombre et organiser un redressement national.
De Paris, la sollicitude de la SIE s’étend à la province ; elle y encourage la fondation de sociétés filiales, à qui elle offre « de leur envoyer des maîtres, de leur communiquer les renseignements dont elles pourraient avoir besoin, de leur donner au prix coûtant les tableaux et les livres… ».
La SIE se mobilise également pour l’éducation publique des filles (art. 10). Elle met sur pied, pour s’occuper d’elles, un comité de dames : présidente, la baronne de Gérando ; vice-présidente, la comtesse de Laborde. Des filles, le mouvement gagne les adultes sans instruction, si nombreux alors.
Le 1er mai 1816 la Société créait une commission pour l’établissement d’écoles d’adultes. Elle s’occupe aussi des casernes, dont on veut faire des écoles pour militaires ; des prisons, prisons d’enfants surtout; des habitants des colonies, que l’on pense élever par le développement de l’instruction.
Enfin les membres de la Société, attribuant une valeur humaine et générale à leur mission, rêvent de fonder des filiales à l’étranger. En novembre 1818, Laborde demande la création d’un comité spécial pour les écoles étrangères.

La Société enfin, ne bornant pas son activité à la simple création d’écoles, organisait des inspections, des examens. Elle assurait la publication d’ouvrages (ouvrages relatifs à la méthode mutuelle, livres élémentaires de lecture, de grammaire et d’arithmétique). Elle distribuait des récompenses aux meilleurs maîtres et moniteurs. Elle demandait aux maîtres, après promulgation de l’ordonnance du 29 juillet 1818 autorisant les sociétés de Caisse d’Epargne, de confier à ces Caisses une partie de leurs gages pour assurer leurs vieux jours. Donnant l’exemple, elle déposait à la Caisse des fonds pour les maîtres des écoles créées par elle.
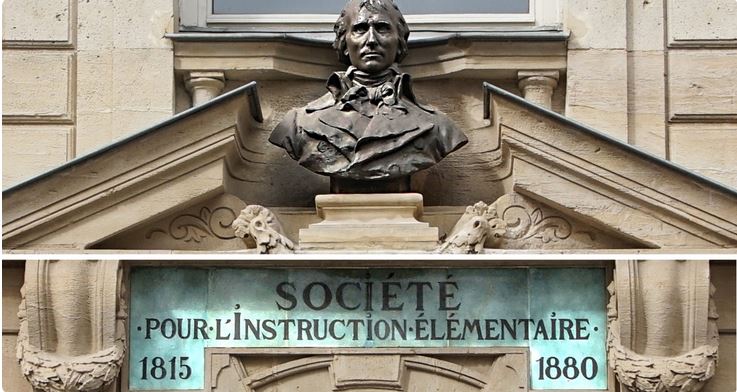
La SIE, dont le siège est un local spécialement construit pour elle, situé au 6, rue du Fouarre à Paris 5e, reste aujourd’hui la plus ancienne et la plus grande association laïque d’enseignement primaire que nous possédons en France.
11. Le projet pilote de la rue Saint-Jean-de-Beauvais
Après son voyage en Angleterre, Jomard, dont le portrait figure en médaillon sur la façade de la SIE est lui aussi acquis au nouveau système. Faisant part de ses « réflexions sur l’état de l’industrie anglaise », il écrit, après s’être enthousiasmé pour diverses inventions observées outre-Manche :
« Il y a cependant quelque chose de plus extraordinaire encore : ce sont des écoles sans maîtres : rien, pourtant, n’est plus réel. On sait à présent qu’il existe des milliers d’enfants enseignés sans maître proprement dit, et sans qu’il n’en coûte rien à leur famille, ni à l’État : admirable méthode qui ne peut tarder à se propager en France. »
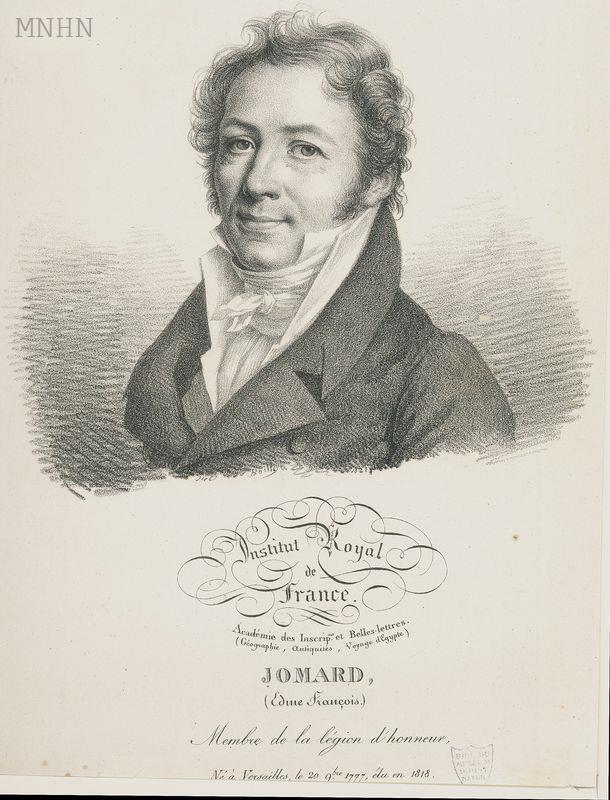
Polytechnicien, Jomard est l’homme idéal pour piloter l’organisation matérielle de l’école d’essai, s’attachant notamment à faire réaliser le mobilier et imprimer les supports pédagogiques conformément aux principes anglais. Il supervise également la formation au rôle de « moniteur » d’un petit noyau d’élèves – ils sont une vingtaine – avant l’ouverture en septembre 1815 de l’école proprement dite, prévue pour 350 élèves : une modalité qui n’est pas sans rappeler les « chefs de brigade » de la première promotion de l’École polytechnique.
Cependant, très rapidement, les membres de la SIE se rendent à l’évidence qu’il faut former des formateurs. Les Anglais accueillent alors plusieurs Français pour les former à l’enseignement mutuel. Un pasteur cévenol, François Martin (1793-1837), après sa formation comme « moniteur » en Angleterre, est appelé par Lasteyrie pour diriger la première école mutuelle, qui ouvre ses portes le 13 juin 1815, rue Saint-Jean-de-Beauvais à Paris. Il s’agit de l’école modèle qui doit permettre l’ouverture d’autres écoles mutuelles grâce à la formation de « moniteurs » compétents. Rapidement, elle ne peut plus faire face à la demande de centaines de communes qui envisagent d’y envoyer l’un des leurs pour se former à la nouvelle méthode.
Le pasteur Paul-Emile Frossard, lui aussi formé par les Anglais, prend la tête d’une école parisienne rue Popincourt, Bellot en dirige une autre. En juillet, Martin rend son rapport. La classe modèle accueille une quinzaine d’élèves destinés à devenir moniteurs et directeurs d’écoles élémentaires qui comptent jusqu’à 350 enfants. Martin rapporte qu’en six semaines, ils lisent, écrivent, calculent et « savent exécuter les mouvements qui forment la partie gymnastique du nouveau système d’éducation ».
12. Enseignement mutuel et chant choral
Or, comme le documente amplement Christine Bierre dans son article « La musique et formation du citoyen à l’ère de la Révolution française » (1990),
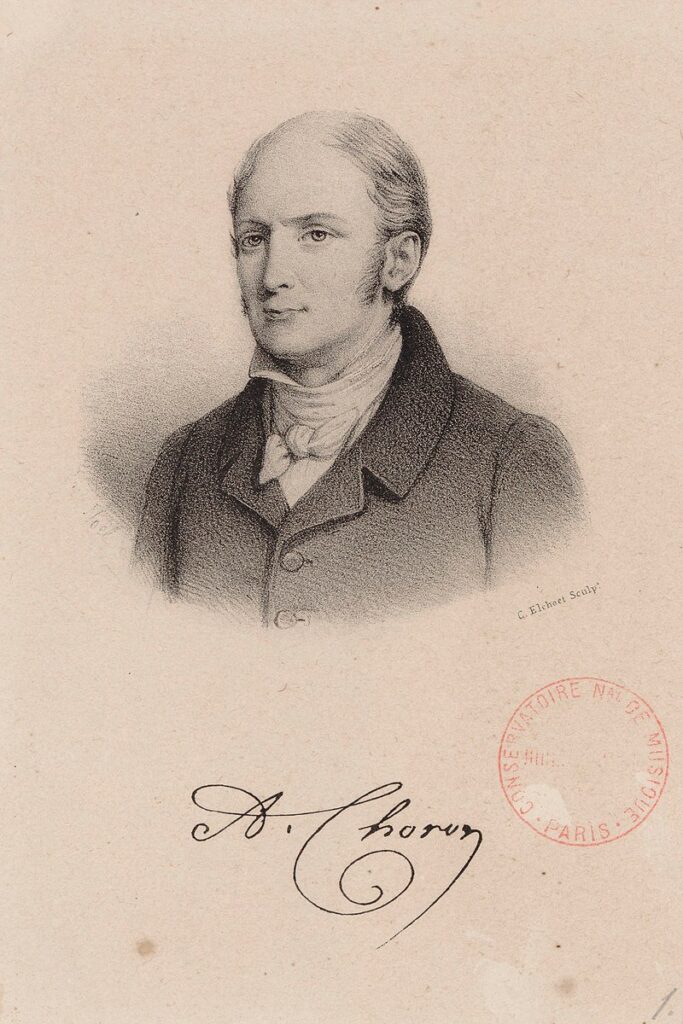
« C’est à cette école de la rue Saint-Jean-de-Beauvais, sous la direction d’une Commission comprenant Gérando, Jomard, Lasteyrie, Laborde et l’abbé Gaultier, que fut testée pour la première fois, l’application de l’enseignement mutuel à l’apprentissage du solfège et du chant.
Alexandre Choron, qui depuis 1814 avait ouvert deux écoles de musique de garçons et de filles, faisait également partie de la Commission.
Il n’est donc pas étonnant de découvrir que ce fut à l’initiative du baron de Gérando, que l’idée d’introduire le chant dans l’instruction primaire a été adoptée. ‘Quant Monsieur le baron de Gérando vous a fait la proposition d’introduire le chant élémentaire dans les écoles de premier degré’, dit Jomard dans un rapport présenté au Conseil d’administration de la Société pour l’Enseignement mutuel, ‘vous avez tous été frappés de la justesse des vues développées par notre collègue (…) Il a fait voir l’influence heureuse que pourrait avoir une pareille pratique, et la connexion réelle qui existe entre un bon emploi du chant et le perfectionnement de la morale, but final de l’instruction et de tous nos efforts. Non seulement, l’application de l’enseignement mutuel à la musique était révolutionnaire en elle-même, mais ce qui l’était tout autant, c’est le fait que les enfants apprenaient à lire et à écrire, de façon presque aussi intensive. Les enfants étudiaient le chant, à raison de quatre à cinq heures par semaine ! »
En réalité, c’est Lazare Carnot lui-même qui a voulu introduire la musique dans les écoles d’enseignement mutuel. Dans cette intention, il rencontre plusieurs fois Alexandre Choron, qui réunit un certain nombre d’enfants et leur fait exécuter en sa présence plusieurs morceaux appris en fort peu de leçons. Carnot connaît Wilhem depuis dix ans. Il entrevoit donc la possibilité d’introduire, par lui, le chant dans les écoles, et tous deux visitent ensemble celle de la rue Saint-Jean-de-Beauvais, école pilote gratuite d’enseignement mutuel ouverte à Paris à trois cents enfants.
L’article récent de Michael Werner, « Musique et pacification sociale, missions fondatrices de l’éducation musicale (1795-1860) » dans la revue Gradhiva (N° 31/2020), vient en écho confirmer les recherches initiées par Christine Bierre en 1990.

Extrait :
« L’un des domaines où les résultats de la pédagogie mutualiste sont bien visibles est précisément l’éducation musicale. Plusieurs acteurs y ont joué un rôle décisif et méritent qu’on s’y attarde un moment. Le premier est Guillaume-Louis Bocquillon, dit Wilhem. Fils d’officier et lui-même issu d’une formation militaire, il s’est ensuite consacré à la composition et à l’enseignement musicaux, en particulier au lycée Napoléon (ultérieurement collège Henri-IV). Son ami Pierre Jean de Béranger le met en contact avec Joseph-Marie de Gérando et François Jomard, grands animateurs de la SIE. Par leur intermédiaire, il prend connaissance de l’enseignement mutuel et comprend immédiatement les apports de cette méthode à l’éducation musicale. En 1818, la municipalité de Paris lui permet de monter une première expérience à l’école élémentaire de la rue Saint-Jean-de-Beauvais.
Wilhem élabore une méthode, le matériel pédagogique nécessaire (sous forme de tableaux) et instruit les élèves moniteurs choisis. Les résultats sont, aux dires de Jomard, spectaculaires. Au terme d’un enseignement de quelques mois, les élèves ont non seulement acquis les notions de base du solfège et de la notation musicale, les gammes chromatiques, les intervalles et mesures, mais exécutent aussi des chants collectifs à plusieurs voix (Jomard 1842 : 228 sq.).
La réussite conduit la SIE à proposer au préfet et au ministre de l’Intérieur d’introduire la musique dans l’enseignement des écoles élémentaires de la ville de Paris, ce qui sera officiellement entériné en 1820. Wilhem lui-même est nommé professeur titulaire d’enseignement musical à Paris et les cours de musique se généralisent dans un grand nombre d’écoles de la ville avant de se répandre dans les départements et en région. En même temps, la municipalité ouvre deux écoles normales chargées de former les futurs professeurs de chant.
Le deuxième acteur à intervenir très tôt dans le débat est le compositeur Alexandre Choron. Membre, comme Jomard et Francœur, de la première promotion de l’École polytechnique (1795), compositeur et ami d’André Grétry, il s’est dès 1805 préoccupé du dépérissement du chant choral consécutif à la suppression des maîtrises. Adversaire du Conservatoire dont il critique l’académisme et le désintérêt pour l’enseignement du chant choral, il est chargé par le ministère en 1812 d’une mission de « réorganisation du chœur et des maîtrises de musiques des églises de France ». Il élabore une méthode d’enseignement appelée « méthode concertante », mais reste également attaché à la vocation sociale de la musique chorale. Choron fait par ailleurs partie des membres fondateurs de la SIE en 1815, signe de son engagement dans les questions éducatives. Pendant la Restauration, il se tourne davantage vers les chants religieux qu’il considère comme le cœur historique de la pratique de la chorale.
(…) Enfin, il fonde, avec l’appui du roi l’Institution royale de musique classique et religieuse, concurrençant avec succès le Conservatoire dans l’enseignement de l’art vocal. Pour le grand public, il fait exécuter, à grand renfort de chanteurs issus de son école, des oratorios, requiem et cantates dans quelques églises spacieuses, assurant ainsi à la musique sacrée une nouvelle présence sur la scène parisienne. Pour certains de ces concerts, il lui arrive de mobiliser des élèves chanteurs des écoles élémentaires et des écoles des pauvres qu’il n’a jamais cessé de suivre tout au long de sa carrière.
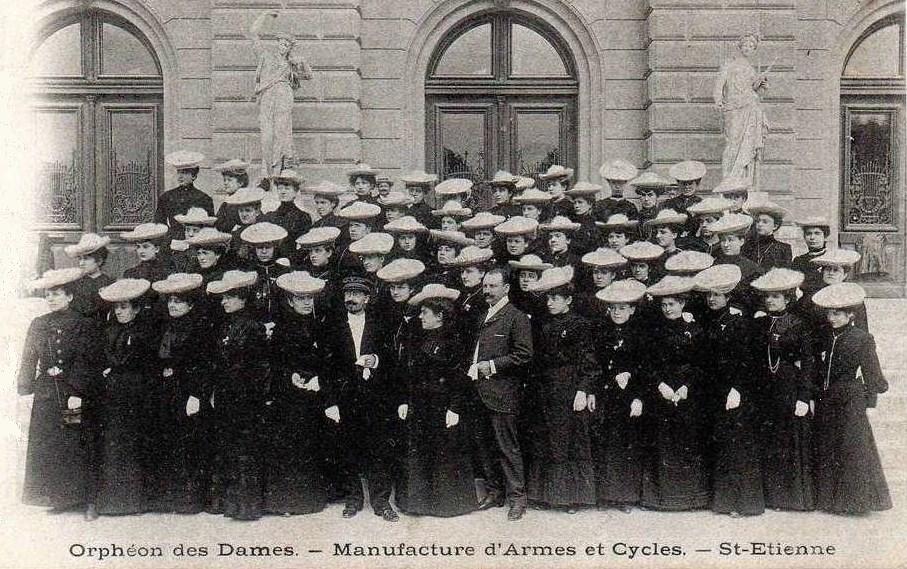
« (…) Ce qui a favorisé cette expansion de l’enseignement de la musique à destination des jeunes et des couches populaires à partir de 1820 était bien une volonté politique partagée par un large spectre de responsables et d’intervenants. Du côté des libéraux qui constituaient le noyau de la SIE, on continuait de s’inscrire dans la mission émancipatrice de l’éducation, fixée par la Convention. En pointant à la fois la formation intérieure de l’âme et l’épanouissement d’une conscience collective, la musique, et en particulier le chant, devient un terrain de choix pour l’éducation populaire. Les libéraux insistent donc sur les bienfaits moraux de la musique. Ainsi, dans sa proposition d’introduire le chant dans les écoles primaires, Gérando remarque-t-il : ‘Ceux d’entre nous qui ont visité l’Allemagne ont été surpris de voir toute la part qu’a une musique simple aux divertissements populaires et aux plaisirs de famille, dans les conditions les plus pauvres, et ont observé combien son influence est salutaire sur les mœurs.’
« Et Joseph d’Ortigue constate de façon lapidaire : ‘Un peuple qui chante est un peuple content, et par conséquent un peuple moral.’ Cette mise en avant des bienfaits sociaux de l’activité musicale correspond bien à l’idée d’une ‘éducation universelle’, héritée des Lumières et au fondement des pédagogies de Lancaster en Angleterre ou de Johann Heinrich Pestalozzi en Suisse.
« Le chant, après l’essai fait à l’école St-Jean-de-Beauvais en 1819, pénètre très rapidement dans toutes les écoles mutuelles. Wilhem est à la fois le créateur et l’artisan du développement de cet enseignement qui gagne bientôt les cours d’adultes et d’apprentis. Des réunions périodiques d’enfants initiés à la musique vocale furent organisées. Ainsi naquit la première œuvre post-scolaire française : l‘Orphéon qui, après Wilhem, compte parmi ses directeurs Charles Gounod et Jules Pasdeloup. »
Dans un discours de 1842 devant la SIE, Hippolyte Carnot (fils de Lazare Carnot) affirme que Wilhem « a élevé la musique au rang d’une institution civique » et que « l’ennoblissement » de l’âme individuelle doit s’accomplir dans le nouvel ordre collectif de la nation réunie.
13. Jomard, Choron, Francoeur et savoirs « élémentaires »
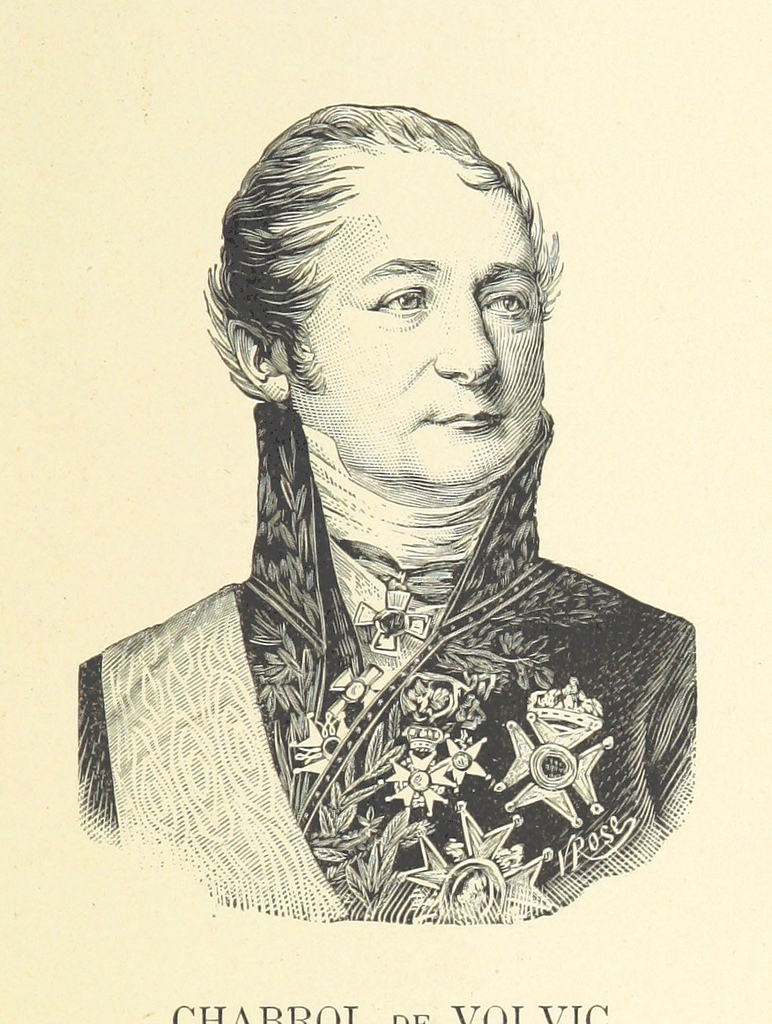
L’article très complet de Renaud d’Enfert, publié sur le site de la Société de la bibliothèque et de l’histoire de l’Ecole polytechnique (SABIX), permet de compléter le tableau en faisant un gros plan sur l’action de Jomard et Francoeur dont les portraits figurent d’ailleurs en médaillon sur la façade du siège de la SIE rue du Fouarre à Paris.
Dès le début de la Seconde Restauration, la SIE reçut l’adhésion et l’appui du préfet de la Seine, Gaspard Chabrol de Volvic (1773-1843). Ce dernier va nommer dès l’été 1815 Jomard, le linguiste en contact avec les frères Humboldt qui a fait partie de l’éphémère commission sous Carnot et qui l’a protégé pendant les Cent-Jours, « chef de bureau d’instruction publique et arts », poste qu’il occupe jusqu’en 1823.
Par un arrêté du 3 novembre 1815, Volvic, afin d’arrêter « les mesures nécessaires pour étendre le bienfait de l’instruction à toutes les familles pauvres domiciliées dans l’étendue de la préfecture » et de développer « le nouveau système d’instruction élémentaire » dans l’ensemble du département de la Seine, crée, « pour étendre les bienfaits de l’instruction gratuite au département de la Seine » un comité de onze personnes, et y fait entrer tous les membres influents de la SIE (Jomard, Gérando, Laborde, Doudeauville, Lasteyrie, Gaultier, etc.).
Dans ces fonctions, Jomard est chargé de trouver des sites pour établir de nouvelles écoles. Celles-ci se multiplient rapidement dans la capitale et ses environs : en 1818, il comptabilise 18 écoles mutuelles gratuites et 32 payantes couvrant l’ensemble des arrondissements de la capitale, ainsi que 13 écoles dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. De ce travail, il tire son « Abrégé des écoles élémentaires » (1816), sorte de guide pratique dans lequel il réunit tout ce que doit savoir, du point de vue de l’organisation matérielle, tout citoyen décidé à fonder une école mutuelle.
Sur le plan pédagogique, Jomard est l’auteur, en 1816, d’une méthode de lecture réalisée en collaboration avec le compositeur et musicien Alexandre Choron qui avait publié dès 1802 une méthode pour apprendre à lire et à écrire, et l’abbé Gaultier, un pédagogue qui avait développé une méthode d’enseignement sous le nom de « jeux instructifs » et s’était rendu à Londres pour étudier les méthodes anglaises.

Conçue pour la nouvelle école normale élémentaire de la rue Saint-Jean-de-Beauvais, où Choron a été nommé comme enseignant de musique, elle rompt avec la méthode traditionnelle d’épellation. Au lieu de dire « b-o-n = bon », elle part des sonorités musicales de la langue pour dire « b-on = bon ».
Jomard fait également paraître, en 1821-1822, une « Arithmétique élémentaire », destinée à pallier les faiblesses constatées de la méthode d’arithmétique de Lancaster : celle-ci est en effet accusée de « faire contracter aux enfants une simple habitude routinière et mécanique » au lieu de servir « à fortifier leur attention et à les former au raisonnement ». Dans l’intervalle, il a mis au point avec Francœur et Lasteyrie, au sein d’une « Commission de calligraphie » de la SIE, les principes qui doivent guider l’apprentissage de l’écriture dans les écoles mutuelles, une écriture voulue « nationale », afin de remplacer les modèles anglais.

Pour sa part, Louis-Benjamin Francoeur (1773-1849) fournit, selon Jomard, « une longue suite de rapports lumineux sur les traités d’arithmétique, de poids et mesures, de chant et d’art musical, de dessin et de géométrie, qu’il serait bien trop long de rapporter ou de citer ».
Comblant un manque, Francœur publie en 1819 « Le dessin linéaire », une méthode de dessin basée sur le dessin à main levée des figures géométriques qui rompt avec les modalités traditionnelles d’enseignement et d’apprentissage du dessin, inspirées de pratiques académiques.
Pour Jomard et Francoeur, il s’agit, avec l’enseignement mutuel, d’élargir le nombre des matières de l’instruction primaire au-delà du traditionnel « lire, écrire, compter » : outre le dessin, des matières comme le chant, la gymnastique, la géographie ou la grammaire font ainsi leur apparition dans les écoles primaires via l’enseignement mutuel. Le dessin linéaire n’en apparaît pas moins comme un savoir élémentaire à part entière, au même titre que la lecture, l’écriture et l’arithmétique.
Présentant la méthode de Francœur à la Société d’encouragement, Jomard déclare ainsi :
« L’utilité que l’industrie en peut retirer un jour est si grande et si visible, qu’il serait superflu d’y insister. Ce n’est pas sans raison qu’on a regardé ce résultat comme aussi précieux pour le peuple, que la connaissance de la lecture et de l’écriture. »
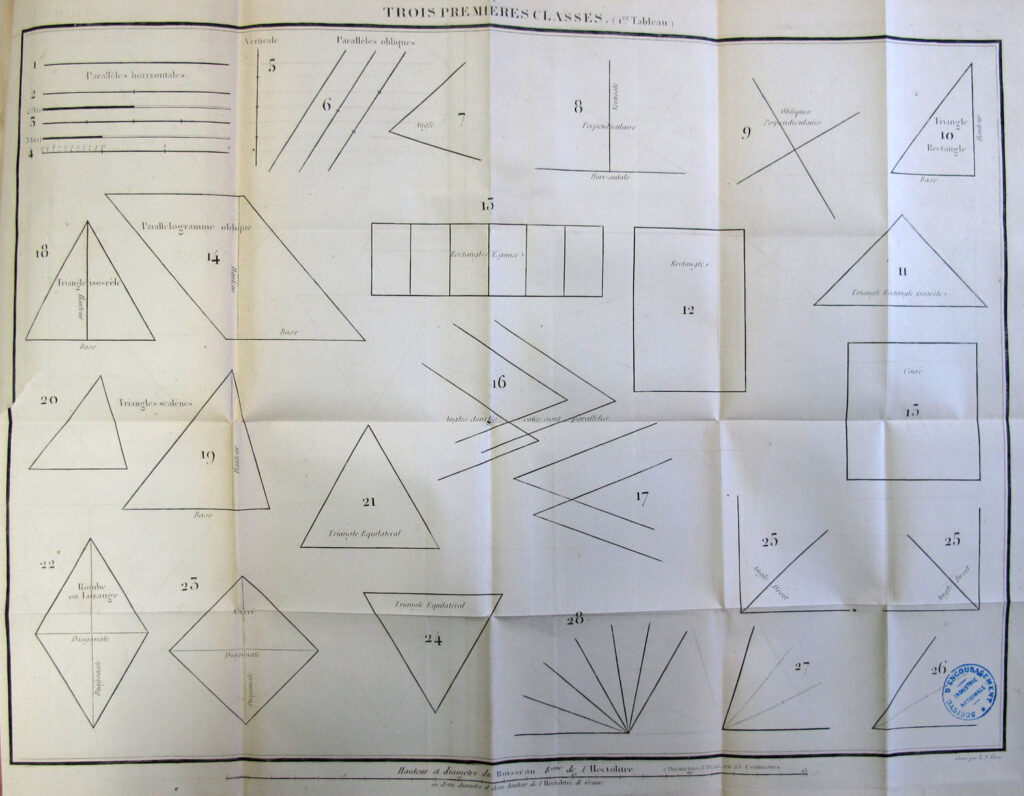
Enfin, pour Jomard, l’apprentissage généralisé de la lecture, de l’écriture, du calcul, du dessin linéaire et du chant, est le préalable obligé à l’éducation scientifique du peuple :
« On a dans ces derniers temps, avec grande raison, insisté sur l’utilité de l’enseignement des éléments des sciences physiques et mathématiques à la classe ouvrière. C’est de là que dépend l’avancement de l’industrie et de l’agriculture, qui, malgré tous leurs progrès, sont encore arriérées chez nous sous plusieurs rapports. Ce n’est que par la possession de ces notions élémentaires que les ouvriers perfectionneront leurs procédés, leurs moyens, leurs instruments, leurs produits, et pourront devenir d’habiles contremaîtres et de bons chefs d’ateliers. Mais comment arriver à ce résultat, quand la masse de la population est encore si ignorante.
« Comment, sans l’art de lire et d’écrire, pourrait-elle, non pas comprendre un seul mot des arts chimiques et mécaniques, mais seulement en sentir l’avantage et consentir à se livrer à des études pénibles ? Quoi ! 15 millions de Français et plus peut-être, ne savent pas faire les deux premières règles de l’arithmétique, et l’on se flatterait de propager parmi eux les premiers principes de la mécanique et de la géométrie ! La base de cette amélioration est évidemment l’instruction primaire rendue plus générale ou même universelle. »
14. Rayonnement au niveau national
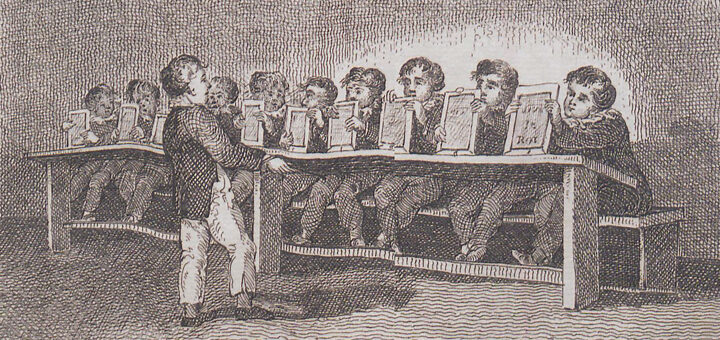
Les résultats de l’enseignement mutuel sont spectaculaires et rapides, qu’il s’agisse de la durée des apprentissages ou de la qualité des acquis. Alors que dans les écoles des Frères il fallait 4 années pour apprendre à lire, ce temps est réduit à une année et demie dans les établissements mutuels !
Les Français de 1815, à l’enthousiasme si prompt, et à l’imagination si vive, virent dans ce système d’enseignement, une véritable panacée. Il présentait certes d’incontestables avantages. D’abord il est économique puisqu’il exige peu de maîtres, et permet d’instruire à peu de frais un nombre considérable d’enfants. On estime qu’il suffisait de 4000 à 5000 fr. par an pour entretenir une école de 1000 enfants : 4 francs par élève ! Jamais l’instruction n’aura été donnée à si bas prix. Il permettait aussi d’assurer un développement rapide de l’enseignement primaire puisque l’on n’était plus arrêté désormais par la pénurie de maîtres. Chiffres à l’appui, on calculait qu’il suffirait d’une douzaine d’années pour étendre à la France entière les bienfaits de l’instruction primaire !
A ces avantages indiscutables, ceux qui avaient visité l’Angleterre en 1815 ajoutaient des arguments qualitatifs. Ils estimaient l’enseignement des instructeurs supérieur à celui des maîtres :
« Il ne sait pas sa leçon mieux que le maître, écrivait Laborde, mais il la sait autrement ».
L’enfant instructeur (moniteur) a plaisir à communiquer à ses camarades ses connaissances nouvellement acquises, il fait son travail
« avec autant de charme qu’un précepteur y trouve de dégoût » (Laborde).
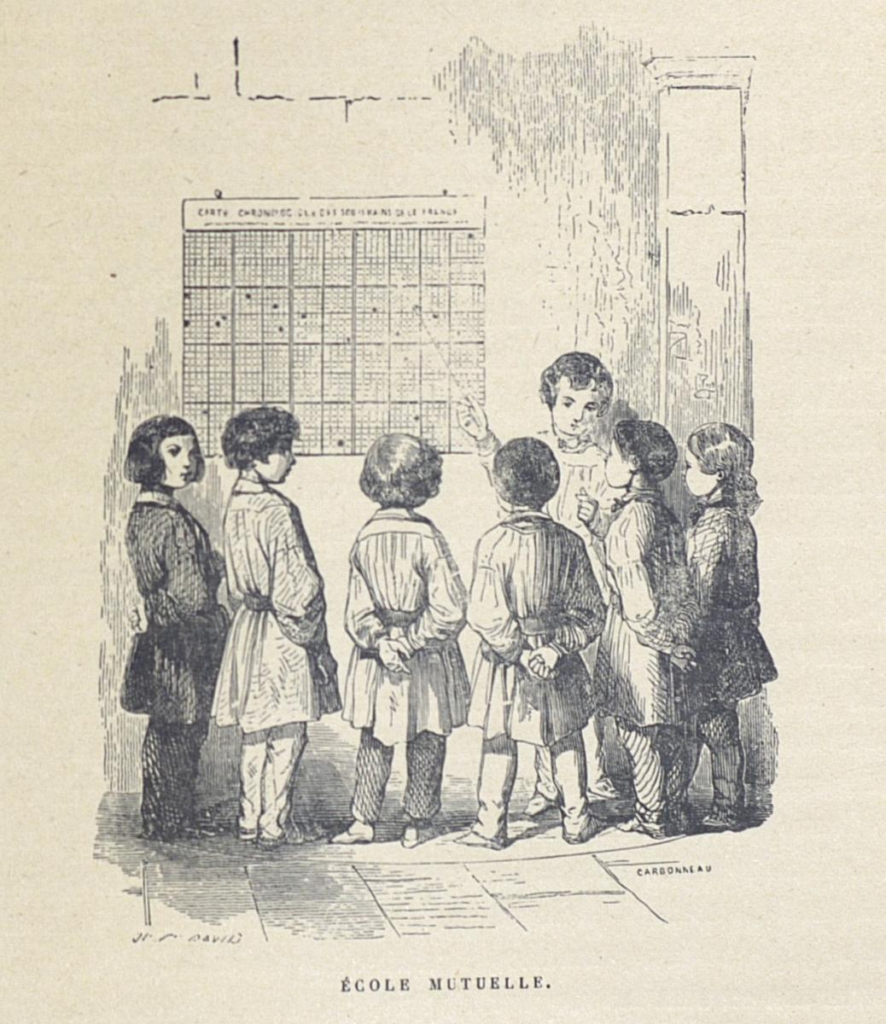
D’autre part, étant enfant lui-même, il connaît mieux que le maître les difficultés de la tâche, les embûches de la leçon, sur lesquelles il vient juste de trébucher. Il conduira donc ses camarades plus lentement, plus sûrement, sera pour eux un meilleur guide.
Mais l’enseignement ne sera pas seul à profiter du système mutuel ; la discipline de l’école et la morale y trouveront aussi leur compte. L’enfant, soumis à son camarade, lui obéira plus volontiers qu’au maître, puisque le jeune instructeur ne doit sa supériorité qu’à son mérite. Enfin l’enfant, avec son camarade qui le connaît bien puisqu’il vit avec lui, n’aura pas, comme avec le maître, la ressource de mentir pour cacher ses pensées intimes ou ses fautes ; et la dissimulation, fléau social que l’on apprenait dès les bancs de l’école, disparaîtra ainsi des établissements mutuels. Et Laborde concluait son apologie de la méthode par ce chant de triomphe : dans les nouvelles écoles,
« le travail est pour eux un jeu, la science une lutte, l’autorité une récompense ».
Les bienfaits de cet enseignement ne devaient d’ailleurs pas se limiter au cadre de l’école : les enfants rentrés chez eux exerçaient à leur tour sur leurs parents une heureuse influence ; ils devenaient des « missionnaires », à la fois de la morale et de la vérité dans leur famille.
« Et que de mauvais esprits n’aillent pas dire qu’il s’agit là de rêveries et d’utopies d’idéalistes ! » écrit Gontard en 1956. Des preuves existent, et irréfutables, de la valeur de la méthode. Regardez l’Ecosse. C’était à la fin du XVIIe siècle une terre de mendicité et de misère, vivant sans loi, sans religion, sans morale, les hommes buvant, les femmes blasphémant, tous se battant. En 1815, grâce à la baguette magique de l’école mutuelle, l’Ecosse est devenue un paradis.
«Il n’est pas rare de trouver en Ecosse un berger lisant Virgile… mais il est presque inconnu d’y rencontrer un malfaiteur », renchérit Laborde. Que l’on développe la méthode en France et celle-ci, en 1850, sera une terre de prospérité et de bonheur, d’où seront bannis l’immoralité, le fanatisme, les révolutions, les troubles sociaux, tous fils et filles de l’ignorance.
En 1818 Joseph Hamel, dans son rapport à l’Empereur de Russie, constate que
« la méthode d’enseignement mutuel s’est introduite dans toute la France avec une rapidité et un succès fort supérieur à ce qu’on pouvait raisonnablement en attendre, et, en moins de trois années, on a déjà fondé plus de 400 écoles. Tout porte donc à espérer que, dans un temps peu éloigné, plus de 2 millions d’enfants qui restaient dans l’ignorance la plus complète, pourront recevoir chaque année les bienfaits d’un enseignement gratuit, suffisant pour leur vocation ultérieure ».
D’emblée, toute la France s’y met ! A titre d’exemple, le récit de l’arrivée à Amiens et dans le département de la Somme.

A Amiens et dans la Somme
Après beaucoup de méfiance et bien des hésitations, la mairie d’Amiens fonde, le 15 mai 1817, une société d’encouragement de l’instruction élémentaire dans le département. Plus que l’ennoblissement de l’âme des élèves, pour le recteur, il s’agit,
« en donnant aux enfants de ces ouvriers l’instruction élémentaire, [de les préparer] non seulement à l’habitude de l’ordre et de la subordination que l’on puise dans les écoles d’enseignement mutuel et qu’ils reportent dans les ateliers, mais encore que cela les mette en état de servir plus utilement dans l’intérieur des fabriques comment pouvoir étudier les procédés industriels dont la conservation et le perfectionnement sont si essentiels à la prospérité nationale ».
Pour le recteur, la rapidité d’acquisition est un gage de succès de la nouvelle méthode par rapport à la « méthode simultanée » :
« Qu’une instruction primaire qui enlève pendant des années entières les enfants à un travail nécessaire à la subsistance de la famille devienne pour les pauvres une charge très onéreuse ; mais que l’expérience apprenne au père de famille que quelques mois suffiront pour procurer à ses enfants un avantage dont il a regretté tant de fois dans le cours de la vie de n’avoir pas pu jouir lui-même, on doit espérer qu’il ne balancera pas pour faire un léger sacrifice pour obtenir un résultat important ».
Ce sont principalement des écoles de garçons. Il existe quelques écoles de filles et des cours du soir pour adultes. Elles accueillent surtout des enfants de petits artisans : teinturier, employé d’octroi, cabaretier, contremaître, tailleur, garçon meunier, apprêteur, tonnelier, couturier, serrurier, boucher, fileur, repasseur, ouvrier, chargeur de voiture, menuisier, bouquiniste, allumeur de réverbère, coutelier, relieur, etc.

À son apogée, en 1821, l’enseignement mutuel comporte dans le département de la Somme non pas une école mais 25 dont 4 (payantes) pour des filles : près de la moitié sont situées en ville. Il en comportera encore 16 en 1833. Le réseau se réduira considérablement ensuite, toutefois, il ne disparaîtra pas complètement. Les deux dernières écoles d’Amiens fermeront involontairement leurs portes en 1879 et celle d’Abbeville en 1880 : jusqu’à cette date, elle jouera un rôle important dans la préparation des candidats aux examens.
L’école modèle d’Amiens – la première école modèle d’enseignement mutuel de province – prépare les futurs instituteurs à la pratique de l’enseignement mutuel. Elle est fondée le 26 mai 1817. Elle accueille plus de 200 élèves. Dès 1818, 6 instituteurs de la Somme en sortaient. La plupart des maîtres de l’Aisne, de l’Oise et du Pas-de-Calais y font un séjour avant de prendre leur fonction. C’est dire son importance, au point d’ailleurs que lorsque le préfet a créé l’école normale de garçons en 1831, elle s’appelle « école normale primaire d’enseignement mutuel ». Elle servit d’abord d’école d’application : les élèves maîtres devaient se rendre une fois par semaine dans ses locaux afin d’observer et de pratiquer, en s’exerçant, la méthode mutuelle.



Après les remaniements de 1817-1818, plusieurs membres de la SIE accèdent à des ministères importants : Mathieu Molé (1778-1838) à la Marine, Laurent Gouvion-Saint-Cyr (1764-1830) à la Guerre, Elie Decazes (1780-1860) surtout, à l’Intérieur, ministère dont dépend l’enseignement primaire. Le soutien gouvernemental devient alors systématique.
Le ministre de l’Intérieur soutient la SIE de Paris et ses filiales par des subventions pour fondation ou entretien d’écoles. Il invite les préfets à concourir par tous moyens au développement de la méthode. Les préfets prennent l’initiative de constituer des sociétés locales, ils interviennent auprès des assemblées pour solliciter des subventions.
Des conseils généraux et municipaux, en nombre croissant, votent des crédits pour l’établissement d’écoles mutuelles. L’école fondée, les autorités locales, préfet, maire, la visitent, et président sa distribution des prix. De son côté, la commission d’instruction publique, qui depuis 1815 remplace le Grand Maître de l’Université, décide le 22 juillet 1817 d’établir dans les chefs-lieux des douze Académies de France une école modèle pour l’enseignement mutuel, pépinière des futurs maîtres. Les autres ministres, chacun dans leur sphère, soutiennent la méthode.
Mathieu Molé, chargé de colonies, fonde des écoles d’enseignement mutuel au Sénégal.
En 1818, Laurent Gouvion-Saint-Cyr établit à Paris, dans la caserne Babylone, une véritable école normale militaire d’enseignement mutuel. Chaque régiment de Paris et de province doit y envoyer un officier et un sous-officier qui, de retour après quelques mois de stage, dispenseront à la troupe les bienfaits de l’instruction primaire.
En 1817-1818, l’enseignement mutuel triomphe. Un enthousiasme irrésistible porte la France vers lui. Le réseau des écoles ne cesse de s’étendre. De trimestre en trimestre, toujours plus nombreux, arrivent à Paris les comptes-rendus de la province, dénombrant les écoles et leurs élèves.
C’est un chant de victoire que peut entonner Jomard à la séance de la SIE de janvier 1819. Sur les 81 départements que compte la France, 5 seulement sont dépourvus d’école mutuelle ; les 76 autres groupent 687 écoles, fréquentées par plus de 40 000 élèves. On compte en outre 105 écoles régimentaires, 5 écoles d’adultes, 4 écoles de prisons, 2 ou 3 écoles au Sénégal.

Exemplaire de ce qui devient alors un nouveau paradigme prométhéen d’optimisme scientifique, le 15 décembre 1821, lors d’une réunion à l’hôtel de ville de Paris, est fondée la Société de géographie par 217 personnalités dont les plus grands savants de l’époque, notamment Jomard, Champollion, Cuvier, Chaptal, Denon, Fourier, Gay Lussac, Berthollet, von Humboldt, Chateaubriand. Parmi ses membres illustres, on peut citer également Jean-Baptiste Charcot, Dumont d’Urville, Élisée Reclus et Jules Verne.
La collecte et l’étude des données géographiques de nombreux continents vont permettre à certains membres, comme Gustave Eiffel et Ferdinand de Lesseps, de proposer de grands projets d’infrastructure, notamment le canal de Suez et le canal de Panama.
15. Critiques
Les premières critiques contre l’éducation mutuelle ne proviennent pas de son échec mais de son succès. Le premier « risque » venait du fait que les enfants, ayant appris trop efficacement et trop vite (de 2 à 3 fois plus rapidement), allaient retourner dans la rue trop tôt, n’ayant pas encore l’âge d’aller travailler !
Les enfants n’étaient pas « enfermés » à l’école assez longtemps, et donc l’enseignement mutuel troublait l’ordre social existant. Ainsi entendit-on au sein du Conseil général du Calvados en 1818 :
« Le plus grand service à rendre à la société serait peut-être d’imaginer une méthode qui rendît l’instruction destinée à la classe inférieure et indigente de la société plus difficile et plus longue »…
Le deuxième « risque » était qu’en continuant à utiliser l’enseignement mutuel, ces nouvelles personnes instruites, pour la plupart issues des classes les plus pauvres, deviennent trop intelligentes, trop « éveillées », et commencent à exprimer des revendications politiques ou sociales, et notamment que chacun ait les mêmes droits que les classes sociales les plus aisées.
Imaginez le chaos si l’ordre social est remis en question ! L’urbaniste et sociologue Anne Querrien remarque qu’en effet, une majorité des organisateurs du mouvement ouvrier à l’époque sont issus de l’école mutuelle au sein de laquelle ils avaient bien sûr appris à lire, à écrire, à compter, mais aussi à se faire confiance et à faire confiance à leurs camarades. L’école mutuelle pousse ses élèves à réfléchir, et notamment à réfléchir à l’organisation de la société, société qui leur assignait alors un destin de soumission et d’obéissance.



Pour l’influent théologien et homme politique breton, Félicité Robert de Lamennais (1782-1854),
« Les écoles à la Lancaster sont la folie du jour. Toutes les autorités de ce pays, et surtout le Préfet, en sont engouées au-delà de toute expression. La haine pour les prêtres entre pour beaucoup dans cette manie. Le fait est que tout ce qu’il y a de bon dans cette méthode, était pratiqué depuis plus d’un siècle par les Frères des Écoles chrétiennes ; le reste est pur charlatanisme. On parle d’apprendre à lire et à écrire en quatre mois aux enfants : d’abord ce serait un grand malheur, car que faire de ces enfants si bien instruits, et à qui leur âge ne permettrait pas encore de travailler ? En second lieu, rien n’est plus faux que ces résultats merveilleux ».
S’il faut « se prononcer entre l’instruction de l’abbé de La Salle et celle de Lancaster, la question est bien simple ; il s’agit de choisir entre la société et l’anarchie ».
Son frère, le vicaire Jean-Marie de la Mennais (1780-1860) prendra alors la tête de ce qu’il faut bien qualifier de chasse aux sorcières. Il dit :
« L’enseignement mutuel fut introduit en France par des protestants, dans les funestes cent jours. M. Carnot était alors ministre de l’Intérieur ; sous ses auspices, la société d’encouragement, établie pour propager cette méthode, tint sa première séance le 16 mai 1815 ».
Il se démène pour prouver que « la méthode lancastérienne est défectueuse dans ses procédés, dangereuse pour la religion et les mœurs dans ses résultats » et dans une brochure, De l’Enseignement mutuel, publiée en 1819 à Saint-Brieuc, il attaque vigoureusement ce mode d’enseignement.
Il n’est pas faux que la remise en question de l’autorité et de l’ordre établi est en soi inhérente à l’enseignement mutuel. L’école « simultanée » se base sur le postulat que pour transmettre un savoir il faut être diplômé (être le professeur). À l’inverse, au sein de l’école mutuelle, le professeur n’est plus le dépositaire du savoir, chaque élève pouvant expliquer à ses camarades.
Un autre souci pour les élites était lié au fait qu’avec cette méthode, les enfants ne sont plus qu’instruits et non pas « éduqués », qu’aucune éducation morale chrétienne ne leur est transmise.
Enfin, l’enseignement mutuel s’appuyait sur un nombre d’encadrants plus faible, du fait du rôle des élèves comme créateurs, transmetteurs et porteurs de savoirs. Certains ont peut-être eu peur pour leur poste…
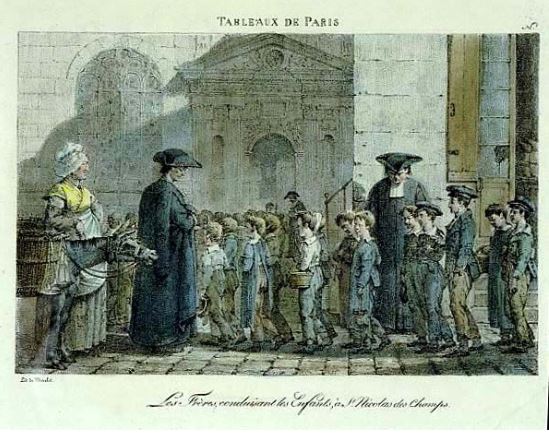
Joseph Hamel, en 1818, dans son rapport à l’Empereur de Russie, répond aux principaux adversaires des mutualistes, les « Frères des écoles chrétiennes », qu’ils ignorent presque entièrement ce qu’ils dénoncent. Hamel rappelle également qu’il y a 40 000 communes à prévoir des écoles primaires et que le nombre d’écoles des Frères ne « s’élève pas à plus de 100 dans le royaume… »
Du côté négatif, ce qui frappe, lorsqu’on examine les incriminations, c’est qu’on dise une chose le matin et son contraire l’après-midi. Le matin on dit que l’enseignement mutuel brouille les esprits en diluant l’autorité des maîtres, l’après-midi on affirme qu’il « militarise » à outrance l’éducation par une structure de commandement totalement hiérarchisée ! Allez comprendre…
Sur la question de la moralité, jamais Lazare Carnot n’aurait cautionné une éducation ruinant l’esprit chrétien et encore moins la notion d’autorité légitime, tout en combattant avec vigueur celle qui en manquait, comme par exemple celle de la Monarchie de droit divin ou du Consulat à vie imposé par Napoléon. De la même façon, le matin on accuse le système mutualiste de ne pas transmettre « la morale » chrétienne, l’après-midi on y voit un complot protestant…
Or, l’élan national en faveur de « la patrie » et des générations futures, a justement réussi à unir, dans un même effort, des personnalités de tout bord politique et religieux. Cuvier (protestant) et Gérando (catholique), tous deux fervents républicains et promoteurs du mode mutuel, ainsi que l’inspecteur général de l’Université, Ambroise Rendu (1778–1860, catholique), participent même à la rédaction de l’ordonnance du 29 février 1816 promulguée par Louis XVIII et le ministre de l’Intérieur, de Vaublanc (1756–1845).
Suite aux pressions massives des congrégations, les enseignants mutualistes Martin, Frossard et Bellot, tous trois protestants, se voient contraints de quitter leur direction d’école. Martin se rendra fort utile dans d’autres pays européens, notamment à Bruxelles où il organise, en 1820, une école mutuelle aux Minimes.
16. Dérive mécaniste ?
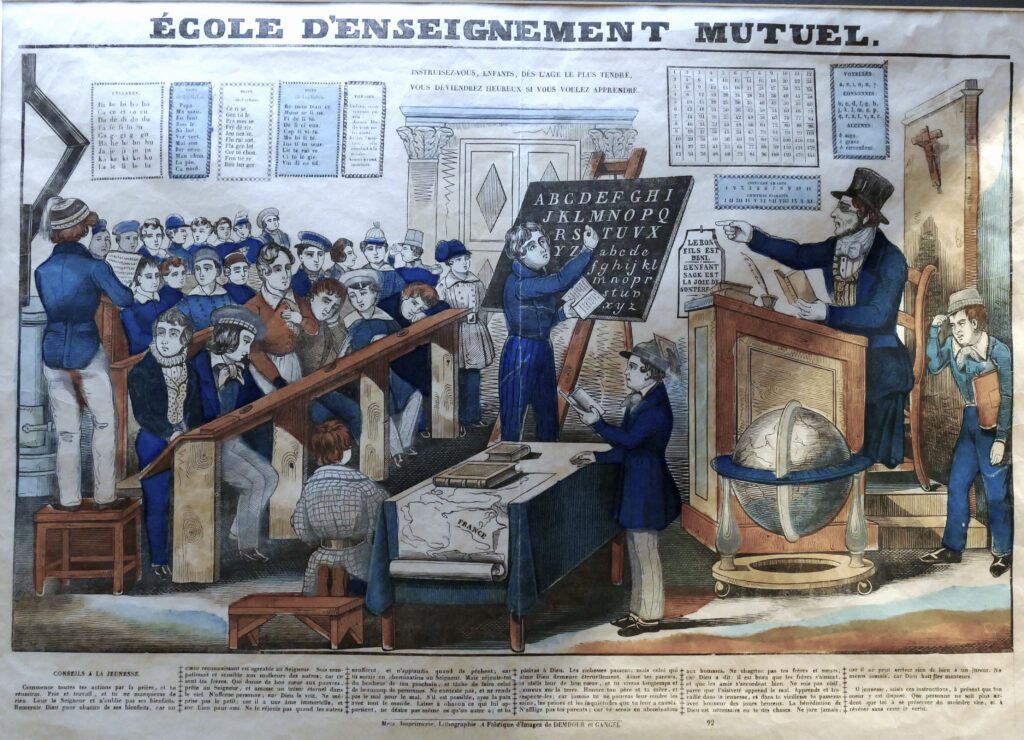
Sans appréhender l’état d’esprit et l’enthousiasme que pouvaient avoir des jeunes polytechniciens pour l’éclosion d’une culture industrielle et les merveilles du machinisme, les défenseurs d’une France cul-terreuse et féodale n’y voient qu’une « vision foncièrement mécaniste », lorsque Jomard compare la méthode mutuelle à une machine, avec ses rouages et ses ressorts, dont le maître n’est qu’un simple opérateur :
« Une fois l’école disposée et garnie de tout le mobilier qui lui est nécessaire, il ne s’agira plus que d’introduire les élèves et le maître, et de mettre ensuite en mouvement tous les ressorts de cette espèce de mécanisme, au moyen des nouvelles pratiques ».
Alors que Victor Hugo y évoquait un « essaim heureux », on accuse Laborde de dérive « mécaniste » lorsqu’il compare le bourdonnement produit par l’activité des élèves dans les écoles mutuelles anglaises au bruit des machines dans les filatures de coton.
La communication, disent-ils, y est « toute mécanique et entièrement hiérarchisée ». Elle ne s’exerce « que du maître ou du moniteur général vers les moniteurs et vers les élèves, non dans l’autre sens. C’est un moyen d’action, non un moyen d’échange. »
Admettons que toute approche pédagogique, peu importe laquelle, érigée en système et postulant qu’il suffit de l’appliquer mécaniquement à une personne humaine, peut faire dans l’horreur. Facile donc d’accuser l’enseignement mutuel de tous les maux dont souffraient, peut-être bien plus, ceux qui l’en accusaient.
A l’école mutuelle, les châtiments corporels sont bannis. C’est une décision courageuse qu’Octave Gréard (1828-1904) ne manquera de souligner :
« C’est l’un des titres des fondateurs des écoles mutuelles à la reconnaissance publique d’avoir proscrit les peines corporelles, férules et fouets, qui étaient encore en usage, et l’on ne saurait trop leur savoir gré d’avoir cherché à remplacer dans le cœur des élèves le sentiment de la crainte par le sentiment de l’honneur, ou, comme disait M. de Laborde, le sentiment de la honte bien administrée. »
Connaissant l’immense bonheur des milliers d’enfants qui ont accédé rapidement à un minimum d’instruction publique et qui ont connu la joie indescriptible d’instruire leurs camarades, on ne peut que soupçonner la plume des congrégations jalouses derrière ce poème se désolant faussement du malheur des pauvres petits :
« Ce système, dit l’un, né de l’anglomanie,
Contraste horriblement avec notre génie.
Là, tout est mécanisme et nos tristes enfants
Semblent une machine, au milieu de leurs bancs ;
Leur discipline absurde, et sans doute funeste,
Règle même les pas, l’attitude ou le geste :
On peut, dès aujourd’hui, prophétiser le sort
De ce peuple automate ainsi mu par ressort ».
17. Mort de l’enseignement mutuel en France

En 1815, après Waterloo, Louis XVIII, qui avait fui, revient le 8 juillet 1815. Contrairement à son frère, le futur Charles X, chef des ultra-royalistes, il a pleinement conscience que l’on ne peut effacer les pages de l’histoire de la Révolution. Il constate que la France ne peut plus redevenir un pays de « sujets » et qu’elle est devenue une Nation. D’où la « Charte constitutionnelle » qu’il promulgue, et qui a valeur de constitution. Dans le même esprit, face à la popularité de l’enseignement mutuel, il lui accorde ses faveurs (subsides, création d’écoles modèles, protection du ministère de l’Intérieur).
L’enseignement mutuel va rapidement perdre ses protecteurs, la commission ministérielle créée par le décret du 27 avril ne survivant pas à la chute de Napoléon en juin 1815.
Dès l’automne 1816, alimentées par les congrégations, les critiques pleuvent. Le Grand Aumônier de France, cardinal de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims (ville natale de Jean-Baptiste de La Salle…), s’adressa de son côté au Roi pour lui faire connaître les alarmes des catholiques.
Si, en 1820, la SIE possède déjà un réseau de 1 500 écoles mutuelles groupant, grâce à une audacieuse pédagogie collective, plus de 170 000 élèves, le mutualisme subit les coups de bélier des ultras qui l’estiment trop libéral, trop favorable à l’autonomie des enfants et incapable « d’élever la jeunesse dans des sentiments religieux et monarchiques ».
L’enfant sortant de cette école, disent-ils,
« est un perroquet savant, sans idée religieuse, sans valeur morale, plus dangereux que l’ignorant pour l’ordre politique et social puisque l’instruction a développé en lui de nouveaux besoins, toujours prêt à s’engager dans de nouvelles scènes de révolution ou de déchristianisation. Ah, Carnot, le conventionnel régicide, le patron de l’enseignement mutuel, savait ce qu’il préparait en l’introduisant en France par le décret de 1815 ! »

Partisan farouche de l’ordre et soupçonnant un vaste complot protestant contre le Vatican, le pape Léon XII, le « pape de la Sainte-Alliance » décide dans Quod Divina Sapientia, sa bulle papale du 28 août 1824 (art. XXVII, 299), que
« les écoles publiques d’instruction mutuelle seront supprimées et abolies dans tous les États pontificaux. Les évêques poursuivront ceux qui continueront à utiliser cette méthode d’enseignement ou qui tenteront de l’introduire dans leurs diocèses ».
Comme on l’a dit plus haut, en France, l’enseignement mutuel est perçu comme une agression par les congrégations religieuses qui pratiquent « l’enseignement simultané », codifié dès 1684 par Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) pour les Frères des Écoles Chrétiennes (Latin : Fratres Scholarum Christianarum ; Italien : Fratelli delle Scuole Cristiane, en abrégé FSC) : classes par âge, division par niveau, places fixes et individuelles, discipline stricte, travail répétitif et simultané supervisé par un maître inflexible.
Et les mérites des écoles des FSC et de « l’enseignement simultané », confirmés depuis leur création, sont considérés en totale opposition avec ceux de l’enseignement mutuel, la « manie du moment », et considéré comme l’œuvre de « charlatans » spéculant sur l’enseignement primaire.
Anticipant la bulle papale par l’ordonnance d’avril 1824, l’enseignement mutuel est placé chez nous sous la stricte tutelle de l’Église traditionnelle qui s’empare de l’ensemble de la question éducative. En août, donc après la bulle de Léon XII, un ministère des « Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique », dont l’appellation dit bien le retour de l’Eglise aux affaires, est créé. L’accession de Charles X, ne fera qu’aggraver cette situation. L’Église d’alors aime les Lumières, mais avant tout celles des bougies…

Dès lors, le bilan de la scolarisation tourne au drame. En 1828, sur les 39 381 communes :
- environ 24 000 sont pourvues d’écoles de garçons, recevant 1 070 000 enfants ;
- le nombre des jeunes filles qui fréquentent les écoles primaires est au plus de 430 000 ;
- 15 381 communes sont sans écoles de garçons ;
- et peut-être 20 000 sans écoles de filles ;
- 1 680 000 garçons et 2 320 000 jeunes filles, soit 4 millions au total, ne fréquentent aucune école.
Malgré une embellie entre 1828 et 1829, le mutuellisme est rejeté, ses écoles fermées les unes après les autres (leur nombre diminua des trois-quarts par rapport à 1820) bien que le poids électoral des ultras diminue d’élections en élections. Cependant, les éducateurs du peuple résistent.
Dans les années qui suivent la révolution de 1830, encore plus de 2 000 écoles mutuelles fonctionnent, principalement dans les villes, en concurrence avec les écoles confessionnelles promues par le régime. Officiellement, l’école mutuelle n’était pas garante de la moralité et on affirmait qu’elle était « industrielle », inhumaine.

Arrive alors le fameux « moment Guizot ». Alors qu’il avait milité initialement pour le développement de l’enseignement mutuel au sein de la SIE, François Guizot (1787-1874), à partir de 1832 ministre de l’Instruction publique de Louis-Philippe, donnera le coup de grâce en France à l’enseignement mutuel en faisant entériner le mode simultané comme unique méthode pédagogique officielle. Les écoles adoptant l’enseignement mutuel ne sont alors plus subventionnées, elles ne reçoivent plus aucun soutien du gouvernement ni de l’Église. Devant les difficultés matérielles, une majorité des élèves admis gratuitement jusqu’alors doivent payer une rétribution. Beaucoup de parents, dans le besoin, les retirent pour les mettre à l’école gratuite des Frères ou des Sœurs qui vient d’ouvrir ses portes. L’Église calomnie, jette le doute sur la moralité des maîtres, s’efforce d’éloigner de l’école « du Diable » les enfants des familles catholiques, persécute et menace de les écarter du catéchisme et de la communion. Elle veut briser l’enseignement mutuel. Les maîtres, pour la plupart, abandonnent la méthode pour se rallier à l’enseignement simultané. Plus d’élèves, plus de maître, les écoles mutuelles disparaissent peu à peu.
C’est encore Guizot qui donne le dernier coup de marteau pour clouer le cercueil de l’enseignement mutuel en créant en 1867 l’École normale des instituteurs pour former les futurs professeurs de l’école de Jules Ferry à la méthode simultanée.
Le jeune Hippolyte Carnot adhère lui aussi à la SIE afin de renouer, post mortem, avec son père. Il tentera en 1847, lorsqu’il est ministre de l’Instruction publique sous la IIe République, de faire renaître cet enseignement mutuel que son père Lazare Carnot chérissait, mais, bien que son œuvre fût grande, ses ennemis furent nombreux et son mandat fort court.
18. Conclusion
L’enseignement est en crise. Le dossier La désintégration contrôlée de l’éducation – Ce que tout parent et enseignant devrait savoir (S&P, mars 2023) documente en détail comment tout ce qui a été en grande partie accompli par Lazare Carnot et son fils Hippolyte, repris bien sûr par la suite, notamment dans le plan Langevin-Wallon, a été systématiquement mis en pièce par les nouvelles congrégations de notre temps, adorateurs du veau d’or : l’oligarchie financière, transhumaniste et décadente, après avoir conduit le monde au bord du gouffre, toujours déterminée à sauver ses privilèges en organisant la ruine physique et morale de l’humanité.
Pour reconstruire une instruction digne de ce nom, nous en sommes convaincu, l’éducation mutuelle, sous condition de l’adapter à notre époque et de ne pas en faire un système déshumanisant, est une piste extrêmement prometteuse. Plusieurs pays africains ne nous ont pas attendu. Bien que dépourvus de moyens suffisants, ils s’en inspirent déjà. Il ne s’agit donc nullement d’une relique du passé, mais bien un outil concret pour construire l’avenir.
En France, Vincent Faillet, un jeune professeur de SVT, docteur en sciences de l’éducation et de la formation en région parisienne, dont le travail est évoqué dans cette vidéo, semble bien décidé à ouvrir le dossier :
19. Quelques ouvrages et textes consultés
- François Arago, Biographie de Gaspard Monge, lue à l’Académie des sciences, 1846.
- Joseph Hamel, L’enseignement mutuel, Paris, 1818.
- John Franklin Reigart, The Lancastrian System of Instruction in the schools of New York City, Teachers College, Columbia University, 1916.
- Sylviane Tinembart, Edward Pahud, Une innovation pédagogique, le cas de l’enseignement mutuel au XIXe siècle. Editions Livreo-Alphil, 2019, Neuchâtel, Switzerland;
- Bruno Poucet, Petite histoire de l’enseignement mutuel : l’exemple du département de la Somme, Carrefours de l’éducation, N° 27, 2009/1, pages 7 to 18;
- Michel Chalopin, L’enseignement mutuel en Bretagne, Presses Universitaires de Rennes, 2011; (thèse de 2008, en format pdf);
- M. Gontard, Un aspect des luttes de partis en France au début de la Restauration : la question de l’enseignement mutuel, Revue d’Histoire du XIXe siècle – 1849, Année 1953, pp. 48-63.
- Dell Upton, Lancasterian Schools, Republican Citizenship, and the Spatial Imagination in Early Nineteenth-Century America, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 55, No. 3 (Sep., 1996), pp. 238-253,University of California Press;
- Alexis de Garaudé, Manuel de l’enseignement mutuel et populaire de la musique, Paris, 1854;
- Anne Querrien, L’école mutuelle – Une pédagogie trop efficace?, Les Empêcheurs De Penser En Rond, 2005.
- Claire Giordanengo, La grande vogue de l’enseignement mutuel, Hypotheses, Bibliothèque Diderot de Lyon;
- Jacques Cheminade, Dino di Paoli, Claude Albert, La science de l’Education républicaine, le secret de Monge et Carnot: Polytechique et les Arts et Métiers, Campaigner Publications, Paris, 1980;
- René Girard, Carnot et l’éducation populaire pendant les Cents Jours, Paris, 1907.
- Michael Werner, Musique et pacification sociale, missions fondatrices de l’éducation musicale (1795-1860) « , Gradhiva (N° 31/2020);
- Rémi Dalisson, Hippolyte Carnot – 1801-1888, La liberté, l’école et la République, CNRS, Paris, 2019;
- Renaud d’Enfert, Jomard, Francœur et les autres… Des polytechniciens engagés dans le développement de l’instruction élémentaire (1815-1850), Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque et de l’Histoire de l’École polytechnique (SABIX), Paris, 2014.
- Karel Vereycken, Le combat républicain de David d’Angers, la statue de Gutenberg à Strasbourg, Argenteuil, juillet 2023.
- Groupe éducation de S&P, La désintégration contrôlée de l’éducation. Ce que tout parent et enseignant devrait savoir, Clichy, mars 2023;
- Vincent Faillet, La métamorphose de l’école, quand les élèves font la classe, Publishroom Factory, Paris, 2020.
- Radio France: A la découverte de l’enseignement mutuel, Paris, 7 mai 2017.
- Karel Vereycken, Hippolyte Carnot, père de l’éducation républicaine moderne, août 2023.
Alain Bécoulet: la Science, puissant vecteur de rapprochement entre peuples

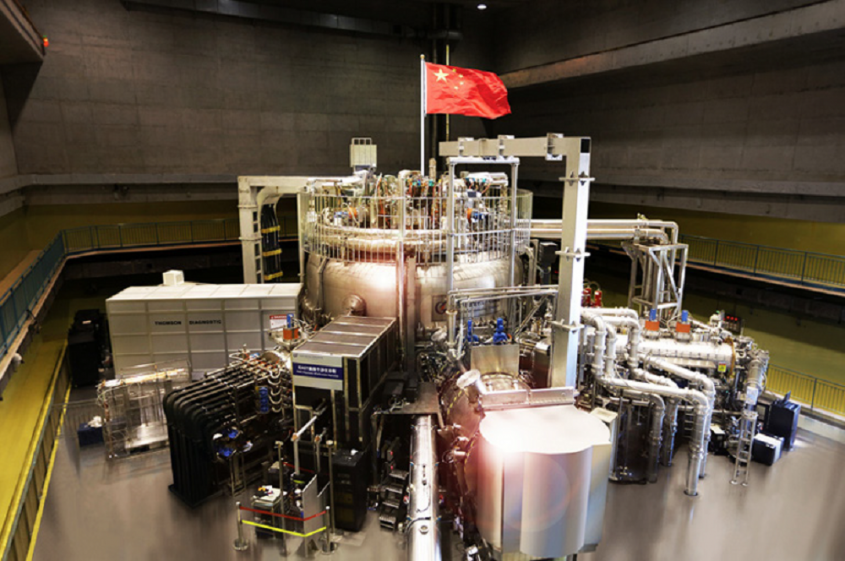

La coopération scientifique entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire civil est très ancienne.
Voici un entretien avec un chercheur qui y participe depuis trente ans, le physicien Alain Bécoulet, ancien directeur de l’Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique (IRFM) du CEA, aujourd’hui directeur du domaine « ingénierie » de l’International thermonuclear experimental reactor (ITER), un tokamak géant en voie d’assemblage à Cadarache, près d’Aix-en-Provence (13).
Au cours de sa longue carrière, Alain Bécoulet a travaillé, avant ITER, sur les tokamaks JET (Culham, Royaume-Uni), DIII-D (San Diego, Californie) et enfin Tore Supra (Cadarache, France).
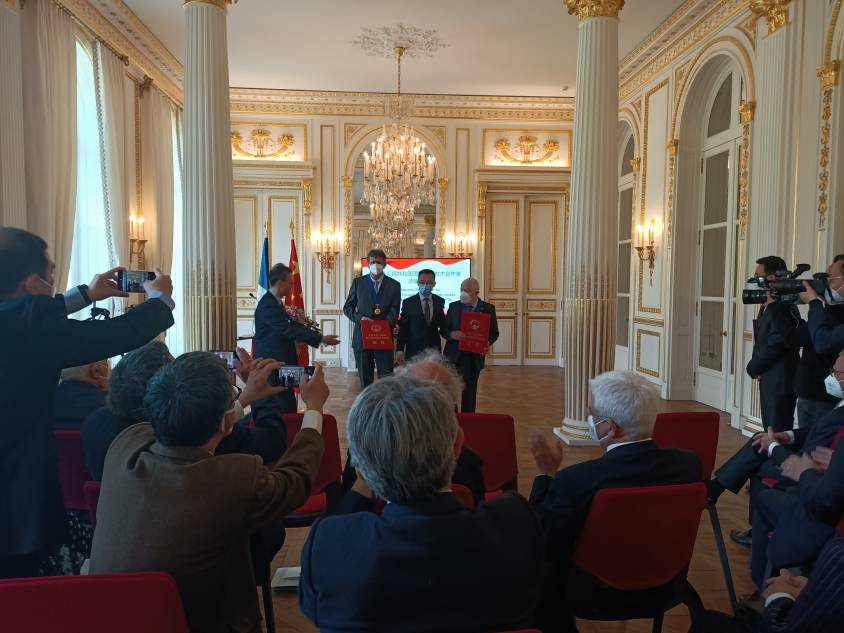
Karel Vereycken : Monsieur Bécoulet, bonjour.
Le 28 mars, lors d’une conférence de presse à Paris, en présence d’Alain Mérieux et de l’ancien président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer, le gouvernement chinois, par la voie de son ambassadeur, a remis son prix de la coopération scientifique et technologique internationale à deux chercheurs français au cœur de la coopération franco-chinoise : le professeur Jacques Caen, hématologue renommé, et vous-même, pour votre travail sur la fusion thermonucléaire dans le cadre du projet ITER.
Coût croissant des énergies fossiles et renouvelables, climat, conflits et croissance démographique. Autant de phénomènes qui interpellent brutalement nos gouvernements sur l’importance de l’énergie. Rappelez-nous brièvement ce qu’est la fusion et en quoi elle apporterait une réponse à ces défis ?
Alain Bécoulet : La fusion de noyaux atomiques légers est le mécanisme qui prévaut au fonctionnement de notre Soleil, et des étoiles en général. C’est une source nucléaire d’énergie virtuellement sûre, propre, décarbonée et très abondante. Si on arrive à la maîtriser, elle entrerait donc tout naturellement en première place des futurs mix énergétiques. Le défi, pour cela, est sa domestication sur Terre, qui entre seulement, avec ITER, dans sa démonstration de faisabilité à l’échelle 1.
Une fois cette étape franchie par ITER dans la deuxième moitié des années 2030, la voie sera ouverte vers des réacteurs électrogènes basés sur le principe de la fusion.
Puisque vous étiez de l’aventure, entre les premiers tokamaks et ceux d’aujourd’hui, quelles innovations ? Les progrès dans la supraconductivité ont-ils contribué à ces avancées ? Quel est l’objectif du tokamak géant ITER par rapport à ses prédécesseurs ?
Le défi est effectivement dans le déclenchement puis le maintien des réactions de fusion dans un « réacteur » de taille raisonnable, c’est-à-dire dans la miniaturisation à l’extrême d’un soleil.
Pour cela il a fallu, et il faut encore, plusieurs décennies non seulement de physique et d’expérimentation sur des « tokamaks » (c’est le nom que l’on donne à ce type de réacteurs) de formes et tailles diverses, mais également de nombreux développements et innovations technologiques.
Vous citez la supraconductivité : elle nous a en effet permis un saut considérable dans la réalisation des aimants continus nécessaires au confinement du milieu extrêmement chaud (une centaine de millions de degrés) dans lequel se passent les réactions de fusion.
La taille du tokamak est ensuite directement liée à la puissance que l’on peut extraire de ce type de réacteur, avec un effet à seuil en deçà duquel on ne peut pas déclencher de réactions. ITER, avec ses 830 m3 de « plasma » (c’est l’état dans lequel est le mélange de réactifs porté à de telles températures) va nous permettre de produire environ 500 MW de puissance fusion.
Un peu comme les missions spatiales, ITER (c’était d’ailleurs un des objectifs fixés par Gorbatchev et Reagan) a su réunir dans un projet commun des pays pas forcément amis. Le partage complet des informations et de la propriété intellectuelle est-il un élément fondamental pour cette coopération gagnant-gagnant ?
ITER est en effet construit par l’Organisation internationale, suite à un traité signé fin 2006 par sept partenaires : Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Japon, Russie et Union européenne. Cette dernière est le membre-hôte, hébergeant le site de construction à Cadarache, dans le sud de la France. Le traité ITER prévoit un partage complet de la propriété intellectuelle développée lors de la construction et de l’exploitation expérimentale d’ITER entre tous les membres.

Quelles retombées pour l’économie française ?
ITER est construit en France et il est clair que les retombées économiques sont très importantes pour le pays (contrats de construction et de transport, hébergement des personnels et de leur famille…). A ce jour (on est encore à environ cinq ans de la fin de l’assemblage du tokamak), on estime à plus de 4 milliards d’euros ces retombées.
La politique des sanctions et d’embargos ne risque-t-elle pas de nuire à une science dont les progrès, en dernière analyse, profitent à tous? Les 10 millions de pièces nécessaires à l’assemblage d’ITER seront-elles au rendez-vous?
De manière générale, ITER est construit par assemblage des millions de pièces fabriquées et fournies « en nature » par ses membres. Les échanges entre pays sont donc au cœur du maintien du planning de construction. L’assemblage d’ITER est ainsi fortement perturbé depuis deux ans par les effets de la pandémie de Covid-19, qui a non seulement déstructuré la production industrielle partout dans le monde, mais également ralenti et compliqué considérablement les transports.
Toute difficulté politique entre les membres d’ITER est effectivement également de nature à perturber la mise au point de la fusion. La situation de tension actuelle entre la Russie et les autres pays en fait partie. Rappelons cependant qu’ITER n’est pas une « collaboration » internationale, mais bel et bien un traité international.
A ce jour, ce traité n’a pas été questionné par ses membres et l’impact est essentiellement lié à la grande complication des échanges internationaux, dont ITER dépend fortement en effet.
En quoi la Chine contribue-t-elle à ITER ?
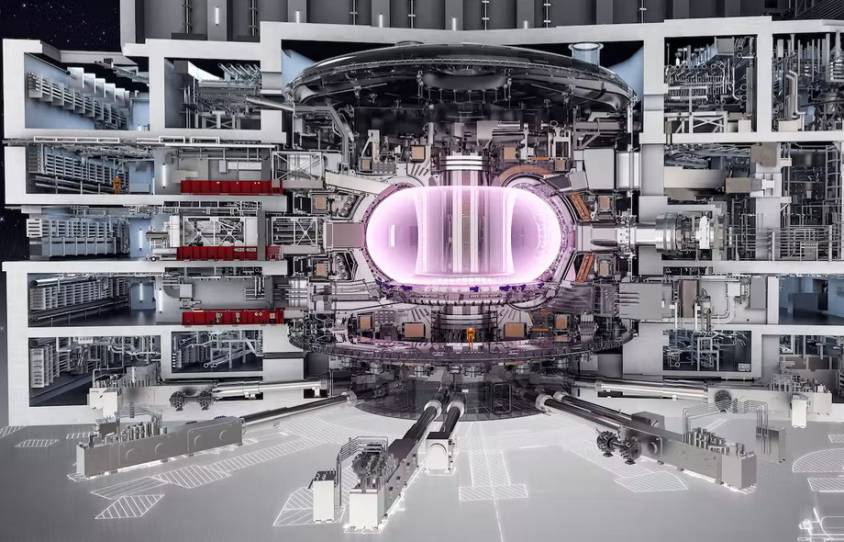
La Chine est l’un des signataires du traité ITER et à ce titre, contribue au projet via des fournitures en nature et sa contribution au budget de l’Organisation internationale. Elle a, en parallèle, un programme national de recherche et développement ambitieux et dynamique qui prévoit, comme plusieurs autres membres, de tirer tous les enseignements d’ITER dans le design et la construction des futurs réacteurs.
La France, notamment EDF, n’a-t-elle pas contribué dès le début au développement du nucléaire civil dans ce pays ? Comment a évolué la coopération franco-chinoise dans ce domaine ? Comment a-t-on su créer une confiance mutuelle dans un domaine aussi sensible ?
La coopération franco-chinoise en fusion a déjà plus de trente ans, et je suis d’ailleurs particulièrement fier d’y avoir contribué activement très tôt. A ce stade, elle a été portée par les grands instituts de recherche que sont le CEA d’une part et l’Académie des Sciences de Chine de l’autre. La CNNC (Compagnie nucléaire nationale chinoise) s’est jointe il y a une vingtaine d’années, via son institut SWIP. Les grands industriels du nucléaire commencent à rejoindre la fusion essentiellement depuis l’étape ITER.
Quel rôle avez-vous pu jouer dans ces échanges ?
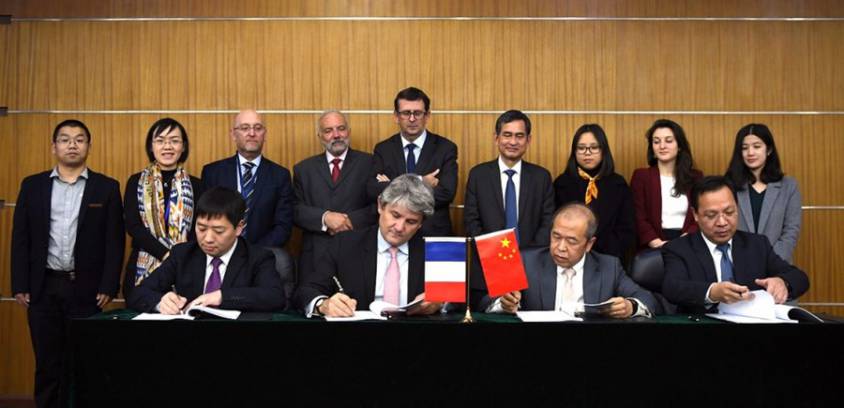
J’ai personnellement contribué au rapprochement de la Chine et de la France en fusion depuis plus de trente ans. Mes premières contributions ont évidemment été purement scientifiques et liées à mes propres activités de recherche, incluant de nombreux échanges dans les deux sens. Ce rôle s’est progressivement développé et amplifié au fur et à mesure du développement de mes responsabilités au CEA et au sein du programme fusion européen (programmes de recherche communs, échanges de matériel, projets communs, etc.), culminant au milieu des années 2010 par la création de SIFFER, le Sino-French Fusion Energy centeR, laboratoire virtuel joignant les forces en fusion du CEA, de l’Académie des Sciences Chinoise et du CNNC, en vue d’accélérer les échanges et la collaboration entre les deux pays. Des investissements significatifs sur les tokamaks des deux pays ont ainsi été réalisés dans des domaines technologiques tels que les composants face au plasma, la robotique d’inspection, les diagnostics, etc.
Racontez-nous un peu l’histoire de Tore Supra (devenu WEST), du projet EAST et des dernières percées obtenues en Chine.

Tore Supra est le premier tokamak, dans les années 1980, à avoir démontré la possibilité d’utiliser la technologie des aimants supraconducteurs pour la fusion. Il a ainsi réellement ouvert la voie technologique vers ITER. Tore Supra a ensuite continué systématiquement la mise au point des autres technologies-clés pour le maintien des conditions de fusion dans un tokamak (injection en continu de puissance, évacuation en continu de la chaleur, contrôle en temps réel…) avec de vrais succès et records mondiaux, dont notamment des plasmas maintenus plus de six minutes à très haute puissance injectée, au début des années 2000. Le tokamak EAST.
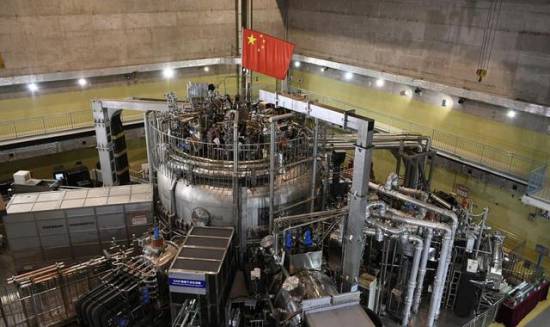
La Chine a voulu très tôt suivre la même voie de recherche, probablement grâce à l’excellente collaboration que nous avions déjà en place. Elle a ainsi conçu et construit le tokamak EAST, sur des concepts très proches de Tore Supra, et de très nombreux échanges ont permis l’émergence rapide d’EAST.
Quand il s’est agi de faire évoluer les technologies de composants face au plasma de Tore Supra (milieu des années 2010), en soutien au programme ITER, la Chine a très largement soutenu le CEA et j’ai voulu d’une certaine manière souligner ce « jumelage » grandissant entre les deux tokamaks en rebaptisant Tore Supra en WEST, combinant le clin d’œil géographique au fait que Tore Supra embarquait ainsi une technologie à base de tungstène, dont le symbole chimique est le W.
Que faut-il faire pour susciter des nouvelles vocations en France ? Comment cela se passe-t-il en Chine ?

La Recherche en général a besoin des meilleurs talents. Elle se développe ainsi sur un terreau de vocations. Dans le cas de la fusion, le défi est l’un des plus importants auquel l’humanité se soit attaquée. La route est encore assez longue et nécessite un soutien fort de la part des États mais aussi, de plus en plus, des acteurs de l’Energie au sens large, et des investisseurs privés. On voit actuellement un intérêt grandissant de ce côté. Il est de nature à soutenir ces vocations. Ceci est valable en Occident, mais également en Chine.
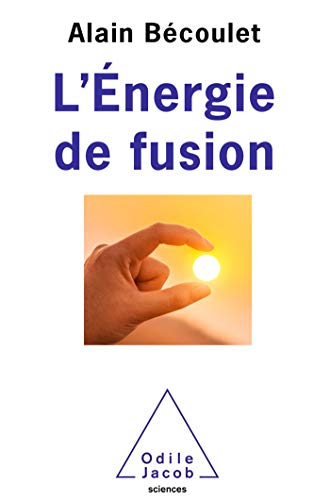
Votre livre, L’énergie de fusion, publié en français en 2019 chez Odile Jacob et déjà traduit en anglais et en néerlandais, sortira bientôt en chinois, c’est un bon signe ?
Ce livre a en effet pour but de sensibiliser le plus largement possible aux recherches en fusion, en « racontant » avec des mots simples quelles sont les avancées scientifiques et techniques déjà acquises et quels sont les défis qu’il reste à relever jusqu’au réacteur.
Il est de nature à susciter de nouvelles vocations, je l’espère, et les retours que j’ai des lecteurs et des éditeurs me font très plaisir.
Comment réagissez-vous au prix que la Chine vous a décerné ?
Comme je l’ai dit dans mon discours, au-delà de l’immense honneur que le gouvernement chinois me fait en me décernant ce prix plus que prestigieux, c’est la recherche en fusion et son caractère totalement ouvert et collaboratif qui sont distingués. Ma conviction professionnelle la plus profonde est que la Science est l’un des vecteurs les plus puissants du rapprochement entre les peuples, et donc de la paix. La volonté de savoir, de connaître, de décoder la Nature, est une source inépuisable et universelle de l’être humain. Je suis particulièrement fier d’y contribuer et très reconnaissant que cela ait été reconnu et salué par le gouvernement chinois au travers de ce prix. Il couronne aussi de très belles rencontres et amitiés qui se sont développées au cours de ces années, et le plaisir à chaque fois renouvelé pour moi des visites en Chine.
La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations


Il est de bon ton aujourd’hui de présenter les enjeux maritimes dans le cadre d’une l’idéologie géopolitique britannique moribonde dressant les pays et les peuples les uns contre les autres.
Cependant, comme le démontre cette brève histoire de la Route de la soie maritime, tirée pour l’essentiel d’un document de l’organisation internationale du tourisme, l’océan a été avant tout un lieu fantastique de rencontres fertiles, de brassages culturels et de coopérations mutuellement bénéfiques.
Les anciens Chinois ont inventé beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours, notamment le papier, les allumettes, les brouettes, la poudre à canon, la noria (élévateur), les écluses à sas, le cadran solaire, l’astronomie, la porcelaine, la peinture laque, la roue de potier, les feux d’artifice, la monnaie de papier, la boussole, le gouvernail d’étambot, le tangram, le sismographe, les dominos, la corde à sauter, les cerfs-volants, la cérémonie du thé, le parapluie pliable, l’encre, la calligraphie, le harnais pour animaux, les jeux de cartes, l’impression, le boulier, le papier peint, l’arbalète, la crème glacée, et surtout la soie dont nous aller parler ici.

Origine de la soie
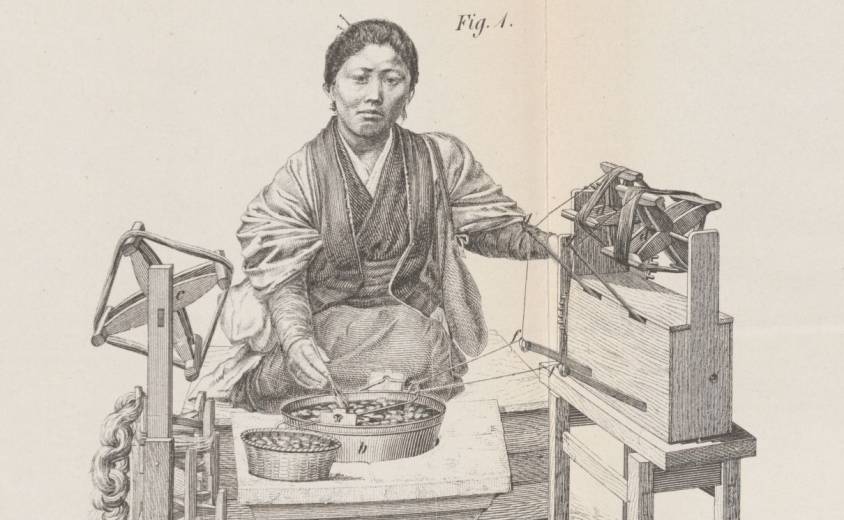
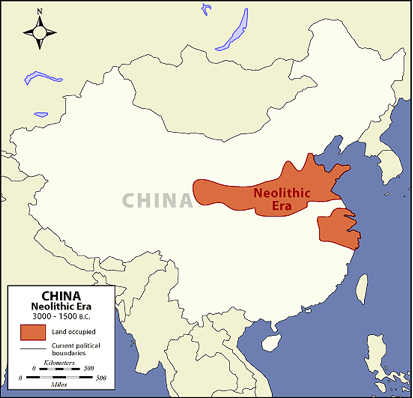
Avant de parler des « routes » de la soie, deux mots sur les origines de la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage de vers à soie.
Comme le confirment des découvertes archéologiques récentes, la production de la soie représente un savoir-faire ancestral. La présence du mûrier pour l’élevage du ver à soie a été constatée en Chine autour du fleuve jaune chez la culture de Yangshao lors du néolithique moyen chinois de 4500 à 3000 av. JC.
En général, on préfère retenir la légende qui affirme que la soie a été découverte vers 2500 ans avant J.C., par la princesse chinoise Si Ling-chi, lorsqu’un cocon tomba accidentellement dans son bol de thé. En essayant de le retirer, elle s’aperçut que le cocon ramolli par l’eau chaude déployait un fil délicat, doux et solide pouvant être dévidé et assemblé. Ainsi serait née l’idée de confectionner des étoffes. La princesse décida alors de planter de nombreux mûriers blancs dans son jardin pour élever des vers à soie.
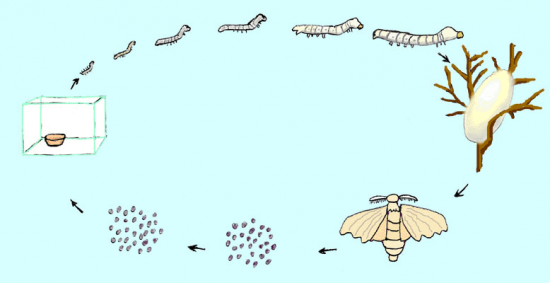
Les vers à soie (ou bombyx) et les mûriers furent divinement bien soignés par la princesse (les vers à soie se nourrissent uniquement de feuilles de mûriers blancs).
La production de soie est un processus long qui nécessite une grande surveillance. Les papillons de soie pondent environs 500 œufs au cours de leurs vies, qui est de 4 à 6 jours. Après éclosion des œufs, les bébés vers se nourrissent de feuilles de mûrier dans un environnement contrôlé. Ils ont un féroce appétit et leur poids peut considérablement augmenter. Après avoir emmagasiné suffisamment d’énergie, les vers sécrètent par leurs glandes de la soie une gelée blanche et s’en servent pour réaliser un cocon autour d’eux.
Après huit ou neuf jours, les vers sont tués et les cocons sont plongés dans de l’eau bouillante afin d’assouplir les filaments de protection qui sont enroulés sur une bobine. Ces filaments peuvent être de 600 à 900 mètres de long. Plusieurs filaments sont assemblés pour former un fil. Les fils de soie sont alors tissé pour former une toile ou utilisée pour de la broderie fine ou encore le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d’or et d’argent.
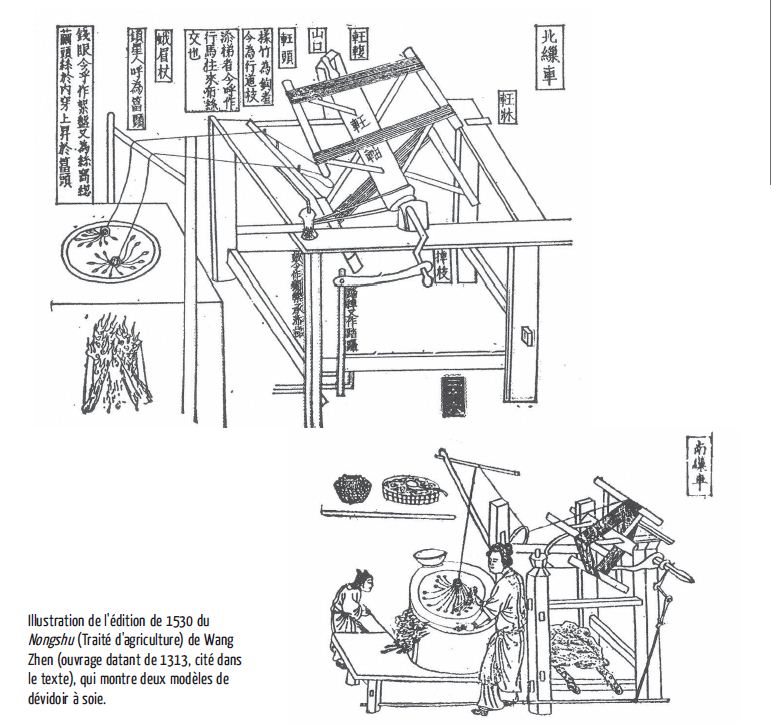
Le début du commerce de la soie
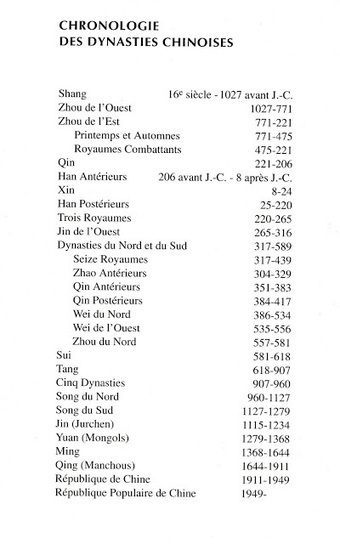
Sous la menace de la peine capitale, la sériciculture resta un secret bien gardé et la Chine conservera durant des millénaires son monopole sur la fabrication.
Ce n’est que sous la dynastie des Zhou (1112 av. JC.), qu’une Route de la soie maritime va desservir à partir de la Chine le Japon et la Corée car le gouvernement décide d’y envoyer, depuis le port situé dans la baie de Bohai (de la Péninsule de Shandong), des Chinois chargés de former les habitants à la sériciculture et l’agriculture. C’est ainsi que les techniques d’élevage du vers à soie, du bobinage et du tissage de la soie ont, peu à peu, été introduites en Corée via la mer Jaune.
Lorsque l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine (221 av. JC.), de nombreuses personnes des États de Qi, Yan et Zhao s’enfuient vers la Corée en emportant, avec eux, des vers à soie et leur technique d’élevage. Ceci va accélérer le développement de la filature de la soie dans ce pays.
Pour les relations internationales de la Chine, la Corée a joué un rôle central en particulier comme un pont intellectuel entre la Chine et le Japon. Son commerce avec la Chine a également permis la divulgation du bouddhisme et des méthodes de fabrication de la porcelaine.
Bien qu’initialement réservé à la Cour impériale, la soie s’est répandu à travers toute la culture asiatique, aussi bien géographiquement que socialement. La soie devient rapidement le tissu de luxe par excellence que la terre entière désire.
A l’époque des dynasties Han (206 av. JC à 220), un canevas dense de routes commerciales fait exploser les échanges culturels et commerciaux à travers l’Asie centrale et impacte profondément la dynamique civilisationnelle. La dynastie des Han continue la construction de la grande muraille et crée notamment la commanderie de Dunhuang (Gansu), poste clé de la Route de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles av. JC, jusqu’à la Grèce puis Rome où la soie est réservée aux élites.
Au IIIe siècle, l’Inde, le Japon et la Perse (Iran) réussissent à percer le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs.
La soie arrive en Europe
L’élevage du ver à soie, dit-on, aurait débuté en Europe au VIe siècle grâce à deux moines du Mont Athos, envoyés par l’empereur byzantin Justinien. Ils ont rapporté de Chine ou d’Inde, des œufs de vers à soie cachés dans leur bâton de pèlerin en bambou creux. Une autre version prétend que ce serait l’empereur Han Wu (IIe siècle) qui envoya des ambassadeurs, munis de présents tel que la soie, vers l’occident. L’élevage se répandit d’abord dans l’empire byzantin qui en conserva le secret.
Au VIIe siècle, la sériciculture se répand en Afrique et en Sicile où, sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l’ancien Péloponnèse.
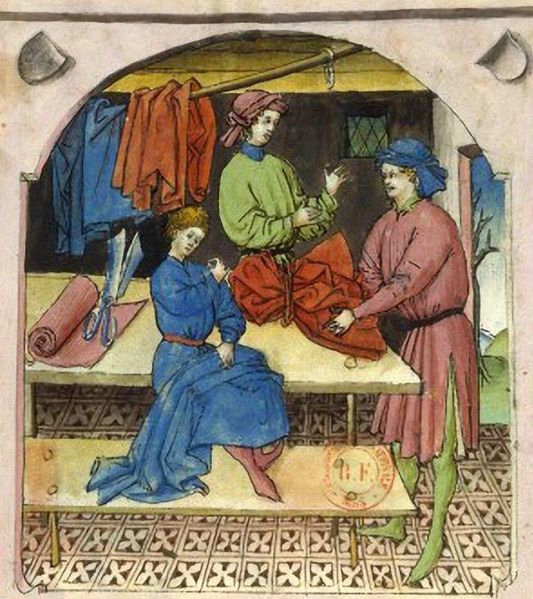
Au Xe siècle, l’Andalousie devient l’épicentre de la fabrication de la soie avec Grenade, Tolède et Séville. Lors de la conquête arabe, la sériciculture passa en Espagne, en Italie (Venise, Florence et Milan) et en France.
Les plus anciennes traces françaises d’une activité séricicole remontent au XIIIe siècle, notamment dans le Gard (1234) et à Paris (1290).
Au XVe siècle, face à l’importation ruineuse de la soie (brute ou manufacturée) italiennes, Louis XI essaye de créer des manufactures de soieries, d’abord à Tours sur la Loire, en ensuite à Lyon, une ville au carrefour des routes nord-sud où les émigrants italiens pratiquaient déjà le commerce de soieries.
Au XIXe siècle, la production de la soie a été industrialisée au Japon mais au XXe siècle, la Chine reprend sa place comme le plus grand producteur mondial. Aujourd’hui, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Ouzbékistan et le Brésil ont des grosses capacités de production.
Brassage culturel
Autant que la soie elle-même, le transport de la soie par voie maritime remonte à des âges immémoriaux.
Pour les Chinois, il existe deux principales routes : la Route de la Soie de la Mer orientale de Chine (vers la Corée et le Japon) et la Route de la Soie de la Mer méridionale de Chine (via le détroit de Malacca vers l’Inde, le golfe Persique, l’Afrique et l’Europe). Royaume du Fou-Nan
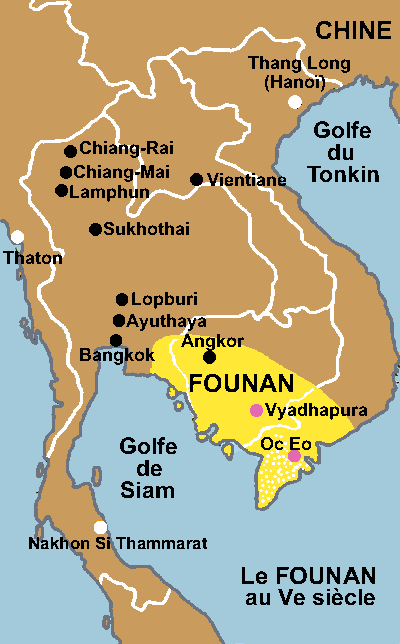
Au Vietnam, le musée de Hanoï possède une pièce de monnaie datant de l’an 152 arborant l’effigie de l’empereur romain Antonin le Pieux. Cette pièce a été découverte dans les vestiges d’Oc Eo, une ville vietnamienne située au sud du delta du Mékong, qu’on pense avoir été le port principal du Royaume du Fou-nan (Ier au IXe siècle).
Ce royaume, qui couvrait le territoire du Cambodge actuel et de la région administrative vietnamienne du delta du Mékong, a prospéré du Ier au IXe siècle. Or, la première mention du royaume du Fou-nan, apparait dans le compte rendu d’une mission chinoise qui s’y est rendue au IIIe siècle.
Les Founamiens furent à la gloire de leur puissance lorsque l’hindouisme et le bouddhisme furent introduits en Asie du Sud-Est.
Ensuite, à partir de l’Egypte, des marchands grecs ont atteint la baie de Bengale. Des quantités considérables de poivre atteignent alors Ostia, le port d’entrée de Rome. Toutes les preuves historiques démontrent que le commerce est-ouest fleurissait dès notre premier millénaire.
Perses et Arabes en Asie

Du coté occidental, à l’entrée de la baie de Koweït, à 20 kilomètres au large de la ville de Koweït City, non loin du débouché de l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate dans le golfe Persique, l’île de Failaka a été l’un des lieux de rendez-vous où la Grèce, Rome et la Chine échangeaient leurs marchandises.
Sous la dynastie des Sassanides (226-651), les Perses ont développé leurs routes commerciales jusqu’en Asie du Sud-est en passant par l’Inde et le Sri Lanka. Cette infrastructure commerciale fut reprise ensuite par les Arabes lorsqu’en 762 ils déplacèrent la capitale Omeyyade de Damas à Bagdad.


Ainsi, la ville de Quilon (Kollam), la capitale du Kerala en Inde, voit cohabiter dès le IXe siècle des colonies de marchands arabes, chrétiens, juifs et chinois.
Du coté occidental, les navigateurs perses et ensuite arabes ont joué un rôle central dans la naissance de la route de la soie maritime. A la suite des routes sassanides, les Arabes poussaient leurs dhows, c’est-à-dire les boutres ou voiliers arabes traditionnels, de la mer Rouge aux côtes chinoises et jusqu’aux confins de la Malaisie et de l’Indonésie.
Ces marins apportèrent avec eux une nouvelle religion, l’islam qui s’étendra en Asie du Sud-Est. Si initialement le pèlerinage traditionnel (le hajj) vers la Mecque ne fut qu’une aspiration pour de nombreux musulmans, il leur deviendra de plus en plus possible de l’effectuer.
Lors de la mousson, la saison où les vents sont favorables à la navigation vers l’Inde dans l’océan Indien, les missions commerciales semestrielles se transformaient en véritables foires internationales offrant du même coup une occasion pour transporter par la mer une grande quantité de marchandises dans des conditions (abstraction faite des pirates et de l’imprévisibilité du temps) relativement moins exposées aux dangers du transport par voie terrestre.
Chine : la Route de la soie maritime
sous les dynasties Sui, Tang et Song

C’est sous la dynastie Sui (581-618), qu’en partance de Quanzhou, ville côtière dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, la Route de la soie maritime trace ses premiers itinéraires commerciaux.
Riche de sa panoplie d’endroits pittoresques et de sites historiques, Quanzhou a été proclamée « point de départ de la Route de la Soie maritime » par l’UNESCO.
C’est à cette époque que les premières méthodes d’imprimerie font leur apparition en Chine. Il s’agit de blocs de bois permettant d’imprimer sur du textile. En 593, l’Empereur Sui, Wen-ti, ordonna l’impression des images et des écrits bouddhiques. Un des plus anciens textes imprimés est un écrit bouddhiste datant de 868 retrouvé dans une grotte près de Dunhuang, une ville étape de la Route de la soie.
Sous la dynastie Tang (618-907), l’expansion militaire du Royaume apporta de la sécurité, du commerce et des idées nouvelles. Le fait que la stabilité de la Chine des Tang coïncide avec celle de la Perse des Sassanides, permet alors aux routes de la soie terrestres et maritimes de prospérer. La grande transformation de la route de la soie maritime aura lieu à partir du VIIe siècle lorsque la Chine s’ouvre de plus en plus aux échanges internationaux.
Le premier ambassadeur arabe y prend ses fonctions en 651.
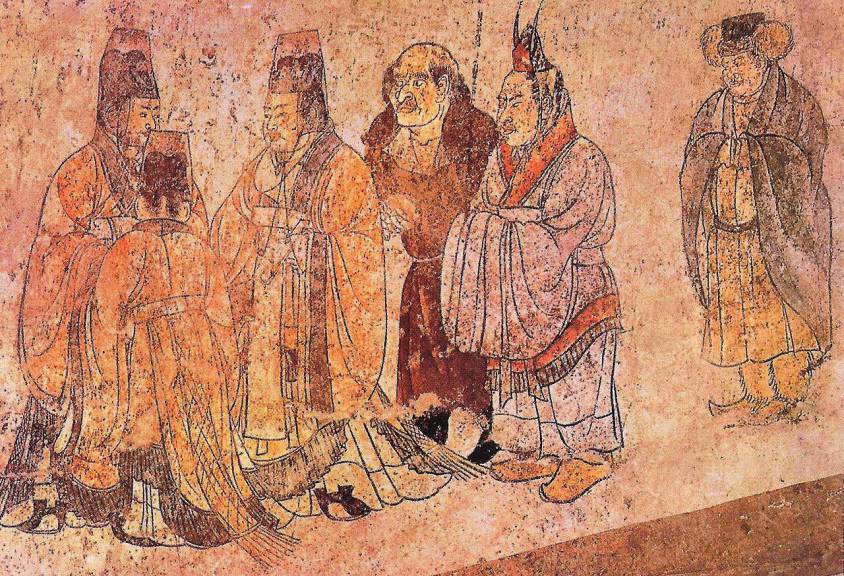
La Dynastie Tang choisit comme capitale la ville de Chang’an (appelé aujourd’hui Xi’an). Elle adopte une attitude ouverte vis-à-vis des différentes croyances. Des temples bouddhistes, taoïstes et confucéens y coexistent pacifiquement avec des mosquées, des synagogues et des églises nestoriennes chrétiennes.
Chang’an étant le terminus de la Route de la Soie, le marché ouest de Chang’an devient le centre du commerce mondial. Selon le registre de l’Autorité Six des Tang, plus de 300 nations et régions avaient des relations commerciales avec Chang’an.
Presque 10 000 familles de pays étrangers de l’ouest vivaient dans la ville, spécialement dans la zone autour du marché ouest. Il y avait beaucoup d’auberges étrangères dont le personnel était des servantes étrangères choisies pour leur beauté. Le poète le plus célèbre dans l’histoire Chinoise, Li Bai, flânait souvent parmi elles. La nourriture étrangère, les costumes, la musique étaient la mode de Chang’an.
Après la chute de la dynastie Tang, les Cinq dynasties et la période des dix royaumes (907-960), l’arrivée de la dynastie Song (960-1279) va inaugurer une nouvelle période faste caractérisée par une centralisation accrue et un renouveau économique et culturel. La route maritime de la soie retrouve alors de son allant. En 1168 une synagogue est érigée à Kaifeng, capitale de la dynastie Song du Sud, pour servir aux marchands de la route de la soie.
Durant la même période, de pair avec l’expansion de l’islam, des comptoirs commerciaux vont apparaître tout autour de l’océan Indien et dans le reste de l’Asie du Sud-est.
La Chine incite alors ses marchands à saisir les occasions qu’offre le trafic maritime, notamment la vente du camphre, une plante médicinale très recherchée. Un véritable réseau commercial se développe alors dans les Indes orientales sous les auspices du Royaume de Sriwijaya, une cité-Etat du sud de Sumatra en Indonésie (voir ci-dessous) qui fera pendant près de six siècles la jonction entre d’un coté les marchands chinois et de l’autre les Indiens et les Malais. Une route commerciale émerge alors réellement méritant le nom de « route de la soie » maritime.
Des quantités de plus en plus importantes d’épices passent alors par l’Inde, la mer Rouge et Alexandrie en Egypte avant d’atteindre les marchands de Gênes, Venise et les autres ports occidentaux. De là, ils repartiront vers les marchés du nord de l’Europe de Lübeck (Allemagne), Riga (Lituanie) ou encore Tallinn (Estonie), qui deviendront, à partir du XIIe siècle, des villes importantes de la Ligue hanséatique.

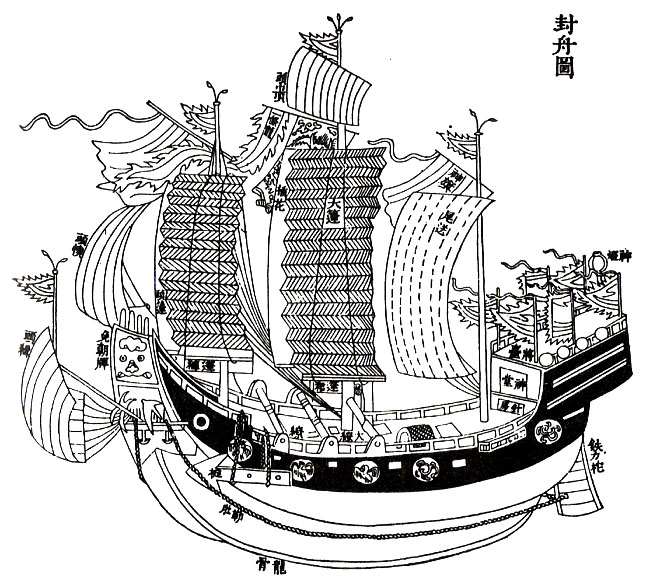
En Chine, sous le règne de l’empereur Song, Renzong (1022-1063), beaucoup d’argent et d’énergie furent dépensés pour réunir les savoirs et les savoir-faire. L’économie fut la première à en bénéficier.
En s’appuyant sur le savoir-faire des marins arabes et indiens, les navires chinois deviennent alors les plus avancés du monde.
Les Chinois, qui avaient inventé la boussole (au moins depuis l’an 1119), dépassèrent rapidement leurs concurrents au niveau de la cartographie et l’art de naviguer alors que la jonque chinoise devient le vraquier par excellence.
Dans son traité géographique, Zhou Qufei, en 1178, rapporte :
« Les gros navires qui croisent la Mer du sud sont comme des maisons. Lorsqu’ils déplient leurs voiles, on dirait d’énormes nuages. Leur gouvernail est long de plusieurs dizaines de pieds. Un seul navire peut abriter plusieurs centaines d’hommes. A bord, il y a de quoi manger pour un an ».
Des fouilles archéologiques confirment cette réalité comme par exemple l’épave d’une jonque datant du XIVe siècle, retrouvée aux larges de la Corée, dans laquelle on a découvert plus de 10 000 pièces de céramique.
Lors de cette période, le commerce côtier passe graduellement des mains des marchands arabes aux mains des marchands chinois. Le commerce s’étend, notamment grâce à l’inclusion de la Corée ainsi que l’intégration du Japon, de la côte indienne de Malabar, du golfe Persique et de la mer Rouge dans les réseaux commerciaux existants.
La Chine exporte du thé, de la soie, du coton, de la porcelaine, des laques, du cuivre, des colorants, des livres et du papier. En retour, elle importe des produits de luxe et des matières premières, notamment des bois rares, des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des épices et de l’ivoire.
Des pièces de monnaie en cuivre de la période Song ont été découvertes au Sri Lanka, et la présence de la porcelaine de cette époque a été constatée en Afrique de l’Est, en Egypte, en Turquie, dans certains Etats du Golfe et en Iran, tout comme en Inde et en Asie du Sud-est.
L’importance de la Corée et du Royaume de Silla

Pendant le premier millénaire, la culture et la philosophie ont fleuri dans la péninsule Coréenne. Un réseau marchand bien organisé et bien protégé avec la Chine et le Japon y opérait.
Sur l’île japonaise d’Okino-shima on trouve de nombreuses traces historiques témoignant des échanges intenses entre l’archipel japonais, la Corée et le continent asiatique.
Des fouilles effectuées dans des tombeaux anciens à Gyeongju, aujourd’hui une ville sud-coréenne de 264 000 habitants et capitale de l’ancien Royaume de Silla (de 57 av. JC à 935) qui contrôlait la plus grande partie de la péninsule du VIIe au IXe siècle, démontrent l’intensité des échanges de ce royaume avec le reste du monde, via la route de la soie.
L’Indonésie, une grande puissance maritime au coeur de la Route de la soie maritime
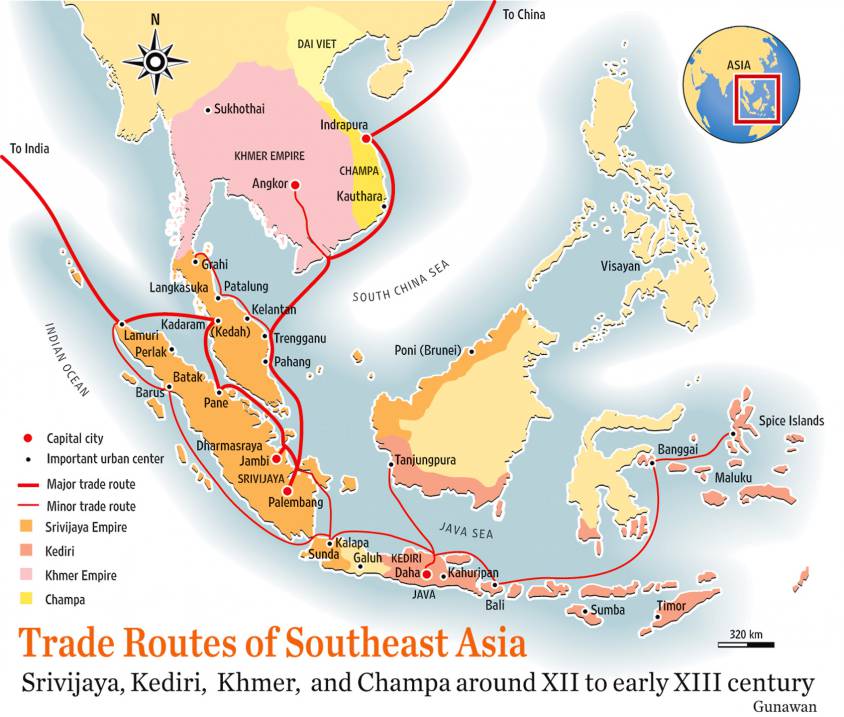
En Indonésie, en Malaisie et dans le sud de la Thaïlande, le Royaume de Sriwijaya (VIIe au XIIIe) a joué le rôle majeur de comptoir maritime où furent entreposées des marchandises de forte valeur de la région et au-delà en vue de leur commercialisation ultérieure par voie maritime. Sriwijaya contrôlait notamment le détroit de Malacca, le passage maritime incontournable entre l’Inde et la Chine.
A l’apogée de sa puissance au XIe siècle, le réseau des ports et des comptoirs sous domination Sriwijaya échangèrent une vaste palette de produits et de productions : du riz, du coton, de l’indigo et de l’argent de Java, de l’aloès (une plante succulente d’origine africaine), des résines végétales, du camphre, de l’ivoire et des cornes de rhinocéros, de l’étain et de l’or de Sumatra, du rotin, des bois rouges et d’autres bois rares, des pierres précieuses de Bornéo, des oiseaux rares et des animaux exotiques, du fer, du santal et des épices d’Indonésie orientale, d’Inde et d’Asie du Sud-est, et enfin, de Chine, des porcelaines, des laques, du brocart, des tissues et de la soie.
Avec comme capitale la ville de Palembang (à ce jour 1,7 million d’habitants) sur la rivière Musi dans ce qui est aujourd’hui la province méridionale de Sumatra, ce royaume d’inspiration hindouiste et bouddhiste, qui a prospéré du VIIIe au XIIIe siècle, a été le premier royaume indonésien d’importance et la première puissance maritime indonésienne.
Dès le VIIe siècle, il règne sur une grande partie de Sumatra, la partie occidentale de l’île de Java et une partie importante de la péninsule malaise. Avec une étendue au Nord jusqu’en Thaïlande, où des vestiges archéologiques de cités Sriwijaya existent encore.
Le musée de Palembang — une ville où communautés chinoises, indiennes, arabes et yéménites, chacun avec ses institutions particulières, co-prospèrent depuis plusieurs générations — raconte à merveille comment la Route de la soie maritime a engendré un enrichissement culturel mutuel exemplaire.
Madagascar, le sanskrit et la Route de la cannelle
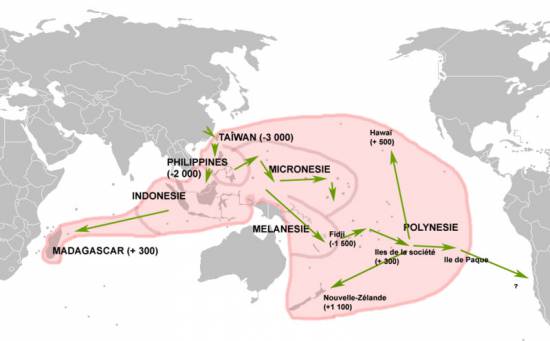
Aujourd’hui, Madagascar est habitée par des noirs et des asiatiques. Des tests ADN ont confirmé ce que l’on savait depuis longtemps : de nombreux habitants de l’île descendent de marins malais et indonésiens qui ont mis pied sur l’ile vers l’année 830 lorsque l’Empire Sriwijaya étend son influence maritime vers l’Afrique.
Autre élément de preuve de cette présence, le fait que la langue parlée sur l’île emprunte des mots sanskrits et indonésiens.
Sans surprise, la carte de l’expansion des langues austronésiennes est quasiment superposable à celle de la Route de la cannelle (ci-dessus).

Pour démontrer la faisabilité de ces voyages maritimes, une équipe de chercheurs a navigué en 2003 d’Indonésie jusqu’au Ghana en passant par Madagascar à bord du Borobudur, la reconstruction d’un des voiliers figurant dans plusieurs des 1300 bas-reliefs décorant le temple bouddhiste de Borobudur sur l’île de Java en Indonésie, datant du VIIIe siècle.
Beaucoup pensent que ce navire est une représentation de ceux que les marchands indonésiens utilisaient autrefois pour traverser l’océan jusqu’en Afrique. Les navigateurs indonésiens utilisaient habituellement des bateaux relativement petits. Pour en assurer l’équilibre, ils les équipaient de balanciers, aussi bien doubles (ngalawa) que simples.
Leurs bateaux, dont la coque était taillée dans un seul tronc d’arbre, étaient appelés sanggara. Dans leurs traversées vers l’est, les marchands de l’archipel indonésien pouvaient jadis se rendre jusqu’à Hawaii et la Nouvelle-Zélande, à une distance de plus de 7 000 km.
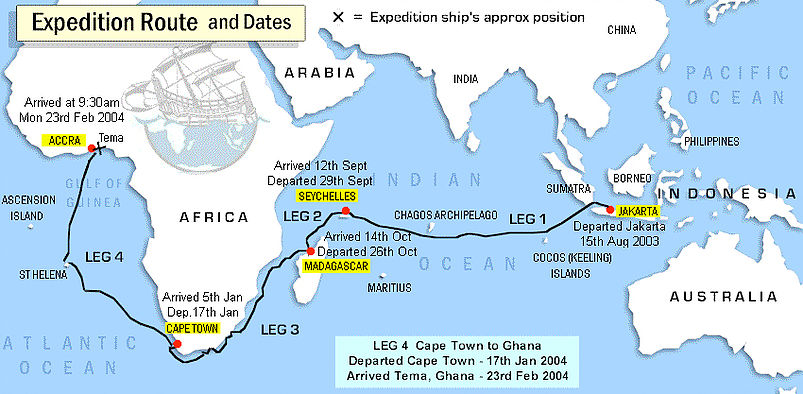

En tout cas, le bateau des chercheurs, équipé d’un mât de 18 mètres de haut, a réussi à parcourir la route Jakarta – Maldives – cap de Bonne-Espérance – Ghana, une distance de 27 750 kilomètres, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre !
L’expédition visait à refaire une route bien précise : celle de la cannelle, qui a conduit les marchands indonésiens jusqu’en Afrique pour vendre des épices, dont la cannelle, une denrée très recherchée à l’époque. Elle était déjà très prisée dans les régions du bassin méditerranéen bien avant l’ère chrétienne.
Sur les murs du temple égyptien de Deir el-Bahari (Louksor), une peinture représente une expédition navale importante dont il est dit qu’elle aurait été ordonnée par la reine Hatshepsout, qui régna de 1503 à 1482 avant JC.
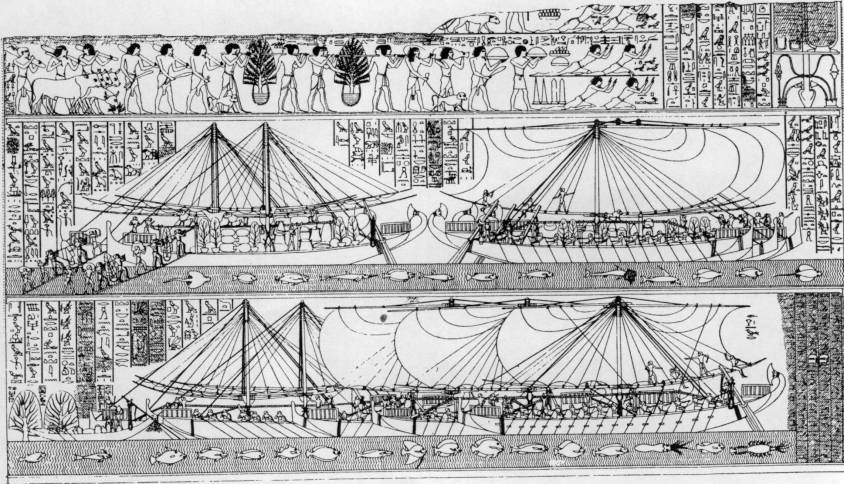
Autour de cette peinture des hiéroglyphes expliquent que ces navires transportaient diverses espèces de plantes et d’essences odorantes destinées au culte. Une de ces denrées est la cannelle. Riche en arôme, elle était une composante importante des cérémonies rituelles dans les royaumes d’Egypte.
Or, la cannelle poussait à l’origine en Asie centrale, dans l’est de l’Himalaya et dans le nord du Vietnam. Les Chinois méridionaux l’ont transplantée de ces régions dans leur propre pays et l’ont cultivée sous le nom de gui zhi.
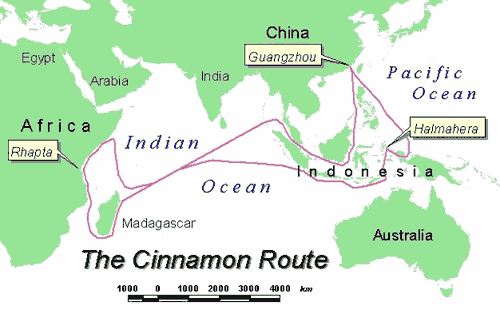
De la Chine, le gui zhi s’est répandu dans tout l’archipel indonésien, trouvant là une terre d’accueil très fertile, en particulier dans les îles Moluques. De fait, le commerce international de la cannelle était alors un monopole tenu par les marchands indonésiens. La cannelle d’Indonésie était appréciée pour son excellente qualité et son prix très compétitif.
Les Indonésiens parcouraient donc à la voile de grandes distances, jusqu’à plus de 8 000 km, traversant l’océan Indien jusqu’à Madagascar et le nord-est de l’Afrique. De Madagascar, les produits étaient transportés à Rhapta, dans une région côtière qui prit par la suite le nom de Somalie. Au-delà, les marchands arabes les expédiaient vers le nord jusqu’à la mer Rouge.
Le détroit de Malacca
Pour la Chine, le détroit de Malacca a toujours représenté un intérêt stratégique majeur. À l’époque où le grand amiral chinois Zheng He mène la première de ses expéditions vers l’Inde, le Proche-Orient et l’Afrique de l’Est entre 1405 et 1433, un pirate chinois du nom de Chen Zuyi a pris le contrôle de Palembang. Zheng He défait la flotte de Chen et capture les survivants. Du coup, le détroit est redevenu une route maritime sûre.
Selon la tradition, un prince de Sriwijaya, Parameswara, se réfugie sur l’île de Temasek (l’actuelle Singapour) mais s’établit finalement sur la côte ouest de la péninsule malaise vers 1400 et fonde la ville de Malacca, qui deviendra le plus grand port d’Asie du Sud-est, à la fois successeur de Sriwijaya et précurseur de Singapour.
Suite au déclin de Sriwijaya, c’est le Royaume de Majapahit (1292-1527), fondé à la fin du XIIIe siècle sur l’île de Java, qui dominera la plus grande partie de l’Indonésie actuelle.
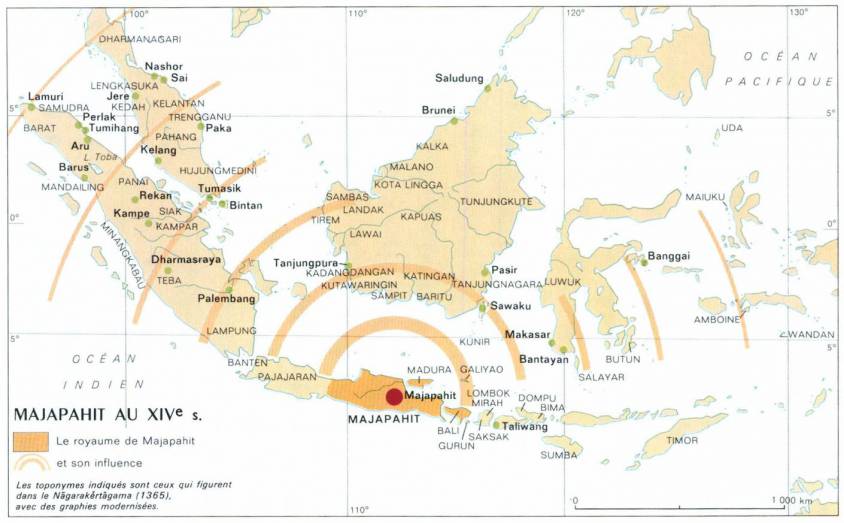
C’est l’époque où les marins arabes commencent à s’installer dans la région.
Le royaume de Majapahit noua des relations avec celui le Royaume de Champa (192-1145 ; 1147-1190 ; 1220-1832) (Sud Vietnam), du Cambodge, du Siam (la Thaïlande) et du Myanmar méridional.
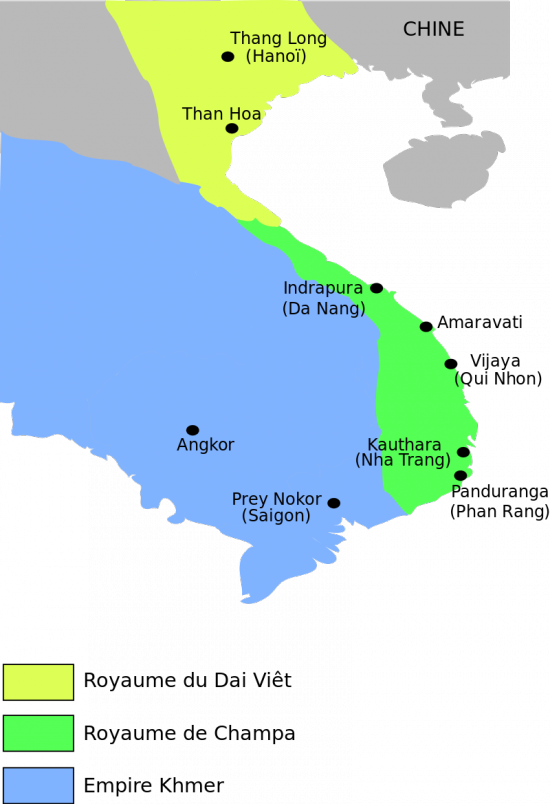
Le royaume de Majapahit envoyait également des missions en Chine. Alors que ses dirigeants étendirent leur pouvoir sur d’autres îles et mirent à sac les royaumes voisins, il chercha avant tout à augmenter sa part et son contrôle sur le commerce des marchandises transitant par l’archipel.
L’île de Singapour et la partie la plus au sud de la péninsule malaise fut un carrefour clé de l’ancienne Route de la soie maritime. Des fouilles archéologiques entrepris dans l’estuaire du Kallang et le long du fleuve Singapour, ont permis de découvrir des milliers d’éclats de verre, des perles naturelles ou en or, des céramiques et des pièces de monnaie chinoises de la période des Song du nord (960-1127).
La montée de l’Empire mongol au milieu du XIIIe siècle va provoquer l’accroissement du commerce par la mer et contribuer à la vitalité de la Route de la soie maritime. Marco Polo, après un voyage terrestre qui dura 17 ans, vers la Chine reviendra par bateau. Après avoir été témoin d’un naufrage, il passa de la Chine à Sumatra en Indonésie avant de remettre pied à terre à Ormuz en Perse (Iran).
Sous les dynasties Yuan et Ming
Sous la dynastie des Song, on exporte, vers le Japon, une quantité importante d’articles de soie. Sous celle des Yuan (1271-1368), le gouvernement instaure le Shi Bo Si, bureau en charge des échanges commerciaux, dans de nombreux ports comme, notamment, Ningbo, Canton, Shanghai, Ganpu, Wenzhou et Hangzhou, permettant, ainsi, l’exportation des soieries vers le Japon.
Durant les dynasties des Tang, Song et Yuan, et au début de celle des Ming, on assiste, dans chaque port, à la création d’un département océanique de négoce pour gérer l’ensemble des échanges commerciales extérieures maritimes.
Le commerce avec les sud de l’Inde et du golfe Persique fleurit. Le commerce avec l’Afrique de l’Est se développe également en fonction de la mousson et apporte de l’ivoire, de l’or et des esclaves. En Inde, des guildes commencent à contrôler le commerce chinois sur la côte du Malabar et au Sri Lanka. Les relations commerciales se formalisent tout en restant soumises à une forte concurrence. Cochin et Kozhikode (Calicut), deux grandes villes de l’Etat indien du Kerala, rivalisent alors pour dominer ce commerce.
Les explorations maritimes de l’amiral Zheng He
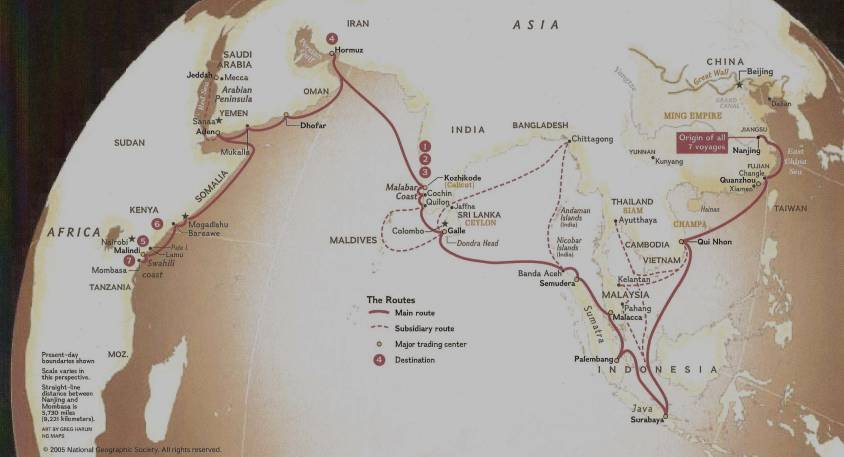
Les explorations maritimes chinoises connaitront leur apogée au début du XVe siècle sous la dynastie Ming (1368-1644) qui, pour diriger sept expéditions diplomatiques navales, choisira un eunuque musulman de la cour, l’amiral Zheng He.
Financées par l’Empereur Ming Yongle, ces missions pacifiques en Asie du Sud-est, en Afrique de l’Est, dans l’Océan indien, dans le golfe Persique et en Mer Rouge, viseront avant tout à démontrer le prestige et la grandeur de la Chine et de son Empereur. Il s’agit également de reconnaître une trentaine d’Etats et de nouer des relations politiques et commerciales avec eux.
En 1409, avant une des expéditions, l’amiral chinois Zheng He demanda à des artisans de fabriquer une stèle en pierre taillée à Nanjing, actuelle capitale de la province du Jiangsu (est de la Chine). La stèle voyagea avec la flottille et fut laissée au Sri Lanka comme cadeau à un temple bouddhiste local. Des prières aux divinités en trois langues -chinois, persan et tamoul- furent gravés sur la stèle. Elle fut retrouvé en 1911 dans la ville de Galle, dans le sud-ouest du Sri Lanka et une réplique se trouve aujourd’hui en Chine.
L’armada de Zheng était composée de vraquiers armés, le plus modeste étant plus grand que les caravelles de Christophe Colomb. Les plus vastes atteignaient une longueur de 100 et une largeur de 50 mètres. D’après les chroniques Ming de l’époque, une expédition pouvait comprendre 62 navires avec 500 personnes à bord chacun. Certains d’entre eux transportaient la cavalerie militaire et d’autres des réservoirs d’eau potable. La construction navale chinoise était en avance. La technique de cloisons hermétiques, imitant la structure interne du bambou, offrait une sécurité incomparable. Elle fut la norme pour la flotte chinoise avant d’être copiée par les Européens 250 ans plus tard. A cela s’ajoutait l’emploi de la boussole et celui de cartes célestes peintes sur soie.
La synergie qui a pu exister entre marins arabes, indiens et chinois, tous des hommes de mer qui fraternisent face à l’adversité de l’océan, a de quoi nous impressionner. Par exemple, certains historiens estiment qu’il n’est pas exclu que le nom « Sindbad le marin », qui apparaît dans la fable d’origine perse qui conte les aventures d’un marin du temps de la dynastie des Abbassides (VIIIe siècle) et fut intégrée dans les Contes des Mille et Une Nuits, dérive du mot Sanbao, le surnom honorifique donné par l’Empereur chinois à l’amiral Zheng He, signifiant littéralement « Les trois joyaux », c’est-à-dire les trois vertus capitales indissociables communes aux principales philosophies que sont l’Eveil (qui permet d’apprendre), l’Altruisme (qui permet la compréhension de l’autre) et l’Equité (qui invite à partager avec lui).

Aussi bien en Chine (à Hong-Kong, à Macao, à Fuzhou, à Tianjin et à Nanjing) qu’à Singapour, en Malaisie et en Indonésie, des musées maritimes mettent les expéditions de l’amiral Zheng en valeur.
Soulignons cependant qu’au moins douze autres amiraux ont effectué des expéditions similaires en Asie du Sud-est et dans l’océan Indien. En 1403, l’amiral Ma Pi a conduit une expédition jusqu’en Indonésie et en Inde. Wu Bin, Zhang Koqing et Hou Xian en ont fait d’autres. Après que la foudre avait provoqué un incendie de la Cité interdite, une dispute éclata entre la classe des eunuques, partisans des expéditions, et des mandarins lettrés, qui obtiendront l’arrêt d’expéditions jugées trop onéreuses. Le dernier voyage a eu lieu entre 1430 et 1433, c’est-à-dire 64 ans avant que l’explorateur portugais Vasco da Gama ne se rende sur les mêmes lieux en 1497.
Le Japon, de son coté, de façon similaire, a restreint ses contacts avec le monde extérieure lors de la période Tokugawa (1600-1868) bien que son commerce avec la Chine ne fut jamais suspendu. Ce n’est qu’après la restauration Meiji en 1868 qu’un Japon ouvert au monde a ré-émergé.
Dans un repli sur eux-mêmes, le commerce aussi bien la Chine que du Japon tomba aux mains de comptoirs maritimes comme Malacca en Malaisie ou Hi An au Vietnam, deux villes aujourd’hui reconnues par l’Unesco comme patrimoine de l’humanité. H ?i An était un port étape majeur sur la route maritime reliant l’Europe et le Japon en passant par l’Inde et la Chine. Dans les épaves de navires retrouvées à Hi An, les chercheurs ont retrouvé des céramiques qui attendaient leur départ pour le Sinaï en Egypte.
Histoire des ports chinois
Au fil des années, on assiste à une évolution en ce qui concerne les principaux ports de la Route maritime de la Soie. A partir des années 330, Canton et Hepu étaient les deux ports les plus importants.
Cependant, Quanzhou se substitue à Canton, de la fin de la dynastie des Song à celle des Yuan.
A cette époque, Quanzhou, dans la province du Fujian et Alexandrie en Egypte étaient considérés comme les plus vastes ports du monde. A cause de la politique de fermeture sur le monde extérieur imposée à partir de 1435 et de l’influence des guerres, Quanzhou a été, progressivement, remplacé par les ports de Yuegang, Zhangzhou et Fujian.
Dès le début du IVe siècle, Canton est un important port de la Route maritime de la Soie. Peu à peu, il devient le plus vaste mais, également, le port d’Orient le plus renommé à travers le monde sous les dynasties des Tang et des Song. Durant cette période, la route maritime reliant Canton au golfe persique en passant par la Mer de Chine méridionale et l’océan Indien est la plus longue du monde.
Bien que plus tard supplanté par Quanzhou sous la dynastie des Yuan, le port de Canton demeurera le second plus grand port commercial de Chine. Par comparaison avec les autres, on le considère comme étant un port durablement prospère au cours des 2000 ans d’histoire de la Route maritime de la Soie.
Le système tributaire de 1368
La dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, a régné de 1644 à 1912. Depuis l’arrivée de la dynastie Ming, les échanges commerciaux maritimes avec la Chine s’organisaient de deux façons :
- le « système tributaire » chinois ;
- le système dit « de Canton » (1757–1842).
Né sous les Ming en 1368, et le « système tributaire » atteindra son apogée sous les Qing. Il prend alors la forme raffinée d’une hiérarchie inclusive mutuellement bénéfique. Les Etats qui y adhèrent faisaient preuve de respect et de reconnaissance en présentant régulièrement à l’Empereur un tribut composé de produits locaux et en exécutant certaines cérémonies rituelles, notamment le « kowtow » (trois génuflexions et neuf prosternations). Ils demandaient également l’investiture de leurs dirigeants par l’Empereur et adoptaient le calendrier chinois. Outre la Chine, on y retrouvait le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, les îles Ryükyü, le Laos, le Myanmar et la Malaisie.
Paradoxalement tout en occupant un statut culturel central, le système tributaire offrait à ses vassaux un statut d’entité souveraine et leur permettait d’exercer leur autorité sur une aire géographique donnée. L’Empereur gagnait leur soumission en se préoccupant vertueusement de leur bien-être et en promouvant une doctrine de non-intervention et de non-exploitation. En effet, d’après les historiens, en termes financiers, la Chine ne s’est jamais enrichie d’une façon directe avec le système tributaire. En général, tous les frais de voyage et de séjour des missions tributaires étaient couverts par le gouvernement chinois. En plus des coûts de fonctionnement du système, les cadeaux offerts par l’Empereur avaient en général beaucoup plus de valeur que les tributs qu’il recevait. Chaque mission tributaire avait en effet le droit d’être accompagnée par un grand nombre de commerçants et une fois le tribut présenté à l’Empereur, le commerce pouvait commencer.
Il est à noter que, lorsqu’un pays perdait son statut d’Etat tributaire suite à un désaccord, ce dernier essayait à tout prix et parfois de façon violente d’être à nouveau autorisé à payer le tribut.
Le système de Canton de 1757

Le deuxième système concernait les puissances étrangères, principalement européennes, désireuses de faire du commerce avec la Chine. Il passait par le port de Guangzhou (à l’époque appelé Canton), le seul port accessibles aux Occidentaux.
Ainsi, les marchands, notamment ceux de la Compagnie britanniques des Indes orientales, pouvaient accoster, non pas dans le port mais devant la côte de Canton, d’octobre à mars, lors de la saison commerciale. C’est à Macao, à l’époque une possession Portugaise, que les Chinois leur fournissait le cas échéant une permission à cet effet. Les représentants de l’Empereur autorisaient alors des marchands chinois (les hongs) de commercer avec des navires étrangers tout en les chargeant de collecter les droits de douane avant qu’ils ne repartent.
Cette façon de commercer s’est amplifiée à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la forte demande anglaise de thé. C’est d’ailleurs du thé chinois de Fujian que les « insurgés » américains ont jeté à la mer lors de la fameuse « Boston Tea Party » de décembre 1773, un des premiers événements contre l’Empire britannique qui déclenchera la Révolution américaine. Des produits en provenance de l’Inde, en particulier le coton et l’opium furent échangés par la Compagnie des Indes orientales contre du thé, de la porcelaine et de la soie.
Les droits de douane collectés par le système de Canton étaient une source majeure de revenus pour la dynastie des Qing bien qu’elle bannira l’achat d’opium en provenance de l’Inde. Cette restriction imposée par l’Empereur chinois en 1796 conduira au déclenchement des guerres de l’Opium, la première dès 1839. En même temps, des rebellions éclatèrent dans les années 1850-60 contre le règne affaibli des Qing, doublées de guerres supplémentaires contre des puissances européennes hostiles.

En 1860, l’ancien Palais d’été (parc Yuanming), avec un ensemble de pavillons, de temples, de pagodes et de librairies, c’est-à-dire la résidence des empereurs de la dynastie Qing à 15 kilomètres au nord-ouest de la Cité interdite de Pékin, fut ravagée par les troupes britanniques et françaises lors de la Seconde guerre de l’opium. Cette agression reste dans l’histoire comme l’un des pires actes de vandalisme culturel du XIXe siècle. Le Palais fut mis à sac une deuxième fois en 1900 par une alliance de huit pays contre la Chine.
Aujourd’hui, on peut y admirer une statue de Victor Hugo et un texte qu’il avait écrit pour s’élever contre Napoléon III et les destructions de l’impérialisme français, pour rappeler que cela était non pas le fait d’une nation, mais celui d’un gouvernement.
A la fin de la première guerre mondiale, la Chine disposait de 48 ports ouverts où les étrangers pouvaient commercer en suivant leurs propres juridictions. Le XXe siècle fut une ère de révolutions et de changements sociaux. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 engendra un repli sur soi.
Ce n’est qu’en 1978 que Deng Xiaoping annonça une politique d’ouverture sur le monde extérieur en vue de la modernisation du pays.
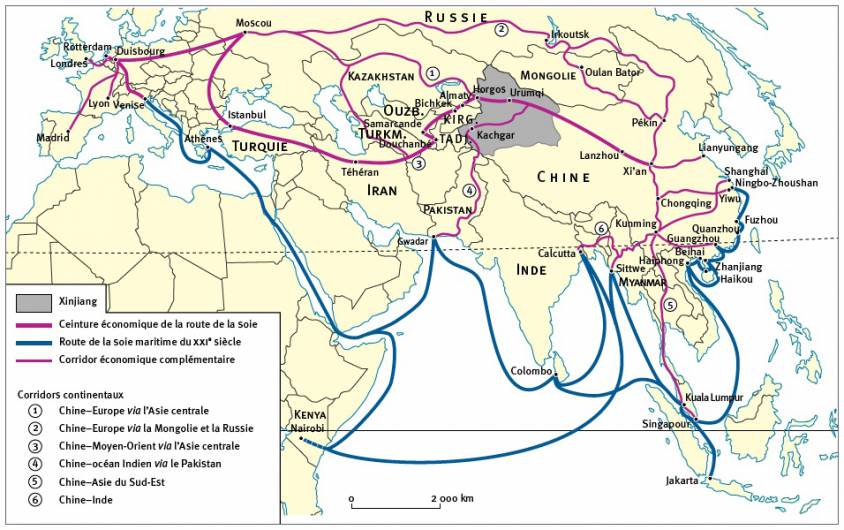
Au XXIe siècle, grâce à l’Initiative une ceinture (économique) une route (maritime) lancée par le Président Xi Jingping, la Chine ré-émerge comme une grande puissance mondiale offrant des coopérations mutuellement bénéfiques au service d’un meilleur avenir partagé pour l’humanité.